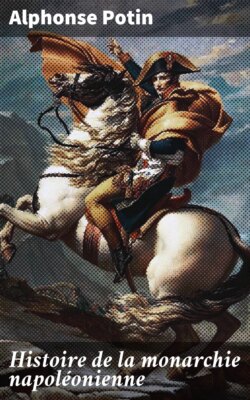Читать книгу Histoire de la monarchie napoléonienne - Alphonse Potin - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеTable des matières
Napoléon à Valence. — Ses travaux. — Son Histoire de Corse. — Napoléon, lauréat de l’Académie de Lyon. — Paoli. — Voyage de Napoléon en Bourgogne. — Napoléon au 10 août 1792, ses impressions. — Insurrection de la Corse. — Exil de la famille Bonaparte. Siége de Toulon. — Massacre des prisons. — Conduite de Napoléon.
A Valence, comme à Brienne et à l’École-Militaire de Paris, Napoléon recherchait l’isolement: silencieux, rêveur, plein de tact et de finesse, d’un air sévère, il maîtrisait tous ceux qui étaient en relation avec lui; sa figure pâle, enthousiaste, sa réserve révélaient le philosophe, l’observateur, le penseur sous l’uniforme du jeune officier. On l’aimait peut-être moins que tout autre au premier abord, mais on l’écoutait; on subissait l’influence de son regard électrique, et, après l’avoir entendu, on l’admirait; son autorité, son ascendant tenaient à sa supériorité morale; élevé par le XVIIIe siècle, il n’avait ni la corruption, ni les vices de cette époque; il était pauvre, mais fier; il voulait arriver.
«Je ne possédais, disait-il lui-même, que ma solde de lieutenant en premier: cependant je trouvais le moyen d’en économiser une partie pour faire élever l’un de mes frères; j’y parvenais en ne mettant jamais les pieds au café ni dans le monde, en mangeant du pain sec à mon déjeuner, en brossant mes habits moi-même pour qu’ils durent plus longtemps propres; pour ne pas faire tache parmi mes camarades, je vivais comme un ours, toujours seul dans ma chambre avec mes livres... les seuls amis que j’eusse, et ces livres, pour me les procurer, par quelles dures économies faites sur le nécessaire j’achetais cette jouissance; quand, à force d’abstinence, j’avais amassé deux ou trois écus de six livres, je m’acheminais vers la boutique d’un vieux bouquiniste qui demeurait près de l’évêché..... je convoitais longtemps avant que ma bourse me permît d’acheter! Telles ont été pour moi les débauches, les joies de la jeunesse.»
On le voit, les loisirs de garnison n’étaient pas perdus; l’étude en remplissait les heures. M. Domairon , professeur de belles-lettres à l’École-Militaire, avait dit des amplifications du jeune élève, que c’était du granit chauffé au volcan, et Napoléon essayait sa plume jusqu’au moment où il devait déployer ses talents militaires. «Je n’avais guère que dix-sept ans, disait-il à M. O‘Méara , lorsque je composai une petite Histoire de Corse; je la soumis à M. l’abbé Raynal qui me donna des éloges et parut désirer que je la publiasse. Cet ouvrage, selon lui, devait servir la cause de la liberté, dont on commençait à parler fortement alors, et me faire une sorte de réputation. Il était écrit selon l’opinion du jour qui tendait vers le républicanisme; il respirait la liberté d’un bout à l’autre et était rempli de maximes et de sentences républicaines.
» Étant à Lyon en 1786, je remportai au collége le prix proposé sur le thème suivant: Quels sont les sentiments que l’on doit le plus recommander, afin de rendre l’homme heureux? Quand je montai sur le trône, bien des années après, je parlai de cela à Talleyrand; il envoya un courrier à Lyon pour chercher ce morceau; il parvint facilement à le retrouver. Un jour, comme nous étions seuls, il tira le manuscrit de sa poche, et, croyant me faire sa cour, me le remit entre les mains, en me demandant si je le connaissais. Je reconnus aussitôt mon écriture et je le jetai au feu où il fut consumé en dépit de Talleyrand qui ne put le sauver. Comme il ne l’avait pas fait copier auparavant, il parut très-mortifié de cette perte . J’en fus au contraire très-satisfait parce qu’il abondait en sentiments républicains et contenait quelques principes libéraux que je n’aurais pas été flatté qu’on pût m’accuser d’avoir eus dans ma jeunesse.»
On comprendra facilement que dans un moment où l’on s’imaginait qu’il était facile à des Français d’être des Brutus, des Scipions, un jeune homme pût céder à son penchant inné pour la grandeur antique des républiques grecques et romaines.
Le pays natal est toujours cher: tout y semble meilleur, et Napoléon visita souvent la Corse, franchissant au milieu des précipices les sommets élevés, recevant les honneurs et les plaisirs de l’hospitalité.
«Dans une des excursions de Paoli à Porto-Nuovo, il m’expliquait, raconte Napoléon, chemin faisant, les lieux de résistance ou de triomphe de la guerre de la liberté ; il me détaillait cette lutte glorieuse, et, sur les observations que je lui fis sur les idées qu’il avait émises, il me dit, en me frappant sur l’épaule: Napoléon, tu n’es pas de ce siècle, tu n’as rien de moderne, tu appartiens tout entier à Plutarque .»
Les souvenirs des premières années de Napoléon se présentaient à lui sous les couleurs les plus brillantes, lorsqu’il languissait sur le rocher de Sainte-Hélène. «Les plus beaux jours de ma vie, disait-il à M. O’Méara , ont été ceux qui se sont écoulés depuis seize jusqu’à vingt ans. Pendant la durée de mes semestres, j’avais l’habitude de parcourir successivement tous les restaurateurs, vivant avec une sorte de frugalité. Mon logement me coûtait environ trois louis par mois. J’étais heureux alors..... à cet âge où tout est gaieté, désir, jouissance, à ces heureuses époques de l’espérance, de l’ambition naissante, où le monde tout entier s’ouvre devant vous, où tous les romans sont permis.»
La France qui souhaitait la réforme des abus signalés par Fénelon, par Montesquieu, avait marché à une révolution politique à travers la banqueroute de Terray, le Pacte de famine, les scandales du Parc aux Cerfs et de la Régence. Aux États-Généraux avait succédé l’Assemblée Constituante, et à la Constituante la Convention, chargée de prononcer sur les mesures propres à assurer le règne de la liberté et de l’égalité. Les insurrections des dantonistes, des hébertistes, des enragés Jacobins donnèrent naissance à ces agitations qui devaient aboutir au régime de la Terreur. Le 20 juin, le peuple plaçait le bonnet rouge sur la tête de Louis XVI; le 10 août, il souillait l’asile de la monarchie; quelques mois plus tard, les factions jetaient comme défi aux insurrections antérieures, aux invasions, la tête du descendant de trente-deux rois.
Le jeune officier d’artillerie accourut à Paris, observa, parcourut les places publiques; il se perdit dans la foule même, vit tomber les Tuileries sous la main des révolutionnaires, sans se mêler à rien. Sa haute intelligence comprenait que si la nuit de la destruction était venue, il fallait attendre le jour de l’organisation. C’est ce qu’il dévoile dans le récit de son voyage sentimental en Bourgogne, et de ses impressions sur la journée du 10 août: laissons-le parler.
«Dans un voyage que je fis au commencement de la révolution en Bourgogne, à Nuits, voyage sentimental à la façon de Sterne, j’allais souper chez mon camarade de régiment, Gassendi, capitaine d’artillerie, marié assez richement à la fille d’un médecin du lieu. Je ne tardai pas à m’apercevoir du dissentiment des opinions politiques du beau-père et du gendre. Le gentilhomme Gassendi était aristocrate, comme de raison, et le médecin chaud patriote. L’apparition d’un jeune officier d’artillerie, d’une bonne logique et d’une langue alerte, était une recrue précieuse et rare pour l’endroit. Il me fut aisé de voir que je faisais sensation. Du reste... cette diversité d’opinions se trouvait alors dans toute la France, dans les salons, dans la rue, sur les chemins, dans les auberges; tous les esprits étaient prêts à s’enflammer, et rien de plus facile que de se méprendre sur la force des partis et de l’opinion, suivant les localités où l’on se plaçait. Aussi un patriote s’en laissait imposer facilement s’il se trouvait dans les salons ou parmi les rassemblements d’officiers, tant il se voyait en minorité ; mais sitôt qu’il était dans la rue ou parmi les soldats, il se retrouvait alors au milieu de la nation entière.
» Les sentiments du jour ne laissèrent pas de gagner jusqu’aux officiers mêmes, surtout après le fameux serment à la nation, à la loi et au roi; jusque là, si j’eusse reçu l’ordre de tourner mes canons contre le peuple, je ne doute pas que l’habitude, le préjugé, l’éducation ne m’eussent porté à obéir; mais le serment national une fois prêté, c’eût été fini, je n’eusse plus connu que la nation. Mes penchants naturels se trouvaient dès lors avec mes devoirs et s’arrangeaient à merveille de toute la métaphysique de l’Assemblée. Toutefois les officiers patriotes, il faut en convenir, ne composaient que le petit nombre; mais, avec le levier des soldats, ils conduisaient le régiment et faisaient la loi. Les camarades du parti opposé, les chefs mêmes, recouraient à nous dans tous les moments de crise. Je me souviens, par exemple, d’avoir arraché à la fureur de la populace un des nôtres dont le crime était d’avoir entonné, des fenêtres de notre salle à manger, la célèbre romance: O Richard! ô mon roi! Je me doutais bien peu alors qu’un jour cet air serait proscrit aussi de la sorte à cause de moi. C’est comme au 10 août, voyant enlever le château des Tuileries et se saisir du roi, j’étais assurément bien loin de penser que je le remplacerais, et que ce palais serait ma demeure.» Puis, s’arrêtant à cette journée, il ajoutait: «Je me trouvais à cette hideuse époque à Paris, logé rue du Mail, place des Victoires. Au bruit du tocsin et de la nouvelle qu’on donnait l’assaut aux Tuileries, je courus au Carrousel chez Fauvelet, père de Bourrienne, qui y tenait un magasin de meubles: il avait été mon camarade à l’école militaire de Brienne. C’est de cette maison, que par parenthèse je n’ai jamais pu retrouver depuis, par les grands changements qui s’y sont opérés, que je pus voir à mon aise tous les détails de la journée. Avant d’arriver au Carrousel, j’avais été rencontré dans la rue des Petits-Champs par un groupe d’hommes hideux, promenant une tète au bout d’une pique. Me voyant proprement vêtu, et me trouvant l’air d’un monsieur, ils étaient venus à moi pour me faire crier vive la nation! ce que je fis sans peine, comme on peut le croire.
» Le château se trouvait attaqué par la plus vile canaille. Le roi avait assurément pour sa défense au moins autant de troupes qu’en eut depuis la Convention au 13 vendémiaire, et les ennemis de celle-ci étaient bien autrement disciplinés et redoutables. La plus grande partie de la garde nationale se montra pour le roi: on lui doit cette justice.
» Le palais forcé et le roi rendu dans le sein de l’Assemblée, je me hasardai à pénétrer dans le jardin. Jamais, depuis, aucun de mes champs de bataille ne me donna l’idée d’autant de cadavres que m’en présentèrent les masses des Suisses; soit que la petitesse du local en fit ressortir le nombre, soit que ce fût le résultat de la première impression que j’éprouvais en ce genre. Je parcourus tous les cafés du voisinage de l’Assemblée. Partout l’irritation était extrème: la rage était dans les cœurs; elle se montrait sur toutes les figures, bien que ce ne fussent pas du tout des gens de la classe du peuple; et il fallait que tous ces lieux fussent journellement remplis des mèmes habitués, car, bien que je n’eusse rien de particulier dans ma toilette, ou peut-être était-ce encore parce que mon visage était plus calme, il m’était aisé de voir que j’excitais maints regards hostiles et défiants, comme quelqu’un d’inconnu et de suspect.»
Les saturnales de 1793 ne trouvèrent pas Napoléon à Paris. La Corse était déchirée par les factions: Paoli, commandant alors la 13e division militaire, ancien ami de son père, avait confié à Bonaparte le commandement provisoire d’un bataillon de gardes nationaux soldés, levés dans l’île pour y maintenir la tranquillité. Obligé de réprimer avec sévérité les mouvements, les désordres de la populace d’Ajaccio, et les menées des affidés de Peraldi, chef du parti antifrançais, il fut accusé d’avoir provoqué lui-même les troubles qu’il avait apaisés. Il se rendit à Paris pour repousser ces injustes incriminations; mais pendant son absence Paoli, entraîné par les intrigues du cabinet anglais, leva l’étendard de la révolte.
Bonaparte et tous les membres de sa famille tenaient à la France. Ils s’efforcèrent de diriger en ce sens l’assemblée de Corté ; mais les Corses avaient moins de répugnance pour la protection des Anglais que pour la domination du comité de Salut public. Aussi Paoli, qui était attaché à la famille Bonaparte et qui professait pour madame Lætitia une considération profonde, essaya près d’elle la persuasion pour la ramener, elle et sa famille, à son parti avant d’employer la force. «Renoncez à votre opposition, lui disait-il, elle vous perdra, vous, les vôtres, votre fortune: les maux seront incalculables, rien ne pourra les réparer .» Madame Lætitia lui répondit en héroïne, comme eût fait Cornélie: Je ne connais que deux lois: moi et mes enfants; ma famille ne connaît que celles du devoir et de l’honneur.
Les malheurs prévus, prédits par Paoli, se réalisèrent. «Douze à quinze mille paysans, racontait Napoléon, fondirent des montagnes sur Ajaccio; notre maison fut pillée et brûlée, les vignes perdues, les troupeaux détruits. Madame Lætitia, entourée d’un petit nombre de fidèles, fut réduite à errer quelque temps sur la côte, et dut gagner la France.» En effet, victime de son patriotisme, de son dévouement à la France, elle se réfugia à bord d’un vaisseau français, et partit pour Marseille, frappée d’un décret de bannissement par la Consulte de Corse (27 mai 1793), conçu dans les termes les plus injurieux. Elle pensait être reçue à Marseille en émigrée de distinction, mais elle s’y trouva perdue, à peine en sûreté, et fut déconcertée de ne rencontrer le patriotisme que dans les rues et tout à fait dans la boue.
La guerre civile et religieuse avait éclaté ; les frontières étaient envahies. Condé et Valenciennes étaient tombées au pouvoir de l’ennemi. Toulon avait pris part à l’insurrection du Midi: la ville avait été mise hors la loi. Les habitants n’avaient d’autre alternative que de se livrer à la merci de Robespierre ou de l’amiral Hood.
Robespierre amenait l’échafaud, les Anglais promettaient de le briser; le comité royaliste , guidé par la peur et l’exploitant, livra Toulon à l’étranger. Napoléon, protégé par M. Gasparin, député d’Orange, homme de talent, obtint un commandement; il arriva au quartier du général Carteaux le 12 septembre 1793. Appelé par ses supérieurs dans les conseils de guerre, il étonna par la rapidité de ses conceptions, la netteté de son coup d’œil. Son plan d’attaque contre la ville rebelle fut adopté : le siége commença. Pendant les opérations il dirigea l’artillerie.
Ici se placent naturellement plusieurs anecdotes. Commençons par une des conversations de l’Empereur avec le docteur O’Méara: nous l’empruntons à sa relation: elle répond à ces idées de fatalisme dont on a exagéré à dessein l’étendue.
«— Êtes-vous fataliste? demandait Napoléon au docteur .
Celui-ci répondit: En action, oui.
— Pourquoi pas en tout? reprit l’empereur.
— Je regarde, répliqua O’Méara, la perte d’un homme comme inévitable, s’il ne s’efforce pas de fuir le sort dont il est menacé. Je dis que si dans une bataille un homme voyait venir à lui un boulet de canon, il se jetterait naturellement de côté et éviterait par là une mort qui, autrement, serait infaillible. »
Napoléon répliqua: «En vous rangeant de côté, vous pourriez peut-être vous placer dans la direction d’un autre boulet qu’autrement vous auriez évité. Je me rappelle, ajouta-t-il, qu’au siège de Toulon, dans le temps que je commandais l’artillerie, j’observai un officier marseillais qui, au lieu de montrer l’exemple, était très-soigneux de se ménager; je l’appelai et je lui dis: Monsieur l’officier, sortez et venez observer l’effet de votre boulet; vous ignorez si vos pièces sont bien pointées ou non; nous faisions feu dans ce moment contre les bâtiments anglais. Je l’engageai à voir si nos boulets frappaient contre le corps des bâtiments. Il ne se souciait guère de quitter son poste; mais à la fin, il s’y décida et vint où j’étais, un peu en dehors du parapet, et commença à examiner; mais, voulant diminuer son volume et s’exposer le moins possible, il se baissa et mit un côté de son corps à l’abri du parapet, tout en regardant par dessous mon bras. Il n’y avait que très-peu de temps qu’il était dans cette posture, lorsqu’un boulet, passant près de moi à hauteur de ceinture, le mit en pièces. Eh bien! si cet homme se fût tenu droit et se fût bravement exposé au danger, il en eût été préservé ; car le boulet aurait passé entre nous deux, sans nous blesser ni l’un ni l’autre.»
Étant un jour dans une batterie où l’un des chargeurs est tué, Napoléon, qui, de simple commandant de l’artillerie de l’armée de Toulon eût pu en devenir le général en chef, prend le refouloir et charge lui-même dix ou douze coups. A quelques jours de là, il se trouve couvert d’une gale très-maligne; on cherche où il peut en avoir été atteint. Muron, son adjudant, découvre que le canonnier mort en était infecté. L’ardeur de la jeunesse, l’activité du service, firent que le commandant d’artillerie se contenta d’un léger traitement. Le mal disparut; mais le poison n’était que rentré, il affecta longtemps sa santé et faillit lui coûter la vie. De là, la maigreur, l’état chétif et débile, le teint maladif du général en chef de l’armée d’Italie et de l’armée d’Égypte.
Lors de la construction d’une des premières batteries ordonnée par lui, il demanda sur le terrain un sergent qui sût écrire. Quelqu’un sortit et écrivit sous sa dictée, sur l’épaulement même; la lettre à peine finie, un boulet la couvre de terre: «Bien! dit l’écrivain, je n’aurai pas besoin de sable.» Cette plaisanterie, faite avec calme, fixa l’attention de Napoléon et fit la fortune du sergent: c’était Junot, depuis duc d’Abrantès, colonel-général des hussards, commandant en chef l’armée française en Portugal.
Pendant le siège, un des commissaires du gouvernement (la Convention, qui voyait la trahison partout, envoyait sous ce titre des représentants du peuple à tous les corps d’armée) voulut blâmer la position d’une batterie que venait d’établir le jeune commandant d’artillerie.
«— Citoyen, répond fièrement Napoléon, faites votre métier de député, laissez-moi faire le mien d’artilleur. La batterie restera là. Je réponds du succès. »
Toulon fut repris le 19 décembre 1779, et le commandant de l’artillerie fut, sur le champ de bataille, nommé général de brigade. Dugommier, qui avait dirigé l’armée de siége, manifesta la haute estime qu’il avait conçue des talents de l’officier qui avait fait taire les batteries anglaises; il écrivit au comité de Salut public: «Récompensez et avancez ce jeune homme, car si on était ingrat envers lui, il avancerait tout seul.»
La destruction de Toulon était décrétée, et une commission militaire avait été instituée pour condamner ceux qui avaient pris part à l’insurrection. On aime à voir, dans ces temps si difficiles, si tristes, se montrer les sentiments religieux de Napoléon, son humanité.
On lit dans un ouvrage déjà cité le passage suivant d’une lettre de madame la marquise de Chabrillan, née Caumont-Laforce:
«La marquise Caumont-Laforce, sa fille, son gendre, le marquis de Chabrillan, deux enfants en bas âge, et d’autres familles émigrées avaient été pris sur mer, et se trouvaient dans les prisons du Saint-Esprit de Toulon. Le général Bizannet commandait la place, et Bonaparte l’artillerie. Tous les prisonniers que renfermaient les prisons furent massacrés, femmes, enfants, indistinctement. Le peuple se porta à celle du Saint-Esprit. La nuit étant venue donna un moment de répit, où les assassins, las de massacrer, se reposèrent. Le général Bizannet, au désespoir de l’affreux spectacle qu’il avait vu et de celui qui se préparait, rencontra Bonaparte, à qui il fit part de sa peine de n’avoir aucun moyen d’essayer de sauver ces malheureux presque tous des femmes, des enfants, des vieillards. Bonaparte lui dit: Tu me sais ici, et tu ne viens pas me trouver quand il s’agit de faire une bonne action. Donne-moi vite une réquisition: tu auras à tes ordres les voitures d’artillerie nécessaires, et je t’aiderai de tous mes moyens.»
A minuit, des troupes arrivèrent: le cortége des infortunés, voués à une mort terrible, trouva près de la Porte de France des chariots d’artillerie sur lesquels on fit monter les prisonniers miraculeusement sauvés pour les diriger sur Grasse.
Bonaparte a pourtant été accusé d’avoir ordonné les massacres; c’est une infâme calomnie. Il a empêché de tout son pouvoir ces scènes de cannibales dont le souvenir n’est pas encore effacé. La famille de Chabrillan a eu longtemps l’ordre que Bonaparte avait adressé en réponse à la réquisition du général Bizannet. Les chariots d’artillerie furent l’arche sainte où se réfugièrent les malheureux menacés par les séïdes de la Terreur. L’impératrice Joséphine désira avoir ce document pour le montrer à l’empereur: cette pièce n’a pas été rendue, malgré les recommandations de la famille; mais la reconnaissance d’une famille s’est chargée d’en proclamer l’authenticité.
Napoléon fit rentrer au service un grand nombre de ses camarades, que leurs opinions en avaient éloignés; sa sollicitude les sauva plus d’une fois de la rage des séditieux; témoin, le colonel Gassendi, placé par ses soins à la tète de l’arsenal de Marseille. Du reste, le général lui-même ne fut pas à l’abri du délire des hommes du temps. Accusé de fédéralisme, il aurait été arrêté, c’est-à-dire perdu, s’il eût été moins nécessaire.
Les troupes réparties dans la Savoie et le comté de Nice avaient été réduites à la défensive pendant la guerre civile. Après la prise de Toulon, on rendit à l’armée d’Italie les forces qu’on lui avait empruntées; Bonaparte, devenu général d’artillerie, y porta la supériorité, que déjà il avait conquise: toutefois ce ne fut pas sans danger. Mis en arrestation à Nice par le représentant Laporte, mis hors la loi, parce qu’il ne voulait pas consentir à ce qu’on s’emparât des chevaux de l’artillerie pour courir la poste, mandé enfin à la barre de la Convention pour avoir proposé des mesures relatives aux fortifications de Marseille, il échappa par sa fermeté aux périls des discordes civiles.
Dans cette armée de Nice ou d’Italie, Napoléon inspira une sorte d’enthousiasme à Robespierre le jeune, qui, rappelé à Paris quelque temps avant le 9 thermidor, fit tout au monde pour le décider à le suivre. La fièvre de la révolution était alors dans son paroxysme.
«— Si je n’eusse inflexiblement refusé, faisait observer Bonaparte, sait-on où pouvait me conduire un premier pas et quelles autres destinées m’attendaient?... »
Les événements de thermidor amenèrent des modifications dans le personnel des comités de la Convention: Aubry, ancien capitaine d’artillerie, chargé de la direction de celui de la guerre, ne s’oublia pas; il se fit général d’artillerie.
Napoléon devint alors général d’infanterie. Désigné pour le service de la Vendée, il voulut réclamer, mais l’inflexible partialité d’Aubry le détermina à donner sa démission. «Vous êtes trop jeune,» lui répondait Aubry.
«— On vieillit vîte sur un champ de bataille,» avait répliqué Napoléon à l’officier de faveur qui n’avait jamais vu le feu.
Toutefois il était difficile de se passer longtemps des talents du vainqueur de Toulon; aussi, lors de l’échec de Kellerman, il fut employé au comité des opérations militaires, où s’élaboraient le mouvement des armées, les plans de campagne. C’est là que le 13 vendémiaire vint le trouver.