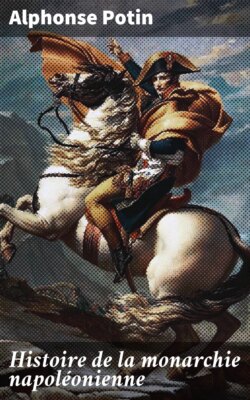Читать книгу Histoire de la monarchie napoléonienne - Alphonse Potin - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеTable des matières
Insurrection de Paris. — Le 13 vendémiaire. — Bonaparte nommé général commandant l’armée de l’intérieur. — Le Directoire. — Eugène Beauharnais. — Joséphine Tascher de la Pagerie. — Bonaparte nommé général en chef de l’armée d’Italie. Sa proclamation. Bataille de Montenotte, de Millesimo, de Mondovi. — Nouvelle proclamation. — Tableaux envoyés à Paris. — Traité avec le roi de Sardaigne. — Mantoue. — Borghetto. — Lodi. — Lonato. — Castiglione. Arcole. — Rivoli. — Reddition de Mantoue. — Traité de Tolentino. — Tagliamento. — Préliminaires de Leoben.
La Convention s’agitait au sein des souffrances publiques; la chute de la municipalité, du parti de Danton, de Robespierre, devait entraîner celle des Jacobins et la fin du gouvernement révolutionnaire. La principale mission de cette Assemblée était remplie: elle adopta sans délai la Constitution de l’an III, qui confiait le gouvernement à cinq personnes, sous le nom de Directoire, et la législature à deux Conseils dits des Cinq-Cents et des Anciens. Cette Constitution devait être soumise à l’approbation du peuple, réuni en Assemblée primaire. Quitter le pouvoir est un acte d’abnégation assez rare; aussi, pour en conserver quelques débris, la Convention se ménagea par deux lois additionnelles la prépondérance dans les deux Conseils: elle décréta que les deux tiers de la nouvelle législature seraient composés de ses membres.
Les sections de Paris rejetèrent les lois additionnelles. Foyer de désordre et d’anarchie, la capitale, en proie à la famine, remuée par les meneurs de toutes les nuances, fut bouleversée par un nouveau soulèvement. Aux cris de: la Constitution de 1793 et du pain! le 20 mai, des bordes sanguinaires souillent l’enceinte de la représentation nationale; le souvenir de cette tourbe, se ruant dans la salle, présentant au président Boissy-d’Anglas la tète pâle et sanglante du jeune et courageux Féraud, pour le forcer à descendre de son fauteuil de gloire, est encore palpitant. On arrête les chefs de l’insurrection; mais un comité séditieux s’installe à l’Hôtel-de-Ville et prend le titre de Convention nationale du peuple souverain; les membres de ce comité sont mis hors la loi; la section Lepelletier, âme de l’anarchie, délibère pour lutter; on la désarme. Alors la Convention se déclare en permanence.
Le commandement des troupes est confié au général Menou: il entre dans Paris. Sa faiblesse compose avec la folie des hommes dont il partage presque les sympathies: l’embarras des comités de Salut public et de Sûreté générale, réunis sous la présidence de Cambacérès, est à son comble. On envoyé chercher Bonaparte. Le général expose que dans ce danger la présence des commissaires du gouvernement, leur omnipotence paralysent les opérations militaires. Menou est destitué. Barras, nommé général en chef, délègue à Bonaparte tous ses pouvoirs. La lutte commence entre les troupes conventionnelles et les sectionnaires, et, à la suite d’un engagement dans les rues avoisinant les Tuileries, les insurgés, refoulés, renoncent au combat; le soir du 13 vendémiaire, Paris était parfaitement tranquille.
Il y eut peu de victimes, eu égard à l’importance de cette journée: les insurgés perdirent environ soixante-dix hommes, et eurent trois ou quatre cents blessés; les troupes conventionnelles, de leur côté, comptèrent trente morts et deux cent cinquante soldats mis hors de combat. La raison en était que Bonaparte avait ordonné de tirer d’abord à boulet et de ne mettre ensuite que de la poudre dans les fusils. «C’est un très-mauvais moyen à employer que de tirer sans balles, disait-il à cette raison à M. O’Méara, car la populace entendant un grand bruit est bien un peu effrayée; mais regardant ensuite autour d’elle et ne voyant ni tués ni blessés, elle reprend bientôt courage; elle commence à vous mépriser et elle n’en devient que plus insolente, et, à la fin, se précipite sur vous sans crainte; en sorte que vous êtes forcés d’en tuer dix fois plus que vous ne l’eussiez fait, si vos premières décharges eussent été à balles.»
Les officiers de l’armée de l’intérieur furent pré sentés à la Convention, qui donna une preuve de sa reconnaissance à Bonaparte en le nommant général en chef, car Barras ne pouvait cumuler un commandement avec le titre de représentant. Elle ne se borna pas là ; elle honora sa victoire par la clémence: pendant trois jours les barrières furent laissées ouvertes afin qu’on pût éviter sa sévérité. Le 25 septembre 1795, elle déclara sa mission remplie, et, dans ses adieux au peuple, elle convia tous les Français à l’union, à l’amitié : c’était, disait-elle, le moyen de sauver la République; elle remit le pouvoir au Directoire exécutif où figurèrent Barras, La Révellière-Lepaux, Carnot, Rewbell et Letourneur.
Pendant son commandement de Paris, à la suite du 13 vendémiaire, Napoléon eut à lutter surtout contre la disette, à prévenir les conséquences de la misère.
Un jour la distribution manquait: des attroupements nombreux se formèrent à la porte des boulangers; le général en chef passait, avec une partie de son état-major, pour veiller à la sûreté publique, lorsqu’un groupe dans lequel on distinguait un grand nombre de femmes, s’approcha de lui, demandant du pain à grands cris; la foule augmentait, les menaces redoublaient, la position était critique; une femme monstrueusement grosse et grasse se faisait remarquer particulièrement par ses gestes et ses paroles. «Tout ce tas d’épauletiers, s’exclamait-elle en apostrophant les officiers, se moquent de nous; pourvu qu’ils mangent et qu’ils s’engraissent, il leur est fort égal que le pauvre peuple meure de faim.» Napoléon l’interpelle en ces termes: «La bonne, regardez-moi bien, quel est le plus gras de nous deux?» Un rire général désarme la populace et l’état-major continue sa route.
«J’étais à cette époque un vrai parchemin, disait Napoléon à Sainte-Hélène: et le portrait tracé par un contemporain le prouverait au besoin. Sa taille était petite et mince: sa figure creuse et pâle, ses cheveux longs tombaient des deux côtés du front: le reste de sa chevelure, sans poudre, se rattachait en queue par derrière. L’uniforme de général de brigade dont il était revêtu avait vu le feu plus d’une fois et se ressentait de la fatigue des bivouacs; la brodure du grade s’y trouvait représentée dans toute la simplicité militaire par un simple galon de soie. Son extérieur n’aurait rien eu d’imposant, sans la fierté de son regard.»
Après la journée du 13 vendémiaire on procéda au désarmement. Un jeune enfant de dix à douze ans vint à l’état-major pour parler au général en chef. Son maintien noble et simple attira l’attention de Bonaparte qui l’accueillit avec bienveillance. «Mon père, dit l’enfant, a péri sur l’échafaud de 1793: il s’était servi de son épée avec honneur; je viens vous demander cette épée, car, par suite du désarmement, elle est déposée dans les magasins de la place.» Touché de cette pieuse démarche, le général accède à la demande de l’enfant qui, en recevant l’épée de son père, la couvre de baisers et de larmes. Cet enfant était Eugène de Beauharnais, depuis vice-roi d’Italie. Le lendemain, Joséphine Tascher de la Pagerie, veuve du marquis de Beauharnais, se présentait pour remercier Napoléon de la réception faite à son fils. Cette visite fit une profonde impression sur le général. Il venait de voir pour la première fois celle que la Providence lui destinait pour compagne: le 9 mars 1796, il s’unissait à elle.
Tandis que le Directoire s’occupait des théories de Babœuf et réprimait aux théâtres les manifestations royalistes, la cour de Turin prenait les mesures nécessaires pour commencer la campagne avec succès: une escadre anglaise croisait dans les mers de la Toscane et de Gênes. L’armée française, dans le comté de Nice, avait repris le nom d’armée d’Italie: elle occupait Savone. Les vainqueurs de Laono, dans leurs quartiers d’hiver, manquaient du nécessaire.
Napoléon, nommé général en chef, part pour Nice: il y arrive le 27 mars 1796. Son premier soin est de pourvoir à tout; il subjugue l’armée par son génie: il provoque la confiance du soldat. Malgré son extrême jeunesse, en dépit de quelques sentiments de secrète jalousie, il s’attache l’estime, l’affectueux dévouement des généraux dont il se montre, dans ses dehors, moins le chef que l’égal en patriotisme. Son coup d’œil a mesuré la distance qui le sépare de Vienne; son plan de campagne est arrêté, et, dans la conscience de sa haute capacité, il arrache ses phalanges à l’engourdissement des privations, à l’apathie du dénûment; l’ordre est donné de porter le quartier-général à Albenga; appel est fait à la valeur des troupes dans une de ces proclamations qui peignent tout l’homme.
«Soldats ,
» Vous êtes nus, mal nourris: on nous doit beaucoup, on ne peut rien nous donner; votre patience, le courage que vous montrez au milieu de ces rochers sont admirables; mais ils ne nous procurent aucune gloire. Je viens vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde; de riches provinces, de grandes villes seront en notre pouvoir, et là, vous aurez richesse, honneur et gloire. Soldats d’Italie, manquez-vous décourage?»
Loin de se plier aux règles de la vieille tactique, Bonaparte improvise tout: il sent en lui l’étincelle morale qui, dans les péripéties de la guerre, prononce, décide et assure le succès; il a foi en son génie.
A la tète de 34,000 hommes environ, il s’avance contre une armée de près de deux cent mille hommes, car les princes d’Italie ont promis leurs contingents. Il frappe le premier coup à Montenotte (11 avril 1796); à Millesimo (14 avril), il sépare les deux armées sarde et autrichienne: Annibal avait franchi les Alpes, il les a tournées. Le résultat n’est plus douteux; il culbute l’ennemi à Mondovi (20 et 22 avril); et le 25 il est à Cherasco. L’abondance à succédé au dénûment dans l’armée dont l’ardeur a secondé sa pensée. Il contraint le roi de Sardaigne à souscrire aux conditions onéreuses d’une paix qui est presque une injure pour ce monarque.
C’est en ces termes qu’il constate la rapidité de ses succès, en s’adressant aux compagnons de sa gloire:
«Soldats,
» Vous avez en quinze jours remporté six victoires, pris vingt-et-un drapeaux, cinquante pièces de canon, plusieurs places, conquis la partie la plus riche du Piémont; vous avez fait quinze mille prisonniers, tué ou blessé dix mille hommes; vous vous êtes battus pour des rochers stériles, illustrés par votre courage, mais inutiles à la patrie; vous égalez aujourd’hui par vos services l’armée conquérante de la Hollande et du Rhin.
» Dénués de tout, vous avez suppléé à tout; vous avez gagné des batailles sans canons, passé des rivières sans ponts, fait des marches forcées sans souliers, bivouaqué plusieurs fois sans pain; les phalanges républicaines étaient seules capables d’actions aussi extraordinaires; grâces vous en soient rendues, soldats!
» Les deux armées qui naguère vous attaquaient avec audace fuient devant vous; il ne faut pas vous le dissimuler, vous n’avez encore rien fait, puisque beaucoup de choses vous restent encore à faire; ni Turin, ni Milan, ne sont à vous; vos ennemis foulent encore les cendres des vainqueurs des Tarquins.
» La patrie attend de vous de grandes choses; vous justifierez son attente; vous brûlez tous de porter au loin la gloire du peuple français, d’humilier les rois orgueilleux qui méditaient de vous donner des fers, de dicter une paix glorieuse qui indemnise la patrie des sacrifices qu’elle a faits.
» Vous voulez tous, en rentrant dans le sein de vos familles, dire avec fierté : J’étais de l’armée conquérante de l’Italie.
» Amis, je vous promets cette conquête; mais il est une condition qu’il faut que vous juriez de remplir: c’est de respecter les peuples que vous délivrerez de leurs fers; c’est de réprimer les pillages auxquels se portent les scélérats suscités par nos ennemis; sans cela, vous ne seriez pas les libérateurs des peuples, vous en seriez le fléau. Le peuple français vous désavouerait; vos victoires, votre courage, le sang de vos frères morts en combattant, tout serait perdu, surtout l’honneur et la gloire.
» Quant à moi et aux généraux qui ont votre confiance , nous rougirions de commander une armée qui ne connaîtrait de loi que la force; mais, investi de l’autorité nationale, je saurai faire respecter à un petit nombre d’hommes sans cœur les lois de l’humanité et de l’honneur qu’ils foulent aux pieds; je ne souffrirai pas que des brigands souillent vos lauriers.
» Peuples d’Italie, l’armée française vient chez vous pour rompre vos fers; le peuple français est l’ami de tous les peuples: venez avec confiance au-devant de nos drapeaux; votre religion, vos propriétés et vos usages seront religieusement respectés; nous ferons la guerre en ennemis généreux; nous n’en voulons qu’aux tyrans qui vous asservissent.»
Beaulieu s’est replié précipitamment pour couvrir le Milanais. Bonaparte met l’expérience de son adversaire en défaut; il tourne sa gauche, prend sa ligne à revers, traverse, dès le 6 mai, la Scrivia et la Staffora. Le 7, il défait Liptay à Tombio, et accorde une suspension d’armes à l’infant, duc de Parme et de Plaisance. Si son armée profite des minutions de toute espèce qu’elle trouve dans sa conquête, il n’oublie pas Paris, dont il doit faire le temple des arts: il y expédie une riche collection de tableaux, parée du Saint-Jérôme du Dominiquin.
Les Autrichiens ont disséminé leurs forces; mais ils occupent une position formidable à Lodi. Napoléon veut les chasser de l’Italie: l’ennemi se croit fort, et ne peut supposer que des soldats soient assez téméraires pour tenter le passage du pont, devenu depuis si célèbre. C’est sur ce point qu’il est attaqué, culbuté. Milan ouvre ses portes au vainqueur, qui y fait son entrée triomphale le jour même où le Directoire signait le traité de paix accordé au roi de Sardaigne (15 mai 1796).
Salué par les acclamations du peuple, Bonaparte adresse aux curés de la capitale de la Lombardie ces paroles, dictées par le sentiment le plus religieux: «Une société sans religion est toujours agitée et secouée par le tourbillon des passions les plus furieuses, et se trouve perpétuellement en proie aux fureurs intestines qui la précipitent dans un abîme de maux et la conduisent nécessairement à périr.»
Combien de nations, en effet, en ont fait la triste expérience!
Dès son entrée, le général réorganise l’administration; il pourvoit son armée d’un nombreux matériel et envoie en France les chefs-d’œuvre de Michel-Ange, du Guerchin, du Titien, de Paul Véronèse, du Corrège, de l’Albane, des Carraches, de Raphaël, de Léonard de Vinci, pour enrichir le musée.
L’inaction pèse au bouillant Bonaparte. Les impériaux sont sous les murs de Mantoue; ils ont reçu des renforts, ils peuvent en obtenir encore; il faut les prévenir; il publie une proclamation dans laquelle on trouve empreinte toute l’âme de l’homme extraordinaire, et qui présageait à l’Europe ce qu’elle devait attendre d’un chef qui pensait avec tant d’énergie, et qui savait exciter tous les genres d’enthousiasme:
«Soldats,
» Vous vous êtes précipités comme un torrent du haut de l’Apennin; vous avez culbuté, dispersé tout ce qui s’opposait à votre passage.
» Le Piémont, délivré de la tyrannie autrichienne, s’est livré aux sentiments naturels de paix et d’amitié qui l’attachent à la France. Milan est à vous; le pavillon républicain flotte dans toute la Lombardie; les ducs de Parme et de Modène ne doivent leur existence qu’à votre générosité.
» L’armée qui vous menaçait avec tant d’orgueil ne trouve plus de barrière qui la rassure contre votre courage. Le Pô, le Tésin, l’Adda, n’ont pu vous arrêter un seul jour: vous avez franchi les boulevards vantés de l’Italie aussi rapidement que l’Apennin.
» Tant de succès ont porté la joie dans le sein de votre patrie: vos représentants ont ordonné une fête dédiée à vos victoires, célébrée dans toutes les communes de la République. Là, vos pères, vos mères, vos épouses, vos sœurs, vos fiancées se réjouissent de vos succès et se vantent avec orgueil de vous appartenir. Oui, soldats, vous avez beaucoup fait, mais il vous reste encore beaucoup à faire: dirait-on de nous que nous avons su vaincre, mais que nous ne savons pas profiter de la victoire?
» La postérité nous reprocherait-elle d’avoir trouvé Capoue dans la Lombardie?... Non, je vous vois déjà courir aux armes; un lâche repos vous fatigue; les journées perdues pour la gloire le sont pour votre bonheur. Eh bien! partons; nous avons des marches forcées à faire, des ennemis à soumettre, des lauriers à cueillir, des injures à venger. Que ceux qui ont aiguisé les poignards de la guerre civile en France, qui ont lâchement assassiné nos ministres, incendié nos vaisseaux à Toulon, tremblent... L’heure de la justice a sonné ; mais que les peuples soient sans inquiétudes, nous sommes amis de tous les peuples, et plus particulièrement des descendants des Brutus, des Scipions et des grands hommes que nous avons pris pour modèles.
» Rétablir le Capitole, y placer avec honneur les statues des héros qui le rendirent célèbre, réveiller le peuple romain engourdi par plusieurs siècles d’esclavage; tel sera le fruit de vos victoires; elles feront époque dans la postérité ; vous aurez la gloire immortelle de changer la face de la plus belle partie de l’Europe.
» Le peuple français, libre, respecté du monde entier, donnera à l’Europe une paix glorieuse qui l’indemnisera des sacrifices de toute espèce qu’il fait depuis six ans; vous rentrerez alors dans vos foyers, et vos concitoyens diront en vous embrassant: Il était de l’armée d’Italie!»
Beaulieu avait pris position sur le Mincio: l’armée française se mit en mouvement, s’empara de Valeggio, rejeta les Autrichiens des lignes de Borghetto: Vérone se soumit, et Louis XVIII reçut l’ordre des Vénitiens de quitter leur territoire. Augereau se trouvait en vue de la ville de Mantoue; le 4juin, il s’était emparé du faubourg de Ceriolo. Emportés par un excès d’audace, bien naturel à des hommes qui avaient surmonté tant d’obstacles, les grenadiers prétendaient se former en colonnes serrées pour enlever la ville dont on leur montrait les remparts hérissés de canons. «A Lodi, s’écriaient-ils, il y en avait bien davantage! » Mais les circonstances n’étaient pas les mêmes. Une ville ne se prend point au pas de course. Aussi le général en chef leur donna l’ordre de revenir.
Des troubles sérieux éclataient dans les fiefs impériaux qui confinent aux États de Gênes, de Toscane et du Piémont. Les convois français étaient attaqués, on assassinait leurs courriers: au lieu de former sur le champ le siége de Mantoue, Bonaparte ordonne un simple blocus; il court pacifier les contrées prêtes à s’insurger, châtier les fiefs impériaux, et sa présence inspire au roi de Naples une terreur qui consolide les conquêtes de l’armée d’Italie.
Wurmser a quitté le Rhin avec des renforts, pour venir au secours de Beaulieu. Il espère cerner l’armée française, la croyant enchaînée à défendre le siége de Mantoue Bonaparte accourt, réunit ses forces sur l’Adige et précipite sa marche contre un ennemi qui a commis la faute de se diviser: seuls contre toutes les phalanges autrichiennes, les Français ne peuvent rien; mais seuls contre chaque corps, il y a égalité. La victoire couronne leur intrépidité à Salo, à Lonato (3 août). A l’âge de Scipion lorsqu’il vainquit Annibal, Bonaparte arrête les dispositions de la bataille générale qu’il se propose de livrer au vieux maréchal, à Castiglione; à Lonato, à peine est-il arrivé, on lui annonce un parlementaire. Il est informé en même temps qu’on prend les armes, que des colonnes ennemies débouchent par Ponte-Saint-Marco, qu’elles veulent sommer cette ville de se rendre à discrétion. Bonaparte ne peut disposer que de douze cents hommes: la situation devient critique; sa présence d’esprit le tire de ce pas dangereux. Il se fait amener l’officier parlementaire, et, au milieu de tout le mouvement d’un grand quartier général, il s’adresse à lui en ces termes: «Allez dire à votre général, qui a prétendu faire une insulte à l’armée française, que je suis ici pour la venger; qu’il est lui-même mon prisonnier ainsi que ses soldats: je sais que sa troupe n’est qu’une des colonnes coupées par des divisions de mon armée qui occupent Salo et la route de Brescia à Trente; dites-lui que si, dans huit minutes, il n’a pas mis bas les armes, que si une seule amorce est brûlée, je le fais fusiller, lui et ses gens; qu’on enlève le bandeau qui couvre les yeux de monsieur; ajoute-t-il; et, continuant: Vous voyez le général Bonaparte au milieu de son état-major et de l’armée républicaine: rapportez à votre général qu’il lui est loisible de faire une bonne capture.» Le chef de la colonne ennemie demande alors à capituler: «Non, répond Bonaparte avec une fierté provoquée par cette démarche, je ne puis capituler avec des hommes qui sont mes prisonniers.» L’Autrichien insiste: une démonstration d’attaque est ordonnée, etle commandant ennemi se rend sans conditions: trois bataillons mettent bas les armes.
Ce trait d’audace n’était pas de nature à affaiblir le moral des troupes; enfin arrivait le jour qui devait décider du sort des deux armées. Wurmser, écrasé à Castiglione, est forcé de s’enfermer dans Mantoue.
Tandis que l’enthousiasme de nos troupes grandissait au milieu de tant de triomphes, la haine de l’Autriche se fortifiait par suite de ses défaites successives. Les armées françaises du Rhin et de Sambre-et-Meuse avaient été battues en Allemagne; elles avaient repassé le Rhin. La cour de Vienne voulut dégager Mantoue, délivrer Wurmser, et réparer ses revers en Italie. Une nouvelle armée s’avança sous les ordres d’Alvinzi. Dès le 2 novembre, Vaubois fut contraint d’évacuer le Tyrol. L’échec de Caldiero fait fléchir un instant le moral de l’armée. Déjà les soldats, dans leur mauvaise humeur, se plaignent de remplir la tâche de tous; des craintes même sont manifestées par les chefs; Ils redoutent d’être forcés de regagner les Alpes en fuyards et sans honneur. A ces rumeurs, Bonaparte fait répondre: «Nous n’avons plus qu’un effort à faire et l’Italie est à nous: Alvinzi battu, Mantoue succombe; vous allez sur les Alpes, mais vous n’êtes plus capables de la vie dure et fatigante de ces stériles rochers; vous avez pu conquérir les délices de la Lombardie; des bivouacs riants et fleuris de l’Italie, vous ne vous élèveriez plus aux rigueurs de ces âpres sommets, vous ne supporteriez plus sans murmures les neiges ni les glaces des Alpes. Des secours sont arrivés; nous en attendons encore; que ceux qui ne veulent plus se battre, qui sont assez riches, ne nous parlent pas de l’avenir. Mais battez Alvinzi, et je vous réponds du reste!...»
Répétées par des cœurs généreux, ces paroles relèvent l’énergie un moment ébranlée. Lorsque la nouvelle de l’échec de Caldiero, par Vaubois, se répand à Brescia, à Bergame, à Milan, à Crémone, à Lodi, à Pavie, à Bologne, les blessés, les malades, encore mal guéris, sortent des hôpitaux; ils viennent prendre leur place dans les rangs, la blessure encore saignante. Ce spectacle émeut l’armée; elle marche sur Ronco, passe l’Adige sur un pont de bateaux, elle touche à Arcole.
Les 15 et 16 novembre, les Français se battent en héros, et le 17, les Autrichiens abandonnent le champ de bataille, après avoir éprouvé des pertes considérables. Les deux partis avaient montré une égale bravoure; mais Bonaparte était là ; les généraux avaient fait preuve de leur haute vaillance, le soldat de cette intrépidité, de cette confiance qui ne désespère jamais de la victoire avec de pareils chefs.
Le maréchal Alvinzi, en se retirant sur Montebello, cherchait à se lier avec son lieutenant Davidowich par les gorges de la Brenta. Bonaparte l’a deviné ; certain, en se portant sur le corps autrichien de la vallée del’Adige, d’accabler ce nouvel adversaire comme le corps d’Alvinzi dans les champs d’Arcole, il écrivait au Directoire, le 19 novembre: «Demain, j’attaque la division Davidowich: je la battrai si elle veut m’attendre, et je la poursuivrai jusque dans le Tyrol. J’attendrai alors la reddition de Mantoue, qui ne peut tarder plus de quinze jours.»
Tandis que le chef de bataillon Lemarrois, aide de camp du général en chef, envoyé à Paris, présentait au Directoire les drapeaux de la colonne autrichienne anéantie sur la chaussée d’Arcole, Napoléon se rendait à Vérone. A mi-chemin, il rencontre un officier d’état-major autrichien, envoyé à Alvinzi par Davidowich. Ce jeune homme se croyait au milieu des siens. D’après ses dépêches, trois jours s’étaient écoulés sans communication entre les deux armées. Davidowich ignorait tout. Le général français entre triomphant dans Vérone par la porte de Venise, trois jours après en être mystérieusement sorti par la porte de Milan; il passe sur la droite de l’Adige, court sur Davidowich, le chasse de poste en poste de Rivoli et le poursuit jusqu’à Roveredo; puis il fait occuper Montebello, la Corona, les gorges de la Chiesa et de l’Adige, ne jugeant pas devoir reprendre le Tyrol.
La bataille de Lonato, celles de Castiglione, d’Arcole, avaient fait échouer deux plans de campagne. Le cabinet autrichien en adopte un troisième, qui se rattachait aux opérations de Rome; pour en donner communication à Wurmser, il envoie un agent secret fort intelligent: une des sentinelles françaises l’arrête comme il franchissait le dernier poste devant Mantoue. On surprend la dépêche: c’était une petite lettre écrite en caractères, très-fins, signée par l’empereur François, qui annonçait au vieux maréchal qu’il allait être dégagé. D’après les ordres de la cour de Vienne, en janvier 1797, Alvinzi reprend l’offensive. Il occupe la Corona, jette un pont sur l’Adige pour enlever le plateau de Rivoli. La bataille s’engage à Rivoli; elle se renouvelle à la Favorite; vainqueur deux fois, en vue même de Mantoue, le général Bonaparte fait connaître à Wurmser, enfermé dans la place, qu’il n’a plus rien à espérer. Il le somme de se rendre; le vieux maréchal répond d’abord qu’il a des vivres pour trois mois; il comprend bientôt que le moment de succomber est arrivé, car la moitié de la garnison encombre les hôpitaux, les édifices publics; les chevaux de sa nombreuse cavalerie ont été mangés; partout la fièvre pestilentielle exerce ses ravages. Klenau, premier aide de camp de Wurmser, se présente au quartier général du général Serrurier Bonaparte, enveloppé dans sa capote, conserve l’incognito. La conversation s’engage, et Klenau discute longuement sur les moyens de défense des Autrichiens; alors le général en chef s’approche de la table, écrit ses décisions en marge des propositions de Wurmser; puis quand il a fini, s’adressant à Klenau: «Monsieur, lui dit-il, si Wurmser avait pour dix-huit ou vingt jours de vivres et qu’il parlât de se rendre, il ne mériterait aucune capitulation honorable. Voici les conditions que je lui accorde parce que j’honore son âge et ses mérites, et que je ne veux pas qu’il devienne la victime des intrigues qui voudraient le perdre à Vienne.» Présentant le papier à Serrurier, il ajoute: «S’il ouvre ses portes demain, il aura les conditions que je viens d’écrire; s’il tarde quinze jours, un mois, deux, il aura encore les mêmes conditions. Il peut donc désormais attendre jusqu’au dernier morceau de pain. Je pars à l’instant pour passer le Pô. Je marche sur Rome. Vous connaissez mes intentions, allez les dire à votre général.»
Pendant que le général Serrurier présidait aux détails de la reddition de Mantoue, Bonaparte, qui s’était dérobé avec indifférence au spectacle d’un généralissime des forces autrichiennes remettant son épée à son vainqueur, gagnait la Romagne, où il détruisait l’armée organisée au nom du chef de l’Église du Seigneur, dont le royaume n’est pas de ce monde (13 février 1797). Avignon, le comté Venaissin. les légations de Bologne, Ferrare et la Romagne, étaient abandonnés à la France par le traité de Tolentino.
Les succès de l’archiduc Charles, en Allemagne, avaient relevé les prétentions de la cour d’Autriche; elle confia à ce prince le commandement de son armée d’Italie dans le courant de février. Les tentatives de Clarke n’avaient eu aucun résultat. Bonaparte résolut de jeter les Autrichiens au delà des Alpes Juliennes, de les pousser sur la Drave, sur la Muer, de traverser le Simmering et de forcer l’empereur d’Autriche d’accepter la paix au sein même de sa capitale. Le 16 mars, les armées françaises et autrichiennes en vinrent aux mains à Tagliamento; la victoire fut vivement disputée; chèrement achetée, elle resta aux vaillantes cohortes de la France. Le 7 avril, l’avant-garde de Bonaparte était à Léoben, où les conditions d’une suspension d’armes étaient arrêtées. Le 17 avril, les plénipotentiaires autrichiens signaient les préliminaires d’une paix glorieuse; immortel souvenir pour la mémoire de l’homme prodigieux qui avait réalisé de tels miracles!
Un moment la guerre se ralluma dans les provinces vénitiennes: les révoltés égorgeaient les Français blessés, au milieu même des hôpitaux de Padoue et de Vérone. Bonaparte courut demander justice de cette violation des lois de l’humanité. A l’approche des divisions Masséna, Joubert, Serrurier et Augereau, l’altière et lâche aristocratie de Venise implora la clémence d’un ennemi justement irrité ; une conférence eut lieu, le 3 mai 1797, dans les marais de Marghera: une suspension d’armes fut consentie sous la condition expresse que les trois inquisiteurs d’État et dix membres du Sénat, instigateurs reconnus de ces massacres, seraient immédiatement livrés. Le Lion de Saint-Marc, si terrible autrefois, subit la loi du vainqueur.
Le 17 octobre, au château de Campo-Formio, se signait le traité imposé à la morgue de l’Autriche: il assurait à la France la possession en toute souveraineté des îles vénitiennes du Levant, et de tous les établissements ci-devant vénitiens et albanais, situés plus bas que le golfe de Lodrino.
Pendant la guerre, le Directoire s’était de plus en plus compromis par de grands travers d’esprit, de mœurs et de combinaisons; sans but, sans direction, il oscillait dans un cercle de fautes et d’absurdités. Une crise politique était infaillible. L’opinion publique, travaillée par les factions, flottait entre toutes les utopies. Les armées d’Italie et d’Allemagne étaient exaspérées contre les journalistes aux gages de l’étranger.
Cette situation, vague, confuse, ne laissait qu’un parti à prendre, celui de se présenter comme régulateur; en remettant les enseignes à ses légions victorieuses, Bonaparte leur avait dit: «Je le sais, votre cœur est. plein d’angoisses sur les malheurs de la patrie; mais si les menées de l’étranger pouvaient l’emporter, nous volerions, du sommet des Alpes, avec la rapidité de l’aigle, pour défendre cette cause qui nous a coûté tant de sang.» A Milan, le général Lannes avait porté un toast: A la destruction du club de Clichy . Augereau avait crié aux Clichyens: Tremblez! vos iniquités sont comptées et le prix en est au bout de nos baïonnettes. Les divisions Brune, Joubert, Serrurier, Victor, s’étaient associées à ces menaçantes manifestations. Plus d’indulgence, plus de demi-mesures; la route de Paris n’offre pas plus d’obstacle que celle de Vienne; tel était l’esprit des deux armées.
Napoléon devint l’objet de prévenances de toutes sortes de la part de La Révellière-Lepaux; un jour il accepta de lui une invitation à dîner en petit comité, strictement en famille, afin d’être plus ensemble, selon les expressions du membre du Directoire. Après le dessert, la conversation roula sur la politique: les femmes s’étaient retirées. La Révellière, après avoir déblatéré contre la religion, et longuement vanté les avantages de sa théophilanthropie, se frotta les mains avec un certain air de satisfaction, et, s’adressant avec un sourire malin à Bonaparte: «Pour le triomphe de cette doctrine, de quel prix serait une acquisition comme la vôtre, lui dit-il; de quelle utilité, de quel poids ne serait pas votre nom! comme cela serait glorieux pour vous! Allons, qu’en pensez-vous?» Le jeune général, à cette brusque ouverture, répondit qu’il resterait toujours dans les principes de ses père et mère. Le grand-prêtre de la théophilanthropie vit qu’il n’y avait rien à faire pour son nouveau culte; mais il se consola en pensant que, du moins, Bonaparte serait peut-être moins inflexible quand il s’agirait de le soutenir, lui et ses collègues, fatigués des variations du système de bascule politique dont tout le monde avait fait une trop longue expérience.
En effet, les révélations de Duverne de Presle, arrêté et traduit devant une commission militaire, le portefeuille du comte d’Entraigues, saisi à Venise et transmis au gouvernement par le général Berthier, avaient dévoilé le plan de la contre-révolution. Barras, Rewbell et La Révellière pensèrent que l’occasion était venue de se débarrasser des dissidences de leurs collègues Carnot et Letourneur.
Dans sa confiance un peu aveugle, le club de Clichy, malgré les avertissements de Pichegru et de Willo, crut qu’on n’oserait le frapper. C’était une erreur: car le 4 septembre (18 fructidor), à la pointe du jour, le canon retentit: c’était le signal donné aux troupes, arrivées de l’armée d’Allemagne, d’entrer dans Paris. Les deux palais des Conseils furent investis par la force armée. Ramel essaya en vain de rappeler à leurs devoirs les soldats de la garde législative; il se vit arracher les insignes de son grade par le commandant de la division de Paris, choisi par le Directoire, le général Augereau. Pichegru fut arrêté, et la minorité des deux Conseils, docile aux suggestions de Barras, de La Révellière-Lepaux, de Letourneur, proscrivit tous ceux que lui signala la vengeance dictatoriale. Cinquante-trois membres furent condamnés à la déportation: parmi eux figuraient Pichegru, Barbé-Marbois, Boissy-d’Anglas, Portalis et Camille Jordan. Une demi-terreur substitua, à une sorte de gouvernement constitutionnel, une autorité révolutionnaire. Merlin de Douai et François de Neufchàteau furent élus au moment où deux des Bourbons restés en
France étaient déportés en Espagne; conséquences voulues, nécessaires de la journée du 18 fructidor.
Après la signature du traité de Campo-Formio, Bonaparte, qui avait organisé la nouvelle république cisalpine, s’était rendu par la Suisse à Rastadt pour y préparer l’heureuse issue des négociations des plénipotentiaires français. La reconnaissance nationale réservait au libérateur de l’Italie, au pacificateur du continent, une brillante ovation. A son retour à Paris, le 5 décembre 1797, il fut présenté au Directoire par le ministre des relations extérieures, Talleyrand de Périgord, qui à cette solennité prononça ces paroles:
«Loin de redouter ce qu’on voudrait appeler son ambition, je sens qu’il faudra (il parlait de Bonaparte) peut-être le solliciter un jour pour l’arracher aux douceurs de sa studieuse retraite. La France entière sera libre, peut-être lui ne le sera-t-il jamais!» Le chef des diplomates prophétisait la destinée de Napoléon.
Lorsque Talleyrand eut fini son discours, Bonaparte prit la parole en ces termes:
«Citoyens Directeurs,
» Le peuple français, pour être libre, avait les rois à combattre.
» Pour obtenir une Constitution fondée sur la raison, il avait dix-huit siècles de préjugés à vaincre.
» La Constitution de l’an III et vous, avez triomphé de tous les obstacles. La Religion féodalisée, le Royalisme, ont successivement, depuis vingt siècles, gouverné l’Europe; mais de la paix que vous venez de conclure, date l’ère des gouvernements représentatifs.
» Vous êtes parvenus à organiser la grande Nation, dont le vaste territoire n’est circonscrit que parce que la nature en a posé elle-même les limites; vous avez fait plus.
» Les deux plus belles parties de l’Europe, jadis si célèbres par les arts, les sciences et les grands hommes dont elles furent le berceau, voient avec les plus grandes espérances le génie de la liberté sortir des tombeaux de leurs ancêtres.
» Ce sont deux piédestaux sur lesquels les destinées vont placer deux grandes nations.
» J’ai l’honneur de vous remettre le traité signé à Campo-Formio, et ratifié par Sa Majesté l’Empereur.
» La paix assure la liberté, la prospérité et la gloire de la République.
» Lorsque le bonheur du peuple français sera assis sur les meilleures lois organiques, l’Europe entière deviendra libre.»
Le président du Directoire, Barras, s’étendit plus particulièrement sur la journée du 18 fructidor. Bonaparte, avec son tact parfait, n’avait pas abordé un sujet si délicat.
Le ministre de la guerre présenta au Directoire le général Joubert et le chef de brigade Andreossy, chargés par Bonaparte, à son départ d’Italie, de rapporter le drapeau décerné par les Conseils aux cohortes victorieuses à Lodi, à Arcole, à Tagliamento. On y lisait sur l’une des faces:
A l’Armée d’Italie, la Patrie reconnaissante!
Sur l’autre côté étaient inscrits les combats livrés, les villes prises. On y remarquait les inscriptions suivantes:
Elle a fait cent cinquante mille prisonniers, pris cent soixante-dix drapeaux, cinq cent cinquante pièces d’artillerie de siége, six cents pièces de campagne; cinq frégates de pont, neuf vaisseaux de soixante-quatre canons, douze frégates de trente-deux, douze corvettes, dix-huit galères;
Donné la liberté aux peuples de Bologne, Ferrare, Modène, Massa-Carrara, de la Romagne, de la Lombardie, du nord de l’Italie, aux peuples de la mer Egée et d’Ithaque; Envoyé à Paris les chefs-d’œuvre de Michel-Ange, du Guerchin, du Titien, de Paul Veronèse, du Corrège, de l’Albane, des Carraches, de Raphaël, de Léonard de Vinci.
C’était l’inventaire de la gloire.
Le succès obtenu par Bonaparte au siége de Toulon ne l’avait pas étonné ; il en avait joui sans s’émerveiller. Comme il le disait, «Vendémiaire et même Montenotte ne me portèrent pas à me croire un homme supérieur. Ce n’est qu’à Lodi qu’il me vint l’idée que je pourrais bien devenir, après tout, un acteur décisif sur la scène politique. Alors naquit la première étincelle de haute ambition.»
Après chaque bataille les soldats de l’armée d’Italie, réunis en conseil, décernaient un grade à leur général en chef. Nommé caporal à Lodi, il était sergent à Castiglione. De promotions en promotions, le petit caporal des vieilles moustaches de l’armée d’Italie devait s’élever à l’empire.