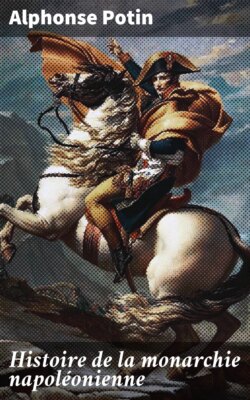Читать книгу Histoire de la monarchie napoléonienne - Alphonse Potin - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV
ОглавлениеTable des matières
Conduite de Bonaparte envers le Saint-Père. — Il est nommé commandant en chef de l’armée d’Angleterre. — Départ de Toulon. — Prise d’Alesandrie. — Les Pyramides. — Bataille des Pyramides. — Le Caire. — Combat de Salahieh. — Désastre d’Aboukir. — Révolte du Caire. — Jaffa. — La Porte. — Retour au Caire. — Bataille d’Aboukir. — Retour en France. — 18 brumaire. — Consulat.
La conduite de Bonaparte envers le Pape, lors des événements de 1797, a été calomniée: l’histoire lui a rendu justice. «Si quelque chose honora Bonaparte dans sa fameuse campagne d’Italie, a dit M. Dus sault , ce fut moins le passage merveilleux de l’Adda, la prise de Mantoue, la conquête de la Lombard die, que la dignité et la noblesse qu’on vit briller dans ses correspondances avec les puissances étrangères, et particulièrement avec la cour de Rome. C’est par cet endroit qu’il se montra supérieur à tous les généraux que la République a produits. Les vrais juges lui surent gré d’avoir conservé, dans les emplois de la révolution, et d’avoir eu le courage de manifester cette délicatesse de sentiments, ce respect des convenances qu’il avait puisés dans un autre ordre de choses.»
On aurait pu lui dire, comme Cicéron à César, en changeant seulement un mot: Vous avez vaincu des nations redoutables; mais votre plus belle victoire est d’avoir triomphé du ton et du préjugé révolutionnaires. Il sentit en effet que jeune et victorieux, à la tète de quatre-vingt mille hommes, il ne devait pas insulter un vieillard faible et désarmé qui le nommait son fils ; car telle est la sublimité de la religion, qu’elle ne désavoue pas ses enfants, lors même qu’ils sont armés contre elle. Mais Bonaparte fut le seul, à ces époques funestes, qui sut encore respecter ce qui est vraiment respectable. Le traité de Tolentino avait un terme à la haine du Directoire contre le Saint-Siège et la Religion.
Le traité de Campo-Formio tranchait la question que Louis XIV n’avait pu résoudre; la France était maîtresse de la limite qui, pendant plus de mille ans, avait séparé la Gaule et la Germanie. Les armées se reposaient de leurs glorieuses fatigues, lorsque le libérateur de Landau, le pacificateur de la Vendée, le général Hoche, succomba le 18 septembre 1797 à Wetzlar. Le destin lui refusait de mourir du trépas des braves sur un champ de bataille.
De retour d’Italie, retiré dans sa petite maison dé la Chaussée-d’Antin, rue Chantereine, depuis nommée rue de la Victoire par délibération de la municipalité de Paris, Bonaparte méditait la conquête de l’Égypte. Depuis la perte des colonies américaines, la prodigieuse activité des Anglais s’était tournée vers l’Inde. L’Égypte était le point intermédiaire du commerce entre l’Europe et l’Asie: c’était là qu’il voulait frapper la puissance britannique dans les sources mêmes de sa prospérité. Dans cette lutte d’un homme seul contre une nation, on admire l’infatigable énergie des deux athlètes. La prévoyante intelligence du vainqueur de l’Italie s’était éclairée de tous les documents utiles à la réalisation de ses projets: tous les livres de la bibliothèque ambroisienne relatifs à l’Orient avaient été envoyés de Milan, et consultés par Napoléon. Dans le silence du cabinet, il élaborait les plans de l’expédition; il sortait rarement; il assistait seulement aux séances de l’Institut. Peu désireux de cette popularité dont les trompeuses séductions entraînent et perdent le commun des hommes, il se dérobait aux démonstrations de la reconnaissance nationale: allait-il au théâtre, c’était dans une loge grillée qu’il se plaçait. Les sciences et la gloire avaient seules leurs entrées dans la retraite de Bonaparte; il recevait Monge, Laplace, Prony, Lagrange, Borda, Bertholet et quelques généraux; Kléber, Desaix, Caffarelli-Dufalgua. Le Directoire témoignait les plus grands égards au général en chef de l’armée d’Italie; mais son ombrageuse impéritie s’effrayait des sympathies dont il était l’objet. Inquiet des sourdes menées de l’aristocratie suisse, des intrigues des agents de l’étranger réunis à Berne, il s’alarmait à la nouvelle de l’assassinat du général Duphot, à Rome; et, heureux de réparer l’outrage prétendu que la modération du négociateur de Tolentino avait fait à la philosophie moderne, il envoyait Berthier renverser le gouvernement pontifical.
Les outrages prodigués par la populace de Vienne à l’ambassadeur français, Bernadotte, entretenaient l’hésitation des Dirècteurs, qui ne pouvaient se décider à attaquer l’Angleterre, soit en Irlande, soit en Égypte. Pour vaincre ces incertitudes, Bonaparte proposa de laisser en France Kléber et Desaix, deux hautes capacités militaires au niveau des plus graves éventualités. L’affaire de Rome était terminée; l’Autriche consentait à une réparation; les opérations en Suisse avaient rehaussé la prépondérance de la République. Rewbell détestait Kléber: ses collègues et lui ne connaissaient pas tout le mérite de Desaix; l’appui proposé par Bonaparte fut refusé ; on répondait d’ailleurs avec un sentiment d’orgueil national un peu affecté, que la République n’en était pas à deux généraux près. Enfin l’irrésolution cessa, et Bonaparte fut nommé commandant en chef de l’armée d’Angleterre.
Le 25 mars 1798, Merlin de Douai lui adressait la lettre suivante, écrite en entier de sa main:
«Vous trouverez ci-jointes, général, les expéditions des arrêtés pris par le Directoire exécutif pour remplir promptement le grand objet de l’armement de la Méditerranée. Vous êtes chargé en chef de l’exécution, vous voudrez bien prendre les moyens les plus prompts et les plus sûrs.
» Les ministres de la guerre, de la marine et des finances, sont prévenus de se conformer aux instructions que vous leur transmettrez sur ce point important dont votre patriotisme a le secret, et dont le Directoire ne pouvait mieux confier le succès qu’à votre génie et à votre amour pour la vraie gloire.»
Bonaparte quitta Paris le 7 mai. Son bon ange l’accompagnait. La tendre et gracieuse Joséphine avait voulu, non le suivre sur le champ de bataille comme en Italie, mais du moins veiller à son départ. A son arrivée à Toulon, le 8, le général en chef identifia à ses conceptions l’armée expéditionnaire par cette proclamation:
«Soldats,
» Vous êtes une des ailes de l’armée d’Angleterre; vous avez fait la guerre des montagnes, des plaines, des sièges; il vous reste à faire la guerre maritime.
» Les légions romaines que vous avez quelquefois imitées, mais point encore égalées, combattaient Carthage tour à tour sur cette même mer et aux plaines de Zama. La victoire ne les abandonna jamais, parce que constamment elles furent braves, patientes à supporter la fatigue, disciplinées et unies entre elles.
» Soldats, l’Europe a les yeux sur vous; vous avez de grandes destinées à remplir, des batailles à livrer, des dangers, des fatigues à vaincre; vous ferez plus que vous n’avez fait pour la prospérité de la patrie, le bonheur des hommes et votre propre gloire.
» Soldats, matelots, fantassins, canonniers, cavaliers, soyez unis; souvenez-vous que le jour d’une bataille vous avez besoin les uns des autres.
» Soldats, matelots, vous avez été jusqu’ici négligés; aujourd’hui la plus grande sollicitude de la République ést pour vous; vous serez dignes de l’armée dont vous faites partie.
» Le génie de la Liberté qui a rendu, dès sa nais-sauce, la République l’arbitre de l’Europe, veut qu’elle le soit des mers et des nations les plus lointaines. »
Le 19 mai 1799, par un temps magnifique, sortait de la rade de Toulon une flotte d’environ cent voiles portant l’élite de l’armée, de ses officiers supérieurs: Kléber, Desaix, Caffarelli-Dufalgua, Murat, Lannes, Berthier, Baraguay-d’Hilliers, Bertrand, Alexandre Dumas, , Beauharnais, Régnier, et une commission scientifique et artistique où figuraient Monge, Fournier, Bertholet, Geoffroy Saint-Hilaire, Larrey, Dubois, Denon, Amédée Joubert. Bonaparte commandait l’expédition; avec lui s’éloignait le génie de la France.
Son expérience avait prévenu la possibilité d’une rencontre avec la marine anglaise. Pour paralyser la supériorité des navires ennemis dans les manœuvres, il avait mis à bord de chaque bâtiment français trois cent cinquante à quatre cents hommes, accoutumés à l’exercice du canon. Cette précaution fut inutile: car, sans avoir rencontré les Anglais, l’armée qui, sur sa route, s’était emparée de l’île de Malte, effectuait son débarquement sur les côtes d’Orient , le 2 juillet, et le 3 elle était maîtresse d’Alexandrie.
Installé dans cette antique cité, dont la splendeur sous les Ptolémées avait excité la jalousie de Rome, Bonaparte écrivait au pacha représentant la Sublime-Porte: «La République française s’est décidée à envoyer une armée puissante sur le Nil, afin de mettre un terme aux brigandages des beys de l’Égypte, comme elle a été obligée de le faire plusieurs fois déjà dans le courant du siècle contre les beys de Tunis et d’Alger. Toi qui devrais être le maître des beys, et que cependant ils tiennent au Caire sans autorité et sans pouvoir, tu dois voir mon arrivée avec plaisir. Tu es sans doute déjà instruit que si je viens ce n’est pas pour rien faire contre le Coran ni contre le Sultan. Tu sais que la nation française est la seule et unique alliée que le Sultan ait en Europe. Viens donc à ma rencontre, et maudis avec moi la race impie des beys.»
Un Divan, espèce de conseil municipal, composé des cheiks les plus révérés, des plus notables habitants d’Alexandrie est constitué : engagement est pris solennellement par tous les membres de ne prendre aucune part aux hostilités, aux trames contre la République: la convention est publiée. La proclamation suivante est adressée au peuple par Bonaparte:
«Peuples d’Égypte,
» Depuis longtemps les beys, qui vous gouvernent en vous opprimant, insultent à la nation française et couvrent ses négociants d’avanies. L’heure du chàtiment est arrivée.
» Depuis longtemps ce ramassis d’esclaves, achetés dans le Caucase et la Géorgie, tyrannise la plus belle partie du monde; mais Dieu, de qui tout dépend, a ordonné que leur empire finit.
» Peuples d’Égypte, on vous dira que je viens détruire votre religion: ne le croyez pas; répondez que je viens vous restituer vos droits, punir les usurpateurs, et que je respecte plus que les Mamelucks Dieu et son prophète.
» Dites-leur que tous les hommes sont égaux devant Dieu; la sagesse, les talents et les vertus mettent seuls de la différence entre eux. Or, quelle sagesse, quels talents, quelles vertus distinguent les Mamelucks pour qu’ils aient exclusivement tout ce qui rend la vie aimable et douce?...
» Y a-t-il une belle terre, elle appartient aux Mamelucks; y a-t-il un beau cheval, une belle maison, tout appartient aux Mamelucks.
» Si l’Égypte est leur ferme, qu’ils montrent le bail que Dieu leur en a fait; mais Dieu est juste et miséricordieux pour le peuple. Tous les Égyptiens sont appelés à gérer toutes les places: que les plus sages, les plus instruits, les plus vertueux gouvernent, et le peuple sera heureux.
» Il y avait parmi vous de grandes villes, de grands canaux, un grand commerce: qui a tout détruit, si ce n’est l’avarice, les injustices et la tyrannie des Mamel ucks?
» Cadis, cheiks, imans, dites au peuple que nous avons été dans tous les temps les amis du Grand-Seigneur, et l’ennemi de ses ennemis. Les Mamelucks ne se sont-ils pas toujours révoltés contre l’autorité du Sultan, qu’ils méconnaissent encore? Ils ne suivent que leurs caprices.
» Trois fois heureux ceux qui seront avec nous; ils prospèreront dans leur fortune et leur rang. Heureux ceux qui seront neutres! ils auront le temps de nous connaître, et ils se rangeront avec nous.
» Mais malheur, trois fois malheur à ceux qui s’armeront pour les Mamelucks et combattront contre nous; il n’y aura pas d’espérance pour eux; ils périront! »
La vigilance du général fait face à tout. Il écrit à l’amiral Brueys de ne pas s’éloigner des côtes d’Égypte avant de s’être assuré s’il est impossible à la flotte d’entrer dans le port d’Alexandrie ; il lui prescrit, dans le cas de possibilité, d’exécuter ce mouvement; et, dans le cas contraire, de conduire ses bâtiments à Corfou. Mais la fatalité veut que l’officier Julien, chargé de cette dépêche, soit pris et massacré par les Arabes. «Brueys, disait Napoléon à cette occasion, n’approfondit pas assez le fait, quoique Barré assurât que l’entrée était praticable, ce qui me paraissait tel à moi-même. Quoi qu’il en soit, Brueys ne se crut pas d’une part suffisamment autorisé à se retirer; il craignait du reste, de l’autre, d’entrer dans le port, quand même cela serait possible, jugeant cette mesure hasardeuse, avant d’avoir l’assurance que nous étions en pleine possession du pays.»
L’ordre du départ est donné, l’armée marche sur le Caire. Au sortir d’Alexandrie elle s’engage dans le désert. L’ardeur d’un soleil brûlant force les soldats à se débarrasser de leurs vivres pour alléger la course: sans abri, sans eau, sans pain, ils arrivent haletants, épuisés de fatigue au village Damanhour. Les malédictions n’épargnent pas cette Égypte, si regrettée des Hébreux, et dans le repos des bivouacs plus d’un murmure se fait entendre. Bonaparte, seul, montre une sérénité charmante: il n’a ni tente, ni provision de bouche; il se réjouit de la somptuosité de son repas lorsqu’on lui sert un exigu plat de lentilles. Comment ces guerriers, aussi intrépides à lutter contre la nature que contre l’ennemi, pourraient-ils faire peser la responsabilité de leurs privations sur leur général en chef? Ils sont habiles à tout expliquer. «Le petit caporal, disent-ils, est un bon enfant qu’il a plu au Directoire de déporter, et qui s’est laissé faire. — Ce sont les savants qui, pour faire leurs fouilles, ont donné l’idée de l’expédition.» Comme la plaisanterie doit défrayer les ennuis du casernement, ils ajoutent, en parlant de Caffarelli-Dufalgua: «Celui-là peut bien se moquer de ça, il a toujours un pied en France.» Le général avait perdu une jambe sur le Rhin.
Le 10 juillet, les divisions quittent Damanhour. A la sortie, Bonaparte, assailli par un parti de Mamelucks, échappe par miracle à cette surprise. Desaix le gourmande sur son imprudence: «Il n’est pas écrit là haut, lui répond le général en chef en riant, que je doive jamais être prisonnier des Mamelucks... prisonnier des Anglais, à la bonne heure.» Paroles de triste prophétie, réalisées plus tard sur le rocher de Sainte-Hélène! Le danger est l’aiguillon du courage. On apprend que Mourad-Bey et Ibrahim sont campés à Chebreiss. Le 15, il est culbuté, et les vainqueurs, après avoir traversé, le 16, le village de Schabar, le 17 le village de Kom-el-Schérif, le 18 le village d’Alkam, se trouvent le 19 à Abou-Nechabeh, et le 20 à Domédinar; le 21 à l’aurore, ils découvrent les minarets de la capitale de l’Égypte et les Pyramides de Giseh. A la vue de ces muets témoins des vicissitudes humaines, ils s’arrêtent saisis d’admiration. Faisant tourner cette émotion au profit de la victoire: «Soldats, dit Bonaparte, vous allez combattre aujourd’hui les dominateurs de l’Égypte; songez que du haut de ces monuments quarante siècles vous contemplent.» Mémorable allocution que le lecteur, selon les expressions de lady Morgan, trouvera aussi sublime que les objets qui l’inspiraient!
Ibrahim et Mourad-Bey en viennent aux mains avec les phalanges françaises: l’impétuosité des Mamelucks est impuissante contre ces murailles de fer vomissant la mort, et la milice si redoutée vient expirer sous le feu et le fer des baïonnettes. La déroute de l’ennemi est complète; il est anéanti, écrasé ou jeté dans le Nil, et une troupe, sous les ordres du général Dupuy, tant la terreur était grande, pénètre sans obstacle dans le Caire, et va, dès le jour même de la bataille des Pyramides (21 juillet 1798), bivouaquer au centre de la ville.
Le 23, l’armée fait son entrée triomphale. Les premières idées de haute ambition étaient venues à Bonaparte après Lodi; de son propre aveu, elles se déclarèrent sur le sol de l’Égypte, après la bataille des Pyramides et la possession du Caire .
Ses premiers soins furent consacrés à l’administration du pays conquis. Maître absolu, il pensa avec raison qu’il est des mœurs, certains usages contre lesquels vient se briser toute puissance; il respecta les coutumes des habitants, exerçant les lois sur la population par de simples ordres du jour . «Je n’aurais pas osé faire fouiller les maisons, racontait-il plus tard; il eût été hors de mon pouvoir d’empêcher les habitants de parler librement dans les cafés. Ils étaient plus libres, plus parleurs, plus indépendants qu’à Paris. S’ils se soumettaient à être esclaves ailleurs, ils prétendaient et voulaient être libres là. Les cafés étaient la citadelle de leur franchise, le bazar de leurs opinions. Ils déclamaient et jugeaient en toute hardiesse.»
Ibrahim tenait la campagne, infestée par des nuées d’Arabes et de Fellahs. Bonaparte le chasse de Relbeis, il le poursuit à El-Kanka et le réduit à l’impuissance à la bataille de Salahieh (12 août).
Le 14, le général en chef reçut la nouvelle du désastre d’Aboukir. Il parcourut avec un calme stoïque le rapport du contre-amiral Gantheaume, prit à part l’officier chargé de lui remettre la dépêche de Kléber, lui demanda des détails de vive voix sur cette fatale journée, et, le récit achevé, il dit avec sang-froid: Nous n’avons plus de flotte: eh bien! il faut rester en ces contrées, ou en sortir grands comme les anciens. Dans l’accusé de réception, il transmit ses ordres à Kléber; il lui écrivit: Général, voilà un événement qui va nous forcer à faire de plus grandes choses que nous ne comption.: tenons-nous prêts.
La réponse de Kléber ne se fit pas attendre: elle était digne de lui et de celui qui la recevait: «La journée d’Aboukir n’a produit chez le soldat qu’indignation et désir de vengeance. Quant à moi, il m’importe peu où je dois vivre, où je dois mourir, pourvu que je vive pour la gloire de nos armes, et que je meure ainsi que j’ai vécu. Comptez donc sur moi dans tout concours de circonstances, ainsi que sur ceux à qui vous ordonnerez de m’obéir. Vous m’écriviez que nous aurions de grandes choses à faire; soit, je prépare mes facultés.»
De retour au Caire, Bonaparte, jaloux d’étendre ses relations au delà de l’Égypte, avait écrit au schérif qu’il désirait vivre en bonne intelligence avec lui; il lui recommandait de faire connaître, dans tous les cas, à tous les négociants et fidèles, que les musulmans n’avaient pas de meilleurs amis que les Français; de même que les schérifs, les mollahs, les imans et tous ceux qui employaient leur temps et leurs moyens à instruire le peuple, n’avaient pas de plus zélés protecteurs.
Mais, malgré toutes les concessions politiques, le fanatisme se réveille de sa torpeur; la population, égarée, reçoit ses sanguinaires inspirations: les massacres s’organisent: le général Dupuy est assassiné. L’insurrection grandit; il faut la comprimer. Les troupes courent aux armes: le sang coule dans les rues du Caire; les insurgés, refoulés dans la grande mosquée, sont sommés de se rendre; fiers de leur supériorité numérique, ils repoussent la clémence. Alors le canon bat le dernier asile de la sédition; il force les plus mutins à implorer la miséricorde du général en chef: «Vous l’avez refusée, quand je vous l’offrais, cette clémence, répond le Favori de la victoire (nom que le peuple avait donné à Bonaparte), l’heure du châtiment est sonnée. Vous avez commencé, c’est à moi définir.» Cette énergie ôte tout espoir aux séditieux: sous le feu des batteries, ils se voient voués à la mort; les principaux chefs se dévouent et demandent merci. Le feu cesse, Bonaparte leur a pardonné.
Une profonde tranquillité succéda à ces agitations: indépendamment des travaux militaires, le chef des braves de l’occident dota le Caire des établissements les plus utiles. Un hospice s’éleva sur le bord du canal de Rodah, un lazaret magnifique fut fondé, un lycée de la patrie créé, un hôtel de la monnaie organisée sur tous les points s’ouvrirent des fonderies, de vastes ateliers de serrurerie, de menuiserie, de corderie, de charronnage, de charpente, d’orfèvrerie, de passementerie. Le Caire eut un théâtre et deux journaux, l’un de science et de littérature, sous le titre de Décade égyptienne; l’autre politique, sous celui de Courrier d’Agée. Le plaisir lui-même eut son temple: le Tivoli du Caire, semblable au Tivoli de Paris.
Tandis que Bonaparte transformait cette ville, naguère vassale de l’Europe et de l’Asie, en une cité industrieuse, commerçante, il songeait à résoudre le problème de la jonction de la mer Rouge avec la Méditerranée, dont il voulait faire un lac français. Il part le 25 décembre 1798 pour Suez; le 27, il y entre; le 30, il traverse la mer Rouge à l’endroit où les Israélites l’avaient traversée, trois mille trois cents ans auparavant. Il visite les sources de Moïse, examine quels peuvent être les travaux à exécuter pour établir une communication entre les deux mers; et, revenu au Caire, le 3 janvier 1799, il ordonne à l’ingénieur en chef Lepère de se rendre à Suez, afin de lever géométriquement le cours du canal des Ptolémées.
Le Directoire, contre l’attente de Napoléon, avait laissé le champ libre à l’influence du cabinet britannique. Secondée par la Russie, cette puissance triomphe des irrésolutions du Sultan. La Turquie déclare la guerre à la République française; des forces considérables se réunissent pour reconquérir l’Égypte. Les hostilités commencent; le pacha d’Acre occupe le fort El-Arisch, situé sur les frontières de la Syrie.
Bonaparte prend l’offensive: les troupes enlèvent le fort d’El-Arisch; le 21 février, le général se porte sur Kan-Younes; il doit trouver la division Kléber à ce village, le premier de la Palestine que l’on rencontre sur la route conduisant à Gazah, à Jaffa, à Saint-Jean-d’ Acre. Quelle est sa surprise! le point est occupé par les débris du corps de Mamelucks défait le 15 près d’El-Arisch. Kléber n’est pas arrivé ; les officiers penchent pour la retraite; Bonaparte repousse ce timide conseil: à la tête de ses guides, il court sur les bandes d’Abdallah-Pacha, qui s’enfuient à son approche.
Kléber, égaré par un guide, paraît enfin, et le 25 les divisions traversent ces vallons que jadis les Croisés firent retentir des cantiques de la foi chrétienne, égayant leur marche par les chants tyrtéens des hymnes de la victoire.
Gazah ouvre ses portes: Abdallah s’est replié ; on le poursuit sous les murs de Jaffa, qui, inondé de sang, encombré de cadavres, tombe au pouvoir de l’armée expéditionnaire, après les journées du 7 et du 8 mars. Jamais la guerre ne parut si hideuse au général en chef; elle portait dans ses flancs le fléau qui, le 13, décimait les rangs des cohortes victorieuses. Les courages les plus indomptés, les imaginations les plus fermes les plus vigoureuses, s’affaissent à ce cri qui répand la terreur: c’est la peste. L’épidémie éclate avec intensité : elle frappe avec la rapidité de la foudre. La crainte, le désespoir livrent les pestiférés aux étreintes de la mort. Le remède le plus efficace aux yeux de Bonaparte était l’énergie: il annonce l’intention de visiter les malades: en vain veut-on l’en dissuader. Qu’importe, répond-il, c’est mon devoir, puisque je suis général en chef.
Il se transporte à l’ambulance, parcourt lentement les salles, s’arrête devant presque tous les lits, relevant de leur abattement ses malheureux soldats, trop braves pour mourir à l’hôpital; il ne se borne pas aux paroles, il écarte la couverture d’un grenadier, prêt à succomber, et pressant de sa main les bubons sanglants: Vous voyez, dit-il à son entourage, vous voyez que ce n’est rien. Cet acte d’héroïsme paralyse l’influence de la contagion: l’armée est sauvée.
Le 14 mars 1799, les divisions ont rejoint l’avant-garde au village de Miski; le 16, Abdallah est précipité des hauteurs de Qâquoun, et le 18, animées d’une noble ardeur, elles investissent l’ancienne Ptolémaïs. Saint-Jean-d’Acre devait opposer à nos soldats, habitués aux succès, une résistance si opiniâtre que, malgré la dispersion, à la bataille de Mont-Thabor, d’une armée syrienne, innombrable comme les étoiles du ciel, innombrable comme les sables de la mer, et en dépit des plus brillants faits d’armes, elle détermina le général en chef à lever le siège. Pour donner le change à l’ennemi, le feu continua jusqu’au 16, et le lendemain on mit à l’ordre du jour de l’armée cette proclamation:
«Soldats,
» Vous avez traversé le désert qui sépare l’Afrique de l’Asie avec plus de rapidité qu’une armée d’Arabes.
» L’armée qui était en marche pour envahir l’Égypte est détruite; vous avez pris son général, son équipage de campagne, ses bagages, ses outres, ses chameaux.
» Vous vous êtes emparés de toutes les places fortes qui défendent les puits du désert.
» Vous avez dispersé aux champs du Mont-Thabor cette nuée d’hommes accourus de toutes les parties de l’Asie dans l’espoir de piller l’Égypte.
» Les trente vaisseaux que vous avez vus arriver devant Acre, il y a douze jours, portaient l’armée qui devait assiéger Alexandrie, mais, obligés d’accourir à Acre, elle y a fini ses destins: une partie de ses drapeaux orneront votre entrée en Égypte.
» Enfin après avoir, avec une poignée d’hommes, nourri la guerre pendant trois mois dans le cœur de la Syrie, pris quarante pièces de campagne, cinquante drapeaux, fait six mille prisonniers, rasé les fortifications de Gazali, Jaffa, Caïffa, Acre, nous allons rentrer en Égypte. La saison des débarquements m’y rappelle.
» Encore quelques jours et vous aviez l’espoir de prendre le pacha même au milieu de son palais; mais dans cette saison, la prise du château d’Acre ne vaut pas la perte de quelques jours; les braves que je devais y perdre me sont aujourd’hui nécessaires pour des opérations essentielles.
» Soldats, nous avons une carrière de fatigues et de dangers à parcourir. Après avoir mis l’Orient hors d’état de rien faire contre nous dans cette campagne, il nous faudra peut-être repousser les efforts d’une partie de l’Occident.
«Vous y trouverez une nouvelle occasion de gloire, et si, au milieu de tant de combats, chaque jour est marqué par la mort d’un brave, il faut que de nouveaux braves se forment et prennent rang, à leur tour, parmi ce petit nombre qui donnent l’élan dans les dangers et maîtrisent la victoire.»
Desaix en cinq mois avait conquis la Haute-Égypte, vaillamment défendue par Mourad-Bey: sa modération lui méritait le titre de Sultan juste. «Caractère tout à fait antique, disait de lui Napoléon, il ne rêvait que la guerre et la gloire: les richesses et les plaisirs n’étaient rien pour lui, il ne leur accordait pas même une seule pensée.»
Pendant que l’armée expéditionnaire effectuait sa retraite, et, sur l’ordre de Bonaparte, jetait à la mer les pièces prises à Jaffa pour conserver les seuls moyens de transports disponibles aux malades et aux blessés, il surgissait en Égypte un habile imposteur, d’une origine inconnue, s’annonçant aux Arabes du désert de Barca comme l’ange El-Mohdhy, dont la venue était promise par le Coran à la crédulité des musulmans; à la tête de bandes nombreuses, il procédait à sa prétendue mission par. Je massacre de soixante marins chargés de la défense de Damanhour. Ce charlatan du fanatisme, qui prétendait être invulnérable et paralyser avec une certaine poudre l’effet de la mous queterie de l’artillerie française, tombait quelque temps après percé d’une balle sur le théâtre de ses sanglantes jongleries.
Le général en chef atteignait Jaffa le 23 mai, après avoir châtié les Naplousains. C’est ici le lieu de parler d’un événement odieusement travesti par la malignité d’un officier étranger. La haine est toujours une Mauvaise conseillère. Sir Robert Wilson a imprimé que des malades français pestiférés, au nombre de cinq cent quatre-vingts, avaient été empoisonnés à Jaffa par les ordres précis et positifs de Bonaparte.
«Il y avait, dit M. le commissaire Miot, dans nos ambulances, et particulièrement au mont Carmel, des blessés et des malades hors d’état de faire la route autrement qu’en litière; la plupart étaient attaqués de la peste, et leur transport exigeait au moins huit hommes pour se relayer en chemin. Je sais qu’à l’époque du départ, on fit courir le bruit (qui a été répété depuis) qu’on administra aux malades désespérés des médicaments composés exprès pour accélérer leur triste fin, et leur éviter, par une mort adroitement préparée, celle plus cruelle qui les attendait en tombant entre les mains de leurs féroces ennemis. Je sais qu’on disait encore qu’il fallait, pour le salut d’un seul pestiféré, exposer huit hommes et même douze aux atteintes presque inévitables d’un fléau dont les effets étaient si rapides.
» J’ai été témoin de toute l’horreur qu’inspirait cette fatale résolution; mais il est de la droiture de mes sentiments, et il appartient à la franchise et à la simplicité avec lesquelles j’ai peint ce que j’ai vu, de déclarer que je n’ai d’autres preuves évidentes de l’empoisonnement de nos blessés que les propos sans nombre que j’ai entendu tenir dans l’armée.»
Ce témoignage, émané d’une personne qu’on ne saurait accuser de partialité, ébranle singulièrement la base des accusations de sir Robert Wilson. A ces ouï-dire, à ces propos, Napoléon lui-même a opposé, non une protestation, la calomnie pouvait-elle l’atteindre? mais un récit véridique et authentique que nous empruntons à la Relation du docteur O’Méara :
«Avant de quitter Jaffa et après en avoir fait embarquer la plus grande partie de mes malades et de mes blessés, on vint me dire qu’il restait à l’hôpital des hommes dans un état si dangereux, qu’il était impossible de les transporter. J’ordonnai aussitôt à l’état-major des chirurgiens de se réunir et d’examiner ce qu’il y avait de mieux à faire. En conséquence, ils se consultèrent et trouvèrent que sept à huit hommes étaient si dangereusement malades qu’on regardait comme impossible leur retour à la vie; on pensa que ce serait un acte de charité de condescendre a leurs désirs et de devancer leur mort de quelques heures.
» Desgenettes ne fut pas de cet avis, et dit que sa profession était de guérir les malades et non de les tuer. Larrey vint me trouver sur-le-champ et me fit part de cette opposition, ainsi que du raisonnement de Desgenettes, en ajoutant qu’il avait raison. Mais, continua Larrey, ces hommes ne peuvent vivre que peu d’instants, et si vous voulez laisser une arrière-garde pour les protéger contre les postes avancés de l’ennemi, cela suffira.
» J’ordonnai, en conséquence, à quatre ou cinq cents cavaliers de rester en arrière et de ne pas quitter l’endroit que les malades ne fussent morts. Ils restèrent en effet et vinrent me faire le rapport qu’ils avaient tous expiré. J’ai appris depuis que Sydney-Smith en avait trouvé un ou deux encore vivants quand il est entré dans la ville. Je ne fais pas de doute que cette histoire d’empoisonnement n’ait été faite en quelque sorte par Desgenettes, qui était un bavard; on aura mal entendu et mal répété ensuite.
» Je ne pense point, ajoutait-il, que c’eùt été commettre un crime que de donner de l’opium aux pestiférés; au contraire, c’eût été obéir à la voix de la raison: il y avait plus d’inhumanité à laisser quelques malades dans cet état désespéré, exposés à être massacrés par les Turcs, ou à éprouver de la part de ceux-ci des tourments épouvantables. Un général doit agir envers ses soldats comme il voudrait qu’on agit envers lui-même. Si mon fils, et cependant je crois l’aimer autant qu’un père peut aimer son enfant, si mon fils, dis-je, était dans une situation pareille à celle de ces malheureux, mon avis serait qu’on en agît de même, et si je m’y trouvais moi-même j’exigerais qu’on en usât ainsi envers moi. Au reste, si j’avais cru qu’il fût necessaire de donner de l’opium à ces soldats, j’aurais fait assembler un conseil de guerre, j’aurais exposé la nécessité de cette action, et je l’aurais fait mettre à l’ordre de l’armée. Croyez-vous que si j’eusse été capable d’empoisonner secrètement mes soldats, mes troupes eussent combattu pour moi avec un enthousiasme et une affection sans pareils? Non, non, je n’aurais pas accompli une telle action, quelque soldat m’eût brûlé la cervelle sur mon passage, quelque blessé même aurait conservé assez de force pour lâcher la détente d’un fusil et m’expédier.
«Je n’ai jamais commis de crime dans tonte ma carrière politique; je pourrais l’affirmer à mon agonie (il était alors à Sainte-Hélène). Je ne serais pas ici, si j’avais su commettre le crime.»
Tous les malades et blessés furent indistinctement transportés à la suite de l’armée, et Bonaparte donna ses propres chevaux pour faciliter cette opération. Ces malheureux campèrent constamment à une petite distance des bivouacs. Le général en chef, chaque soir, faisait dresser sa tente près d’eux, et il ne se passait pas un jour sans qu’il les visitât, sans qu’il les vît défiler au moment du départ.
Le 1er juin 1799, le corps expéditionnaire traversait le désert, Kan-Younes et El-Arisch, et le 10, à Matarieh, il se soumettait aux mesures de précautions en usage dans les lazarets pour entrer, le 14, dans la capitale de l’Égypte.
Les troupes de la garnison déploient toute leur coquetterie, les membres des administrations civiles et militaires, les membres de la commission des sciences et des arts, ceux de l’Institut d’Égypte, le grand Divan, les Cophtes, les principaux négociants, les officiers-généraux vont au-devant de Bonaparte Le scheik El-Bekri, représentant de la plus illustre des nombreuses familles issues du Prophète, lui offre en cadeau un magnifique cheval arabe, ainsi que l’esclave qui tient la bride de l’animal. Cet esclave, c’était le Mameluck Roustan, investi pendant quinze ans de la confiance de son maître.
La tranquillité la plus profonde régnait en Égypte; les forces qui y avaient été laissées augmentaient tous les jours: les soldats, en quittant les hôpitaux, grossissaient les troisièmes bataillons des corps.
Le Grand-Turc, qui avait prêté une oreille complaisante aux conseils de l’Angleterre et de la Russie, avait réuni une armée considérable; elle devait reconquérir l’Égypte: le 14 juillet 1799, elle débarque à Aboukir. Bonaparte réprimande Marmont de ne point s’être opposé à ce débarquement et d’avoir abandonné son poste: Marmont s’excuse sur le peu de forces qu’il avait pour repousser dix-huit ou vingt mille Turcs: Avec douze cents hommes, dit Bonaparte en l’interrompant, c’en était assez pour aller jusqu’à Constantinople.
Le péril stimule le génie du général en chef, il court à la victoire: ses dispositions sont prises, ses ordres exécutés, et les Turcs, rejetés hors de leur camp, poursuivis, sont précipités dans la mer. Une seule chaloupe, restée près du rivage, sauve Sydney-Smith de la mort qu’il fuit en vain, pourchassé de toutes ses positions. Avec moins de six mille hommes, Bonaparte, qui n’avait jamais montré plus d’habileté stratégique, venait d’en exterminer vingt mille. Telle fut la bataille d’Aboukir (25 juillet); telle fut la glorieuse revanche, prise par les troupes de terre, de l’affront reçu onze mois auparavant par notre marine. Vers le soir, Kléber arriva avec sa division. Transporté d’enthousiasme en apprenant tous les détails de cette brillante journée, il courut à Bonaparte, et, le soulevant entre ses bras: Général, s’écria-t-il, vous êtes grand comme le monde!
Avide d’apprendre des nouvelles de l’Europe, Bonaparte envoya à bord du vaisseau-amiral turc, sous prétexte de traiter des prisonniers qu’il venait de faire, se doutant bien que le parlementaire serait arrêté par Sydney-Smith . En effet, le commodore anglais le combla de bons traitements et se fit un malin plaisir d’adresser au général en chef une série de journaux.
Napoléon passa la nuit dans sa tente à dévorer ces papiers. Déjà le Directoire lui avait écrit, le 26 mai 1799, la lettre suivante, dont les termes lui démontraient la nécessité de remédier aux maux de la patrie, de la sauver:
«Les efforts extraordinaires, citoyen général, écrivaient Treilhard, La Révellière-Lepaux et Barras, que l’Autriche et la Russie viennent de déployer, la tournure sérieuse et presque alarmante que la guerre a prise, exigent que la République concentre ses forces. Le Directoire vient, en conséquence, d’ordonner à l’amiral Brueys d’employer tous les moyens qui sont en son pouvoir pour se rendre maître de la Méditerranée et pour se porter en Égypte, à l’effet de ramener l’armée que vous commandez. Il est chargé de se concerter avec vous sur les moyens à prendre pour l’embarquement et le transport. Vous jugerez, citoyen général, si vous pouvez avec sécurité laisser en Égypte une partie de vos forces, et le Directoire vous autorise, dans ce cas, à en confier le commandement à qui vous jugerez convenable.
» Le Directoire vous verrait avec plaisir revenir à la tête des armées républicaines, que vous avez jusqu’ à présent si glorieusement commandées.»
La résolution de Bonaparte est prise. La France le réclame. La mésintelligence entre le Directoire et le Conseil des Cinq-Cents mène à l’anarchie. Les armées, battues en Italie, sur le Rhin, n’offrent plus qu’une protection bien précaire: la discorde est prête à secouer ses torches incendiaires. Son départ est arrêté.
Il écrit à Kléber, qui commandait alors la province de Garbieh:
«Le gouvernement m’ayant rappelé près de lui, il est enjoint au général Kléber de prendre le commandement de l’armée d’Orient.»
Cette lettre laconique était destinée à devenir publique: sous le pli se trouvaient les instructions nécessaires. Précieux document historique que son haut intérêt nous oblige à consigner ici:
«Au général Kléber,
» Vous trouverez ci-joint, citoyen général, un ordre pour prendre le commandement de l’armée. La crainte que la croisière anglaise ne paraisse d’un moment à l’autre me fait précipiter mon voyage de deux ou trois jours. J’emmène avec moi les généraux Berthier, Lannes, Murât, Andréossy, Marmont, et les citoyens Monge et Bertholet.
» Vous trouverez ci-joints tous les papiers anglais de Francfort jusqu’au 10 juin; vous y verrez que nous avons perdu l’Italie, que Mantoue, Turin et Tortone sont bloqués. J’ai lieu de croire que la première de ces places tiendra jusqu’au mois de novembre; j’ai l’espérance, qui me sourit, d’arriver en Europe avant le commencement d’octobre.
» Vous trouverez ci-joint un chiffre pour correspondre avec le gouvernement, et un autre pour correspondre avec moi.
» L’intention du gouvernement est que le général Desaix parte pour l’Europe dans le courant de novembre, à moins d’événements majeurs.
» L’arrivée de notre escadre à Toulon, venant de Brest, et de l’escadre espagnole à Carthagène, ne laisse aucune espèce de doute sur la possibilité de faire passer en Égypte les fusils, sabres et fers coulés dont vous aurez besoin, et dont j’ai l’état le plus exact, avec une quantité suffisante de recrues pour réparer la perte de deux campagnes.
» Le gouvernement vous fera connaître alors ses intentions, et moi, en mon propre et particulier, je prendrai des mesures pour avoir fréquemment des nouvelles.
» Si, par des événements incalculables, toutes les tentatives étaient infructueuses, et qu’au mois de mai vous n’eussiez reçu aucun secours ni nouvelles de France; si, cette année, malgré toutes les précautions, la peste était en Égypte et que vous perdissiez plus de quinze cents soldats, perte considérable, puisqu’elle serait en sus de celle que les événements de la guerre occasionneraient journellement, je dis que, dans ce cas, vous ne devez point vous hasarder à soutenir la campagne prochaine, et vous êtes autorisé à conclure la paix avec la Porte ottomane, quand même l’évacuation devrait être la condition principale. Il faudrait seulement éloigner l’exécution de cet ordre, si cela était possible, jusqu’à la paix générale.
» Vous savez aussi bien que personne, citoyen général, combien la possession de l’Égypte est importante pour la France. L’empire turc, qui tombe en ruines de tous côtés, s’écroule aujourd’hui, et l’évacuation de l’Égypte par la France serait un malheur d’autant plus grand, que nous verrions, de nos jours, cette belle province passer en d’autres mains européennes.
» Les nouvelles des succès et des revers qu’aurait la République en Europe, doivent aussi influer puissamment sur vos calculs; mais si, avant que vous ayez reçu aucune nouvelle de France, la Porte répondait aux ouvertures de paix que je lui ai faites, déclarez que vous avez tous les pouvoirs que j’avais; entamez les négociations; répétez bien que l’intention de la France n’a jamais été d’enlever l’Égypte à la Porte; exigez que la Porte sorte de la coalition et nous accorde le commerce de la mer Noire; exigez qu’elle mette les prisonniers français en liberté ; exigez enfin une suspension d’armes de six mois, afin que pendant ce temps-là l’échange des ratifications puisse avoir lieu.
» A supposer des circonstances telles que vous croyiez devoir conclure le traité avec la Porte, vous feriez sentir que vous ne pouvez pas le mettre à exécution qu’il ne soit ratifié, et que, suivant l’usage des nations, l’intervalle entre la signature d’un traité et sa ratification doit toujours être une interruption d’hostilités.
» Vous connaissez, je pense, citoyen général, mes idées sur la politique à suivre envers l’Égypte elle-même. Quoi que nous fassions, les chrétiens seront toujours pour nous: il faut les empêcher d’être trop insolents, afin que les Turcs n’aient pas contre nous le même fanatisme que contre les chrétiens, ce qui nous les rendrait irréconciliables ennemis; il faut endormir le fanatisme en attendant qu’on puisse le déraciner; en captivant l’opinion des grands cheicks du Caire, on a l’opinion de toute l’Égypte et de tous les chefs du peuple. Si l’on sait les prendre, rien n’est moins dangereux pour nous que ces chefs peureux et pusillanimes, qui ne savent ni n’osent se battre, et qui imposent le fanatisme sans être fanatiques eux-mêmes.
» Quant aux fortifications, Alexandrie, El-Arisch, voilà les clefs de l’Égypte. J’avais l’intention de faire établir cet hiver plusieurs redoutes de palmiers; il y en aurait eu deux, notamment, de Salahieh à Katieh, deux autres de Katieh à El-Arisch, et l’une des deux dernières serait élevée à l’endroit où le général Menou a découvert de l’eau potable.
» J’avais le projet, si nul événement ne survenait, d’aviser aux moyens d’établir cet hiver un nouveau système d’impositions, qui eût à peu près permis de se passer des Cophtes; cependant, avant de rien innover à cet égard, je vous conseille de réfléchir longtemps: mieux vaut entreprendre un jour plus tard qu’un jour trop tôt.
» Des vaisseaux de guerre français se présenteront indubitablement cet hiver devant Alexandrie ou devant Bourlos, ou devant Damiette. Faites, soit dit en passant, faites construire une tour et une batterie à Bourlos; puis, quand les navires français auront paru, réunissez cinq ou six cents Mamelucks, arrêtez-les en un jour au Caire et dans les provinces, et les embarquez pour la France. A défaut de Mamelucks, des ôtages d’Arabes ou des fils de cheicks. Ces individus, transportés en France, verront la grandeur de la nation, prendront une idée de nos mœurs et de notre langue, et, revenus en Égypte, nous formeront autant de partisans.
» Le poste éminent que vous allez occuper, citoyen général, va vous mettre à même de déployer enfin les talents que vous a donnés la nature; l’intérêt de ce qui se passe ici est vif, et les résultats en seront immenses pour le commerce, immenses pour la civilisation: ce sera l’époque d’où dateront les grandes révolutions.
» Pour moi, accoutumé que je suis à ne voir la récompense des peines et de la vie que dans l’opinion de la postérité, j’abandonne l’Égypte avec le plus grand regret. L’intérêt de la patrie, sa gloire, l’obéissance, les événements extraordinaires qui viennent de se passer, me décident seuls à braver les escadres ennemies: je serai d’esprit et de cœur avec vous; vos succès me seront aussi chers que ceux auxquels je participerais en personne, et je regarderais comme mal employés tous les jours de ma vie où je ne ferais pas quelque chose pour l’armée dont je vous laisse le commandement, quelque chose pour consolider l’établissement magnifique dont nous venons de jeter les fondements.
» L’armée que je vous confie est toute composée de mes enfants; j’ai reçu dans tous les temps, au milieu de leurs plus rudes fatigues, des marqués de leur affection. Entretenez-les dans ces sentiments; vous le devez à l’attachement vrai que je vous porte, et, citoyen général, à l’estime toute particulière que j’ai pour vous.»
Il fait ses adieux à ses enfants, comme il les appelait lui-même, et prie Kléber de les mettre à l’ordre du jour. Écoutons-le:
«Soldats,
» Lès événements qui se passent en Europe m’ont décidé à partir pour la France. Je remets le commandement de l’armée au général Kléber. L’armée aura bientôt de mes nouvelles: je n’en peux dire davantage, il m’en coûte de quitter des soldats auxquels je suis tant attaché ; mais ce ne sera que momentanément, et le général que je leur laisse a la confiance du gouvernement et la mienne.»
Il fait venir l’amiral Gantheaume et lui donne l’ordre d’aller en toute hâte à Alexandrie, d’y amener avec mystère, et avec toute la célérité possible, une des frégates vénitiennes qui s’y trouvent, et de l’avertir dès qu’elle sera prête.
La nuit venue, le général en chef se rend sur une plage non fréquentée, avec vingt-cinq ou trente guides; des canots le conduisent à la frégate. On appareille: une voile anglaise est signalée: Bonaparte croit lire une sorte d’hésitation sur les visages de ceux qui l’ont accompagné. Il est encore temps, leur dit-il; de retourner au rivage. Chacun de se récrier: Soit, reprend-il, restez: au surplus, vous n’avez rien à craindre, ma bonne étoile vous protégera, et nous arriverons en dépit des Anglais.
La traversée fut longue, très-difficile; souvent on prit l’alarme à la vue des voiles ennemies. Seul, Napoléon fut toujours calme: un coup de vent quand on approcha de l’Europe fit rabattre sur la Corse: on entra à Ajaccio. La Providence semblait vouloir faire respirer l’air natal à celui qui allait assurer les destinées du monde.
En remettant à la voile, on gouverna vers Marseille et Toulon. Enfin l’on aborda à Fréjus le 9 octobre 1799.
L’Autriche avait déchiré le traité de Campo-Formio: ses armées, celles de la Russie menaçaient les frontières: Masséna avait pu contenir Souvarow à la bataille de Zurich; les dangers de 93 se présentaient aux imaginations effrayées; la discorde agitait son brandon sur le sein de la patrie; la faiblesse, l’indécision du Directoire enhardissaient les plus mauvaises passions; la République expirait sous le poids des agitations, des intrigues fomentées par les partis extrêmes. «Il ne faut plus de parleurs, s’était écrié Siéyès, mais une tête, une épée pour sauver la France; mais cette tête, cette épée que tout le monde nommait, désirait, que l’on rencontrait dans Napoléon, de quel côté apporterait-elle son invincible et tutélaire appui? Les amis sincères du pays étaient dans l’anxiété, lorsque, le 9 novembre 1799 (18 brumaire), le Conseil des Anciens décrète la translation du Corps législatif à Saint-Cloud, et le place sous la garde du vainqueur de l’Égypte. Bonaparte, accompagné des généraux Berthier, Lefebvre, Macdonald, Murat, entre dans la salle des délibérations: «Citoyens représentants, dit-il, la République périssait, vous l’avez vu, et votre décret vient de la sauver. Malheur à ceux qui voudraient le trouble et le désordre, je les arrêterais, aidé du général Berthier, du général Lefebvre, et de tous mes compagnons d’armes; qu’on ne cherche pas dans le passé des exemples qui pourraient retarder votre marche; rien dans l’histoire ne ressemble à la fin du XVIIIe siècle: votre sagesse a rendu le décret, nos bras sauront l’exécuter. Nous voulons une République fondée sur la liberté civile, sur la représentation nationale; nous l’aurons, je le jure; je le jure en mon nom et celui de mes compagnons d’armes!» Il sort pour passer en revue les troupes placées sous son commandement: de nombreuses acclamations répondent à l’appel qu’il fait aux soldats de sauver la patrie.
Abandonné par ses deux collégues, Barras expédie son secrétaire au général, afin de se ménager son appui; celui-ci repousse les ouvertures du directeur par cette terrible sortie: «Qu’a fait le Directoire de cette France que je lui avais laissée brillante? Je lui avais laissé la paix, j’ai retrouvé la guerre; je lui avais laissé des victoires, et j’ai trouvé des lois spoliatrices, la misère. Qu’a-t-il fait de cent mille Français, tous mes compagnons de gloire? Ils sont morts!» Une heure après, Barras et son collègue Gohier envoyaient leur démission.
Le 10 novembre (19 brumaire) les deux Conseils, qui touchaient à leurs derniers moments politiques, prenaient possession chacun d’une salle au château de Saint-Cloud. L’espoir, la rage, le doute, animaient les deux Assemblées. Gaudin, au Conseil des Cinq-Cents, excite, dans un discours, les émotions d’usage: il psalmodie sur les dangers de la République. A l’instant où l’on prêtait serment à la Constitution de l’an III, Bonaparte, qui quittait le Conseil des Anciens, parait suivi de quelques grenadiers. A sa vue, les cris: Des soldats! des armes! à bas le tyran, à bas le dictateur, le Cromwell! retentissent dans la salle. Sortez, sortes! vocifèrent les uns. Hors la loi! hors la loi! exclament les autres.
Le Corse Aréna tire un poignard et s’élance sur le général. Les injures, les menaces redoublent; des grenadiers s’avancent la baïonnette en avant; les députés se sauvent par les couloirs, par les fenêtres, et Bonaparte, mis hors la loi, les met, selon l’expression de Siéyès, hors la salle.
Ainsi disparurent, comme au souffle du vent, ces fantômes de législateurs. Du moins la force n’était plus aux hordes de l’échafaud, aux noyades, aux égorgeurs, comme à l’époque de la Terreur; elle se nommait alors Arcole, Rivoli, les Pyramides et le Mont-Thabor . La République avait accompli son œuvre de destruction d’un bras infatigable; son œuvre du dehors avait été poursuivie avec une généreuse ardeur, un religieux enthousiasme; mais, à toutes les époques, elle n’avait pu établir l’œuvre gouvernementale.
Lucien Bonaparte qui, dans la séance des dangers de la patrie du 18 fructider, avait ramené ses collégues égarés par des opinions trop exaltées, se montra victorieux adversaire des ultra-jacobins: sa fermeté, sa présence d’esprit, son dévouement aux intérèts du pays triomphèrent des fureurs anarchiques.
Il est d’un grand intérêt historique de connaître les appréciations du général Bonaparte sur la journée du 18 brumaire; nous ne pouvons mieux faire que de les emprunter au confident, au dépositaire de ses pensées, à M. de Las-Cases:
«Pour mon compte, disait Napoléon, dans le complot d’exécution, ma part se borna à réunir à une heure fixe la foule de mes visiteurs, et à marcher à leur tète pour saisir la puissance. Ce fut du seuil de ma porte, du haut de mon perron, et sans qu’ils eussent été prévenus d’avance, que je les conduisis à cette conquête. Ce fut au milieu de leur brillant cortége, de leur vive allégresse, de leur ardeur unanime que je me présentai à la barre des Anciens, pour les remercier de la dictature dont ils m’investissaient.
» On a discuté métaphysiquement, et l’on discutera longtemps encore si nous ne violâmes pas les lois, si nons ne fûmes pas criminels; mais ce sont autant d’abstractions bonnes tout au plus pour les livres et les tribunes, et qui doivent disparaître devant l’impérieuse nécessité ; autant vaudrait accuser du dégât le marin qui coupe ses mâts pour ne pas sombrer. Aussi les auteurs, les grands acteurs de ce mémorable coup d’État, au lieu de dénégations et de justifications, doivent-ils, à l’exemple de ce Romain, se contenter de répondre avec fierté à leurs accusateurs: Nous protestons que nous avons sauvé notre pays; venez avec nous en rendre grâces aux Dieux. Et, certes, tous ceux qui, dans le temps, faisaient partie du tourbillon politique, ont eu d’autant moins de droit de se récrier avec justice, que tous convenaient qu’un changement était indispensable, que tous le voulaient, et que chacun cherchait à l’opérer de son côté. Je fis le mien à l’aide des modérés. La fin subite de l’anarchie, le retour immédiat de l’ordre, de l’union, de la force, de la gloire, furent ses résultats. Ceux des Jacobins ou ceux des Immoraux auraient-ils été supérieurs? Il est permis de croire que non. Toutefois il n’est pas moins très-naturel qu’ils en soient demeurés mécontents, et en aient jeté les hauts cris. Aussi, n’est-ce qu’à des temps plus éloignés, à des hommes plus désintéressés qu’il appartient de prononcer sainement sur cette grande affaire.»
Comme le pensait Bonaparte, l’histoire a prononcé, et, dans son impartialité, elle a approuvé le 18 brumaire.
Après cette journée, il ne se trouvait pas au Trésor de quoi expédier un courrier: telle était la situation des finances de l’État faite par le Directoire. Lorsque le consul voulut se procurer la force précise de l’armée, il fut obligé d’envoyer sur les lieux mêmes pour en faire le relevé.
«— Vous devez avoir des rôles au bureau de la guerre? disait-il à Dubois-Crancé.
» — A quoi nous serviraient-ils? répondait-on; il y a eu tant de munitions dont on n’a pu tenir compte
» — Mais, du moins, vous devez avoir l’état de la solde, qui nous mènera à notre but?
» — Nous ne la payons pas.
» — Mais les états de vivres?
» — Nous ne les nourrissons pas.
» — Mais ceux d’habillement?
» — Nous ne les habillons pas.»
L’esprit d’ordre, d’investigation administrative de Bonaparte mit un terme à ce chaos. La supériorité incontestable de Napoléon dans toutes les questions relatives aux finances, à l’armée, à la politique, aux lois, était telle qu’à la suite d’une conférence, Siéyès déconcerté, courut dire à ses intimes: Messieurs, vous avez un maître; cet homme sait tout, veut tout et peut tout.
La révolution de brumaire donna naissance à une trinité de consuls provisoires, Bonaparte, Siéyès, et Roger Ducos. La présidence revint de fait au plus capable; c’était l’avis de Ducos, qui se déclara pour toujours de l’avis du général Dès la première séance, Siéyès, très-enclin à satisfaire ses intérêts, alla mystérieusement regarder aux portes si quelque oreille indiscrète pouvait entendre. Il revint en adressant la parole à Napoléon, et montrant une commode: «Voyez-vous ce beau meuble , lui dit-il à demi-voix; vous ne vous doutez peut-être pas de sa valeur? Bonaparte crut d’abord qu’il lui faisait considérer un meuble de la couronne. Ce n’est pas cela, reprit Siéyès, souriant de la méprise: je vais vous mettre au fait; il renferme huit cent mille francs! A cette confidence ses yeux s’écarquillaient brillants de convoitise.
» Dans notre magistrature directoriale, continuait-il, nous avons réfléchi qu’un directeur, sortant de place, pouvait fort bien rentrer dans sa famille sans posséder un denier; ce qui n’était pas convenable. Nous avions donc imaginé cette petite caisse, de laquelle nous tirions une somme pour chaque membre sortant. Maintenant il n’y a plus de directeurs; nous voilà donc possesseurs du reste; qu’en ferons-nous?
Napoléon l’avait écouté avec attention: il le comprit et répliqua. «Si je le sais, la somme ira au Trésor public; mais si je l’ignore, et je ne le sais point encore, vous pouvez vous la partager, vous et Ducos, qui êtes tous deux anciens directeurs; seulement, dépêchez-vous, car demain il serait peut-être trop tard.» Ses deux collègues ne se le firent pas répéter. Siéyès s’adjugea la part du lion: il en prit une comme plus ancien directeur; une autre comme ayant dû rester en charge plus longtemps que son collègue; une troisième enfin, parce qu’il avait donné l’idée de cet heureux changement; bref, il se réserva six cent mille francs, disait l’empereur à Sainte-Hélène, et il n’envoya que deux cent mille francs au pauvre Ducos, qui, revenu des premières émotions, voulait absolument réviser ce compte et lui chercher querelle. Tous les deux en référaient à chaque instant, à ce sujet, à leur troisième collégue, pour qu’il les mît d’accord; mais celui-ci leur répondait toujours: «Arrangez-vous entre vous, soyez surtout silencieux, car si le bruit remontait jusqu’à moi, il vous faudrait abandonner le tout.» La somme en question, du reste, n’appartenait point à l’État: MM. Siéyès et Ducos y avaient droit.
Il fallait se fixer sur une constitution: Siéyès développa complaisamment aux commissions des deux Conseils l’œuvre qu’il avait conçue: il proposait un Grand-Électeur, comme représentant la dignité nationale, avec résidence à Versailles et six millions de traitement, investi du pouvoir de nommer deux consuls, l’un de la paix, l’autre de la guerre, complètement indépendants dans leurs attributions. Dans ce système, si ce grand-électeur venait à faire un choix malheureux, il devait être absorbé par le Sénat.
Napoléon avait pris peu de part à la discussion; mais, à cette combinaison qui faisait disparaître le grand-électeur, il se mit à rire au nez de Siéyès et renversa cet échafaudage d’utopiques institutions, qu’il qualifiait de niaiseries métaphysiques; Siéyès, soutenant son grand-électeur, essaya de prouver qu’après tout un roi n’était pas autre chose. «Vous prenez l’abus pour le principe, l’ombre pour le corps, répliqua Napoléon: comment avez-vous pu imaginer, monsieur Siéyès, qu’un homme de quelque talent et d’un peu d’honneur voulût se résigner au rôle d’un cochon à l’engrais de quelques millions?» Cette saillie noya la création de Siéyès: il n’y eut plus moyen pour lui de revenir à son fétiche politique. L’on se décida pour un premier consul à décision suprême, ayant la nomination à tous les emplois, assisté de deux consuls accessoires à voix délibératives seulement: c’était, en fait, l’unité du pouvoir. Le premier consul était un vrai président d’Amérique, gazé sous des formes que commandait l’esprit du temps, de sa nature fort ombrageux. De ce jour là, le règne de Napoléon commençait réellement.
Le premier consul choisit pour consuls accessoires Cambacérès et Lebrun, tous deux hommes de mérite et de nuance entièrement opposée dans son opinion; l’un était l’avocat des abus, des préjugés, des anciennes institutions, du retour des honneurs; l’autre, froid, sévère, insensible, tombait naturellement dans l’idéologie.
La Constitution de l’an VIII, qui remplaçait celle l’an III, violée au 18 fructidor, au 22 floréal, au 30 prairial, tantôt invoquée par toutes les factions, tantôt conspuée par elles, fut présentée au peuple. La proclamation du 24 frimaire se terminait par ces paroles remarquables: Citoyens, la révolution est fixée aux principes qui l’ont commencée; elle est finie.
Le ministère fut modifié, le Sénat, constitué à huis-clos, désigna les membres du Tribunat et du Corps législatif.
L’état des finances devait attirer l’attention de Bonaparte. Par la loi du 4 nivôse, relative au rachat de trois millions cinq cent mille francs de rente provenant des émigrés, cinquante millions rentrèrent dans les caisses de l’État: l’aliénation de diverses parties des biens nationaux, l’extension du système des cautionnements, l’ordre prescrit dans toutes les branches de l’administration financière, ramenèrent l’abondance. La banque de France fut fondée: source de prospérité et d’activité commerciales, elle donnait au pays les richesses du crédit. Les services publics furent réorganisés; les rouages de l’administration départementale, mis en mouvement par une puissante centralisation, convergèrent vers le foyer des intérêts nationaux.
Bonaparte plaça dans le conseil de préfecture une sorte de conseil d’état, et, dans le conseil général, une espèce de Corps législatif: le sous-préfet eut son conseil d’arrondissement, les maires des communes leurs conseils municipaux; partout l’action était dévolue à un seul, et la délibération réservée à plusieurs.
Chaque arrondissement eut son tribunal civil, son receveur particulier des finances; chaque département un tribunal criminel et un receveur-général; vingt-sept cours d’appel planèrent sur les juridictions du premier degré, et la cour de cassation, placée au-dessus de toutes, servit d’égide à la législation: une commission composée de Portalis, de Tronchet, de Bigot de Préameneu, de Malleville, prépara le Code civil des Français.
Enfin, les proscrits du 18 fructidor furent rappelés, les églises rétablies, les campagnes purgées des brigandages. Sous la main puissante de l’homme du destin s’apaisèrent les orages de la tourmente révolutionnaire. Après dix années d’attente, de déceptions, de stériles espérances, la France, heureuse d’oublier les tristes et sanglants souvenirs du passé, voyait, pleine de confiance en l’avenir, luire l’aurore de ses brillantes destinées.