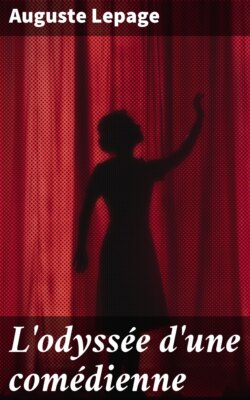Читать книгу L'odyssée d'une comédienne - Auguste 1835-1908 Lepage - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
A.D. 1715
ОглавлениеTable des matières
La ville que Van der Werft avait choisie si vite pour sa demeure, et que nous devons examiner d’un peu près, n’avait, dans ce temps et au premier coup d’œil, rien d’extraordinaire ni d’attrayant.
C’était une des moindres résidences de l’Allemagne, avec tout l’apparat dont un prince de ce temps avait besoin pour gouverner un pays aussi petit. L’endroit même se composait de la vieille ville, agglomération de rues et de ruelles tortueuses et sales, et de trois nouveaux faubourgs qui furent peu à peu bâtis par divers princes.
Le plus ancien, qui devait son origine au fondateur de la maison régnante, formait une seule rue large, ressemblant à un place entourée de maisons à pignons sculptés entièrement pareils, comme s’ils avaient été faits par la volonté d’un seul.
L’époque qui suivit la guerre de Trente ans avait fait ajouter à cette grande rue une rue pareille du côté droit, ce qui formait le deuxième faubourg. Au moment où se passe notre récit, le troisième faubourg existait déjà.
Pendant que les deux premiers offraient à la vue les pignons et les toits sculptés du XVIe siècle, ce troisième quartier était bâti selon le genre français, c’est-à-dire mansardé avec de grandes lignes droites; son style, tout moderne, différait entièrement des anciennes maisons style Renaissance; il était surtout commode pour les porteurs des perruques démesurées qui arrivaient de France, et dont le principal représentant à cette époque était Louis XIV.
Au milieu de ces diverses parties de la ville était situé, comme nous l’avons déjà dit, le château du landgrave, et la place du Marché avec son hôtel de ville, résidence modeste des chefs de la commune.
Le château et le marché formaient, réunis, ce que les premiers quartiers de la ville présentaient en détail. Le château surtout avait été agrandi à diverses époques, et ses dernières constructions appartenaient au siècle rococo de la perruque; ce même style n’avait pas été épargné sur différents autres bâtiments.
De même que le château formait le centre de la ville, de même le prince et sa cour y formaient le centre de la vie.
Le landgrave Ernest-Louis était, en l’an1715, dans la force de l’âge; il était veuf depuis onze ans, et sa famille, réunie autour de lui, se composait de deux fils; les princes Louis et Ernest; le premier avait vingt-cinq ans, le second vingt ans, et d’une jeune fille nommé Charlotte.
Le landgrave, comme tous les princes de cette époque, aimait le luxe et le plaisir et tout ce qui pouvait émouvoir; tout ce qui était intéressant et amusant trouvait écho à sa cour. Une nombreuse maison, avec toutes sortes de charges et d’emplois qu’on avait copiés sur ceux de la cour de France, s’agitait dans le château princier, où l’étiquette raide et cérémonieuse était observée en tout point, étalant ce luxe splendide que Louis XIV avait inventé, et dont il sut s’entourer pendant son règne, afin de donner à son trône une splendeur imposante.
Quoique au fond le prince ne fût pas trop amateur de toute cette représentation et de tout ce bruit, il devait les supporter et les respecter; car, en ce siècle, la dignité d’un prince régnant ne pouvait s’en passer: cela lui donnait, sur tout le monde, un air de supériorité auquel rien ne pouvait résister.
Le landgrave, au milieu de tous ces plaisirs, ne se livrait avec joie qu’à la chasse, satisfaction qu’il trouvait seule digne d’un prince.
Après la chasse venaient les opéras, les ballets et les comédies, dont les rèprésentations remplaçaient les anciennes cavalcades et les éblouissants carrousels, où les princes et les nobles figuraient autrefois et étaient les premiers acteurs. A l’époque de notre histoire, ils commençaient à abandonner la scène à des chanteurs, à des danseuses ou à des comédiens de profession.
En revanche, ils étaient assis dans de belles loges commodes, et jouissaient en repos du plaisir d’entendre réciter les poésies que les auteurs français de la cour avaient faites à la gloire du grand Louis XIV.
Si les plaisirs de la chasse et du théâtre plaisaient à Ernest-Louis, il aimait peu le troisième, qui est presque toujours le complément des deux autres– l’amour.–Quoique veuf, il n’avait à sa cour aucune maîtresse officielle, aucun bâtard à légitimer.
Pourtant si, sur ce point, le prince était réservé, il se trouvait à sa cour plus d’un seigneur qui faisait en petit ce que le landgrave aurait pu faire en grand, et ce dont Louis XIV avait usé si largement en France.
Les liaisons secrètes étaient considérées comme de bon ton à la cour de Darmstadt, qui voulait prendre en tout modèle sur Versailles.
Ce genre de vie, qui, d’après les mœurs d’alors, n’avait rien de surprenant, trouvait des imitateurs dans la ville, cela se comprend; et ce que nobles et seigneurs faisaient ouvertement, en fait d’intrigues et d’aventures galantes, se répétait sous forme plus modeste chez les bourgeois de la ville qui avaient leurs entrées à la cour. C’est ainsi que disparurent peu à peu les austères et graves manières de la noblesse, pour faire place à la folie et à la dissipation. Pourtant, il y avait à la cour et dans la bourgeoisie de brillantes exceptions, et la ville pouvait désigner beaucoup de maisons dans lesquelles se trouvaient, selon l’ancien usage, une piété véritable et une heureuse vie de famille.
Le prince s’était voué corps et âme à la chasse à courre et aux représentations théâtrales; il les avait introduites et encouragées dans sa résidence par tous les moyens possibles. Il entretenait une nombreuse meute; pour une telle chasse, il fallait chevaux, piqueurs, chasseurs, coureurs, et de nombreux domestiques.
Il existait peu de contrées plus favorables pour ces chasses que la résidence du prince, car celle-ci, entourée de larges routes, environnée de forêts superbes entourées par des palissades, formait un grand parc.
Cet entourage était si proche de la ville d’un côté que, dans la nuit, les bourgeois étaient souvent dérangés et incommodés par les cris des bêtes fauves.
Il y avait dans les forêts plusieurs rendez-vous de chasse et des bâtiments ne servant que dans ces occasions, où chevaux, chiens, piqueurs et chasseurs trouvaient un abri. L’on nomma même un des ponts conduisant au château «le pont à courre,» nom qu’il porte encore aujourd’hui, quoique les chasses n’existent plus. Le prince et ses coureurs seuls avaient le droit de franchir ce pont, ou les chasseurs quand ils partaient pour la chasse en sonnant une fanfare.
Dans un ancien grand manège, situé dans une des ailes du château, le landgrave avait fait installer un théâtre tout à fait dans le goût du jour.
Il y avait une scène avec toutes sortes de machines, trappes et dessous, d’après les plaps de Londeac, l’inventeur de ce genre d’opéras français.
Dans les magasins se trouvaient un grand nombre de décors de fantaisie des meilleurs peintres de la cour, des jardins avec des bosquets, des statues dorées et des pièces d’eau superbes. Cette salle, qui était ornée de toutes sortes de sculptures dorées, avait la prétention d’être antique, mais, en réalité, était tout à fait du style Louis XIV. Il y avait de riches costumes pour les comédiens et les chanteurs.
Les places, outre le parterre, se composaient de trois galeries, entourées de loges, qui, quoique commodes et coquettes, étaient pourtant trop petites pour les costumes volumineux à la mode. Le tout était peint de couleurs sombres, rehaussé de dorures et ressemblant au théâtre royal de Versailles.
Il y avait environ quatre ans qu’Ernest-Louis avait fait construire cette salle. Au commencement on n’y faisait représenter que des opéras allemands, avec des chanteurs allemands, comme à Hombourg. Mais ces plaisirs ne suffirent pas longtemps au landgrave, et l’on fit venir de Paris toute une troupe de comédiens français, chanteurs, danseurs, corps de ballet et maître de chapelle, qui devait représenter à Darmstadtce que l’on jouait à Paris, précédé des mêmes prologues. Tout ce qui avait été composé à Paris pour Louis le Grand changeait de nom et, de situation, et s’adressait au prince régnant, et, à Darmstadt comme en France, un parterre de courtisans applaudissait au mérite du souverain.
Van der Werft s’était lancé malgré lui dans cette société mêlée. Il devait savoir ce qui l’attendait dans sa nouvelle demeure, car il connaissait le monde et les hommes par ses fréquents voyages, ainsi que les habitudes de diverses cours. Quoiqu’il portât un nom bourgeois, la cour et les cercles des nobles ne devaient pas lui être étrangers, à la manière dont il se présenta au landgrave et aux favoris.
Le prince parut enchanté des manières distinguées du riche étranger, qui, après avoir beaucoup voyagé, avait choisi sa résidence pour y faire un long séjour, et il fit tout son possible pour le lui rendre agréable.
Une loge lui fut donnée pour lui et sa fille par l’intendant des menus plaisirs du prince. En même temps, il reçut du grand veneur, par ordre du souverain, une invitation à toutes les chasses, et le grand maréchal du palais lui annonça qu’on lui accordait, ainsi qu’à s-a fille, l’honneur d’être admis aux petites réunions de la cour.
Van der Wcrft avait tranquillement tout accepté, à la grande joie de sa fille qui se promettait de profiter de toutes les occasions qui lui étaient offertes; il avait promis d’amener sa fille à la, cour au milieu des trabansétincelants qui entouraient le landgrave comme un soleil. Blanche fut heureuse de prendre part à ces plaisirs, auxquels son père avait résisté jusqu’alors; aussi fut-il récompensé de sa condescendance par de bien tendres baisers.
Van der Werft s’était transformé entièrement aux yeux de sa fille.
Blanche, dès son enfance, avait appris à connaître son père comme un homme sévère et soucieux, que le monde n’aimait pas et qu’il n’aimait pas davantage, et qui ne paraissait avoir un cœur que pour son enfant.
Elle n’avait jamais connu sa mère; celle-ci était morte en lui donnant le jour. Depuis sa plus grande jeunesse, elle avait vécu seule avec son père, qui l’aimait par-dessus tout et ne s’occupait que d’elle. L’Angleterre avait été le pays où elle avait passé ses premières années.
Ensuite, elle avait parcouru avec son père, pendant plusieurs années, l’Italie, l’Allemagne et l’Autriche; mais, chose étonnante, elle n’avait jamais visité la France, dont elle parlait la langue, ni la Hollande, ni la Flandre.
C’est dans la basse Autriche qu’ils avaient résidé le plus longtemps; là, ils avaient appris l’allemand.
Pendant ces dernières années, l’inquiétude et le caractère sombre de Van der Werft avaient augmenté, et ni ses fréquents voyages, ni le changement d’habitudes n’étaient pas parvenus à le distraire.
Ensuite, ils étaient allés en Suisse et avaient descendu lentement le Rhin. Souvent Van der Werft avait laissé échapper des paroles bizarres, comme s’il eût désiré franchir ce grand fleuve et entrer en France, mais il n’avait jamais essayé de réaliser ce projet.
Pendant tout leur voyage sur les bords du Rhin, il sembla à la jeune fille qu’il se passait en son père une lutte intérieure, car souvent il avait regardé, tout triste et préoccupé, les montagnes bleues des Vosges qui se dessinaient à l’horizon, et était retombé dans une sombre rêverie; en ces moments, il lui paraissait plus malheureux que jamais.
Evitant les villes et les hommes, il ne choisissait comme séjour que des endroits insignifiants. La jeune fille était de plus en plus attentive et empressée pour son père, mais en même temps plus triste; car elle sentait que des chagrins secrets le torturaient, et qu’elle ne pouvait ni le secourir, ni le consoler, puisqu’elle ne pouvait deviner ce qui le rendait malheureux.
A Darmstadt, un changement soudain s’était opéré en son père; il visita toute la ville, ce qu’il n’avait fait nulle part, dans les endroits où ils s’étaient arrêtés. Son air sombre et son aversion pour le monde semblaient avoir subitement disparu. Il se préparait à entrer dans la vie amusante et brillante de la cour, la tête haute et l’œil fier.
Qui avait pu amener ce revirement soudain? C’est ce que se demandait souvent Blanche, et sa tête travailla longtemps pour le deviner.
Etait-ce la rencontre du trompette, qui lui plaisait de plus en plus, ou Balzer avait-il raison, en désignant la comédienne française, qu’il avait appelée Valoy, comme sorcière? ou celle-ci, lors de sa courte apparition, avait-elle produit sur son père une impression surnaturelle?
Si cette dernière conjecture était la vraie, songeait la jeune fille, la belle dame aux yeux noirs et aux longs cheveux, qui parlait sa langue maternelle, ne pouvait être une sorcière, car ce qu’elle avait fait jusqu’alors n’avait produit qu’un bon résultat.
Quoi qu’il en fût, Blanche résolut de la connaître.