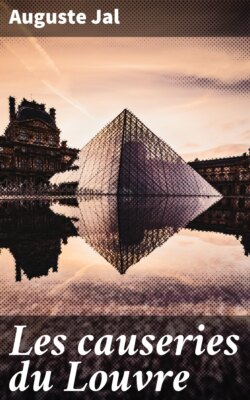Читать книгу Les causeries du Louvre - Auguste Jal - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеTable des matières
Deux Bourgeois. — Un Passant. — Sapho et Phaon. — M. Delorme. — Michu. — M. Dubufe. — Don Juan. — Les types. — Les tics. — Françoise de Rimini. — Les Pécheurs charnels. — Les Poètes. — M. A. Colin. — M. Monsiau. — Le chagrin monte en croupe et galope avec lui. — M. Poterlet. — Le Malade imaginaire. — Baptiste cadet. — La Canonnière. — Madame Marie M. — M. Gigoux. — M. Gilbert. — César Bourraine.
Une grosse bourgeoise. — A la bonne heure! voilà que je m’y retrouve! me revoilà au bon temps! deux amoureux qui causent! La femme sourit tendrement; le jeune homme sourit galamment. C’est joliment joli! Dis donc, M. Gaillard, devines-tu l’anecdote qu’ils ont tirée en tableau?
M. Gaillard. — Je regarde, ma choute, et je cherche. Ce qui me frappe, c’est que ces deux particuliers soient là à causer de leurs affaires, nus comme la main. Il faut en tout cas que la chambre soit fièrement chauffée pour qu’ils n’attrapent pas un gros rhume, et je n’y vois ni poêle ni cheminée! s’ils étaient susceptibles pour les catarrhes, comme moi, du diable s’ils resteraient aussi légèrement habillés!
Madame Gaillard. — Sauf le respect que je vous dois; comme à mon époux légitime, devant le curé de Saint-Méry, vous dites-là des choses incroyables, M. Gaillard. Vous voyez bien que c’est dans les pays chauds qu’ils sont, ces deux particuliers-là !
M. Gaillard. — Oh! pas si chauds que vous voulez bien dire; je suis sûr qu’ils ont froid; je vois ça à la couleur de leur peau; ils sont tout violets. Des caleçons et des camisoles de flanelle leur iraient très-bien.
Madame Gaillard. — Oui, l’amour en flanelle, c’est aimable! et pourquoi pas en bonnet de coton?
M. Gaillard. — Vous allez recommencer encore avec vos bonnets de coton! vous les avez terriblement sur le cœur!
Madame Gaillard. — J’aime mieux les avoir là que de vous les voir sur la tête. Vous n’êtes déjà pas trop beau en chinoise de madras de Saint-Quentin!
M. Gaillard. — Allons, c’est bon! je ne viens pas au Louvre pour être agoni de vos méchancetés; nous serons assez tôt de retour à notre rue Planche-Mibray.
Madame Gaillard. — Mais aussi pourquoi dites-vous des bêtises! croyez-vous que le peintre soit un imbécille? Les peintres, c’est des hommes d’éducation qui ne feraient pas une chose pour l’autre; ils savent leur état, p’t-être bien. Si celui-ci a fait les deux jeunes gens tout nus, c’est que c’est la mode du pays..... Mais, comment s’appellent-ils? ça m’intrigue. Je vas demander, tant pire. (A un passant.) Pardon, monsieur, si je vous importune; mais mon mari, M. Gaillard, qui a bien l’honneur de vous saluer... M. Gaillard, monsieur a la bonté de relever son chapeau.... (Elle fait la révérence. ) M. Gaillard, mon époux, n’a pas voulu acheter le livre d’affiches des tableaux, parce qu’il dit que c’est inutile, et qu’on sait toujours assez deviner les sujets. Eh bien! en voilà un de sujet que je ne devine pas du tout. Voudriez-vous me faire l’amitié de me dire ce que c’est que le numéro 654.
Le Passant. — Volontiers, madame. C’est Sapho, récitant à Phaon une ode qu’elle vient de composer. Le tableau est de M. Delorme.
Madame Gaillard. — Ma foi, comme dit le proverbe: il est bon là, M. Delorme. Ceci est très-beau, dans mon idée. N’est-ce pas que c’est très-beau, monsieur?
Le Passant. — Je n’ai pas le droit de contredire votre goût: vous avez peut-être raison; mais j’aime peu ce genre de peinture.
Madame Gaillard. — Moi, j’adore ce genre-là. Que voulez-vous! on se rappelle sa jeunesse, et ça fait battre le cœur. Mais, excusez encore, cette demoiselle, dont je ne sais pas le nom, n’a pas l’air de réciter quoi que soit; vous vous êtes peut-être trompé de numéro.
Le Passant. — Je ne me suis pas trompé, madame, je vous assure.
M. Gaillard. — Monsieur ne peut pas s’être trompé ; il sait lire, certainement! pour une femme bien éduquée, et qui a dû prendre l’habitude d’être polie dans une boutique bien achalandée, vous faites là une grossièreté qui me confusionne!
Le Passant. — Il n’y a pas de mal, monsieur. Je vais vous redire les noms des personnages, madame. La femme s’appelle Sapho, son amant a nom Phaon.
Madame Gaillard. — Anon Phaon!
Le Passant. — Je me suis mal expliqué ; son nom est Phaon.
Madame Gaillard. — Aussi, je disais qu’il avait là un singulier nom de baptême, Anon! Et de quel pays étaient-ils? jamais je n’avais entendu parler de Phaon et de Sapho.
Le Passant. — Ils étaient Grecs.
Madame Gaillard. — Ah! oui, c’était des dieux de la fable!
Le Passant. — Pas tout-à-fait. Phaon était un capitaine de navire de Mytilène, fort bel homme, et qui se faisait aimer de toutes les femmes.
M. Gaillard. — Diable! il était bien heureux!
Madame Gaillard. — Voulez-vous bien vous taire, M. Gaillard! Monsieur n’a pas besoin de savoir que vous n’auriez pas mieux demandé que d’être un dérangé et un coureur, comme ce marin de Sainte-Hélène, si vous aviez eu le physique comme lui et des couronnes de fleurs.
Le Passant. — Si Phaon était aimé de toutes les femmes, il ne les aimait pas toutes, témoin la célèbre Sapho, poétesse de Lesbos, qui, fort éprise de lui, n’éprouva que ses froideurs.
Madame Gaillard. — Voilà un grand impertinent! Si ce qui est arrivé à cette Sapho m’était arrivé, j’aurais tiré les yeux à ce fat.
Le Passant. — Sapho prit un parti bien différent.
Madame Gaillard. — Elle se périt peut-être!
Le Passant. — Justement; elle se précipita dans la mer, du haut de la montagne de Leucade; cet endroit a pris de là le nom de Saut de Leucade.
M. Gaillard. — Elle fit là une fameuse sottise avec son saut!
Madame Gaillard (riant). — Un calembour! J’étais bien étonnée qu’il n’en eût pas encore lâché quelques-uns. Il est très-gentil dans le calembour; c’est un petit agrément de société qui le fait beaucoup rechercher de tout notre quartier... Vous avez dit, monsieur, que Sapho récite à Phaon?...
Le Passant. — Une ode; c’est-à-dire une pièce de vers en strophes ou couplets.
Madame Gaillard. — Quelque chose en manière de chanson, comme Babet, dans Blaise et Babet, chante: C’est pour toi que je les arrange, cher Blaise! Oh! je connais l’Opéra-Comique; nous y allions tous les dimanches autrefois, du temps de M. Michu, à qui nous fournissions des gants, de la poudre et des rubans de queue, et qui nous donnait des billets de la comédie. Ce n’était pas pour nous faire prendre patience, car il payait bien. Un fort bel homme, M. Michu! Vous ne l’avez pas connu, vous, monsieur, vous êtes trop jeune. Ma foi, il était aussi bien au moins que Phaon, et je trouve qu’il lui ressemblait un peu. N’est-ce pas, M. Gaillard, que si ce Phaon avait une perruque poudrée, une petite veste de satin blanc, liserée de rose, une culotte de même, et des bas de soie à coins, il te rappellerait M. Michu?
M. Gaillard. — P’t-être bien.
Madame Gaillard. — Ne dites donc pas ça d’un air boudeur; monsieur pourrait croire que vous êtes jaloux, et que j’étais la Sapho de M. Michu... Je suis bien fâchée de vous avoir dérangé de votre promenade, et je vous remercie bien de votre complaisance.
Le Passant. — Tout à votre sérvice, madame; on est heureux de pouvoir être agréable à des personnes...
M. Gaillard. — Vous êtes bien honnête, monsieur, et vous nous flattez. Mais nous craindrions d’abuser...
Le Passant. — Point du tout, cela me fait plaisir.
Madame Gaillard (à son mari). — Ce monsieur est fort poli; vous voyez, il dit que ma conversation lui fait plaisir! ( Haut à son Cicérone. ) Si ça ne vous fâche pas, alors, ce n’est pas de refus; et je prendrai la liberté de vous demander ce que c’est que ce grand tableau là haut. A charge de revanche toujours, si vous avez beson d’une adresse rue Planche-Mibray, nous y connaissons tout le monde.
Le Cicérone. — Madame, le tableau que vous me désignez est de M. Dubufe.
M. Gaillard. — Un grand peintre, n’est-ce pas, monsieur?
Le Cicérone. — Il obtient beaucoup de succès.
M. Gaillard. — C’est lui qui a fait ces femmes au lit, avec de fort belles gorges qui sautaient aux yeux des amateurs.
Madame Gaillard. — De la pudeur, M. Gaillard, pour l’amour de Dieu, de la pudeur!
Le Cicérone. — M. Dubufe a trouvé la route d’une certaine renommée qu’il n’aurait probablement pas rencontrée sans cela. Il a choisi des sujets...
Madame Gaillard. — Un peu lestes quelquefois.
Le Cicérone. — Mais, madame, guère plus, il me semble, que celui de Sapho et Phaon.
M. Gaillard. — Je voudrais bien savoir, monsieur, quel est le plus fameux artiste de M. Dubufe ou de M. Delorme, pour voir seulement qui a plus de goût de mon épouse ou de moi.
Le Cicérone. — La question est embarrassante, monsieur. Je crois ces deux messieurs à peu près de même force, et je suis persuadé que M. Dubufe ne voudrait pas être M. Delorme, et que M. Delorme serait très-fâché d’être M. Dubufe. Si le mérite se mesure à la popularité, je crois que M. Dubufe est un plus grand homme que M. Delorme; si c’est à l’estime de. l’Académie, je crois que M. Delorme l’emporte sur M. Dubufe.
M. Gaillard (bas à l’oreille au Cicérone): — Je suis, moi, pour Dubufe. J’ai dans un double fond de ma tabatière, que ne connaît pas mon épouse, une petite lithographie des Regrets.
Madame Gaillard (de même). — Moi, j’aime mieux M. Delorme, et je donnerais quelque chose de bon cœur pour qu’il dessinât sur ma bonbonnière d’écaille la tête de son Phaon, qui ressemble à mon pauvre Michu!
Le Cicérone. — C’est Don Juan chez Haïdée que M. Dubufe a représenté dans ce grand tableau.
M. Gaillard. — Don Juan! il est drôlement habillé. J’ai vu jouer le Festin de Pierre à la Comédie-Française, avant la révolution: Molé avait l’habit français tout pailleté, la perruque à bourse, l’épée, et non pas ce grand coquin de sabre rond qui a l’air d’une faucille; il ne portait pas de moustaches. Et puis Sganarelle n’était pas à la turque. Quant à la femme, elle avait des demi-paniers, ce qui allait très-bien à mademoiselle Contat.
Le Cicérone. — C’est que ceci n’est pas le Don Juan de Molière, mais celui de lord Byron, le poète.
M. Gaillard. — Connais pas.
Madame Gaillard. — Alors, taisez-vous, et laissez monsieur nous expliquer la chose.
Le Cicérone. — Don Juan avait fait naufrage dans une petite île grecque.
Madame Gaillard. — Oui, c’était un capitaine de vaisseau grec, comme Phaon.
Le Cicérone. — Pas tout-à-fait, mais il n’importe. Dans cette île habitait un vieux pirate nommé Lambro. Ce Lambro avait une fille, Haïdée.
M. Gaillard. — Jeune personne fort jolie, à en croire son portrait. Tiens; mais elle ressemble beaucoup à Don Juan.
Madame Gaillard. — Eh bien! qu’y a-t-il d’étonnant? est-ce la première fois qu’on a vu des gens qui n’étaient pas parens se ressembler.
Le Cicérone. — Il est vrai qu’ils se ressemblent dans le tableau de M. Dubufe, et je vous demande la permission de vous dire pourquoi. Il est des peintres, et même parmi les plus célèbres, qui ont adopté une certaine forme de corps, de mains, de pieds et de têtes; ce qu’on appelle un type. Ils le répètent partout, sans trop s’inquiéter si la nature n’est pas variée, quand ils restent toujours les mêmes.
Madame Gaillard. — Pardon, monsieur, vous avez dit un type; c’est un tic que vous vouliez dire, n’est-ce pas?
Le Cicérone. — Votre mot vaudrait mieux que le mien, et je l’adopterais volontiers. Tic ou type, M. Dubufe a le sien: il affectionne une certaine tête qu’il reproduit partout; vous la retrouverez dans tout ce qu’il a exposé cette année, comme vous auriez pu la remarquer les années précédentes. Cette tête est plus forte que lui, elle l’obsède, le tourmente; il faut qu’elle sorte de son pinceau absolument, inévitablement. Il veut faire une femme, voilà la tête qui lui échappe; un homme, encore la tête; un enfant, la tête; un vieillard, la tête! Et cette tête de convention ressemble à un masque verni; il n’y a pas apparence de nature. Voyez ici Haïdée, c’est la femme entretenue que vous avez vue sur un lit, pleine de regrets ou de souvenirs; c’est la fille Alsacienne que vous avez vue pleurant sa virginité perdue; c’est la jeune fille de 1814, que je vous montrerai dans la galerie, sous le n° 731, pleurant je ne sais pas quoi sur une botte de paille; c’est cette dame qui pleurait au Salon de 1831 une mésange morte; ce sont les deux femmes (735) qui se montrent l’une à l’autre un portrait; c’est la jeune fille (736) lisant une lettre; ce sont enfin tous les portraits de M. Dubufe; car M. Dubufe a l’art de forcer toutes les natures à entrer dans son moule. Don Juan n’est autre qu’Haïdée avec des moustaches et des favoris. Je crois bien que M. Dubufe n’aura pas voulu cette fraternité ; mais le tic l’a emporté.
M. Gaillard. — C’est égal, le tableau est superbe: ce Turc me fait presque peur. Est-ce qu’il va tuer don Juan?
Le Cicérone. — Ne craignez rien.
Madame Gaillard. — Il est si drôle, monsieur Gaillard, que je ne peux pas seulement le mener au mélodrame, et qu’il est tout effrayé quand il voit des scènes de tragédie au salon de cire de Curtius.
Le Cicérone. — Oh! alors, monsieur Gail lard n’est pas en sûreté devant ce tableau! Je vous engage à l’emmener. Voulez-vous que nous passions dans la galerie?
Madame Gaillard. — Sainte Vierge! qu’est-ce que je vois là-haut? que font donc tous ces hommes et ces femmes dansant en l’air?
Le Cicérone. — Ce sont les pécheurs charnels de l’enfer du Dante.
Madame Gaillard. — Par exemple, j’ai du malheur! Je ne connais pas un seul de leurs sujets, à tous les peintres de cette année. Qu’est-ce que ça l’enfer du Dante? et les pécheurs..... Comment avez-vous dit, monsieur, s’il vous plaît?
Le Cicérone. — Les pécheurs charnels.
Une vieille demoiselle. — Eh parbleu! charnel, cela vient de chair. Les pécheurs charnels sont ceux qui vont en enfer pour avoir mangé de la viande pendant le carême, sans dispense de l’évêque.
Le Cicérone (à l’oreille de madame Gaillard). — Ce n’est pas absolument cela: les pécheurs charnels sont, à proprement dire, les amoureux, les femmes qui ont aimé....
Madame Gaillard. — Phaon?
Le Cicérone. — Ou Michu! (Haut): Dante est un ancien poète italien.
Madame Gaillard. — Il n’y a donc que des poètes ici? Cette femme qui faisait des chansons en Grèce, le milord anglais de don Juan et l’Italien des péchés charnels!
M. Gaillard. — Et quel est cet homme étendu par terre?
Le Cicérone. — C’est Dante qui s’évanouit au récit que Françoise de Rimini vient de lui faire de ses amours.
M. Gaillard. — Je trouve ce tableau-là encore plus terrible que l’autre! c’est effrayant de voir tous ces damnés! Vous pouvez regarder ça, monsieur, sans fermer les yeux et sans avoir la chair de poule?
Le Cicérone. — Assurément je le regarde sans crainte, et même avec assez de plaisir, parce qu’il y a dans cet ouvrage de M. Colin de fort bonnes parties, des groupes bien composés et d’une exécution très-estimable, surtout dans les spirales hautes des damnés.
Madame Gaillard. — C’est trop noir. Je préfère toujours M. Delorme.
M. Gaillard. — Et moi, M. Dubufe.
Le Cicérone. — Je tiens, moi, pour M. Colin.
Madame Gaillard. — Ce qui prouve bien que la chanson dit vrai, dans le Calife de Bagdad: Chacun a son goût, sa folie.
Le Cicérone. — Voulez-vous me suivre, madame? vous m’arrêterez aux tableaux que vous voudrez examiner à loisir.
Les trois interlocuteurs entrés dans la galerie, la parcourent rapidement.
Madame Gaillard. — Monsieur, monsieur! je vous dérange encore, c’est bien mal à moi; mais faites-moi l’amitié de m’expliquer ceci.
M. Gaillard. — Parbleu! c’est bien aisé ; on n’a pas besoin du livret pour cela, ma choute. Que voit-on sur ce tableau? un cheval qui galoppe; sur ce cheval il y a deux hommes qui courent comme les quatre fils Aimon: celui qui est devant porte la main droite à son front en faisant la grimace; il est bien clair qu’il s’est fait mal à quelque chose en passant..... Tiens, pardieu! à ce petit tronc d’arbre.
Madame Gaillard. — Cet arbre l’aurait blessé au genou, et non pas au front; le simple bon sens dit cela; n’est-ce pas, monsieur?
Le Cicérone. — Je vous ai laissé dire, en cherchant moi-même à deviner le sujet de ce tableau. Il me semble que M. Gaillard a très-bien trouvé.
M. Gaillard (avec un sourire vaniteux). — Ah! vous l’entendez, mon épouse, je ne l’ai pas fait dire à monsieur; j’ai trouvé. Tu vois bien qu’on n’a pas besoin du petit livre.
Le Cicérone. — Toutefois, M. Gaillard, voyons. Nous sommes peut-être dupes de nos yeux et de notre bon sens. Cherchons: n° 1743; MONSIAU, au palais de l’Institut.
Le chagrin monte en croupe et galope avec lui.
Boileau, épître V.
Madame Gaillard. — Eh bien! après? qu’est-ce que ça veut dire?
Le Cicérone. — Cela veut dire que cet homme, le plus grand des deux, s’ennuyant dans sa maison, a monté à cheval pour se distraire, et que le chagrin le suit dans cette promenade; le petit être barbu monté en croupe, représente le chagrin; la main au front, que monsieur Gaillard interprétait tout-à-l’heure à l’aide du tronc d’arbre, c’est le complément de l’idée représentée par le personnage fantastique.
Madame Gaillard. — Tout ça n’est pas clair, monsieur.
Le Cicérone. — C’est ce qui arrive trop souvent dans la matérialisation des pensées; la peinture n’aime pas les choses métaphysiques.
Madame Gaillard. — Ni moi, monsieur, parole d’honneur; car, malgré la peine que vous prenez à m’expliquer la fantastique, la métaphysique, la matérialaison des pensées, que sais-je! je n’y comprends rien.
M. Gaillard. — Vous dites que le sujet est de M. Boileau? En tout cas, si M. Boileau faisait ses actes aussi peu clairs que ses sujets de tableau, ça devait donner du tintoin aux tribunaux. Je ne suis pas fâché de ne pas l’avoir eu pour notaire.
Le Cicérone. — Prenez garde à la confusion: le Boileau dont il s’agit n’est pas l’honorable ancien notaire de Paris, mais le poète satirique du temps de Louis XIV.
Madame Gaillard. — Ah! encore un poète! ils me feront devenir folle, ces gens-là, avec leurs idées saugrenues.... Et, à propos d’idées saugrenues, dites-moi pourquoi le Chagrin a une grande barbe blanche?
M. Gaillard. — Parbleu, pourquoi? parce que quand on a du chagrin, on ne pense pas à faire sa barbe.
Le Cicérone. — Parfaitement juste.
Madame Gaillard. — Passons à ce mort qui parle.
Le Cicérone — C’est le Malade imaginaire, représenté par M. Poterlet.
M. Gaillard. — Diable! imaginaire! quand j’aurai cette mine-là, je commencerai à me croire sérieusement malade, et à envoyer chercher un confesseur. Il est affreux, ce vieillard!
Le Cicérone. — Et croiriez-vous que les autres sont plus beaux? C’est une collection de fantômes grotesques, sous forme demi-humaine.
Madame Gaillard. — Suis-je heureuse de n’être pas enceinte! un regard d’un de ces êtres-là m’aurait fait faire des singes.
Le Cicérone. — Traduire ainsi Molière! Molière qui créa des personnages si complets, si parfaits! Molière qui est si vrai, si naturel! être rendu par des formes si menteuses et par de si fausses apparences de couleur!
M. Gaillard. — Vous trouvez donc cette peinture bien mauvaise?
Le Cicérone. — Pitoyable! Et voilà où conduit la manie de l’imitation d’un maître! Peut-être que si M. Poterlet avait appris un peu à dessiner, et que si M. Boulanger n’avait pas fait du laid par système, nous aurions de M. Poterlet quelque chose d’estimable. Mais on se jette dans un des partis qui séparent l’école; on brouille sur une palette des tons brillans ou vigoureux qu’on va arracher par teintes à Rembrandt, à Rubens, à Lawrence ou à d’autres; on applique cela sur des dessins que les enfans, barbouilleurs naïfs des murs de la ville, ne voudraient pas avouer; et l’on se croit peintre! Cela fait mal!
Madame Gaillard. — Mon Dieu! monsieur, je suis bien fâchée d’être cause que vous vous mettez en colère; si je ne vous avais pas arrêté ici, vous n’auriez pas eu cet accès, qui peut troubler votre déjeuner; avec ça qu’il fait très-chaud ici!
Le Cicérone. — Défigurer Molière! mais, madame, c’est un crime, entendez-vous bien!
M. Gaillard. — Monsieur a bien raison; c’est si amusant le Malade imaginaire! et celui de M. Poterlet est si triste! J’aime mieux Baptiste cadet.
Le Cicérone. — Vous n’êtes pas dégoûté ! Baptiste cadet! c’est lui qui comprenait et rendait Molière!
M. Gaillard. — Oh! oui; il était joliment farce quand il sortait de son fauteuil pour aller, vous savez bien où !
Le Cicérone. — C’était un excellent acteur que Baptiste; il vit encore, et M. Poterlet aurait bien fait de l’aller consulter, et de lui demander la permission de copier sa tête longue, expressive, si heureusement comique et si touchante dans la scène où ressuscite M. Argan, scène dont ce que nous voyons ne donne aucune idée.
Madame Gaillard. — Ah ça! monsieur, sans façon, vous êtes peut-être fatigué de lire dans votre livret pour satisfaire mes indiscrétions; mon mari va vous relever un peu. Allons, monsieur Gaillard, mets tes lunettes, et dis-moi qui est cette dame là-haut, en robe jaune.
M. Gaillard. Mande excuse, monsieur; prêtez-moi le catalogue aux adresses. Voyons, quel numéro.... Diable! ils sont bien petits leurs numéros.... mille, mille six cent....
Madame Gaillard. — 1065, c’est clair; je vois cela très-bien. N’est-ce pas, monsieur, que c’est 1065?
Le Cicérone. — Oui, madame.
M. Gaillard. — M’y voici, m’y voici: «1065.
» Combat de la frégate française la Canonnière
» contre le vaisseau anglais le Trémendous.»
Madame Gaillard. — Que dites-vous là, monsieur Gaillard? lisez donc bien.
M. Gaillard. — Je lis bien; si vous aviez vos lunettes, je vous ferais voir qu’il y a là, page 77, article 1065.... Mais monsieur peut vérifier.
Madame Gaillard. — Un combat, une frégate, une canonnière! Je vois bien dans le fond une fumée noire et épaisse; je reconnais bien que le visage de cette dame peut être noirci par la poudre à canon en quelques endroits; mais la frégate, où est-elle? Après ça, comme nous ne savons pas ce que c’est qu’une frégate.... c’est peut-être le nom d’une femme dans des pays étrangers; cette femme sert peut-être dans l’artillerie, comme on en a vu en France, pendant la première révolution, à Lyon et ailleurs.
M. Gaillard. — Très-bien; mais ce n’est pas là une tenue de combat. Ce n’est pas l’embarras, les peintres ont de si drôles d’idées! Comprenez-vous ce tableau, monsieur?
Le Cicérone. — C’est tout simplement un portrait d’une charmante femme, fille d’un de nos plus parfaits écrivains.
Madame Gaillard. — Est-ce qu’elle est canonnière? et quel est ce nom de frégate qu’on lui donne dans le livret?
Le Cicérone. — Vous êtes certainement sous l’empire d’une faute d’impression. Permettez que je voie.... Justement: «1065, combat de la frégate la Canonnière.» Mais, 1063, au-dessus: portrait de madame...... On a mis à l’ouvrage de M. Gigoux l’étiquette du tableau de M. Gilbert. M. Gilbert est un peintre de marine; une frégate est une espèce de vaisseau de guerre: celle dont il a peint le combat s’appelait la Canonnière; elle était commandée par César Bouraine, brave officier de l’empire; elle se mesura contre le vaisseau le Trémendoux; beaucoup plus fort qu’elle, et le força de prendre le parti de la fuite. Venez de ce côté, et vous allez voir la représentation de cette affaire honorable pour la marine impériale. A deux pas d’ici.... là.
Madame Gaillard. — C’est ce petit-là qui va battre l’autre?
M. Gaillard. — Tiens! Bonaparte n’était pas si grand que l’empereur Alexandre et que l’empereur d’Autriche; il les a pourtant solidement battus. Ce n’est pas la taille, c’est le cœur qui fait cela.
Le Cicérone. — Oui, pour les hommes, mais pas toujours pour les vaisseaux.
M. Gaillard. — Je parle de ça sans connaître, voyez-vous; je n’ai appris un peu de marine que dans le Petit Matelot de l’Opéra-Comique.
Un Gardien (criant). — On ferme, messieurs!
Madame Gaillard. — Il faut sortir, déjà ! c’est dommage! mais nous reviendrons un autre jour. Monsieur, bien flattée d’avoir fait votre connaissance; vous êtes un homme charmant et très-instruit. Je n’oublierai pas tout ce que vous m’avez dit; je suis sûre que tout ça va me tourner dans la tête comme la peinture me tourne devant les yeux; je vas rêver toute la nuit frégates, poètes, Sapho et péchés charnels.