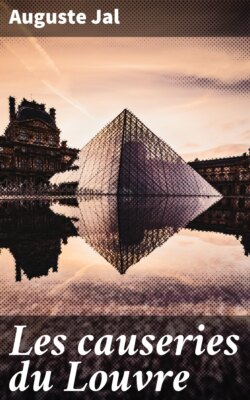Читать книгу Les causeries du Louvre - Auguste Jal - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV
ОглавлениеTable des matières
Famille de juifs de Maroc. — M. E. Delacroix. — L’expression. — Les coloristes ont le mouvement. — Portrait de M. de Mornay. — Corps-de-garde de soldats maures. — Voyage à Maroc. — Charles-Quint au couvent de Saint-Just. — M. Court. — Une châtelaine.
NON, point de ces grands ouvrages sur lesquels s’asseyait la discussion il y a quelques années. Trois ou quatre dessins, des portraits et une toile du genre historique, mais dans de petites dimensions. Tout cela est noyé dans l’océan de peinture qui déborde de la galerie d’Apollon à la porte des Tuileries.
— Je n’ai encore rien vu de lui.
— J’ai tout vu, moi.
— Et qu’en dites-vous?
— Venez juger vous-même. Nous sommes dans la travée des dessins, et à deux pas d’une fenêtre où j’ai trouvé une famille de juifs marocains que Delacroix a dessinée dans le voyage qu’il a fait l’année dernière à Mequinez et à Tanger. Tenez, voilà ce dessin.
— Oh! que c’est curieux!
— Et d’une belle couleur. Remarquez aussi que cela est d’une excellente indication de formes.
— Je n’aime pas la manière de dessiner de ce peintre; je ne la comprends pas.
— Ce n’est pas un style commun; cela ne ressemble ni à Ingres, ni à David, ni à Rubens, ni à Vélasquez; on peut aimer mieux un trait plus pur, plus élevé, plus gracieux; on ne peut nier que celui-ci soit plein de mouvement, de vie, de passion, et de vigueur. Les personnages de Delacroix se meuvent; ils expriment complétement l’idée de l’artiste; ce sont enfin de bons acteurs, auxquels manque seulement quelquefois l’élégance, une des qualités que nous autres spectateurs français faisons passer tout de suite après l’esprit, et avant le sentiment.
— Oui, mais ces bons acteurs ne pourraient-ils pas être moins laids?
— Ils ont du caractère.
— Je ne sais pas ce que vous entendez par-là. Ils sont laids, c’est tout ce que je comprends, parce que cela me frappe.
— Je voudrais, comme vous, que Delacroix n’eût pas adopté un type si éloigné des idées que nous avons tous du beau, ou plutôt du joli; mais je ne suis guère touché, quant à moi, de cet inconvénient. Ce que je m’attends à trouver en lui, c’est l’expression énergique de la pensée; et toujours je l’y rencontre. Il a, à un haut degré, une des qualités qu’ont possédée les grands peintres coloristes: l’action, et, j’ose le dire, l’actualité. Les figures de presque tous les maîtres dessinateurs posent devant vous, elles sont comme pétrifiées; il y a je ne sais quoi de roide, d’arrêté, de chevillé dans leurs jointures, qui tient à la scrupuleuse finesse du dessin, dégénérant en sécheresse. Chez les coloristes, les personnages du drame sont plus souples, plus capables de la vie; ils ont une apparence d’organisation complète qui manque aux silhouettes précieuses des autres. Delacroix sait animer une toile. Je crois que pour son succès il eût été à souhaiter que cette animation souffrît une forme moins bizarre et plus vraie, afin d’être plus intelligible...
— Il a toujours l’air d’être possédé de quelque idée fantastique, et d’aller chercher ses modèles en enfer.
— Non pas au moins dans ce dessin, où la beauté des juifs de l’Orient est bien fidèlement traduite; non pas dans ce portrait de M. Mornay, où tout le positif de la vie réelle d’un amateur fashionable est rendu avec scrupule, et dissimulé à peine sous l’harmonie ardente d’un brillant coloris.
— Je vous accorde cela. Mais dans ce corps-de-garde de soldats maures, ne retrouvez-vous pas le laid?
— Il est certain qu’aucun de ces gens-là ne passerait ici pour un joli garçon, ni pour un gracieux cavalier; mais ils ont tous cette beauté barbare qui leur convient, et c’est justement ce que j’appelais tout à l’heure le caractère du dessin; ce qui est une des conditions de la philosophie du sujet.
— Je suis fâché que Delacroix n’ait pas exposé quelque tableau capital.
— Je m’en afflige aussi, parce qu’il y a toujours, selon moi, un grand inconvénient pour l’artiste à s’effacer volontairement quand il s’est mis tout d’abord au premier plan. J’aurais voulu cette année une chose de l’importance de sa Liberté, exposée en 1831. Mais le temps lui a manqué. Il a voulu aller visiter un peu la terre d’Afrique, et recueillir des matériaux pour un long avenir de productions; il est revenu avec un riche portefeuille, dont il a détaché les dessins que vous voyez, et qui peignent si fidèlement le peuple de Maroc. Il avait jeté sur la toile quelques épisodes de son voyage, quelques scènes de la vie privée ou des mœurs publiques des hommes de cet empire, dont il a visité plusieurs villes, et au milieu desquels il a vécu en caravane; mais il n’en était pas satisfait encore, et il ne les a pas voulu exposer à une critique qu’il prévoyait, et contre laquelle il a un remède, puisqu’il veut retoucher ses tableaux. Cependant il y a ici, comme je vous le disais au commencement de notre entrevue, un tableau historique de Delacroix que vous n’avez pas remarqué. Je vais vous le montrer. Remontons un peu la galerie..... Tenez, cherchez dans ce petit carré.
— Je ne vois rien qui ressemble au Massacre des Grecs de Missolonghi, à Sardanapale ou à Marino Faliero.
— Levez la tête. Voyez ces deux moines, dont l’un prélude sur le clavier?
— Oui, mais ce n’est pas de Delacroix. J’ai bien aperçu ce tableau en passant, et je n’y ai pas fait la moindre attention. D’abord, cela ne m’a pas frappé ; ensuite je n’ai pas cru que ce fût d’un homme en réputation, juché comme il est là-haut, visible à peine, dans un cadre qui ne se relève point en bosse, et sans visiteurs romantiques.
— C’est pourtant une des belles choses de Delacroix.
— Oh!
— Récriez-vous, mais regardez. Ce moine n’a-t-il pas l’air de succomber à un profond ennui, et de chercher une distraction que la musique ne lui donnera pas?
— Oui, cette idée est bien exprimée. C’est un religieux malgré lui, sans doute?
— C’est Charles-Quint!
— En effet; l’empereur au couvent de Saint-Just. Ah! oui, bien, très-bien! Il pense, il se souvient; le passé le dévore, l’avenir lui pèse déjà ; il souffre. Ses doigts tirent de l’orgue des sons que n’entendent pas ses oreilles. Le seul bruit qui résonne encore dans sa tête, et qu’il voudrait couvrir par quelque harmonie religieuse, c’est celui de la fanfare guerrière. Il y a lutte dans ce cœur où les regrets du pouvoir abdiqué sont en présence d’un besoin de calme, de repos: ce cœur demande à Dieu la force de renoncer aux nobles vanités du monde; il pleure, il s’humilie. La cuirasse ne perce pas encore sous la robe de laine du moine; mais si Dieu ne vient pas en aide à cette grande mélancolie, il y aura révolte tout à l’heure, et le capuchon noir fera place à la couronne fermée des empereurs, et la pourpre viendra cacher le scapulaire, et le cilice restera sous le large ceinturon de l’épée.
— Vous trouvez donc que cela vaille quelque chose?
— Si cela vaut quelque chose! vraiment, c’est superbe! Cette tête de Charles-Quint est pleine de sentiment et de poésie.
— Est-ce que vous la trouvez laide?
— Je n’en sais rien; je ne me suis point occupé des traits, mais de l’ensemble qui est beau. Ce moine, c’est un homme, un homme qui m’intéresse et me touche; je n’aurais pas besoin de savoir que ce malheureux est le reste d’un grand homme, d’un héros, du roi des monarques du seizième siècle, pour être ému. Comminges ou Charles-Quint, je le plains, je compatis à sa peine, parce qu’il est véritablement homme. Ce n’est pas un comédien qui joue la tristesse, c’est Charles-Quint qui n’a pas la force de jouer la comédie, qui ne sait pas en imposer à ses frères de Saint-Just par l’apparence du bonheur et de la résignation, et qui, sans proférer une parole, les yeux tristement levés au ciel, promenant, sans s’en douter, ses doigts sur le clavier de l’orgue, confesse au religieux, qui le regarde avec étonnement, l’état de son âme inquiète.
— Ce second personnage, subordonné pour le tout à Charles-Quint, est très-dramatique aussi.
— Ah! mon cher, que cela est bien! plus je regarde cet ouvrage, plus je l’aime: je m’en veux de l’avoir presque méprisé d’abord.
— Je l’avais méconnu, moi aussi, grand admirateur de Delacroix; mais j’y suis revenu, et j’y reviens toujours. C’est la plus belle chose du salon comme morceau d’expression tendre et profonde. Notez que je ne veux point vous parler de la couleur des mains qui sont charmantes, de la grâce simple et naïve qui voile le moine du fond; je m’en tiens à l’expression, et je vous demande si vous croyez que cette figure de Charles-Quint n’est pas bien dessinée?
— Je ne puis en apercevoir ni en chercher les imperfections; je suis tout à la pensée.
— Vous seriez bien vite revenu à la forme, si cette forme n’était pas bonne. Sans doute le dessin est bon; car, s’il ne l’était pas, l’expression serait fausse; le visage grimacerait, ce serait un masque hideux. Il y a dans tout cet ouvrage un calme, une douceur, une simplicité, qui plaisent. Dans ce cadre étroit, il y a de la grandeur. Le public ne s’en est guère douté encore. Si nous pouvions amener là tous ces gens qui s’ébahissent devant je ne sais quelle châtelaine, tête de bois vernie par M. Court, ils reconnaîtraient qu’il ne peut y avoir qu’un artiste du premier ordre qui a fait ce Charles-Quint, et que c’est là une œuvre de cœur.