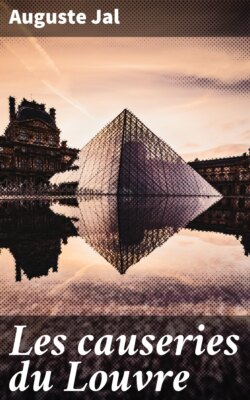Читать книгу Les causeries du Louvre - Auguste Jal - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V.
ОглавлениеTable des matières
Les portraits. — Une gavote par M. Parent. — Justification des peintres de portraits. — Portrait de madame Albert, du Vaudeville. — Mademoiselle Martin. — Portrait de M. Lemaire, sculpteur. — M. Quecq. — M. Girod de l’Ain. — Mademoiselle Pagès. — Boccage, de la Comédie-Française. — M. Lebour. — Tamburini. — M. Canzy. — Portrait de M. Mérilhou. — M. Despois. — L’attention. — Portrait de M. Parquin. — M. Finck. — M. Eusèbe Salverte. — Madame Saint-Omer. — Mademoiselle Julia, de l’Opéra. — M. Collas. — M. Petrus Borel, le Lycantrope. — M. Thomas. — Le cadre tricolore. — La manie du costume. — M. Armand Carrel. — M. Henry Scheffer. — La livrée de Marat. — M. Ary Scheffer. M. Odillon-Barrot. — M. Cauchois-Lemaire. — M. Henriquel Dupont. — Cromwell, gravure. — Avenir des arts. — L’art constitutionnel. — Aquarelles de M. H. I. Hesse. — M. Isabey père. — Les ateliers d’un peintre de miniature. — Portrait de M. Tiolier. — Portrait de M. H. I. Hesse. — Encouragement impossible aujourd’hui. — Encouragement sous le pouvoir absolu et la république. — Artistes par conviction. — L’artiste ne peut plus vivre dans le recueillement et la retraite. — Imitateurs. — Les cadres extraordinaires. — Classification morale dans le genre portrait.
QUEL débordement de faces ignobles! Pourquoi donc admettre un si grand nombre de portraits?
— Pourquoi? pourquoi? Voulez-vous m’écouter? je vais vous le dire.
— Vous avez des plaidoiries pour toutes les mauvaises causes.
— Nous allons voir si vous trouverez une bonne réplique à celui-ci.
— La meilleure réplique, et je la sais d’avance, c’est que l’immense majorité de ces portraits est détestable, qu’ils ne doivent pas plus compter parmi les ouvrages d’art que n’y comptent les enseignes des cabarets de province, et qu’enfin c’est déshonorer le Louvre que d’y étaler ces figures barbouillées qui crient aux étrangers: «Voyez-vous, nous sommes ici pour constater l’état de la peinture en France.»
— Très-bien. J’ai été aussi indigné que vous quand, pour la première fois, je suis entré ici, et que j’ai vu toutes ces vanités de famille étalées dans de beaux cadres, l’une voulant primer l’autre, toutes faisant tapage par le faux éclat de la couleur, par le luxe exagéré de l’arrangement ou par le maniéré de la pose.
— Le maniéré de la pose ne m’indigne pas, moi; il me fait rire. Je n’ai pas pu y tenir quand j’ai vu, debout devant sa table, ce monsieur, riant, gracieux, la bouche en cœur, le jarret tendu, la culotte et les bas de soie noirs, le jabot au vent, prêt à partir, à s’élancer, et attendant seulement que sa levrette blanche soit prête pour continuer le pas de deux qu’ils ont commencé de danser. Ce portrait en pied, j’y reviens toujours, et je serais bien fâché qu’il ne fût pas exposé : il est une de mes joies. Et puis, il n’y a rien à dire pour l’exécution; ce n’est ni d’un dessin bien fort, ni d’une bien bonne couleur, mais ce n’est pas mauvais. Je ne sais pas le nom de l’auteur.
— Il est écrit sur le parquet: Parent.
— Oui, parent éloigné de Van-Dyck.
— Mauvais jeu de mots, digne d’un Rapin.
— Quand vous voudrez ne pas m’interrompre, je pourrai vous expliquer la présence au salon de tous ces portraits qui vous révoltent.
— Dites; je vous écoute, en regardant toutes ces grimaces, comme les juges écoutent les avocats des assises en présence des pièces de conviction.
— Peu de gens prêtent leurs têtes aux artistes par amour de l’art, et pour faciliter aux peintres les moyens de faire des études. Il y a cependant ici des portraits qui sont le résultat de cette complaisance. Ceux-là se divisent en deux classes: les bons, que nous serions bien fâchés de ne pas voir, et les mauvais, qu’il faut bien que nous voyions, car le jury n’a pu refuser de les recevoir.
— Voici qui est fort. Le jury ne pouvait refuser!
— Non, et vous allez le comprendre. Un artiste qui a peu de renom a besoin d’exposer des ouvrages qui le fassent remarquer; il lui faut donc choisir ses sujets. Il s’adresse aux hommes marquans dans le monde politique ou dans le monde des arts, aux femmes qui ont acquis de la célébrité par leurs talens, leur beauté ou quelques grandes aventures. Voilà pourquoi vous avez toutes les années au Louvre tant de députés de l’opposition, tant d’écrivains, tant d’artistes, tant d’actrices.
— Est-ce là ce qui nous a valu le portrait si triste et si peu ressemblant de madame Albert par mademoiselle Martin? celui de M. Lemaire le sculpteur par M. Quecq? celui de M. Girod de l’Ain par mademoiselle Pages? Celui où M. Lebour a représenté Boccage de la Comédie-Française, faisant du drame sentimental, la tête appuyée dans sa main droite? celui de Tamburini par M. Canzy? celui si étroit, si sec, si faible, de M. Mérilhou, par M. Despois, qui, du reste, me semble avoir fait mieux dans cette figure de l’Attention, jeune fille à demi nue, à qui l’on pourrait dire: «Attention, mademoiselle! vous allez perdre la gorge de marbre que le peintre galant vous a donnée?» celui de M. Parquin, par M. Finck? celui de l’honorable M. Eusèbe Salverte, à qui madame Saint-Omer a fait la tête d’un singe? celui de mademoiselle Julia, jolie personne de l’Opéra, que M. Collas a voulu représenter dans un costume mexicain, et qui, par le ton, a plutôt l’air d’un morceau de poterie étrusque que d’une femme de la chair rouge? celui de M. Petrus Borel, surnommé le Lycantrope, jeune écrivain plein de verve et de talent, auteur de contes moraux qu’il appelle immoraux?
— M. Thomas n’avait pas besoin de cet élément de curiosité ; il pouvait se passer de la recommandation du nom de son modèle comme de son cadre tricolore. Ainsi, quelques-uns des jeunes citoyens qui composent la famille artiste dont la prétention est d’être plus patriote et plus amie de la liberté dans les arts que tout le monde, pourraient se passer du costume à la Marat pour être remarqués. Dans ce temps-ci, le costume importe assez peu; je vois que M. Ingres, qui s’habille comme vous et moi, a un talent immense; je vois que M. Armand Carrel, dont voici un très-bon portrait, par M. Henri Scheffer, est un des meilleurs prosateurs de ce temps-ci, un des publicistes ardens en idées républicaines, et assurément le plus terriblement spirituel, et le plus fort des organes de la presse politique: cependant il n’a pas arboré le gilet rouge, l’habit aux larges revers pointus, les gants couleur sang-royaliste, le chapeau pointu ou écrasé, la barbe ou les longs cheveux flottans; il est mis comme un carliste, comme un épicier, comme un juste-milieu, comme on se met; il ne croit pas qu’on fasse des idées avec des formes d’habits; il a trop affaire pour s’occuper de ces petits détails. Qu’ont fait les élèves de David qui se déguisaient en Grecs ou en Romains? qu’ont fait les saint-simoniens? qu’ont fait les jeunes-France avec leur intention de retour au moyen-âge? Rien sur la société. Les œuvres influent, et point les costumes. Nos petits fantassins bien simples ont toujours valu sur un champ de bataille les hussards les mieux brodés. Dans les luttes de la pensée, il en est de même. «L’habit ne fait pas le moine,» disait-on autrefois; il ne fait pas non plus le penseur. Diogène serait sérieusement ridicule avec son manteau troué et son tonneau, qui conviendrait tout au plus aujourd’ hui à une ravaudeuse de la halle; il aurait beau crier: «Je suis le citoyen Diogène, prolétaire; je réclame les droits politiques pour mes frères et amis les prolétaires!» personne ne ferait cercle autour de lui pour l’écouter; il n’y aurait plus d’Alexandre pour venir causer dans son soleil; on s’éloignerait de lui, parce qu’aujourd’ hui on sait très-bien ce que valent l’originalité et l’orgueil des Diogènes, et qu’on les fuit par précaution de propreté, et par un juste sentiment de dégoût pour les travestissemens prétentieux. Chodruc-Duclos a fini par comprendre cela; il a une redingote, un chapeau et des souliers neufs! Il ne faut pas donner une livrée à son idée pour la populariser; on la rend presque sotte. Et puis, on porte une livrée, ce qui est anomal avec la vanité qu’on affiche d’être absolument et complétement homme libre. La livrée de Marat ou celle de Louis XV, c’est tout un; celle de Louis XV, du moins, n’était tachée que du vin de l’orgie; il y avait du sang sur celle de Marat! — Je reviens à M. Thomas. Son portrait de M. Petrus Borel est bien; la. tête pense sans trop d’effort; il y a du calme dans l’expression et dans la couleur. Quoique la pose soit un peu affectée, je préfère cette figure à celle que M. Ary Scheffer a faite d’après M. Odillon-Barrot. L’éloquent tribun est jeté là dans un effet d’ombre mélodramatique très-peu agréable, selon moi. Cela manque de la simplicité et de la gravité qui convenaient au sujet; on ne peindrait pas autrement un conspirateur. M. Odillon-Barrot a une tête d’un caractère fin et ferme; son front chauve est lumineux: il y a bien en lui quelque chose d’apprêté, de compassé ; mais cela ne va pas plus loin que l’air d’autorité et de magistrature sur un parti. M. Scheffer ne me semble pas avoir saisi, sous ce rapport, la physionomie de M. Barrot. Il aurait fallu rendre ce trait que personne, depuis Napoléon, n’a eu, je crois, au même point que M. Odillon-Barrot, la dignité un peu superbe — Bonaparte la prit de bonne heure comme un masque, pour mettre son visage en harmonie avec son ambition, et habituer tous les yeux à son empire — la dignité un peu superbe qui, dans un homme vulgaire, ferait rire comme un orgueil puéril, et qui sied à un homme supérieur, comme la coquetterie à une femme éminente par l’esprit et la beauté. M. Henri Scheffer a fait aussi M. Armand Carrel un peu trop théâtral; peut-être ne lui a-t-il pas donné toute la finesse et toute la puissance d’expression que nous connaissons au modèle. J’aime d’ailleurs mieux ce portrait que l’autre.
— Si vous voulez voir une ressemblance intime, une individualité bien saisie, allez voir au bout de la galerie le portrait au pastel de M. Cauchois-Lemaire, par M. Henriquel Dupont, le graveur.
— Oh! je le connais, et j’en suis enchanté ; c’est une fort bonne chose, qui me paraît ne manquer que de deux ou trois touches pour être parfaite. On ne saurait mieux reproduire sa pensée. L’habitude de raillerie élevée, qui fut l’arme constante de M. Lemaire pendant sa guerre sérieuse contre les Bourbons, se lit très-bien dans ces yeux à demi couverts, sur ce front large et dénudé avant le temps, sur ces lèvres dénonçant à peine le sourire qui traverse certainement les idées de l’écrivain, un des maîtres de la polémique d’opposition. Cet ouvrage fait honneur au talent de M. Dupont; il prouve en lui le sentiment vrai de l’art du portraitiste, qui consiste non-seulement à produire une ressemblance matérielle, mais encore à donner au personnage représenté son caractère moral, sans affectation, sans charge, sans grimace. Les portraits au pastel de M. Dupont sont justement recherchés; ils ont de la finesse et de la grâce, outre la qualité précieuse que je vous signalais dans celui de M. Cauchois-Lemaire. Le jeune artiste a des succès de plus d’un genre. Comme graveur, il s’est placé parmi les hommes habiles par sa belle estampe du Gustave Wasa, d’après Hersent. Cette année, voilà qu’il expose le Cromwell, d’après Paul Delaroche: c’est un morceau plein de force et de couleur, non pas dans le genre de Gustave Wasa, mais à la manière noire. Il est fâcheux que la grande gravure, celle qu’il faut appeler classique, ait si peu de chance aujourd’hui, et qu’un artiste aussi capable que M. Dupont ne puisse se hasarder à entreprendre de ces grands travaux qui rangent leurs auteurs dans les périodes importantes de l’art: je crois qu’il se classerait promptement de la manière la plus honorable. Mais les encouragemens manquent à la gravure au burin; il n’y a presque plus d’amateurs et pas de fonds larges au budget. Aussi M. Dupont est obligé de se jeter dans le pastel. Il y est supérieur, c’est à merveille; mais ce n’était pas sa carrière. M. Dupont n’est malheureusement pas le seul qui soit détourné des voies de sa vocation par la nécessité de produire pour vivre. Et c’est là encore une des causes qui font affluer au salon ces légions de portraits, dont vous avez déjà reconnu, j’espère, qu’il est une classe admise de toute nécessité par le jury, celle des portraits d’artistes besogneux de gloire ou d’argent, qui spéculent sur les personnages célèbres.
— Mais ce n’est là qu’une industrie où l’art n’est que trop souvent désintéressé !
— Sans doute, et cette industrie, il faut bien qu’on la tolère, puisque les voies au succès et à la fortune se ferment chaque jour devant les artistes.
— Dans un pays ami de la civilisation et des arts comme la France, les voies s’agrandissent, bien loin de se fermer.
— Ce sont là des phrases de vaudeville national; je vous en demande bien pardon. Soyons vrais; point d’illusions trompeuses. Permettez-moi de vous dire ce que je crois être l’avenir des beaux-arts en France. Vous voyez que les grandes toiles sont rares; l’histoire fait retraite.
— La mode a écrasé les Romains, et personne ne pense plus au nu.
— Que le goût ait changé, il n’y a pas de doute; mais il ne s’agit pas ici d’une simple question de goût. La peinture historique est monumentale; quels monumens élevons-nous? La religion ne nous est plus de rien; il y a beaucoup de sectes et peu de croyances. Je ne sais quel succès obtiendra l’église française de l’abbé Chatel, ou celle de l’abbé Auzou; ce sont des schismes, sans crédit encore, qui vont chacun de leur côté, et redonneraient à l’église romaine une puissance réelle, si le temps des schismes et de la foi ardente n’était point passé. Je crois que la division a tué l’église française: toute opposition qui se divise périra, à une époque de doute et d’indifférence comme celle où nous vivons. De tous les cultes, ceux qui dureront le plus long-temps, parce qu’ils ont déjà duré, ce sont la religion catholique romaine et le pouvoir monarchique. L’habitude remplace la foi; et puis on a horreur des controverses religieuses et peur de la république. Mais supposons que monseigneur Chatel ou monseigneur Auzou prospère, d’ici à long-temps il ne sera assez riche pour faire bâtir des temples et y appeler des peintres et des sculpteurs. Je doute que la religion de saint Jean, qui a commencé par exhumer le vieux costume des Templiers de la garde-robe du Théâtre-Français, soit plus heureuse que celle où l’on dit le Pater en français. Il n’est déjà plus question du dieu Saint-Simon. Tous ces essais sont perdus pour l’art; il n’y a guère que les tailleurs qui y gagnent quelque chose, si on les paie. En dehors des religions, qu’y a-t-il à faire pour les peintres d’histoire? un peu d’histoire politique. Mais quand on a orné la Chambre des députés et celle des pairs, que reste-t-il? Des Musées à meubler, à embellir. C’est l’affaire du gouvernement; et que peut le gouvernement à cet égard? Le budget alloue au ministre des beaux-arts 79,000 fr. environ pour achats de tableaux et de statues; n’est-ce pas une pitié ? Avec cela, il y a de quoi payer convenablement huit ou neuf bons ouvrages, pas trop considérables encore. La protection du gouvernement manque donc tout-à-fait à la peinture historique, à la statuaire, comme à la grande gravure. Si les particuliers riches du moins leur restaient! Mais non; il n’y a plus à Paris d’importans galeries. Autrefois les fermiers-généraux, les grands seigneurs mettaient quelque vanité à posséder des tableaux et d’autres beaux objets d’art; ils avaient des galeries à la ville et dans leurs châteaux. Souvent ils y prostituaient les muses, et les traitaient comme les filles de l’Opéra dans leurs petites maisons; mais, s’ils manquaient de goût, ils ne manquaient pas d’orgueil et d’argent; ils enchérissaient l’un sur l’autre pour l’acquisition d’un tableau de Boucher, ou d’un groupe de Falconet. Maintenant plus de grands seigneurs, plus de fermiers-généraux. Je ne dis pas que moralement et politiquement l’état actuel des choses ne vaut pas mieux que l’ancien; mais il est certain que pour les arts et les artistes il est beaucoup plus mauvais. Les grands hôtels ont fait place à des maisons dont toutes les distributions sont étroites; on y est mieux logé peut-être, mieux chauffé et à moins de frais, plus confortablement installé ; mais les arts, je parle des arts sublimes, en sont exilés. Aussi l’architecture, qui trouvait autrefois quelques grands développemens pour émettre ses idées, est réduite à la construction de maisons bourgeoises, et à la décoration de quelques salons de danse ou de quelques petites chambres à coucher. D’ailleurs, les banquiers, qui ont remplacé les fermiers-généraux, n’aiment pas à avoir des fonds morts; et les hauts fonctionnaires, qui sont dans notre société constitutionnelle ce qu’étaient dans les sociétés aristocratiques les grands seigneurs, sont peu riches, et calculent leur existence, pour la conformer aux prévisions d’un avenir tout incertain. Aujourd’hui quelque chose, destitués demain, ils ont une famille à pourvoir, une retraite à accroître par l’économie; ils ne font donc rien pour l’art. Quant à quelques très-riches propriétaires qui font valoir leur argent et leurs terres, je n’en sais point qui donnent asile à la peinture ou à la sculpture dans leurs parcs ou leurs salons. Ils ont des actions des ponts, des canaux, de chemins de fer; que sais-je! ils ont des loges à l’Opéra ou aux Bouffes; ils ont des voitures et des chevaux; tout cela est très-bien, mais dans la répartition du budget, rien qui aille à l’encouragement des arts. Si, par hasard, ils ont le goût des tableaux, ils font comme les fonctionnaires et les banquiers, ils achètent des tableaux de genre, des paysages, quelques dessins d’album, parce que l’album est imposé par la mode, comme le piano et les écrans brodés; mais ils marchandent, et ils croient faire une grande faveur à l’artiste quand ils lui paient son œuvre au prorata du temps qu’il a passé à la confectionner. C’est de la peinture à l’heure qu’ils achètent, comme ils louent de la volupté au mois, en prenant des maîtresses. Et vous dites qu’il y a en France amour des arts et sentiment artiste! Ils ne sont point dans les classes qui pourraient les avoir d’une manière profitable à la gloire du pays, ou s’ils y sont, c’est exceptionnellement. Le sentiment des arts n’existe que chez un petit nombre d’amateurs riches, mais pas assez pour être des Mécènes. Où il faudrait qu’il se trouvât, à la Chambre des députés, cherchez-le, et vous entendrez d’honorables orateurs vous dire que les arts sont un luxe onéreux au peuple; que celui qui a besoin de la peinture historique ou de la statuaire doit la payer; qu’il faut avant tout doter l’industrie, en faisant des routes, des canaux, des écoles d’arts et métiers. Les subventions des arts libéraux sont disputées, comme les fonds secrets de la police: c’est que les arts ne sont pas compris de la plupart de nos honorables représentans; c’est qu’on ne sait pas quelle influence la belle peinture et la statuaire peuvent exercer sur le goût, sur la civilisation, sur les mœurs, et, en définitive, sur l’industrie; on n’y voit qu’un moyen d’ornement assez vain et fort dispendieux, et l’on vote contre. Je n’ai rien exagéré ; je vous ai dit la vérité sur l’art constitutionnel; je n’ai aucun intérêt à assombrir les couleurs du tableau; j’ai établi un fait dont vous allez voir tout de suite les conséquences. La grande peinture va décliner pendant trois ou quatre ans puis elle disparaîtra presque complètement, et n’apparaîtra de temps à autre que dans des ouvrages commandés par le ministère, la ville de Paris et la maison du roi. Ces apparitions seront très-rares, faute de fonds et d’emplacemens. La statuaire, qui, malgré les longs malheurs des arts, se soutient honorablement, et beaucoup mieux que la peinture, suivra la même décadence forcée. Les peintres, doués de talens véritables, feront de l’histoire dans la proportion de Le Sueur ou de Poussin, à la condition, toutefois, qu’ils choisiront des sujets qui n’agacent pas trop les nerfs des femmes, ou ne blessent pas les délicatesses de leur goût, parce que leurs ouvrages seront, dans les salons des heureux du jour, accrochés à côté des tableaux familiers, et qu’il faut de l’harmonie dans la décoration d’un appartement. Ceux qui renonceront à l’histoire feront des tableaux de chevalet, et vous voyez que déjà la plupart ont pris cette direction. Tous feront des portraits. Le portrait est le pot-au-feu du peintre; c’est avec des portraits qu’il bat monnaie; c’est sa vie entière, celle de sa famille; c’est sa seule ressource pour sa vétérance et sa retraite. Il résultera de là que le portrait sera beaucoup mieux fait qu’il n’était autrefois.
— Et qu’on en exposera peut-être un plus grand nombre encore que cette année!
— C’est possible. Tel artiste sera adopté par telle coterie, et toute cette société passera par son pinceau, parce que personne ne voudra rester en arrière de protectorat avec le peintre. C’est déjà ce qui arrive: on voit ici des séries de portraits faites par des artistes dont les clientelles sont fort distinctes. Il n’y aura que l’éclat d’un grand talent ou un avantage dans le prix, comme on dit dans le commerce, qui dépossédera l’artiste en titre dans la petite société. La concurrence, que tout tend à accroître, fera que les artistes s’efforceront de faire bien; mais, comme elle amènera nécessairement une sorte de rabais, il faudra que les peintres se hâtent à produire, afin de pouvoir y trouver à vivre. Malheur aux hommes comme M. Ingres, qui recommence sans cesse ce qu’il a fini!
— Mais n’ai-je pas vu déjà des portraits faits dans le système de vitesse que vous dites? des aquarelles sur lesquelles l’artiste a écrit: en deux jours?
— Oui, des aquarelles de M. H. I. Hesse. Aussi toutes se ressentent de la promptitude de l’exécution. On dirait qu’il y a un procédé mécanique employé dans la fabrication de cette peinture; il semble que les points larges, uniformes, invariablement gris, ou roses, viennent se poser sur le papier avec un pinceau mu par la vapeur. Tout cela se ressemble; il n’y a pas apparence de chair; c’est quelque chose de transparent, de coquet, d’agréable si vous voulez, qui est loin du charme, du chatoyant et de la coquetterie des peintures rosées de M. Isabey père, que je ne vous donne pas du tout pour de bonnes représentations de la nature, mais pour la fin d’une manière qui eut de la célébrité lorsqu’elle était plus forte, et qui trouve encore des partisans chez les belles dames. Quand je regarde un portrait, je veux savoir s’il me reproduit bien la personne que j’aime, ou que j’ai le désir de connaître; j’examine tout pour retrouver l’individualité, le caractère; je ne m’imforme pas du temps qu’a passé l’artiste à le peindre. C’est là comme pour les sonnets: «Le temps ne fait rien à l’affaire.» Je sais qu’il est agréable pour un voyageur qui passe à Paris, et veut laisser un souvenir de lui à la maîtresse qu’il s’y est faite dans son séjour d’une semaine, d’avoir en deux jours un à peu près de sa figure, à peu près spirituellement touché, assez joli à l’œil, éclatant, qui fasse dire à la jeune fille: «Dieu! que cet homme a de bonnes manières! les spectacles, les fiacres, les présens de toutes sortes, et par-dessus tout cela, un portrait fait avec des couleurs fines, et qui a dû lui coûter cher!» Mais, hors cette circonstance, quand peut-on avoir besoin d’un portrait en deux jours? Au reste, il paraît que ce genre d’opération n’est pas mauvais. — Il faut là-dessus s’en rapporter aux industriels qui l’exploitent. — Car on m’a raconté qu’il y a un peintre, au Palais-Royal ou dans les environs, qui fait des portraits à la minute, et qui a écrit sur le cadre enseigne de sa maison de commerce: «Aussitôt qu’un portrait est commandé, l’artiste le met en main dans ses ateliers.» Un bottier ou un tailleur ne ferait pas de promesses plus engageantes; seulement, l’artiste, — c’est le peintre que je veux dire, — a oublié d’ajouter: «On garantit la qualité et la ressemblance.» M. Hesse au surplus, a plus de talent qu’il n’en faut pour faire beaucoup mieux l’aquarelle: voyez plutôt le portrait de M. Tiollier, le graveur en médailles, et celui que M. Hesse a fait de lui-même. Ce sont des morceaux consciencieux, deux têtes fermes de modelé, et brillantes, sinon de couleur, au moins de lumière. — Je reviens à l’avenir de nos artistes. Les statuaires seront réduits au portrait. Mais comme la sculpture trouve moins d’yeux intelligens que la peinture, parce que son relief manque de cette vie du coloris qui charme dans la peinture, les sculpteurs seront plus à plaindre que les peintres. Un buste est toujours une chose chère; tout le monde ne peut pas payer suffisamment bien un marbre; et avoir un buste en plâtre, c’est s’exposer à ne rien avoir bientôt. On y regarde donc à deux fois avant de poser pour un sculpteur. Je vous ai dit tout à l’heure, à propos d’Henriquel Dupont, ce que souffre la gravure sans protection, et engagée dans une lutte impossible avec la lithographie. Quant à l’architecture, elle est contrainte de se réfugier dans les constructions à bon marché. Si, dans l’espace de dix ans, il lui échoit. trois monumens, elle devra être fière. Ainsi, plus d’architecture, peu de gravure, de la sculpture pour les bustes, et de la peinture pour les portraits et les ouvrages de genre: voilà tout. Dans cinq ans, vous me direz si je n’ai pas prophétisé juste.
— Triste prophétie au moins!
— Et dans tout ceci il n’y a de la faute de personne. La forme du gouvernement est le plus grand obstacle aux larges développemens des arts; l’art constitutionnel, c’est l’art à bon marché. On prêche l’économie, avec raison; il faut être économe, mais il faudrait que l’économie ne portât pas sur les arts civilisateurs. C’est ce qu’on ne sait pas assez. Il n’y a que le pouvoir absolu qui protège passablement les arts. D’abord, il a besoin de l’éclat que les arts procurent; il les exploite à son profit; et puis, comme il faut qu’il se fasse pardonner ses tyrannies, il cherche la grandeur, il travaille à éblouir, il donne aux intelligences l’aliment des hautes controverses sur l’art; enfin, il a une volonté forte, une pensée unique, celle de sa gloire; il ne compte avec personne les deniers de l’Etat; il peut être grand, magnifique, ou au moins noblement juste avec les artistes. Le pouvoir constitutionnel, tel qu’il est, n’a aucun de ces avantages dans sa position avec les arts; il va plus au positif des choses; il est, par nature, utilitaire; il pense à la satisfaction des besoins matériels avant de songer à celles des besoins intellectuels; c’est le confort qu’il faut qu’il donne au peuple; une diminution d’un centime dans l’impôt personnel est pour sa sûreté et sa force plus que ne seraient dix monumens. La gloire n’est pas une de ses nécessités; il n’est ni guerrier, ni artiste, ni poète, qu’on ne lui ait démontré l’urgence de l’être; il n’a pas ces instincts chevaleresques, ces sympathies pour le génie que le pouvoir absolu, quand il est aux mains d’un grand homme, peut avoir et satisfaire; l’intérêt des citoyens est la règle de sa conduite; aussi, avec lui, l’art est presque impossible. Vous entendez bien que je ne veux pas faire ici la critique de la forme de gouvernement que je crois la meilleure, sous tant de rapports; mais j’explique la cause de la décadence de la peinture historique, et j’appuie mes prévisions sur l’avenir des beaux-arts, d’un fait incontestable, l’existence d’un état de choses presque antipathique à leur existence, et, à plus forte raison, à leur progrès.
— Il me semble qu’il y a quelque chose de paradoxal dans cette opinion; car enfin la république...
— Oui, celle de Périclès ou de la Convention nationale, n’est-ce pas? Et vous croyez que cela diffère beaucoup du pouvoir absolu! Rappelez-vous bien Périclès; quant à la république française, si elle fut protectrice des beaux-arts, elle le fut comme l’empire, non plus pour les arts eux-mêmes, mais pour elle. Elle avait déclaré la guerre au principe régnant en Europe; elle avait des armées victorieuses dont il fallait que les victoires retentissent pour que leurs rangs se recrutassent dans la population; il fallait bien que les arts vinssent exciter l’enthousiasme: de là ces fêtes renouvelées des Grecs; de là cette poésie pindarique, cette harmonie tyrthéenne, cette peinture épique qui malheureureusement ne fut admirable que sous le pinceau de Gros. Si la république eût été en paix, comme elle aurait eu à combatttre à l’intérieur les opinions de la société ancienne sur laquelle elle régnait, il lui serait arrivé ce qui arrive au gouvernement constitutionnel de juillet, qui n’a pu changer la société impériale et royale, et qui lutte contre d’anciennes idées. L’opposition se serait ralliée autour d’une pensée d’économie, et l’époque n’aurait rien produit de grand; elle aurait été heureuse, sans doute, mais elle ne nous aurait légué, en fait d’art, que quelques innocens opéras-comiques, des poèmes descriptifs et des portraits. Je ne sais si je me trompe, mais il me semble que le siècle des arts, c’est celui de Léon X. Le XVIIe siècle a jeté de l’éclat aussi; Napoléon a senti le besoin des arts, pour lesquels il a dépensé beaucoup d’argent. Aujourd’hui l’école est plus chercheuse qu’éclatante; elle use le reste des forces qu’elle avait prises alors, et que la restauration avait alimentées: car il faut être juste envers la restauration, elle a fait pour les artistes tout ce qu’elle pouvait faire.
— Ainsi, vous croyez que tout est perdu pour les arts élevés?
— Je crois que dans la disposition présente des esprits, contre laquelle il serait nécessaire que les trois pouvoirs de l’État luttassent par des encouragemens nombreux, et surtout intelligens, il n’y a pas grand’chose à espérer. Je crois que jusqu’au jour où la société sera enfin posée, où aura cessé le combat des opinions contraires qui se disputent le monde social, c’est-à-dire la possession immédiate de l’autorité politique, il en sera des arts ce qu’il en est aujourd’hui.
— Mais n’y a-t-il pas un peu de la faute des artistes dans cet état de marasme? La conviction ne leur manque-t-elle pas?
— Elle manque à la plupart. Excepté pour quelques hommes doués d’une âme vraiment artiste, et qui ne peuvent point trouver à développer leur génie parce qu’on leur refuse les larges pans de murailles qu’on donnait aux peintres du seizième siècle, l’art est une profession comme une autre, un métier qu’on apprend pendant tant d’années à l’académie, ou dans l’atelier d’un peintre, et qu’on exerce ensuite dans l’intérêt du bien-être personnel. L’artiste ne peut pas être assez recueilli aujourd’ hui, pour toutes sortes de raisons. La première, parce qu’il y a tant de gens qui courent la carrière, qu’il faut entrer franchement dans la concurrence, sous peine de mourir de faim. La seconde, c’est qu’il faut que l’artiste soit citoyen; il ne peut faire abstraction de ses devoirs politiques; il se doit à la cour d’assises comme juré, et à l’émeute comme garde national. Il faut donc qu’il lise les journaux pour savoir où en est le monde, comme il faut qu’il aille dans les salons pour se procurer la vente de ses tableaux et le placement de son talent en monnaie de portraits. La troisième raison, c’est que la société est aux prises avec des idées dont il est difficile de se désintéresser, et qui donnent à l’esprit des préoccupations graves. L’artiste est sous l’influence du choc de ces idées, et ne sait à laquelle s’arrêter; car, s’il se fixe, par exemple, à celle qui va le mieux à l’énergie des âmes fortes et pures, et si celle-ci est en opposition avec celle de la majorité des citoyens, il produira des œuvres de conviction, mais qui trouveront tout un pays révolté contre elles. Alors il se prendra de haine contre le siècle et le pays; il brisera sa brosse ou son ciseau, et sera dévoré par le chagrin. Le recueillement nécessaire à l’artiste est presque impossible: aussi ne voit-on, en général, que des œuvres sans profondeur. Il y a sur presque toutes ses toiles les preuves d’une habileté mécanique et de l’absence de pensées; la main, mais pas le cœur; le métier, mais pas l’art. Qu’invente-t-on aujourd’hui? ce qu’on faisait il y a quatre siècles. On s’évertue à chercher l’originalité, et on la trouve dans la copie du Giotto, d’Alber-Durer, de Primatice. L’art était complet, ce semble, après Titien; on le recommence pour être primitif; on veut à toute force être naïf, et l’on est niais. On se perd dans toutes sortes d’imitations. Un artiste a-t-il attiré par un ouvrage l’attention du public, qui ne sait à quoi s’arrêter dans ces images kaléidoscopiques qu’on fait tourner devant ses yeux à chaque salon, vite et vite tout le monde court sus à l’idée qui a réussi, à la manière, à l’effet qui ont séduit. Les peintres sont devenus comme les directeurs de théâtres, qui s’arrachent les spectateurs en faisant tous représenter les mêmes pièces, et en brouillant tous les genres. Les directeurs de théâtre placardent des affiches gigantesques, où tous les caractères de l’alphabet grimpent les uns sur les autres en s’enflant, se grandissant, se boursouflant pour produire des mots qui puissent prendre le passant au collet; les peintres composent des cadres guillochés, ouvragés, ornés, où les fleurs, les rinceaux, les arabesques, sont entassés comme Pélion sur Ossa; des cadres noirs comme les vieilles bordures des miroirs de Venise; des cadres d’or comme les encadremens roccoco des trumeaux de Louis XV; des cadres tricolores, protestations contre le gouvernement; des cadres à compartimens, comme ceux du quinzième siècle; jusqu’à des cadres en ficelles. Tout cela, voyez-vous, atteste le malaise, l’incertitude, le doute, la tendance à la spéculation lucrative, le besoin de quêter les regards du public. Tout cela prouve que nous sommes à une époque de transition; il en sortira quelque chose, quand? je l’ignore; que sera-ce? je n’en sais rien. En attendant, plaignez les artistes, et ne les accusez pas trop, excepté de la manie d’imitation qui s’est emparée de toutes les têtes. Maintenant comprenez-vous pourquoi il y a tant de portraits ici? et en voulez-vous encore au jury qui les a reçus?
— Encore un peu, parce que, malgré toutes vos raisons, il y en a de si mauvais...
— Attendez. Le jury n’a pas voulu être inhumain, et sous cette détestable peinture il y a une question d’humanité. Il est, parmi ces portraits si déplorables, des ouvrages dont les auteurs sont professeurs dans des pensionnats ou à domicile; rejetez-les, et les professeurs perdent leurs élèves. L’admission est un titre de capacité dont la vanité vous est bien démontrée, sans doute, mais qui sur le vulgaire est si positif, qu’il y a d’honnêtes bourgeois qu’on voit attendre le salon pour savoir si le portrait qu’ils ont fait faire est bon. Admis, ils vont dire partout: «Monsieur un tel a du talent, mon portrait est aux tableaux.» Refusé, ils iraient crier dans tout leur quartier: «J’ai été trompé, on m’a volé, mon portrait n’est pas au Louvre; c’est qu’il est mauvais; je rabattrai vingt francs au peintre.» Le jury sait très-bien cela, et il transige avec le pot-au-feu de l’artiste. Ensuite, vous avez ici plus de cent portraits que les peintres n’auraient pas présentés si les modèles s’étaient fait peindre pour leurs parens seulement. Mais c’est pour le public que celui-ci revêt son habit d’ex-ministre, celui-là sa robe rouge de conseiller à la cour, cet autre son uniforme de capitaine de la garde nationale. Ainsi l’amour de l’art, l’état de l’art, le besoin et la vanité, voilà les quatre grandes classifications dans lesquelles il faut ranger les portraits.
— A la bonne heure.
— Vous voilà plus calme. Voulez-vous à présent que nous regardions quelques-uns des portraits devant lesquels nous ne nous sommes pas encore arrêtés ensemble?
— Remettons, s’il vous plaît, à demain. Je suis bien fatigué d’être depuis deux heures sur mes jambes, allant et venant d’un salon dans l’autre, d’un cadre à un autre cadre, poussé à droite, repoussé à gauche, soulevé par le flot des promeneurs à la porte de chaque salle, et étourdi par les rumeurs diverses qui couvraient souvent votre voix, respirant un air empesté et avalant force poussière.
— Eh bien donc! à demain. Mais de bonne heure! A neuf heures précises; nous serons plus tranquilles pendant les deux premiers tiers de la matinée.
— A neuf heures, soit.