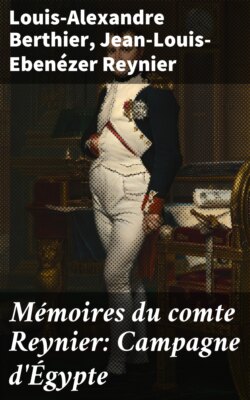Читать книгу Mémoires du comte Reynier: Campagne d'Égypte - Berthier Louis-Alexandre - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DES FELLÂHS OU CULTIVATEURS.
ОглавлениеTable des matières
Les fellâhs, ou cultivateurs de l'Égypte, tiennent beaucoup des Arabes, et sont probablement un mélange de leurs premières immigrations avec les anciens habitans. On retrouve chez eux la même distinction en familles; lorsqu'elles sont réunies dans un même village, elles forment une espèce de tribu. Les haines entre les familles ou les villages sont aussi fortes; mais l'extrême dépendance détruit chez eux l'esprit altier et libre qui distingue l'Arabe. Les fellâhs végètent sous un gouvernement féodal d'autant plus rigoureux qu'il est divisé, et que leurs oppresseurs font partie de l'autorité qui devrait les protéger; ils cherchent cependant toujours à se rapprocher de l'indépendance des Arabes, et s'honorent de les citer pour ancêtres.
Les fellâhs sont attachés par familles aux terres qu'ils doivent cultiver; leur travail est la propriété des mukhtesims ou seigneurs de villages, dont nous parlerons plus bas; quoiqu'ils ne puissent être vendus, leur sort est aussi affreux qu'un véritable esclavage. Ils possèdent et transmettent à leurs enfans la propriété des terres allouées à leur famille; mais ils ne peuvent les aliéner, à peine peuvent-ils les louer, sans la permission de leur seigneur: si, excédés de misère et de vexations, ils quittent leur village, le mukhtesim a le droit de les faire arrêter. L'hospitalité, exercée par les fellâhs comme par les Arabes, leur ouvre un asile dans d'autres villages, où ils louent leurs services et où ils demeurent si leur propriétaire n'est pas assez puissant pour les y poursuivre. Ils sont aussi reçus chez les Arabes. Ceux qui restent dans le village sont encore plus malheureux; ils doivent supporter tout le travail et payer les charges des absens: réduits enfin au désespoir, ils finissent par tout abandonner, et deviennent domestiques des Arabes du désert, s'ils ne peuvent se réfugier ailleurs. On voit plusieurs villages abandonnés, dont les terres sont incultes, parce que les habitans ont ainsi puni des propriétaires trop avides.
Les mukhtesims ou propriétaires de villages peuvent être comparés aux seigneurs du régime féodal; ils perçoivent la plus grande partie du produit des cultures, dont ils forment ensuite deux portions inégales; la plus faible, sous le nom de miry, est l'impôt territorial dû au grand-seigneur, et ils réservent pour eux la plus forte, sous les noms de fays, de barani, etc., etc. Outre ces droits, ils ont, ainsi que les seigneurs féodaux, la propriété immédiate d'une terre nommée oussieh, que les fellâhs doivent cultiver par corvées outre celles qu'ils possèdent.
Un village n'appartient pas toujours à un seul propriétaire, souvent il en a plusieurs. Pour établir clairement cette division des droits, on le suppose divisé en vingt-quatre parties, qu'on nomme karats, et chaque mukhtesim en a un nombre déterminé. Chaque portion du village cultivé par une ou plusieurs familles, a pour cheik un des chefs de ces familles, nommé par le mukhtesim. Celui de ces cheiks qui possède le plus de richesses, qui peut entretenir des cavaliers, et qui a la principale influence dans les querelles et dans les guerres, est reconnu pour cheik principal et traite des affaires générales; mais il n'a d'autorité que dans sa famille; ses avis ne sont suivis dans le reste du village, qu'en raison de la crainte ou de l'estime qu'il inspire.
Outre les cheiks, il y a dans les villages quelques autres fonctionnaires; l'oukil, chargé par les propriétaires du soin des récoltes de l'oussieh; le chahed et le kholi, espèce de notables, dépositaires du petit nombre d'actes qui se font dans les villages; le méchaid, le mohandis, espèces d'arpenteurs, etc., etc.
Le muckhtesim établit quelquefois un kaimakan, ou commandant de village chargé de le représenter, d'entretenir la police, de suivre les cultures, et de veiller au paiement des contributions. Lorsque cet homme est assez bien escorté pour se faire obéir, qu'il ne cherche pas uniquement sa fortune, et que le propriétaire connaît assez ses intérêts pour n'en pas faire l'instrument de ses vexations, il est utile aux villages, parce que les querelles sont plus facilement apaisées, et que la police étant mieux observée, les fellâhs se livrent entièrement à la culture.
Les fellâhs étant cultivateurs et propriétaires, ont plus de sujets de querelles que les Arabes: leurs cheiks n'ayant d'autorité réelle que dans leur famille, il n'existe aucune puissance municipale centrale; si l'un d'eux ne prend pas de prépondérance, si les mukhtesims ne s'accordent pas pour entretenir un kaimakan avec une force armée imposante, l'anarchie s'empare du village, et chaque famille veut venger elle-même ses querelles. Le besoin de s'occuper de la culture des terres les force cependant à des accommodemens; ils cherchent des arbitres ou des juges; mais il n'existe aucune force chargée de faire exécuter ces arrêts. Souvent l'une des parties qui se croit lésée par le jugement s'y soustrait, à moins que quelque homme puissant ne la force à s'y soumettre.
Les kadis, établis dans chaque province pour juger les différends, d'après le Koran, n'ont qu'un faible ascendant d'opinion. On ne s'adresse à eux que pour quelques affaires générales entre plusieurs villages, et pour des discussions d'intérêt où il faut présenter des pièces judiciaires. Les mukhtesims, qui trouvent plus convenable à leurs intérêts d'être juges dans leurs villages; les cheiks arabes qui veulent conserver leurs juridictions, ont écarté les affaires de ces kadis. Les mameloucks ont achevé de les neutraliser et de leur ôter toute considération. Leur avilissement contraint les fellâhs à s'adresser, pour terminer leurs querelles, à des arbitres assez forts pour faire exécuter leurs décisions: ils choisissent les principaux cheiks de leur village ou des villages voisins, des cheiks arabes, leurs propriétaires, ou le kiachef ou bey, gouverneur de la province.
Ces querelles interrompent quelquefois les cultures et les travaux nécessaires à l'irrigation: chacun cherche à piller ou à assassiner un de ses ennemis. On ne poursuit pas le coupable, qui souvent reste inconnu, mais toute la famille en devient responsable, et alors elle entraîne dans sa querelle ses alliés, des villages entiers, et jusqu'aux grandes ligues elles-mêmes; de là des guerres qu'un médiateur puissant a seul la faculté de terminer.
Le gouvernement n'étant pas toujours assez fort pour prévenir et réprimer les attaques auxquelles les villages sont continuellement exposés de la part des Arabes, ou les guerres qui naissent des haines de familles, a dû permettre le port d'armes. Les fellâhs ont, autant que leurs moyens le leur permettent, de mauvais fusils à mèches, des poignards, des sabres, des lances, des bâtons. Lorsqu'ils se croient assez forts pour se libérer du droit de protection qu'ils paient aux Arabes, ils vont en armes labourer ou faire leur récolte. La monture exclusive des cheiks, une jument arabe, est toujours pour eux, lorsqu'ils visitent leurs champs, l'instrument du combat ou de leur fuite. Chaque village établit des gardes pour veiller à la conservation des digues pendant l'inondation. Lorsque la crue du Nil est faible, ils se disputent l'eau. Des enclos flanqués de petites tours crénelées placés vers les puits éloignés des villages servent à défendre leurs troupeaux lorsque l'ennemi paraît.[10]
Les villages, presque tous entourés de murs de terre crénelés, sont autant de citadelles où les fellâhs se retirent avec leurs bestiaux et se défendent, s'ils ne sont pas assez forts en cavalerie pour tenir la campagne. Ces fortifications sont considérées comme presque imprenables par les Arabes et les fellâhs, qui n'ont point d'artillerie et fort peu d'armes à feu. Les mameloucks même évitaient de les attaquer lorsqu'ils pouvaient les soumettre par la douceur ou par la trahison.
Leurs guerres ne sont que des rencontres partielles; ce sont plutôt des assassinats que des combats. Le sang doit être vengé par le sang d'un ennemi, et ces hostilités seraient interminables si le gouvernement, les propriétaires ou les cheiks arabes puissans n'intervenaient pas comme médiateurs armés, et si l'usage du rachat du sang, en faisant payer des amendes aux deux partis, et des indemnités pour les familles qui ont perdu le plus d'hommes, ne suspendait pas les haines éternelles de famille à famille.[11]
Cet état de guerre presque continuel, ces alliances, ces ligues générales, habituent les fellâhs à résister aux vexations de leurs propriétaires et du gouvernement, lorsque des circonstances s'opposent à l'envoi de forces suffisantes. De là des révoltes très fréquentes dans certaines provinces, et particulièrement dans celles où les Arabes sont nombreux.
On pourrait difficilement imaginer des hommes plus malheureux que les fellâhs d'Égypte, s'ils connaissaient un terme de comparaison, si leur caractère et leurs préjugés religieux ne les portaient pas à la résignation, et s'ils n'étaient pas persuadés que le cultivateur ne doit pas jouir d'un meilleur sort. Ce n'est pas assez qu'ils paient au gouvernement et aux mukhtesims la plus grande partie du produit de leurs récoltes, qu'ils soient employés gratuitement à la culture des terres d'oussieh, que leurs mukhtesims aggravent tous les jours les droits qu'ils en tirent, les commandans de province exigent encore d'eux la nourriture de leurs troupes, des présens, et toute espèce de droits arbitraires dont les noms ajoutent l'ironie à la vexation, tels que raf el medzalim, le rachat de la tyrannie, etc. C'est peu que la justice soit nulle ou mal administrée; qu'ils doivent payer pour l'obtenir; que, ne le pouvant pas, et se la rendant eux-mêmes, ils soient obligés d'acquitter des amendes; que la fuite même puisse difficilement les soustraire à ces vexations, il faut encore, pour les achever, que les Arabes dont ils sont entourés les forcent à payer leur protection contre les autres tribus, protection nulle en effet, puisque, malgré cela, ils n'en partagent pas moins les dépouilles et les récoltes de leurs protégés; et lorsque le gouvernement poursuit les Arabes, les pertes et les punitions retombent encore sur les pauvres fellâhs, qu'ils ont contraints de s'attacher à leur sort.
On doit attribuer à cet état misérable l'indolence générale des fellâhs, leur sobriété, leur dégoût pour toute espèce de jouissance, et l'habitude d'enterrer l'argent, qui leur est commune avec toutes les classes. Certains d'attirer sur eux, par une apparence de bien-être, l'attention, et des avanies quelquefois plus fortes que leurs moyens, ils ont le plus grand soin de cacher ce qu'ils possèdent. Bien différens des fermiers d'Europe, qui mettent leurs plus beaux vêtemens lorsqu'ils vont chez leurs propriétaires, les fellâhs ont soin de se couvrir de haillons lorsqu'ils doivent paraître devant les leurs.