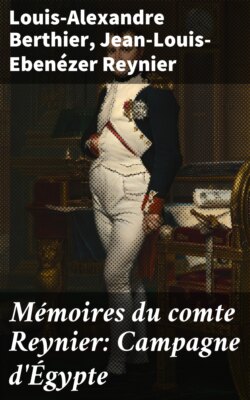Читать книгу Mémoires du comte Reynier: Campagne d'Égypte - Berthier Louis-Alexandre - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
NOTICE
SUR
LE GÉNÉRAL REYNIER.
ОглавлениеTable des matières
Reynier (E.), général de division, comte de l'Empire, etc., naquit à Lausanne, le 14 janvier 1771. Issu d'une famille noble, proscrite pour cause de religion, il profita du bénéfice des lois qui réintégraient les descendans des réfugiés dans les droits qu'ils avaient perdus. Il vint en France, se présenta à l'École des Ponts et Chaussées, où il fut admis dans le courant de mars 1790. Il y fit des progrès rapides, mérita les éloges de Prony, Lesage, Perronet, qui se plaisaient à rendre hommage à ses talens, et le proposaient pour modèle à leurs élèves. Ses cours achevés, il fut nommé officier de son arme: mais nous étions en 1792; l'Europe débordait sur la France; l'Assemblée avait déclaré la patrie en danger, Reynier quitta des épaulettes qui ne l'appelaient pas à la frontière. Il entra dans le bataillon du Théâtre-Français, et marcha comme simple canonnier à la rencontre de l'ennemi. Rappelé presque aussitôt par le directeur des fortifications qu'on élevait autour de la capitale, il fut employé comme ingénieur jusqu'à la fin d'octobre qu'il fut nommé adjoint aux adjudans-généraux de l'armée du Nord. Il fit en cette qualité la campagne de Belgique, assista à la bataille de Jemmapes, à celle de Nerwinde, et partagea cette longue suite de revers qu'entraîna la défection de Dumouriez. L'instruction avait fui: l'émigration, les défiances avaient éloigné les hommes capables; Reynier en devint d'autant plus précieux. Il fut fait chef de brigade, et attaché à l'état-major. C'était là que l'appelait son talent. Froid, réservé, peu propre à enlever la troupe, il était d'une aptitude rare aux méditations du cabinet. Personne ne concevait, ne disposait mieux un plan d'attaque, personne ne discutait mieux les chances d'une opération. La coupe, les accidens du terrain fixaient son attention d'une manière spéciale. Il sentait l'importance du champ de manœuvres, et mettait un soin particulier à le bien choisir. Il n'en mettait pas moins à plier le soldat à la discipline. Il avait vu les merveilles qu'avait exécutées son courage, et les revers que l'insubordination, le défaut d'habitude, avaient entraînés; il résolut d'y remédier. Il exerça, organisa mieux la troupe, et vit bientôt les bandes indisciplinées des volontaires, aussi dociles, aussi fermes, que les vieilles demi-brigades avec lesquelles elles combattaient. Ces heureuses tentatives et les succès dont elles furent couronnées, lui méritèrent la confiance du général en chef, dont il devint bientôt l'ami, le confident. Il avait préparé les victoires qui avaient signalé son commandement à l'armée du Nord, il le suivit à celle de Rhin-et-Moselle, qui lui fut déféré après les désastres de Pichegru. En quel état la perfidie de ce général avait mis des troupes long-temps victorieuses! Battues sous les murs de Mayence, elles avaient été ramenées devant Landau, où les maladies et la misère achevaient de les consumer. Les caisses, les magasins, étaient également épuisés. Point d'habits, point de subsistances, point de solde. L'officier était pieds-nus comme le soldat; tous succombaient aux privations. Assurés de l'homme odieux qui s'était chargé de faire périr les braves qui s'immolaient à sa gloire, les Autrichiens restèrent paisibles tant qu'il présida à ces horribles funérailles. Mais il ne fut pas plus tôt rappelé, qu'ils se mirent en mouvement. Ils se flattèrent sans doute d'achever ce qu'il avait si cruellement ébauché, et rompirent un armistice inconcevable dans des circonstances qui le rendaient plus inconcevable encore. Accordée au milieu de la victoire, la cessation des hostilités était repoussée après la défaite, au moment où elle semblait indispensable pour secourir Beaulieu. Cette conduite paraissait étrange; mais ils marchaient, force était de se mettre en mesure. La chose n'était pas aisée; les transports étaient nuls; la cavalerie n'avait que quelques chevaux galeux; l'artillerie s'était vainement épuisée à reformer ses attelages.
Obligé de suppléer à cet affreux dénûment, Reynier sut trouver, assembler des ressources. Il mit à contribution le patriotisme des campagnes; il obtint des vêtemens, réunit des subsistances, attacha des bœufs aux pièces, et l'armée, dont il avait adouci la misère, put enfin se porter sur Kayserlautern. Heureusement l'ennemi ne nous attendit pas. La victoire de Lodi s'était fait sentir sur les bords du Rhin; Wurmser fut obligé d'accourir au secours de Beaulieu. Jourdan s'était avancé sur la Sieg; les Autrichiens affaiblis, battus dans deux rencontres successives, avaient évacué le Palatinat. Ils ne conservaient plus sur la rive gauche que la position retranchée de la Rehute, en avant de la tête de pont de Manheim, et quelques postes autour de Mayence. On les suivit, on emporta une partie des ouvrages; on eût voulu franchir le fleuve et troubler le mouvement que le prince Charles dirigeait sur l'armée de Sambre-et-Meuse; mais on n'avait ni équipages de pont ni moyens de s'en procurer. On fut obligé de perdre un temps précieux à les chercher. Cette opération regardait plus spécialement le général Reynier; il mit à la préparer, une prévoyance, une habileté peu commune. Sans fonds, sans moyens, obligé de recourir au patriotisme qui lui avait déjà fourni des ressources abondantes, il sut l'animer, le stimuler, et lui arracher encore les sacrifices qu'exigeait l'opération secrète qu'il méditait. Il s'adressa aux administrations, aux villages; demanda des bateaux aux unes, des nacelles aux autres, couvrit ces apprêts de mouvemens de troupes, d'artillerie, et groupant tout à coup à Strasbourg et à Gambsem les corps qui devaient tenter le passage du fleuve, il l'effectua avant que l'ennemi eût vent de son dessein. Le général Latour essaya de nous refouler sur la rive gauche; mais battu dans deux actions consécutives, il fut obligé de s'éloigner en abandonnant des prisonniers et une artillerie nombreuse.
À la nouvelle de ces revers, le prince Charles s'arrêta. Il chargea le général Vartensleben de suivre l'armée de Sambre-et-Meuse, et, rassemblant tout ce qu'il avait de forces disponibles, il accourut avec l'intention de reprendre en sous-œuvre ce que n'avait pu faire son lieutenant. Il ne fut pas plus heureux. Arrêté sur les bords de la Murg, obligé de céder le terrain et les villages où il s'était établi, il se retira dans l'espérance de reprendre, dans une action générale, les avantages qu'il avait perdus. Il se déploya dans la plaine qui sépare Malsch de Memkenstram, jeta des corps dans les montagnes du Rosenthal, et attendit les Français dans cette formidable position. Ils ne tardèrent pas à paraître. Leurs masses étaient moins épaisses, leur cavalerie ne s'élevait pas au quart de celle qu'ils avaient à combattre, mais le courage, de bonnes manœuvres, la nécessité de vaincre, suppléèrent aux forces qui leur manquaient, et fixèrent la victoire. Battus le 21 messidor, à Rosenthal, les Autrichiens le furent encore le 22 à Friedberg par l'armée de Sambre-et-Meuse. Hors d'état désormais de contenir les deux armées qu'il avait sur ses ailes, l'archiduc prit le parti de sortir de la position périlleuse où il s'était placé; il nous abandonna Stuttgard, et se retira sur le Danube. Reynier profita de sa retraite pour se mettre en relation avec le duc de Wurtemberg, le margrave de Baden, qu'il réussit à détacher de la coalition. Il ne fut pas moins heureux avec le cercle de Souabe, et parvint ainsi, par d'adroites ouvertures, à affaiblir une armée dont ses conseils et ses dispositions ne tardèrent pas à accroître les revers. Elle s'était retirée derrière les montagnes d'Alb, et se flattait d'accabler les Français au moment où ils déboucheraient dans la plaine. Mais Reynier disposa les colonnes avec tant d'art, leur marche fut si bien coordonnée, si compacte, qu'elles culbutèrent l'archiduc, et le forcèrent, malgré l'obstination avec laquelle il revenait à la charge, à nous abandonner le champ de bataille. La défaite qu'il venait d'essuyer à Neresheim détermina le prince Charles à tenter un mouvement qui lui réussit. Il passa le Danube, rassembla tout ce qu'il avait de troupes lestes, aguerries, et profitant de la pénurie des Français, qui, dépourvus d'agrès, d'équipages de pont, ne pouvaient de sitôt tenter le passage du fleuve, il courut à la rencontre de l'armée de Sambre-et-Meuse. Il la joignit, la culbuta devant Amberg. Il reporta aussitôt un corps de douze mille hommes d'élite sur la ligne qu'il venait de quitter et se mit sur les traces de l'armée battue. Il l'atteignit à Wurtzbourg, l'attaqua, la défit encore, et menaça les communications de celle qui s'étendait dans la Bavière. Latour avait déjà marché contre les corps qu'elle avait devant la tête de pont d'Ingolstadt. Culbuté à Gessenfeld, taillé en pièces à Freiseing, il avait recueilli ses forces, et s'avançait de nouveau sur nous. D'une autre part, les garnisons que le prince Charles avait jetées dans les places qu'il conservait sur le Rhin, s'étaient réunies sur nos derrières. Le corps du Tyrol se portait sur la droite; notre position devenait critique. Moreau résolut néanmoins de tenter un dernier effort pour dégager l'armée de Sambre-et-Meuse. Il voulut à son tour donner des inquiétudes à l'archiduc sur ses derrières, et chargea le général Reynier de faire les dispositions qu'exigeait le mouvement. L'armée se rassembla vers Friedberg. Desaix passa le Danube; nos troupes s'avancèrent dans toutes les directions. Elles joignirent Latour, qui marchait à leur rencontre, le culbutèrent après un combat des plus vifs, et se répandirent jusqu'à Heidek. Mais rien n'arrivait par la route de Nuremberg; le prince Charles tirait tout de la Bohême; Desaix replia ses troupes, et la retraite de l'armée commença. Elle fut calme, sans désordre, telle qu'on pouvait l'attendre d'un homme froid, méthodique, comme celui qui en arrêtait les dispositions. En vain l'archiduc abandonnant les traces de l'armée de Sambre-et-Meuse, qui précipitait sa marche sur Neuwied, essaya-t-il d'intercepter nos derrières; en vain le général Saint-Julien chercha-t-il à nous déborder sur la droite; l'armée regagna les bords du Rhin, sans perte, sans échec. Ni les troupes descendues du Tyrol, ni celles qui la pressaient de front ne purent l'entamer. Reynier, que la confiance de son chef avait en quelque sorte investi du commandement, régla, disposa les marches, les mouvemens, avec une sagacité, un ensemble, qui lui méritèrent des éloges universels. Mais cette confiance si pleine, si entière, ne tarda pas à lui devenir fatale. La conduite de Moreau excita des soupçons. On le blâma d'avoir long-temps tenu secrets des projets coupables, et de ne les avoir divulgués que lorsque la connaissance ne pouvait plus en être utile. Du général les accusations descendirent au chef d'état-major. On refusa de croire qu'il n'y eût pas complicité; on ne put se persuader que dans l'intimité où ils étaient ensemble l'un ne fût pas au courant des projets de l'autre. Reynier fut victime de cette fausse conviction, et mis à la réforme. Desaix, qui s'intéressait vivement à lui, ne put, malgré ses instances, faire révoquer une mesure aussi rigoureuse[1]. Bonaparte fut plus heureux; il le plaça au nombre des généraux qui devaient former son état-major, et lui fit expédier des lettres de service pour l'armée qu'il allait conduire en Orient.