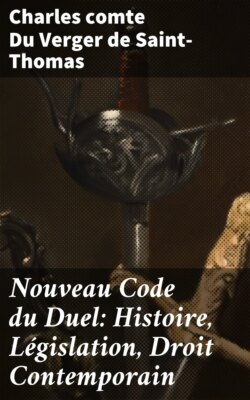Читать книгу Nouveau Code du Duel: Histoire, Législation, Droit Contemporain - Charles comte Du Verger de Saint-Thomas - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE PREMIER
PRÉCIS HISTORIQUE SUR LE DUEL ET SUR SA LÉGISLATION JUSQU'A LA RÉVOLUTION DE 1789.
ОглавлениеTable des matières
Le duel, tel que nous aurons à le définir plus tard, est une institution toute moderne que les anciens ne connurent jamais, dont ils n'eurent pas même l'idée, car ils ne connurent jamais ce que, dans nos mœurs, on appelle le point d'honneur.
D'ailleurs, les anciens n'étaient point chrétiens, et le duel est une institution chrétienne, car il représente la foi complète dans l'omniscience et dans l'ingérence divines, sentiments inconnus des païens, et que nous verrons plus tard servir de base au jugement de Dieu, dont le duel moderne est le successeur direct.
En entrant dans le champ clos, un chevalier prononçait cette formule: «Me voici prêt avec l'Évangile d'une main, et l'épée de l'autre.» En 971, Vivence, champion du clergé, disait: Ecce me paratum cum Evangelio et scuto et fuste.
Les souverains accordaient la prérogative de décerner la patente du camp à des évêques, à des chapitres. En 1028, l'empereur Conrad l'accordait par une charte à Pierre, évêque de Novare.
On trouve encore dans les anciens missels: Missa pro duello. Basnage cite des prêtres, des moines, des évêques, des cardinaux et des papes, lesquels non seulement ont admis, mais pratiqué et même imposé le duel. Selon cet auteur, le pape Martin IV lança une censure, même une excommunication: «pour défaut de comparution sur le terrain». Nicolas Ier appelait le duel un combat légitime. Le pape Eugène III disait à propos du duel: Utimini consuetudine vestra.
Il n'en est plus de même aujourd'hui: l'Église s'est unie au bras séculier pour défendre le duel. (Voir 3e partie, Pièces justificatives, no VII, Décret du concile de Trente.)
Et pourtant, en consultant les plus anciens et les plus célèbres historiens romains, on remarque que dans les premiers âges de la fondation de Rome, ses habitants ne connurent d'autres juges pour le partage de leurs biens que le hasard des combats.
Laissant à part l'enlèvement des Sabines, ce célèbre combat motivé par le besoin de satisfaire à des nécessités conjugales, et ensuite la lutte entre les Horaces et les Curiaces, ces usages régnèrent jusqu'à la publication de ce recueil de lois dues à la sagesse des législateurs romains, lequel, après avoir traversé la suite des âges, constitue encore aujourd'hui la base de toutes nos législations contemporaines.
Les Gaulois, ce peuple entreprenant, guerrier, ami des querelles et des discussions, ne pouvaient manquer de pousser ce caractère batailleur jusqu'à ses dernières limites. Toujours armés (usage qui ne se rencontrait ni chez les Grecs ni chez les Romains), ils avaient toutes facilités pour satisfaire leurs inclinations. Faute de trouver des ennemis à combattre, ils se battaient entre eux. Chez eux les combats singuliers devinrent une sorte de divertissement public que nous verrons plus tard se perpétuer jusque dans le moyen âge. Les différends se terminaient par les armes; c'était également par les armes que les témoins fournissaient les preuves de leur témoignage. Le sanctuaire même où résidaient leurs dieux ne leur semblait pas profané par cette coutume. La chaise curule du grand prêtre, chef des Druides, devenait le prix d'un combat singulier entre ceux qui ambitionnaient sa succession.
Les compagnes de nos ancêtres partageaient les instincts belliqueux de leurs époux. Elles conservaient dans leur sein le germe de cet esprit guerrier fidèlement transmis à leurs descendants.
Le gracieux et sympathique auteur du Mérite des Femmes, M. Legouvé, a consacré de bien belles pages à nous représenter la femme comme toujours supérieure à notre sexe.
Ange consolateur de la famille, la femme supporte avec une indomptable énergie de grandes infortunes qui trompent la vigueur du sexe fort; son dévouement inépuisable la porte à faire en souriant le sacrifice de sa vie pour le salut des êtres qui lui sont chers. Et, sans remonter bien haut, n'avons-nous pas vu la belle et vaillante princesse Marie-Pie, reine de Portugal (digne fille de notre ancien et bien-aimé souverain Victor-Emmanuel dont tout un peuple pleure aujourd'hui la perte prématurée), n'avons-nous pas vu la femme courageuse terrifier des courtisans affolés, en s'élançant elle-même dans les flots pour reconquérir ses enfants emportés par les vagues envahissantes?
Aux nobles princes, ses aïeux, la bravoure dans les combats, le courage militaire! A la femme couronnée, le dévouement maternel, le courage civil!
Dans sa faiblesse même, la femme puise l'admiration pour la force. Tout indice de pusillanimité lui fait regarder comme indigne de son affection, celui-là même qu'elle eût volontiers choisi pour son protecteur.
La finesse exquise, le tact infiniment supérieur de la femme, les sentiments généreux qui abondent dans son cœur, impriment à ses jugements le cachet de la vérité.
Aussi, n'hésitons-nous pas à regarder cette gracieuse moitié du genre humain comme le meilleur juge du point d'honneur.
Avez-vous remarqué ce jeune homme lancé dans une discussion irritante qui côtoie l'agression et va peut-être bientôt dégénérer en violence? Tout à coup l'orage s'apaise. On le voit reprendre le ton courtois de la bonne société... Un simple regard de l'objet aimé l'a ramené dans la bonne voie.
La tendresse de la femme patronnant la cause de la justice et de la raison ne lui donne-t-elle pas le droit au commandement sur tout homme de cœur?
La femme voit-elle l'objet de ses préférences subir une insulte aussi grave qu'imméritée, un regard calme et fier viendra l'encourager à suivre le sentier de l'honneur. Comment pourrait-il y manquer, puisqu'il a la certitude que son courage sera partagé?
C'est encore dans le sentiment de l'honneur que la femme puise la force nécessaire pour donner l'exemple de deux vertus qui lui sont pourtant si souvent contestées: le silence et la discrétion.
Citons un exemple:
Il y a quelque vingt ans, dans une armée étrangère, une querelle entre deux honorables officiers nécessite un duel à outrance. Pour des motifs que nous ne croyons pas devoir préciser, la rencontre ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du terme de trois mois.
Pendant cette longue attente, des mères, une femme, des sœurs, les deux familles enfin, cachent leurs angoisses, leurs inquiétudes, jusqu'au jour du dénouement qui mit l'un des champions hors de combat et fit craindre pendant quelque temps pour la conservation de ses jours.
A quel puissant mobile attribuer un si long silence, une pareille discrétion, si ce n'est au profond sentiment de respect pour le point d'honneur!
Nous le répétons, les sentiments généreux, le respect pour le point d'honneur, l'amour-propre ne sont pas moins développés chez les femmes que chez les hommes. Les mères et les épouses n'aiment point seulement la personne, mais plus encore, si c'est possible, la considération et la dignité de ceux qui leur sont chers.
Et les fiancées surtout, n'ont-elles point voix au chapitre? Souffriront-elles que l'objet de leurs plus chères affections, celui qui doit être bientôt pour elles un protecteur, soit livré au ridicule, aux sourires, aux dédains dans la société? L'amour-propre n'emporte-t-il pas tout?
Jeune homme, si vous osez vous révolter contre l'opinion, vous êtes médusé, quand bien même vous vous seriez assuré l'appui de quelques douairières bien pensantes, en étalant la rigidité de principes du pratiquant, amorce infaillible, rivale de la liqueur à carpes Moriçaud, dans la pêche... à la dot!... Tout est inutile! Une violente secousse brise inopinément la mort-à-pêche!
Quoi qu'il en soit de cette digression, faite pour accidenter la sécheresse de notre course au clocher dans les domaines de l'histoire, c'est chez les peuples barbares dont les diverses agglomérations ont donné naissance aux sociétés modernes, que l'on s'accorde généralement à reconnaître la véritable origine du duel qui dut passer par diverses phases sociales avant de devenir ce qu'il est de nos jours.
Ainsi, le duel nous apparaît d'abord comme une institution judiciaire, un mode de preuve adopté dans les procès, pour obtenir l'éclaircissement des faits contestés.
En justice, il est un principe admis: c'est qu'il appartient au demandeur de fournir la preuve des faits qu'il avance; dans le cas contraire, le défendeur est renvoyé de la plainte.
Des lois barbares méconnurent ce principe en ordonnant que le défendeur prêtât le serment. (Loi des Visigoths, lib. II, tit. II, c. V).
La dissolution progressive des mœurs, l'affaiblissement graduel des caractères et l'abus du serment lui-même, qui n'était plus réservé pour des cas extrêmes, atténuèrent le respect pour la religion du serment qui, au temps de Rome antique, avait enfanté des prodiges.
Placé entre l'alternative de se condamner par un aveu ou de se libérer par un parjure, le défendeur jurait. Pour suppléer à l'insuffisance du serment, on imagina d'exiger que la véracité de celui qui le prêtait, fût attestée par un certain nombre de personnes: conjuratores sacramentales. Le nombre de ces certificateurs de serment était déterminé par la loi, suivant l'importance du procès. (Lib. VI, cap. I, Alamannorum.) Ils juraient sur l'Evangile en même temps que leurs clients. En multipliant les serments, on multiplia les parjures. C'est pour faire disparaître cet abus que fut institué le combat judiciaire.
L'usage de ce combat fut consacré pour la première fois dans la loi des Bourguignons connue sous le nom de loi gombette (du nom de Gondebaud son auteur, tit. XLV).
Cette institution se généralisa bientôt et s'introduisit successivement dans les habitudes juridiques des autres peuples barbares. On la rencontre dans les lois des Francs ripuaires, dans celles des Allemands, des Bavarois, des Thuringiens, des Frisons, des Saxons et des Lombards. L'histoire romaine (Velleius Paterculus, lib. II, 118) nous apprend que c'était la coutume des anciens Germains de terminer par les armes, leurs différends privés.
La loi salique, sauf dans quelques cas très rares et exceptionnels, n'admettait ni la preuve négative par serment ni le combat judiciaire. On observa bientôt combien les mœurs l'emportent sur les lois écrites: cette loi tomba dans l'oubli, et le combat judiciaire s'établit, même parmi les peuples qu'elle régissait.
Au IXe siècle, ce préjugé avait pris de si profondes racines dans les habitudes publiques, et les abus du système qu'il avait remplacé étaient si grands que Charlemagne crut devoir le tolérer par une disposition expresse. (L. Longobard., lib. II, tit. LV, 1, 23.) Forcé d'opter entre deux maux, ce souverain s'efforçait de choisir le moindre.
Cependant, dès son origine même, le combat judiciaire dut essuyer les résistances et les protestations de l'Église. Saint Avit, archevêque de Vienne, adressa à Gondebaud lui-même ses remontrances. Plus tard, saint Agobard, archevêque de Lyon, sollicita énergiquement auprès de Louis le Débonnaire l'abolition de la loi gombette et le retour à la loi salique. L'Église ne se borne pas à adresser de simples remontrances aux souverains, elle établit des peines.
Ainsi on remarque dans les actes du 3e concile de Valence, tenu l'an 855, sous le pontificat de Léon IV, un canon qui déclare assassin celui qui en pareil combat se sera rendu coupable d'homicide ou de blessures graves, le bannit de l'assemblée des fidèles, etc., etc.
Quiconque aura succombé dans le combat, sera considéré comme s'étant suicidé et sera privé de la sépulture ecclésiastique. (Concile de Valence, canon 12.)
Le pouvoir ecclésiastique soutint la lutte dans deux conciles, en demandant que la véracité d'une charte produite pour prendre possession d'un héritage fût certifiée par le serment dans les églises. Les seigneurs persistaient de leur côté à demander le jugement de Dieu, c'est-à-dire la preuve par combat.
Enfin, l'empereur Othon II donne gain de cause à la noblesse par une constitution publiée l'an 969 (V. L. Longobard., lib. II, tit. LV, cap. XXXIV).
La force d'impulsion fut telle que le combat judiciaire pénétra jusque dans les tribunaux ecclésiastiques, et, non seulement les parties contondantes, mais les témoins et même les juges pouvaient être appelés en champ clos (Voir l'Esprit des lois, liv. XXI, chap. XXIII et suivants). Les femmes soutenaient leurs querelles par le moyen de champions.
Cependant avec le temps, la raison commença à prendre le dessus. Les tribunaux ecclésiastiques se mirent à obéir aux injonctions pontificales. La réaction qui s'opérait déjà dans les esprits, se manifesta dans la charte accordée par le roi Louis le Jeune à la ville d'Orléans, en 1168. Cette charte porte qu'il ne pourra y avoir bataille entre deux parties pour une dette de cinq sols et de moins (Laurière, t. I, page 15).
Le premier de nos rois qui ait cherché à abolir le combat judiciaire, fut saint Louis: ce sage prince, persuadé que la meilleure autorité d'un chef, c'est l'exemple, le donna lui-même dans ses domaines, espérant avec juste raison que l'exemple du souverain influerait sur la conduite des barons.
Par son ordonnance ou établissement, en date de l'an 1260, il substitua au combat judiciaire la preuve par témoins et réduisit le nombre des cas dans lesquels ce combat pourrait être demandé. Ses ordonnances sont contenues dans l'important recueil appelé Établissements de saint Louis.
Il est bon d'observer qu'à cette époque de désordre social, outre les préjugés invétérés et les habitudes chères à la noblesse belliqueuse, il existait encore un abus plus important et non moins déraisonnable que le combat judiciaire: celui des guerres privées que se faisaient les seigneurs entre eux et les villes entre elles. Cet abus déplorable était dans toute sa force, lorsque saint Louis monta sur le trône.
Ce sage prince fit d'abord admettre ce que l'on appela la trêve de Dieu. Pendant un intervalle de 40 jours à dater de l'offense, les voies de fait étaient interdites.
Philippe le Bel continua l'œuvre réformatrice de son père. Son ordonnance de 1296 défendait les guerres privées pendant tout le temps que durerait la guerre du roi. Pendant le même temps le combat judiciaire était également défendu, et les procès devaient se terminer par les voies ordinaires.
L'ordonnance de 1303 renouvela les mêmes défenses. Les malfaiteurs n'en furent que plus audacieux, quand ils pouvaient commettre leurs méfaits sans témoins. Le nombre des crimes ne fit que s'accroître, et, en 1306, Philippe le Bel, dans une nouvelle ordonnance, accepte le retour aux gages de bataille.
Le dernier combat judiciaire eut lieu en 1387, sous le règne de Charles VI (le premier qui porta le titre de Dauphin de France), entre messire Jean de Carrouge, seigneur d'Argenteuil, et Jacques Legris, tous deux vassaux du duc d'Alençon. Jean de Carrouge ayant cité par-devant le parlement le sieur Legris, comme ayant attenté à l'honneur de sa femme, le parlement déclare qu'il échoit gage, ordonne le combat, et Legris fut tué. On reconnut son innocence dans la suite.
Ce qui amena peu à peu l'abolition du combat judiciaire, ce fut précisément l'attribution exclusive conférée au parlement de Paris du droit de l'ordonner, quand il y aurait lieu, dans toutes les parties du royaume, sans distinction.
On ne saurait donner la date précise de cette réforme; mais ce que l'on peut assurer, c'est qu'elle s'accomplit progressivement à mesure que la juridiction du roi empiéta sur celle des seigneurs et par suite de l'affranchissement des communes, lesquelles préférèrent naturellement faire juger leurs querelles par leurs échevins plutôt que par les seigneurs qui s'étaient soigneusement réservé le droit de donner le gage de bataille.
Cependant, tandis que le préjugé du combat judiciaire s'affaiblissait de jour en jour, l'habitude des guerres privées opposait à nos rois une résistance opiniâtre. Le règne de Jean II, surtout, fut fécond en édits d'une grande sévérité, justifiés d'ailleurs par la présence des Anglais au cœur de la France.
Quand les résistances durent céder devant l'autorité royale, au lieu de disparaître entièrement, l'abus ne fit pour ainsi dire que se transformer, et c'est alors que prit naissance un autre abus qui tenait à la fois du combat judiciaire et des guerres privées.
Nous voici arrivés au Duel.
Cette transformation commença à la fin du XIVe siècle, et se poursuivit pendant le XVe.
On présentait au roi une requête, pour obtenir l'autorisation de combattre en champ clos. L'autorisation obtenue, le cartel était signifié par un héraut d'armes, au nom du Roi.
Le roi assistait à ces combats, et lorsqu'il croyait devoir y mettre fin, jetait son sceptre entre les combattants.
Ainsi agit François Ier dans le combat qui eut lieu, avec son autorisation, entre deux gentilshommes du Berry, les sieurs Vermiers et Harzay.
Le duel n'était permis qu'aux nobles, et au roi seul appartenait le droit de décerner les combats (Etienne Pasquier, Recherches sur la France, liv. IV, chap. XV).
François Ier avait refusé à deux gentilshommes de sa cour, François de Vivonne, seigneur de la Chasteigneraye, et Guy Chabot, seigneur de Montlieu, connu sous le nom de Jarnac, la permission de se battre; ceux-ci obéirent, attendirent le règne de Henri II, son successeur: ce prince, par son ordonnance de 1547, autorisa le duel.
La Chasteigneraye, son favori, ayant succombé (telle est l'origine du coup de Jarnac), il jura de ne jamais plus accorder semblable autorisation.
Sous le règne de Henri II commença une nouvelle phase dans l'histoire du duel. Quand on ne put plus obtenir l'autorisation royale, on s'en passa, et les duels se multiplièrent d'une manière effrayante.
Un abus aussi monstrueux ne pouvait être toléré par l'Église, qui avait si énergiquement protesté contre le combat judiciaire.
Le concile de Trente, par un canon (encore en vigueur aujourd'hui) de l'année 1563 (Session 25, De Reformatione, chap. XIX) fulmina l'excommunication non seulement contre les combattants, mais contre les parrains (témoins), et priva de la sépulture chrétienne ceux qui trouvaient la mort dans le combat. (Voir ce canon aux Pièces justificatives, page 453.) Nous résumerons ici les règles que les duellistes reconnaissaient au XVIe siècle (Voir Brantôme, Discours sur les duels).
Il commence par recommander de ne pas se battre sans témoins, d'abord pour ne pas priver le public d'un beau spectacle, et ensuite, pour ne pas s'exposer à être recherché et puni comme meurtrier.
«Les combattants, ajoute-t-il, doivent être soigneusement visités et tastés pour savoir s'ils n'ont drogueries, sorcelleries et maléfices. Il est permis de porter reliques de N. D. de Lorette et autres choses saintes. En quoi pourtant il y a dispute, si l'un s'en trouvait chargé et l'autre non, car dans ces choses, il faut que l'un n'ait pas plus d'avantages que l'autre. Il ne faut pas parler de courtoisie; celui qui entre en champ clos doit se proposer de vaincre ou de mourir, et surtout de ne se rendre point, car le vainqueur dispose du vaincu tellement qu'il en veut, comme de le traîner par le camp, de le pendre, de le brusler, de le tenir prisonnier, bref, d'en disposer comme d'un esclave.» En lisant les mémoires des contemporains, on est édifié sur la quantité de meurtres que l'on regardait comme des duels, on en trouve mille preuves dans les ouvrages de Brantôme, de d'Audiguier, de L'Estoile, de Tallemand des Réaux, etc.
Le pouvoir civil tenta de s'associer à l'Eglise dans la voie de répression.
En 1560, les États généraux réunis à Orléans avaient présenté leurs doléances et leurs demandes pour obtenir la répression des duels. Le roi Charles IX y fit droit par une ordonnance rendue à Marchois en 1566 (en même temps que la célèbre ordonnance de Moulins, mais par un acte séparé) et dont l'honneur revient au chancelier de L'Hôpital. Cette ordonnance défend aux gentilshommes de vider leurs querelles par des combats, leur enjoint de soumettre les démentis au gouverneur de la province, au connétable et aux maréchaux de France, lesquels décideront de la valeur du démenti et pourront le déclarer nul: en ce cas, celui qui l'aura donné sera tenu d'en faire amende honorable à celui qui l'aura reçu.
Il convient de noter ici un point essentiel: Cette sage ordonnance ne se contentait pas de punir les duels, mais elle s'attachait à les prévenir, en assurant une légitime satisfaction à celui qui aurait reçu un démenti ou toute autre injure. Ce n'est pas tout d'édicter des lois, il faut veiller à leur impartiale exécution. C'était précisément ce qui manquait. Quand les coupables, souvent favoris ou fidèles serviteurs du roi, demandaient grâce, il ne savait pas résister. Le mal ne faisait donc que s'accroître en raison de l'impunité accordée à la faveur.
Pour donner satisfaction à l'opinion publique et faire droit aux réclamations formulées par les États généraux, rassemblés à Blois en 1575, une ordonnance royale, rendue dans cette ville en 1579, confirme par son article 194 les précédents édits, et l'article 278 déclare criminels de lèse-majesté les gentilshommes qui se réuniraient pour vider leurs querelles particulières.
Ce fut en 1580 que s'introduisit la règle pour les seconds de prendre fait et cause pour leurs tenants; jusque-là, ils n'avaient été que témoins. Ce déplorable usage est, avec juste raison, blâmé par Montaigne.
«C'est une espèce de lâcheté, dit-il, qui a introduit dans nos combats singuliers cet usage de nous accompagner de seconds, tiers et quarts. C'étaient anciennement des duels; ce sont à cette heure rencontres et batailles. Outre l'injustice d'une telle action et vilenie d'engager à la protection de notre honneur autre valeur et force que la nôtre, je trouve du désavantage à mesler sa fortune à celle d'un second. Chacun court assez de hasard pour soye, sans le courir encore pour un aultre.»
Parmi les plus célèbres duellistes de cette époque, nous devons citer les Mignons de Henri III. La manie des querelles était du reste devenue si commune que Montaigne disait: «Mettez trois Français aux déserts de Lybie, ils ne seront pas un mois ensemble sans se harceler et s'égratigner.»
Les temps étaient-ils bien propices pour opérer une pareille réforme, au moment où les passions étaient surexcitées par les luttes religieuses, où les partis étaient en armes, quand le pouvoir était lui-même chancelant par suite des désordres d'une guerre civile?
Était-il possible d'espérer triompher d'habitudes profondément invétérées dans les mœurs de la noblesse et d'autant plus puissantes qu'elles étaient fondées sur un sentiment noble en soi et fécond en généreuses inspirations, le sentiment de l'honneur?
Henri III ne possédait dans son caractère ni assez de fermeté ni assez de grandeur pour dominer la situation. Les historiens contemporains nous le prouvent surabondamment en nous racontant que lors du célèbre duel entre Caylus et Maugiron, et qui coûta la vie à tous les deux, le roi au lieu de punir Caylus, ne quittait point son chevet, lui présentait lui-même les bouillons, et faisait les plus belles promesses aux chirurgiens, s'ils conservaient la vie à son favori (Brantôme, Mémoire touchant les duels; Pierre de L'Estoile et d'Audiguier, le Vrai en ancien usage des duels).
Le mal, aggravé par les troubles de la Ligue, était arrivé à son comble au moment de l'avénement de Henri IV (1589).
Ce prince s'applique à en tarir la source, en apaisant par son influence personnelle les différends des seigneurs de sa cour. Le parlement seconda les efforts du souverain par la rigueur qu'il déploya contre les duellistes, lesquels, dans son Arrêt de règlement en date du 26 juin 1599, il déclara criminels de lèse-majesté et perturbateurs du repos public, etc.
Nous avons déjà vu plus haut que l'ordonnance de Blois en avait agi de même pour les assemblées de gens faites pour vider les querelles particulières ou autres. En effet, le droit de rendre la justice est l'attribut le plus précieux et le plus essentiel de la souveraineté, et, se faire justice soi-même, c'est usurper le droit du souverain, c'est offenser la majesté royale.
Dans nos institutions modernes, le droit de justice est délégué à la magistrature qui rend les arrêts au nom du souverain.
En avril 1602, intervint un édit royal donné à Blois, pour la défense des duels. Cet édit prononçait la peine du crime de lèse-majesté, c'est-à-dire, la mort et la confiscation totale des biens, contre les duellistes et contre ceux qui les seconderaient en quelque manière que ce fût, et ordonnait à la partie offensée d'adresser sa plainte au gouverneur de la province, au connétable et aux maréchaux de France pour obtenir la réparation de l'injure qu'elle avait soufferte.
Telle fut l'origine de la juridiction du point d'honneur.
L'excessive sévérité de cet édit produisit l'effet diamétralement contraire au but du législateur. Sully, dont les prévisions à cet égard eussent dû être écoutées, avait fait de vifs efforts pour obtenir que les peines prononcées fussent plus douces, et par conséquent, plus facilement et plus rigoureusement appliquées.
De là, nombreuses lettres de grâce; de là, scandaleuse impunité.
Sully, paraît-il, possédait un don bien essentiel pour gouverner les hommes et les choses, l'esprit pratique!
Les auteurs contemporains et notamment Pierre de l'Estoile (sur l'année 1609, 27 juin), nous apprennent que depuis l'avénement de Henri IV en 1589, jusqu'à la fin de l'année 1608, sept mille lettres de grâce auraient été expédiées en matière de duel, et sept ou huit mille gentilshommes auraient péri en combat singulier dans le même intervalle.
Ces résultats accusaient hautement les vices de l'édit de 1602, et démontraient péremptoirement l'inutilité de toute réforme qui heurterait de front le préjugé dominant. Aussi, fut-on bientôt amené à lui faire des concessions, c'est-à-dire à tolérer le duel comme un mal nécessaire quand l'honneur des parties semblerait l'exiger. C'est dans cet esprit que le roi Henri IV publia l'édit de Fontainebleau, en juin 1609. Le combat pouvait être accordé par le roi ou par le tribunal des maréchaux, lorsqu'ils le jugeraient indispensable pour réparer l'honneur offensé.
Par contre, l'édit prononçait contre les duels non autorisés, des peines plus ou moins sévères selon la gravité des cas. Ainsi, si l'un des combattants succombait, il y avait peine de mort et confiscation des biens contre le survivant; privation de sépulture pour celui qui avait succombé.
Pour une simple provocation non suivie de combat, le provocateur était privé de ses charges, et, en outre, déclaré «deschu de pouvoir jamais se comparer par les armes à aucun».
Le roi faisait défense à la reine, aux princes de son sang, de lui demander aucune grâce, protestant qu'il n'en accorderait aucune.
Cet édit fut d'un excellent effet (Voir d'Audiguier et plus tard le Préambule de la déclaration de 1611). La licence des duels fut réprimée; on ne cite aucun cas où l'autorisation de combattre fut accordée. Le roi lui-même, par son intervention personnelle, évita souvent l'effusion du sang. Son caractère chevaleresque, sa bravoure reconnue, le rendaient éminemment propre à accomplir cette mission toute conciliatrice, digne d'un bon père de famille désireux de conserver tous ses enfants.
Parmi les affaires arrangées durant le cours du règne du bon roi Henri IV, on cite principalement celle de Duplessis-Mornay, dit le Chevalier théologien, avec un gentilhomme nommé Saint-Phalle, qui l'avait bâtonné en pleine rue et laissé pour mort sur le pavé (Voir le Journal de Pierre de l'Estoile, et le Recueil imprimé concernant le tribunal des Maréchaux, tome I, page 344); celle du prince de Joinville avec le sieur de Bellegarde, grand écuyer de France; enfin, celle de Charles de Bourbon, comte de Soissons, proche parent du roi, avec le ministre Sully que le prince accusait d'avoir tenu des propos injurieux contre sa personne (Voir Pièces justificatives, page 409).
Après la mort d'Henri IV, arrivée peu de temps après la promulgation de l'édit de 1609, la fureur des duels recommença, et continua pendant la minorité de Louis XIII. On éludait la loi en représentant le duel sous les apparences d'une rencontre fortuite. Afin d'ôter cette ressource aux duellistes, intervint une déclaration du roi, portant défense d'user d'appels ou de rencontres suivant l'édit de 1609. Donnée à Paris, le 1er juillet 1611, cette déclaration fut enregistrée le 11 du même mois au parlement de Paris.
Une autre déclaration du roi, donnée à Paris le 18 janvier 1613, prescrivait une nouvelle publication de l'édit de 1609, ordonnait aux gentilshommes qui se croiraient offensés de se pourvoir, dans le délai du mois, par-devant le tribunal des maréchaux, sauf, passé ce délai, à subir la juridiction des tribunaux ordinaires. Cette déclaration réserve aux parlements et aux tribunaux ordinaires la connaissance des poursuites relatives aux duels et rencontres, à l'exclusion de tous juges d'exception, et notamment de la prévôté de l'Hôtel. Elle fut confirmée par lettres patentes adressées au parlement de Paris, le 14 mars suivant.
Cette déclaration du roi contre les duels, en date de 1613, avec protestation de n'en accorder jamais la grâce, fut faite à l'occasion du duel du baron de Luz, tué par le chevalier de Guise.
Chose digne de remarque, peu de temps après, le même chevalier de Guise tua le fils du baron de Luz; on n'en fit aucune recherche, parce qu'alors la reine ménageait MM. de Guise, pour les détacher du parti du prince de Condé. Dans ce temps-là, la politique interceptait parfois le cours de la justice. Pouvons-nous répondre qu'il en soit autrement de nos jours?
Un arrêt de la cour du parlement, sur l'exécution de l'édit sur les duels et combats, parut le 27 janvier 1614.
Autre déclaration du roi sur les édits de pacification et sur les duels et rencontres, donnée à Paris le 1er octobre 1614.
Les rigueurs contenues dans l'édit de 1609 ayant paru insuffisantes, on les aggrava par les lettres patentes du 14 juillet 1617, qui donnèrent lieu à l'arrêt du parlement sur l'exécution de l'édit contre les duels et combats, en date du 6 mars 1621.
Plus rigoureux encore fut l'édit de Saint-Germain-en-Laye, en date du mois d'août 1623, et publiant une amnistie. Cet édit effaça les distinctions établies par la sagesse du législateur de 1609 entre des faits d'une culpabilité souvent inégale. Tout y est confondu. Le fait principal et la participation même la plus indirecte à ce fait sont punis de la même peine.
Cette aggravation dans la pénalité était loin de procurer la diminution des duels. Ils allaient au contraire en croissant.
«Les duels, nous dit Richelieu dans ses Mémoires (Collection Petitot, page 40 et suivantes), étaient devenus si communs, que les rues commençaient à servir de champ de combat, et comme si le jour n'était pas assez long pour exercer leur furie, ils se battaient à la faveur des astres et à la lumière des flambeaux qui leur servaient d'un funeste soleil.»
Ces lois ne pouvaient avoir d'influence, et les peines terribles qu'elles édictaient, n'étaient presque jamais exécutées. Les coupables se dérobaient aux recherches de la justice et, plus tard, obtenaient des lettres d'abolition, motivées même sur la gravité des peines qu'ils avaient encourues.
Plus tard, arrêt du parlement contre les sieurs Bouteville, comte de Pongibaud, le baron de Chaulais et des Salles, pour s'être battus en duel le jour de Pâques (24 avril 1624).
Ordonnance du roi portant défense aux seigneurs de favoriser les duels, en date du 26 juin 1624.
Arrêt du parlement contre ceux qui se sont battus en duel, 28 du mois de janvier 1625.
Édit du roi sur les faits de duels et de rencontres, donné à Paris en février 1626.
Cet édit fut un nouvel essai législatif tenté en même temps que l'on publiait une seconde amnistie générale à l'occasion du mariage d'Henriette de France avec Charles Ier roi d'Angleterre. Richelieu nous apprend qu'il exerça sur la rédaction de ces édits une influence décisive.
Il fit rejeter la proposition de permettre le duel en certains cas, mais il fit prévaloir un système de sévérité modérée et proportionnée à la gravité des circonstances:
Le simple appel comportait la privation des charges et offices, la confiscation de la moitié des biens et le bannissement pendant trois années.
Le duel non suivi de mort emportait la perte de la noblesse, l'infamie et la peine capitale suivant le degré de criminalité.
Les peines du crime de lèse-majesté, c'est-à-dire la mort, et de la confiscation totale des biens étaient appliquées en cas de mort de l'un des combattants.
La sévérité des anciennes ordonnances pouvait être encore appliquée quand l'atrocité des faits semblait mériter un châtiment exemplaire.
La peine de mort était prononcée à titre de lascheté contre ceux qui appelaient d'autres personnes à les soutenir dans leurs querelles comme seconds.
Le roi donnait non seulement sa parole de ne plus accorder aucune grâce, mais il fit jurer à son secrétaire des commandements de ne plus signer aucune grâce en cette matière, et au chancelier de n'en plus sceller.
Avant d'enregistrer cet édit, le parlement adressa au roi des remontrances, afin que la sévérité des anciens édits fût maintenue. Le roi envoya des lettres de jussion, et l'édit fut enregistré le 24 mars 1626.
Déclaration du roi pour le retour des ducs d'Halluin et sieur de Liancourt, donnée à Paris le 14 mai 1627.
Richelieu n'eut garde de laisser tomber des lois qui pouvaient si bien le servir dans le projet qu'il avait formé d'abaisser la noblesse. Il persuada au roi de témoigner par quelques actes de sévérité sa volonté d'en poursuivre la rigoureuse exécution. Le comte de Montmorency-Bouteville, déjà deux fois condamné par contumace, irrité de n'avoir pu obtenir la permission de reparaître à Paris et à la cour, était venu braver l'autorité du roi, en se battant sur la Place Royale, en plein midi, avec le marquis de Beuvron. Il avait pour seconds La Frette et François de Rosmadec, comte des Chapelles; son adversaire était assisté de son écuyer et de Henri d'Amboise, sieur de Bussy. Ce dernier avait été tué par des Chapelles. Tous prirent la fuite. Bouteville et des Chapelles furent arrêtés, mis à la Bastille et condamnés par arrêt du parlement, du 21 juin 1627, à être décapités en place de grève. La grâce fut refusée, et l'arrêt exécuté.
L'effet salutaire produit par cet exemple ne fut que passager. L'habitude reprit le dessus. Au mois de mai 1634, le roi rendit une nouvelle ordonnance datée de Fontainebleau pour remettre en vigueur l'édit de 1626.
L'année suivante, en 1635, à l'occasion de la naissance de Louis XIV, une nouvelle amnistie fut proclamée. C'était la troisième, indépendamment des grâces particulières.
Les efforts de Louis XIII pour réprimer le duel étaient nécessairement frappés de stérilité, car le législateur se donnait à lui-même un démenti, en absolvant le lendemain ce qu'il avait si rigoureusement condamné la veille.
Arrêt de la cour du parlement sur le fait des duels, du 3 mars 1638.
Arrêt de la cour du parlement contre ceux qui contreviendront aux édits du roi touchant les duels et rencontres, du 4 mars 1639.
Lettre du roi, envoyée à Messieurs du parlement, sur la défense des duels et rencontres, avec l'arrêt du parlement du 7 décembre.
Arrêt de la cour du parlement, en exécution des édits des duels et rencontres, du 7 décembre 1640.
Malgré tous ces édits et arrêts, à l'avénement de Louis XIV, la fureur des duels était à son comble. On fit sortir l'édit du roi sur la prohibition et punition des duels, donné à Paris au mois de juin 1643.
Cet édit abolissait tous les précédents, afin d'empêcher les juges de choisir à leur volonté, mais il reproduisait toutes leurs dispositions.
Les troubles de la minorité de Louis XIV n'étaient guère propres à diminuer les querelles, aussi évalue-t-on à quatre mille le nombre des gentilshommes qui périrent en combat singulier pendant les huit années que dura la régence d'Anne d'Autriche. Pendant la fureur des duels, pour la cause la plus frivole, on allait se battre à mort, deux contre deux, quatre contre quatre, sur la Place Royale. Le baron de Chantal, père de madame de Sévigné, apprend dans l'église même où il venait de faire ses pâques qu'il est attendu par Bouteville à la porte Saint-Antoine pour lui servir de second; aussitôt il y court en petits souliers à mules et sans se donner le temps de changer d'habits (Mémoires de Conrart; Mémoires de Bussy-Rabutin). Le mari de madame de Sévigné est accusé d'avoir mal parlé du chevalier d'Albret; il n'en est rien, et il le nie; mais seulement, dit-il, pour rendre hommage à la vérité, et non pour se justifier, ce qu'il ne fait jamais que par la voie des armes. Ensuite il se rend sur le terrain, et après avoir assuré le chevalier d'Albret qu'il est son serviteur et l'avoir embrassé, il met l'épée à la main et tombe mort au bout d'un instant (13 janvier 1651). Bussy-Rabutin a un duel, ce qui lui arrivait souvent, et un gentilhomme inconnu vient lui offrir ses services; mais comme Bussy avait déjà son monde, le gentilhomme lui fait force compliments et révérences et va s'offrir à son adversaire; puis, sur le lieu du rendez-vous s'étant trouvés cinq contre quatre, l'un des seconds court se poster sur le Pont-Neuf, accoste un mousquetaire qui passait, lui conte l'embarras où l'on se trouve, et celui-ci, plein d'empressement, monte en croupe et va se battre à mort contre des gens qu'il n'avait jamais vus. Tout ceci cependant ne se passait que dans une seule famille.
Louis XIV, s'il ne réussit pas à extirper un abus aussi contraire à la paix publique, fut tout au moins le seul souverain qui le combattit avec une énergie et un succès qu'on n'avait point vus jusqu'alors.
Dans son premier lit de justice, tenu à Paris le 7 septembre 1651, il fit lire un nouvel édit qui reproduisait à peu près les dispositions de ses prédécesseurs et faisait encore étendre à la postérité des délinquants, les peines de roture et d'infamie prononcées contre eux.
Une nouvelle déclaration, donnée à Paris en 1653, contenait un principe plus conforme aux idées nouvelles qui commençaient à poindre et que le dix-huitième siècle devait faire triompher.
Les dégradations devinrent personnelles. On comprenait enfin, et ce n'était pas trop tôt, que la postérité des délinquants n'étant pas coupable du crime ne devait point avoir part à la punition. Les héritiers du duelliste mort dans le combat pouvaient se porter partie civile et ils évitaient la confiscation, en procurant la condamnation du meurtrier.
Louis XIV alla plus loin: il créa une institution dont tout l'honneur revient à son règne: la Ligue du Bien public, formée au nom de la religion et de la morale, et dans laquelle il s'efforça de faire entrer les seigneurs dont l'exemple devait avoir le plus d'influence et d'autorité morale. Les associés signaient en entrant une déclaration par laquelle ils promettaient de refuser toute sorte d'appels et de ne se battre en duel pour quelque cause que ce pût être. Le roi fit approuver solennellement cette déclaration par le tribunal des maréchaux.
Nous reproduisons in extenso (Voir 3e partie. Pièces justificatives):
I.—La lettre du roi Henri IV au comte de Soissons (Différend entre le comte de Soissons et Sully. Pièces justificatives, page 409).
II.—Le jugement rendu par le connétable de Montmorency (Différend entre MM. de Montespan et de Cœuvres. Pièces justificatives, page 410).
III.—Le règlement de MM. les maréchaux de France, touchant les offenses entre les gentilshommes, pour l'exécution de l'édit contre les duels, du 22 août 1653 (page 411).
IV.—La déclaration publique de plusieurs gentilshommes de refuser toute sorte d'appels, etc., sur laquelle MM. le maréchaux de France ont rendu leur jugement le 1er juillet 1651 (page 422).
V.—Approbation de MM. les maréchaux de France (page 423).
VI.—L'édit du roi portant règlement général sur les duels, donné à Saint-Germain-en-Laye, au mois d'août 1679, enregistré au parlement le 1er septembre de la même année (page 424).
VII.—L'extrait du concile de Trente sur la répression du duel, Session 25, De Reformatione, chap. XVIII (page 453).
M. de Chateauvillard reproduit en outre un recueil des édits et arrêts sur les duels (Chateauvillard, page 220 et suivantes).
On y remarque de plus: la résolution de MM. les prélats sur cette matière;
L'avis des docteurs en théologie de la faculté de Paris sur le même sujet.
Nous renvoyons nos lecteurs à ce recueil, n'ayant point jugé nécessaire de reproduire toutes ces pièces dans cet exposé purement analytique.
On voit au surplus, par lettres-circulaires de MM. les administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Paris aux administrateurs des Hôtels-Dieu des autres villes de France, que ces derniers étaient chargés de la confiscation des biens au profit des hôpitaux, qu'ils créaient des dénonciateurs, des espions: «Pour avoir plus de facilité, disaient-ils, d'arracher le crime et de procurer quelque bien aux pauvres, sur le tiers qui leur est destiné, on fera quelque part de ce tiers à ceux qui dénonceront les duels commis, en s'obligeant par eux d'en administrer les preuves, si d'ailleurs on en peut avoir la conviction, et de donner des lumières des biens, si on ne pouvait autrement en avoir connaissance. Cela se fera eu égard aux circonstances des choses et des personnes.»
Et cependant dans ces temps de loyauté les administrateurs ne trouvaient pas de dénonciateurs.
Pour déterminer les gentilshommes à faire partie de la Ligue du Bien public, on inséra dans un règlement des maréchaux, en date du 22 août 1653, un article ainsi conçu:
«Lorsqu'il y aura démêlé entre des gentilshommes dont les uns auront promis et signé de ne point se battre et les autres non, ces derniers seront toujours réputés agresseurs, à moins que le contraire ne parût par des preuves bien expresses.»
La combinaison de ces mesures, la fermeté de Louis XIV, l'adoucissement des mœurs par l'action civilisatrice des sciences et des lettres qui prirent sous ce règne un si brillant essor, contribuèrent à diminuer le nombre des duels.
Nous ne passerons pas sous silence un arrêt de la cour du parlement portant réitération de la défense contre les duels, du 30 juillet 1657;
Une déclaration du roi, en explication de celle du mois de mai 1653, touchant la succession de ceux qui auraient été tués en duel, donnée à Saint-Germain-en-Laye, au mois d'août 1658.
Nous nous arrêterons quelques instants sur la nouvelle ordonnance rendue en août 1679, proprement appelée l'Edit des Duels, parce qu'elle a fixé définitivement la législation sur cette matière.
Ses dispositions sont rangées en deux classes principales, comprenant, l'une, les mesures préventives, l'autre, les mesures répressives.
Les mesures préventives consistaient dans l'intervention du tribunal des maréchaux. Ce tribunal, déjà institué pour connaître des faits de guerre et des différends entre gentilshommes touchant le service militaire, joignit à ces attributions la connaissance des affaires d'honneur, en sa qualité de juge naturel de la noblesse et de l'armée.
Le droit de convoquer le tribunal des maréchaux appartenait au doyen. Ses collègues se réunissaient toujours à son domicile, au jour et à l'heure qu'il lui convenait d'indiquer.
Dans l'intervalle des séances de ce tribunal, le doyen des maréchaux avait le droit de prononcer sur toute rixe, querelle ou rencontre; de décerner des mandats d'arrêt contre les agresseurs et enfin contre tous contrevenants aux édits et ordonnances.
A peine informé qu'une querelle s'était élevée entre deux gentilshommes, le doyen des maréchaux, ou le gouverneur de la province, ou le lieutenant général, envoyait auprès de chacun d'eux un garde de la connétablie pour lui intimer de s'abstenir de toutes voies de faits ou rencontre, avant d'avoir répondu à l'assignation qui leur était faite de comparaître devant eux. L'affaire était examinée et décidée dès le lendemain. Le moindre retard eut été en effet préjudiciable au milieu des passions surexcitées de cette noblesse française habituée à porter, trop souvent peut-être, la susceptibilité envers le point d'honneur jusqu'à l'exagération. Il est, du reste, plus facile de remédier aux excès de l'exagération qu'aux inconvénients de la décadence!
Les historiens citent le jugement rendu par le connétable de Montmorency dans la querelle qui eut lieu entre M. de Montespan et le marquis de Cœuvres, et après lequel ces deux gentilshommes s'embrassèrent, entièrement satisfaits et réconciliés (Voir Pièces justificatives, page 410).
Le tribunal des maréchaux de France était assisté par un rapporteur, chargé de l'instruction des affaires et choisi, de droit, parmi les maîtres des requêtes au parlement de Paris.
Les maréchaux étaient supplées par les gouverneurs des provinces et subsidiairement par les lieutenants généraux. Des délégués leur rendaient compte dans chaque bailliage ou sénéchaussée.
La juridiction de ce tribunal s'étendait sur tous les gentilshommes et militaires, même étrangers. Les veuves avaient également le droit de porter plainte devant le tribunal des maréchaux.
Les affaires mixtes, en raison de la qualité des parties, étaient renvoyées à la justice ordinaire. Ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, pour que le tribunal des maréchaux fût saisi, il n'était pas nécessaire d'une plainte. Il informait d'office, quand il avait connaissance d'un crime de quelque manière que ce fût.
Les maréchaux pouvaient employer les voies coercitives pour citer les gentilshommes à leur barre. En cas de désobéissance, les revenus des biens des délinquants étaient appliqués aux hôpitaux pendant toute la durée de leur absence. Les maréchaux avaient toute latitude pour apaiser les différends. En cas d'insuccès, ils devenaient juges et appliquaient des peines suivant la nature de l'offense.
La pénalité que l'édit les autorisait à établir, était déterminée par un règlement dressé en vertu de l'ordre contenu dans la déclaration royale du 27 juillet 1653 et publiée sous la date du 22 août suivant. (Voir Pièces justificatives, page 411.)
Le 22 août 1679, parut un nouveau règlement confirmant les dispositions du premier avec quelques modifications que nous résumons pour donner un aperçu des mœurs du temps:
Quiconque, se trouvant présent à une offense, s'abstenait d'en donner avis à qui de droit, devait être puni de six mois de prison. (Art. 6.)
Celui qui aura offensé, subira deux mois de prison, et, lors de sa sortie, devra déclarer à celui qu'il aura offensé: que mal à propos et impertinemment il l'a offensé par des paroles outrageantes, qu'il reconnaît être fausses, et lui en demande pardon. (Art. 7.)
Quel législateur oserait aujourd'hui imposer de pareilles obligations? Les excuses présentées spontanément sont seules acceptables. Par contre, les excuses imposées par une autorité quelconque sont de nulle valeur. Celui qui aurait la faiblesse de s'y soumettre pour éviter les rigueurs de la loi pénale s'empresserait d'en dénier la valeur ou de les tourner en dérision, quelques minutes seulement après être sorti du prétoire. C'est précisément cette raison qui nous a fait considérer la réunion des témoins comme le meilleur et le plus efficace tribunal d'honneur, car ils n'ont d'autorité que celle qui leur est spontanément accordée par les parties. Acceptée, elle ne peut plus être déniée.
Celui qui aura offensé par parole subira quatre mois de prison et, à sa sortie, devra demander pardon à celui qu'il aura offensé. (Art. 8.)
En cas d'offense par soufflet ou coups donnés dans la chaleur des démêlés et précédés d'un démenti, l'agresseur subira un an de prison; s'ils n'ont point été précédés par un démenti, l'agresseur subira deux ans de prison; cela sans aucune diminution pour quelque cause que ce soit, même sur la demande de l'offensé. De plus, à sa sortie de prison, l'agresseur devra se soumettre à recevoir de la main de l'offensé des coups pareils à ceux qu'il aura donnés, et déclarer par parole et par écrit qu'il l'a frappé brutalement, et le supplie de lui pardonner et d'oublier cette offense. (Art. 9.)
D'un seul offensé par la plus grave des insultes, on en créait deux! C'était une excellente réparation!!
Si les coups de bâton et autres semblables outrages ont été donnés après un soufflet ou coup de main, celui qui aura frappé du bâton ou autrement sera passible de deux ans de prison, et, s'il n'avait point été frappé auparavant, il subira quatre ans de prison, et après sa sortie, demandera pardon à l'offensé. (Art. 10.)
Quiconque, soit par témoignage, par autorité ou autres preuves, sera convaincu d'avoir commis une injure de coups de bâton, canne ou armes de pareille nature, avec préméditation, par surprise ou avec avantage, aura frappé seul et par devant, subira quinze ans de prison. Celui qui aura frappé par derrière, quoique seul et avec avantage, soit en se faisant accompagner ou autrement, subira vingt ans de prison. Cette peine sera subie dans une ville, forteresse ou citadelle, éloignée au moins de trente lieues du domicile ordinaire de l'offensé. D'ordre de Sa Majesté, défense est faite à l'offensant de se sauver de la prison, à peine de vie, et à l'offensé de s'approcher de ladite prison de dix lieues, à peine de désobéissance. (Art. 15.)
Au bas de ce règlement, on rencontrait les signatures de MM. les maréchaux de Villeroy, de Grancey, duc de Navailles, d'Estrades, Montmorency-Luxembourg.
Passons aux mesures de répression contre ceux qui, au lieu de soumettre leurs différends au tribunal des maréchaux, tentaient le sort des armes.
Suivant l'édit d'août 1679, la juridiction appartenait aux officiers et prévôts de la connétablie, prévôts généraux, provinciaux et particuliers, même aux vice-baillis, vice-sénéchaux et lieutenants criminels de robe courte, concurremment avec les juges ordinaires, mais toujours à charge d'appel par-devant la cour du parlement.
Pour éviter cette concurrence qui entravait la marche des procédures, Louis XIV, par une déclaration du 14 octobre suivant, rendit aux cours du parlement le droit qui leur avait été conféré par les édits antérieurs de connaître en premier et dernier ressort les causes de duels et d'évoquer à elles toutes les autres affaires dont elles voudraient connaître.
Quand des juges différents avaient commencé une procédure, elle devait être continuée par le magistrat qui avait informé le premier ou par celui qui avait provoqué l'arrestation du prévenu.
Les officiers de justice avaient droit à 1,500 francs pour chaque capture.
Les parlements pouvaient prolonger la détention préventive pour compléter ou pour acquérir des preuves.
Dans la procédure par contumace, sur la simple notoriété publique, un décret de prise de corps était lancé. Faute par les absents d'y obéir, leurs biens étaient immédiatement saisis, et après trois assignations à briefs jours, sans autre forme de procès, les défaillants étaient, dans la huitaine après le crime, déclarés coupables et condamnés aux peines terribles portées par l'édit.
Les biens confisqués étaient aussitôt mis sous le séquestre, leurs maisons démolies et rasées, leurs bois de haute futaie coupés à moitié. Ils étaient privés de toute succession. S'ils venaient à purger leur contumace, ils perdaient les fruits jusqu'au jugement de restitution.
Les condamnations personnelles étaient exécutées immédiatement, telles que dégradation de noblesse et décret d'infamie.
Le condamné ne pouvait purger sa contumace qu'en obtenant des lettres de permission de se représenter, et sur justification du payement intégral des amendes prononcées.
L'action principale contre le duel ne s'éteignait par aucune prescription; bien plus, elle faisait revivre toutes les autres actions criminelles déjà éteintes pour d'autres faits.
Les peines étaient plus ou moins sévères suivant la nature des affaires.
Le simple appel non suivi de duel entraînait la privation de pouvoir jamais obtenir satisfaction d'une offense; la prison pendant deux années; suspension des charges et privation du revenu pendant trois ans; amende égale au moins à la moitié du revenu des biens pendant une année.
L'appelé acceptant était sujet aux mêmes peines.
En cas de duel consommé: peine de mort, confiscation totale des biens pour les deux combattants, quand bien même le duel n'eût occasionné ni mort ni blessures.
Dans les provinces où la confiscation n'était pas admise (et ce n'était que justice!), elle était remplacée par une amende au moins égale à la moitié de la valeur des biens des condamnés.