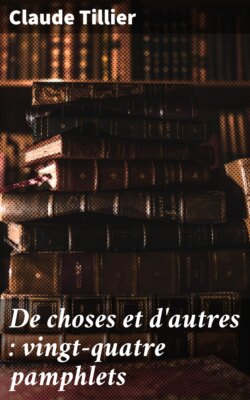Читать книгу De choses et d'autres : vingt-quatre pamphlets - Claude Tillier - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Cinquième Pamphlet.
ОглавлениеTable des matières
C’était le19août. L’Écho de la Nièvre m’était malencontreusement tombé sous la main. Était-ce un trait des vengeances de sainte Flavie, je n’en sais rien; mais que mes détracteurs n’aillent pas arguer de là que je lisais l’Écho de la Nièvre. Non, je le jure à la face du département, je ne lisais point l’Écho de la Nièvre; seulement, je le parcourais, enjambant lestement, d’un paragraphe à un autre, comme un saute-ruisseau qui traverse une rue pleine d’immondices. Je me heurtai–sans me faire de mal toutefois–contre cette fameuse lettre de M. de Lamartine au Bien public de Mâcon. Vous savez comme rédige l’Écho de la Nièvre: il extrait, extrait, extrait, et il met sous bande; voilà comme il se procure du talent et de l’esprit: ce n’est pas plus difficile que cela. Otez-lui sa plume et laissez-lui ses ciseaux, ses tartines n’en perdront pas un centigramme de leur poids. Aussi je soupçonne fort le rapace confrère, d’avoir fait son apprentissage d’écrivain sur l’établi d’un tailleur.
Toutefois, n’allez pas lui dire: M. l’Écho, c’est à votre journal, et non aux Débats, non au Globe, non à la Presse que je suis abonné, il vous répondrait très-pertinemment: monsieur, vous ne perdez point au change.
Mais notre vieux découpeur d’articles n’a pas la main heureuse: le mauvais l’attire. Il pose toujours et fatalement sa droite à côté du bon: parmi cent pièces d’or, il choisirait un sou de Monaco.
N’y eût-il qu’un seul crapaud dans un vivier rempli de magnifiques poissons, s’il y jette l’épervier, c’est le crapaud qu’il péchera. Ainsi a-t-il fait, relativement à la lettre de M. de Lamartine: il a pêché son crapaud, et il l’a mis triomphalement sur le gril. De ces pages magnifiques où tant de beautés de pensée et de style resplendissent, il extrait les lignes suivantes:
«Le misérable métier de pamphlétaire quotidien dégraderait la vérité même. Les journaux ne sont point les gladiateurs salariés de la malignité publique. Se servir de la presse pour de pareils usages, c’est une profanation d’un des plus beaux dons de Dieu. La presse est sainte, car, après avoir été l’instrument qui a nivelé le monde, elle est aujourd’hui l’instrument qui doit y semer l’ordre nouveau, la religion, la liberté et la paix.»
D’abord, ce n’est pas au pamphlet que s’adresse la muse de M. de Lamartine. Assurément, il n’a pas voulu insulter mémoire de Paul-Louis Courrier et la gloire encore militante de M. de Cormenin. C’est le journalisme de l’opposition qu’il veut atteindre; mais l’illustre poète trempe, sans s’en apercevoir, le bout de sa plume dans l’infâme pamphlet? Il croit chanter et il crie; fallait-il donc qu’en indiquant à son compatriote du Bien Public la voie qu’il croit bonne à suivre, il insultât le journalisme qui marche dans une autre voie. La main qui se lève pour montrer, doit-elle nécessairement retomber sur la tête de quelqu’un; et le fanal qui jette aux navires ses lointains rayons, est-il obligé de brûler son rivage. M. de Lamartine est dans son droit, sans doute; la mission de la Presse est d’attaquer comme de défendre; mais au moins, il ne faut pas flétrir chez les autres ce qu’on fait soi-même, et peut-être avec moins de raison qu’eux, et se croire saint quand on les appelle infâmes.
M. de Lamartine, pense-t-il être le seul en France qui ait une conscience à lui? Pourquoi les écrivains qu’il attaque ne seraient-ils pas d’aussi bonne foi dans leur opposition qu’il l’est lui, aujourd’hui, dans la sienne, et qu’il l’était autrefois dans son ministérialisme. Que gagnent-ils–puisque diffamation il y a–à diffamer? Des amendes qui les ruinent, et des détentions qui leur prennent les belles années de leur jeunesse. M. de Lamartine est un si grand homme, que je suis très-contrarié de n’être point de son avis; mais j’aime mieux être de l’avis d’un autre grand homme appelé Blaise Pascal. Je crois à la loyauté de témoins qui déposent sur le seuil de la prison et sous les ongles tranchants du fisc.
L’appréciation de M. de Lamartine a du reste le défaut d’être un peu surannée. Depuis M. de Marcellus de la restauration, jusqu’à M. Liadières de la dynastie de juillet, une grosse d’orateurs bien pensants et mieux payés encore, ont dit la même chose, à peu près dans les mêmes termes. Que quelque canard égaré rencontre le cygne de Mâcon dans les belles eaux où il se baigne, soit, cela n’est pas sa faute; mais qu’il aille salir ses blanches ailes dans la mare verdoyante et pourrie où s’ébat la troupe barbottante des canards, voilà ce qu’il ne devrait point se permettre.
Toutefois, quittons les étangs de Mâcon et revenons à l’Echo de la Nièvre. Pourquoi a-t-il extrait ces malencontreuses lignes de la lettre de M. de Lamartine? N’y a-t-il dans son fait que du mauvais goût? Serait-ce, par hasard, qu’il fait allusion à mes pamphlets? Oui! tel a dû être son dessein; je reconnais la manière de procéder de notre ancien adversaire. Quand il se hasarde à tirer, il se cache volontiers derrière un autre; il aime d’ailleurs l’esprit tout fait, et soit pauvreté, soit avarice, en fait d’imagination, nul plus que lui ne craint la dépense.
Ah! monsieur, me dit quelqu’un, cela ne peut avoir de suites; riez de l’Écho de la Nièvre quand il se rencontre sur votre passage, à la bonne heure, mais ne l’acceptez pas pour adversaire. Riposte-ton à un vieillard goutteux qui vous donne un coup de sa béquille? poursuit-on un méchant enfant qui vous jette une pierre et s’enfuit?–Vous en parlez bien à votre aise, vous, monsieur, qui n’avez été qu’ennuyé par l’Écho de la Nièvre; mais je vous répondrai par des exemples tirés de notre histoire: le chevalier Macaire s’est bien battu en duel avec un caniche de Montargis, et Louis XIII a bien tiré l’épée contre le mulet de Bautru. Oui, le sort en est jeté, je prends l’extrait pour une allusion à mes pamphlets, et je me commets avec l’Écho de la Nièvre. Du reste, je n’ai pas autre chose à faire.
Vous dites que le métier de pamphlétaire est un métier infâme; mais donnez-nous donc au moins vos raisons. Il y a certes, de bien sottes gens, mais il n’y a point de sots métiers; tout métier a de l’esprit quand il est fait tel qu’il doit l’être: ainsi l’a décidé la sagesse des nations. J’ai beaucoup de déférence pour l’opinion de l’Écho de la Nièvre, mais quand sa sagesse se trouve en désaccord avec celle des nations, je ne puis faire autrement que de lui donner tort.
Dans le métier de pamphlétaire comme dans tous les autres, comme dans le métier de doreur d’hémistiches, comme dans le métier de bedeau d’évêché et de tambour de préfecture, il y a des hommes qui déshonorent la profession, comme il y en a qui l’honorent. Mais ceux qui la déshonorent, leurs confrères sont-ils responsables de leur turpitude. Je suppose que l’Écho de la Nièvre se trouvé en présence d’une barre d’acier, traitera-t-il cette barre d’infâme métal, parce qu’on en fait des poignards pour assassiner aussi bien que des instruments pour guérir; et moi-même, est-ce qu’il m’est jamais arrivé d’insulter l’encre de la Petite Vertu, sous prétexte que l’Echo écrit avec.
Mais savez-vous quels sont ceux qui déprécient le pamphlet: ce sont ceux qui sont impuissants à faire des pamphlets, ceux dont le fiel infécond ne peut rien produire, ceux qui n’ont à mettre au service de leurs colères que de plates et triviales injures incessamment répétées. Ces fanfarons effrontés de la presse ministérielle qui n’ayant à leur côté qu’un fourreau, veulent faire croire qu’il y a dedans une épée, une épée qu’ils ne tirent jamais, parce qu’ils craignent de blesser leurs adversaires. Oh! si au lieu de cette épée de sous-préfet, de cette épée de suisse de cathédrale, ils avaient une véritable épée, s’ils pouvaient obtenir, par ordonnance royale, un peu d’esprit, d’imagination et de style, comme ils obtiennent la croix d’honneur, vous verriez quelles terribles estafilades ils nous feraient; comme les bonnes plaisanteries, comme les sanglantes dérisions, comme ces ardentes épigrammes qui s’attachent à la peau, ainsi qu’un trait goudronné aux flancs d’une tour, et dont il faut long-temps porter la cicatrice, partiraient dru et serrées de leur plume. Oh! oui, ils déprécient le pamphlet, comme le sot déprécie l’esprit, comme la vieille décrépite et édentée, dont les yeux ardents pleurent ainsi qu’un tison de bois vert, déprécie la jeunesse et la beauté; gras et podagres renards qui ont queue de plomb et pattes de laine, ils s’indignent de voir l’oiseau becqueter les raisins de la treille, et quand ils ont bien sauté à l’entour, ils décident qu’ils sont pleins d’une liqueur empoisonnée.
Entre ces gens-là et nous, il y a guerre, guerre acharnée; ils veulent ne nous rien rendre de ce qu’ils nous ont pris, et nous, nous voulons tout avoir. De notre part c’est la guerre que faisait Spartacus aux légions de Rome. Nous accourons sur le champ de bataille avec les armes les plus dures, les mieux trempées que nous puissions trouver, tant pis pour eux, si leurs armes ne valent pas les nôtres. De quel droit se plaignent-ils que nous leur fassions trop de mal, quand ils nous font, eux, tout le mal qu’ils peuvent nous faire? Faut-il donc, parce que leur épée est trop courte, que nous rognions notre épée; et moi qui suis moucheron, suis-je obligé d’arracher mon dard et de me couper les ailes, parce que ce gros bœuf, mon adversaire, qui écrase ma touffe d’herbe sous ses pieds n’a que deux cornes immobiles, plantées à perpétuité dans son front? En vérité, ces messieurs devraient bien faire régler par arrêté de préfecture le nombre et la profondeur des blessures que nous avons le droit de leur faire.
C’est un misérable métier que celui de pamphlétaire, me disent-ils du haut de leur chaire et d’en bas de leurs journaux. Je comprends; mes pamphlets les gênent, et ils seraient bien aises que je n’en fisse plus. Mais c’est comme si les bédouins de l’Algérie chantaient au général Bugeaud: enclouez vos canons; vous êtes un misérable de nous attaquer avec de l’artillerie, quand nous n’en avons point. Non, mes honnêtes et scrupuleux ennemis, ne comptez point que je me laisserai impressionner par vos criailleries; ce serait aussi par trop niais de ma part. L’arme dont je me sers est bonne, elle est dure, elle est pointue, elle est tranchante, elle perce et elle estafile; je ne veux pas la briser pour vous faire plaisir.
Vous m’appelez faiseur d’infâmes pamphlets, misérable pamphlétaire. Voilà les seuls pamphlets que vous sachiez faire, vous, et vous les faites; vous n’avez qu’un vieux débris, un fil usé de lanière pour battre ma réputation, et vous l’en frappez. Mais peu m’importe comment vous m’appeliez, pourvu que je vous tienne saignans et terrassés sous mes verges. Loin de me blesser, vos injures me sont agréables; je les reçois comme un hommage; elles prouvent que mes coups tombent d’aplomb. Je suis un homme féroce, moi, un tigre, quelque chose de plus encore: quand je bats quelqu’un, je veux qu’il crie. Mais où avez-vous donc vu qu’une épithète fût un argument, et surtout une preuve: parce que vous m’appelez infâme, cela veut-il dire que je le sois; si je vous appelais, moi, illustres, immortels, serait-ce une raison pour que vous allassiez à la postérité? Ces épithètes, dont un parti croit flétrir d’honnêtes gens, elles sont, à la vérité, répétées de confiance par un chœur de badauds, mais elles ne durent que quelques heures. C’est la boue que des ivrognes jettent à une statue, et que la pluie lave le lendemain. Sous la restauration, les hommes de la convention s’appelaient régicides; les soldats de la république, des buveurs de sang, et ceux de l’empire, les brigands de la Loire. Mais aujourd’hui, écoutez comme on les appelle.
De leur côté, les jésuites écrivaient que Pascal était un tison d’enfer, et le procureur généra! De Broé traitait Courrier de vil pamphlétaire; ces lâches insultes ont-elles fait tort à la mémoire de ces deux grands écrivains, et n’aimeriez-vous pas mieux être leur glorieuse cendre, que votre obscure personne?
Quoi, d’une part je fais des livres infâmes, de l’autre tous les crimes qu’il fallait commettre pour allumer les foudres de l’excommunication–quand l’excommunication était un foudre–je les ai commis, et tous tant qu’ils sont, ils ne peuvent me répondre que par quelques épithètes anonymes, furtivement placardées à la suite de mon nom; mais il est aussi trop commode de répondre à des pages de raisonnements par un adjectif. Apprenez à un perroquet ces quelques mots: Claude est un infâme, Claude est un impie, Claude est un misérable, et pourvu que quelque chat philosophe ne torde pas avant le temps le cou à votre dialecticien, il sera centre moi un adversaire aussi puissant que vous.
Oh ! M. Dufêtre, voyez donc comme donnent vos soldats armés de cierges; comme ils gagnent leur ration de pain bénit. Ils ne savent qu’insulter l’ennemi que vous leur avez donné à combattre; s’ils avaient des canons, ils les chargeraient avec de la boue.
J’ai là sous les yeux votre biographie de prédicateur répandue par la ville avec profusion, et je ne sais par quelles mains, et j’y lis ces lignes:
«Monseigneur Dufêtre, depuis le jour de son entrée dans la milice sainte, est ce soldat sans cesse debout sur les remparts d’Israël, appuyé sur de vieilles armes noircies au milieu des combats; entouré de ses trophées, il est là, l’oreille attentive, toujours prêt à repousser les attaques de l’ennemi du salut, etc. etc.»
Eh bien! l’ennemi du salut est arrivé! Que tardez-vous à prendre vos armes noircies, et que faites-vous là haut sur votre rempart? Puisque vous avez l’oreille attentive, vous devez entendre la foule éplorée de vos béates qui vous crie; Monseigneur Dufêtre, cher monseigneur Dufètre, descendrez-vous de là haut! et cependant vous ne descendez pas. À quoi vous sert donc tout ce Fénélon dont vous êtes empreint? Cette parole abondante et facile que vous épanchiez partout sur votre passage, comme un sac délié épanche sa graine, n’est-elle bonne qu’à célébrer la gloire des frères ignorantins. Est-ce pour dénoncer les impies au ministre et non pour les combattre que Dieu vous a envoyé dans ce diocèse. Votre tribune catholique, dont vous me menaciez, quand sortira-t-elle de votre sacristie? Est-ce donc l’arche de Noé à bâtir, ou quand elle sera faite, craignez-vous de n’avoir personne pour mettre dedans?
Vous avez des armes noircies, et moi je n’ai à la main qu’une frêle houssine, que craignez-vous de descendre de votre rempart? en une minute vous aurez fait de moi un trophée. Je vous en préviens, en loyal ennemi, votre silence à l’égard de mes pamphlets vous fait tort; on dit que vous ne remportez de trophées sur l’ennemi du salut que quand il est absent; que vous ne savez tuer que des mannequins; qu’il faut, puisque vous ne me répondez pas, que votre cause soit bien mauvaise, ou que vous aviez peu de confiance dans la puissance de votre dialectique.
Après cela, vous en ferez ce que vous voudrez, cela m’est bien égal, je vous l’assure.
Mais abstraction faite de moi, pourquoi le pamphlet est-il infâme, pourquoi les pamphlétaires sont ils des misérables? L’infâme pamphlet! le misérable pamphlétaire! docteurs, vous avez bientôt tranché la question. Mais vous êtes un peu excoriés; vous me faites l’effet de malfaiteurs qui se plaignent d’avoir été mal menés par la patrouille.
Le pamphlet est-il donc infâme de droit? Apporte-t-il en naissant sa tache d’infamie comme l’homme sa tache de péché originel: est-il comme Je bourreau infâme, quoi qu’il fasse et aussitôt qu’il apparaît dans la rue, roquets et molosses, ont-ils le droit d’aboyer sus? et pourquoi en serait-il ainsi, pourquoi serait-il plus infâme que le feuilleton, que le premier Paris, que l’histoire et même que la méditation poétique? Ne peut-il, comme les individus susnommés, s’enrôler sous un saint drapeau, Est-il l’ennemi naturel et nécessaire de tout ce qui est gloire, vertu, grandeur, comme le chat l’est de la souris? Son encre se solidifierait-elle dans sa plume s’il voulait défendre une bonne cause. Hélas! non; l’Onguent contre la morsure de la Vipère noire, ce pamphlet qui défend avec tant de puissance de logique et tant d’agrément de style la doctrine chrétienne en est la preuve; mais on le juge sur le nom qu’il porte ce pauvre pamphlet. O vulgaire! t’ameuteras-tu donc toujours contre des noms? une soutane passe, et tu dis voilà un homme pieux; si c’est un uniforme, tu dis voilà un brave; mais regarde-donc au moins ce qu’il y a sous cette étoffe. Si j’avais donné à mes petits livres le titre de Sermons, tous ces badauds qui m’appellent l’infâme pamphlétaire, m’appelleraient le pieux Claude.
Sans doute le pamphlet est infâme, quand il a recours à la diffamation, quand il descend jusqu’à la calomnie; mais qui de nous procède ainsi? Si je voulais remuer votre fumier, j’y trouverais des tas d’horribles choses. Dites, vous qui écrivez maintenant avec de l’eau bénite, quand vous nous accusiez d’avoir provoqué les luttes sanglantes de Clermont, d’être les complices de Quenisset, était-ce de la charité chrétienne que vous faisiez?
Mais, moi, soit rédacteur de l’Association, soit pamphlétaire, quand vous ai-je calomniés? citez-moi une ligne faite par ma plume, qui soit pour vous une calomnie; et pourquoi vous calomnierais-je! la calomnie est l’arme du faible, et c’est vous qui êtes le faible. Vous! car pour m’attaquer vous vous cachez derrière un nom; vous! car ce que vous avez à me dire, vous me l’envoyez dire par M. de Lamartine.
Et à ne considérer que vos éloges, ces éloges que vous distribuez dans l’intérêt de votre marmite, à tous ceux qui peuvent vous aider ou vous nuire, sont-ils donc bien plus moraux que mes critiques? Qui de nous a pris la plus honorable tâche? Quand je vois un homme qui corrompt, je dis il corrompt, vous, vous le niez; quand un homme se vend, je dis voilà un homme qui se vend, vous, vous répondez, c’est un homme qui se détrompe, Quand un homme abandonne sciemment les intérêts de la France, je dis il trahit son pays, vous, vous prétendez qu’il le sert; et pourtant c’est vous qui êtes la presse sainte, et moi la presse impie. C’est vous qui m’appeliez infâme! En vérité, de la manière dont va le monde aujourd’hui, si une querelle s’élevait entre les ombellifères et les graminées, ce serait la ciguë qui reprocherait à l’épi d’être un poison.
Vous défendez au pamphlet les personnalités; mais il faudrait plutôt les lui recommander. N’êtes-vous pas bien aises d’avoir un magistrat, qui fait gratuitement la police morale de la ville? Qui êtes-vous donc, vous, pour prétendre à l’inviolabilité? cette étoffe d’inviolabilité est rare en France, il n’y en a que de quoi faire un manteau, et ce manteau c’est le roi qui le porte. Quoi! vous voulez être un personnage important, et vous vous fâchez de ce qu’on critique vos actes: ne vous êtes-vous donc fait acteur qu’à la condition d’être applaudis? si vous ne voulez pas qu’on marche sur votre ombre, il ne faut pas aller dans la rue. Mais ces personnalités que vous reprochez au pamphlet, elles tournent au profit de tout le monde. Voici un monsieur qui a la manie d’être un grand personnage; il s’est attaché une clochette au cou afin de ne point faire un pas que la ville n’en soit instruite; il fait plus de bruit dans la rue qu’une compagnie de fantassins qui passe tambours battants. Il écrirait volontiers sur son chapeau, comme le Guillot de La Fontaine: c’est moi qui suis dans cette ville le protecteur de l’agriculture, du commerce et de l’industrie; parce qu’il remue beaucoup ses bras et ses jambes, sa langue et sa plume, il se croit un prodige d’activité. Or, si cet homme accapare–comme c’est son dessein– toute l’attention publique, il n’en restera plus pour le mérite modeste, pour l’homme qui se dévoue en silence aux intérêts de son pays. Et pourtant chacun a droit selon ses œuvres, aux coups de chapeau que décerne la cité. Le pamphlet a donc raison de rappeler à l’ordre celui qui en prend une trop grosse ailleurs, n’est-ce pas une bonne œuvre et une œuvre d’autant meilleure qu’elle ne coûte rien à personne, que de chercher à guérir cette pauvre vanité hydropique?
Vous seriez bien aise, n’est-ce pas, quand un intarissable bavard vous étourdit depuis une heure de son tic-tac importun, que le maître du salon lui fît comprendre qu’il ennuie; or, n’est-ce pas ce que fait le pamphlet à l’égard de certaines gens qui, n’étant bons qu’à rédiger des factures, étourdissent la ville de leurs écrits philantrophiques. Un homme, qui n’est que banquier et rien de plus, a donné un bon dîner à son député, pour cette action d’éclat il a reçu la croix d’honneur; le pamphlet perce la foule de ceux qui le saluent et lui dit: monsieur, ce n’est pas vous qui avez gagné cette décoration, c’est votre cuisinière, c’est à elle que reviennent tous ces hommages. En défendant les droits de ce pauvre cordon-bleu, dont le gouvernement a méconnu les services, n’est-ce pas un acte généreux qu’il accomplit, et la presse sainte de M. de Lamartine, pourrait-elle faire mieux.
Si dans une distribution de soupe, vous voyiez un homme vendre sa ration à son voisin, et apporter de nouveau son écuelle à remplir, ne diriez-vous pas à cet appétit frauduleux: mon ami, vous larronnez la portion d’un autre. Le pamplet a-t-il donc tort, quand à un homme, qui ayant reçu du gouvernement une charge en pur don, la vend et en sollicite une autre, il dit la même chose? Souvent ce que vous prenez de la part du pamphlet pour une outrageante personnalité, ce n’est qu’un acte de bienveillance, un bon conseil qu’il inflige. Ainsi quand il voit un savant estimable, bâtir un gros traité entre les deux branches d’un Y, il lui dit, monsieur vous perdez, dans un travail stérile, votre esprit et vos veilles, de même que vous diriez à un homme que vous rencontreriez semant des aiguilles dans un champ, qu’il perd son temps et sa marchandise. Ce savant s’irrite contre l’officieux pamphlétaire et prétend qu’il écrit en style de corps-de-garde, c’est de rigueur; mais le pamphlet n’est-il pas meilleur pour lui en celte occasion que ce perfide ami qui lui caresse les oreilles de ces douces paroles: poursuivez, grand homme, pour le bien de l’humanité, le cours de vos recherches; vous avez déjà trouvé la bifurcation de l’Y, peut-être finirez-vous par découvrir que l’O est elliptique, et l’I simple rectiligne.
Et cette plume de pamphlétaire qu’il faut toujours tenir comme un glaive, croyez-vous qu’elle ne soit pas lourde à porter, qu’elle ne fatigue point les doigts qui la conduisent? En ce moment je suis là, accoudé sur la fenêtre de mon atelier, contemplant cette belle vallée de la Nièvre qui s’emplit d’ombre et ressemble, avec sa forêt de peupliers, à un champ garni de gigantesques épis verts; le soleil se couche derrière moi; ses derniers rayons allument, comme un brâsier, les ardoises du moulin; ils illuminent la cîme vacillante des peupliers et bordent de franges roses les petits nuages qui passent à l’horizon. Dans le lointain, les pâles fumées de Pont-Saint-Ours, ondoient et s’en vont, emportées par le vent, comme une procession de blancs fantômes qui défile. La Nièvre, cette laborieuse naïade que les tanneurs forcent du matin au soir à laver leurs peaux, a fini sa journée; elle se promène libre et tranquille entre ses roseaux et clapotte doucement sous les racines des saules. A cette heure si belle et si douce, je sens à ma vieille lyre de poète une corde qui se réveille; j’aimerais à décrire ces riants tableaux, et peut-être du fond de cette encre immonde, amènerais-je quelque paillette d’or au bec de ma plume; mais hélas! quand je voudrais peindre et chanter, il faut que j’écrive, que je martelle des phrases aggressives contre mes adversaires. Ce faisceau de flèches ébauchées qui est là sur ma table, il faut que je le garnisse de pointes. Quand mon ame s’emplit comme ce vallon de paix et de silence, il faut que j’y tienne la colère éveillée; quand je voudrais pleurer peut-être, il faut que je rie.
Derrière cette verdure étrangère et cette traînée bleuâtre de collines que je ne connais pas, sont les premiers arbres qui m’ont abrité, les premières collines que j’ai foulées; c’est de ce côté que s’envolent mes pensées, semblables à des pigeons qui, lâchés sur une terre lointaine, s’enfuient à tire-d’aile vers le colombier natal. C’est là qu’est ma mère, mon frère, mes amis, tous ceux que j’aime et dont je suis aimé. Quelle destinée m’a donc éloigné de ces lieux! Pourquoi ne suis-je point là avec ma femme et mes enfants! Pourquoi ma vie ne s’y écoule-t-elle pas doucement et sans bruit comme l’eau claire d’un ruisseau! Hélas! ce même soleil qui s’est levé sur mon berceau, il ne se couchera donc point sur ma tombe. Maudits soient ces imprudents persécuteurs qui m’ont appris que j’avais une arme redoutable, en me forçant à me défendre. Loup féroce, c’est pourtant en léchant leur sang, que cet appétit du sang m’est venu! Et que m’importe à moi que ce journal prêche et que cet évêque fasse le journaliste. Cruel pamphlet, laisse-moi un instant avec mes rêves. Ces oiseaux aux plumes blanches et roses, tu les effarouches des éclats stridents de ta plaisanterie. Laisse-moi passer et repasser la main sur leurs ailes, peut-être, hélas! ne reviendront-ils plus de sitôt; et d’ailleurs, ces messieurs sont-ils si pressés qu’on les fustige?
O mes amis, que faites-vous en ce moment? tandis que je suis là pensant à vous et entouré de vos chères images, vous entretenez-vous de moi sous vos tonnelles? Voici l’heure où ma mère se repose à l’ombre de son petit jardin; je suis bien sur qu’elle rêve de moi en arrosant ses fleurs; peut-être dit-elle mon nom à sa petite-fille. O ma mère! si je vous écris moins souvent, c’est ce dur métier de pamphlétaire qui en est la cause; mais soyez tranquille, je n’attendrai point pour vous revoir, que l’hiver ait mis entre nous ses neiges. Quand ce ciel commencera à blanchir, que ces arbres se teindront de jaune, qu’un plus pâle sourire sera venu aux lèvres de l’automne, j’irai m’asseoir à votre foyer et rajeunir ma poitrine à cet air que vous respirez. Ces beaux chemins où j’ai tant rêvé, tant fait de vers perdus, comme le chant des oiseaux dans l’espace, je veux me promener encore entre leurs grandes haies pleines déjà de pourpre et d’or, et. toutes brodées de clochettes blanches, et ce sera pour la dernière fois peut-être .
Je veux encore écouter les flots amis de ma rivière de Beuvron, et les écouter long-temps. L’eau qui mord par le pied mon vieux saule de la petite Vanne, l’a-t-lle renversé? a-t-il encore à ses racines beaucoup de mousse et de petites fleurs bleues? Je veux encore passer une heure sous son ombre, contemplant tantôt ces noirs rubans d’hirondelles qui flottent dans les cieux, tantôt ces longues traînées de feuilles jaunes qui s’en vont tristement au courant de l’eau comme un convoi qui passe, et tantôt aussi ces pâles veilleuses, tant redoutées des jeunes filles, et qui sortent de terre semblables à la flamme de la lampe qu’il leur faudra bientôt allumer. Ces images de deuil plaisent à mon ame; elles la remplissent d’une tristesse douce et presque souriante. Je me représente l’année comme une femme phtysique qui, sortant d’une fête, dépouille lentement et une à une les parures dont elle était revêtue, pour se coucher dans son cercueil. Mais adieu ma mère, adieu mon vieux Clamecy, on m’appelle; je me suis fait l’exécuteur des colères de la société, et il faut que ma tâche s’accomplisse.
Eh! que disais-je tout-à-l’heure? que cette pénalité morale, appliquée par le pamphlet, aux délits que les lois ne peuvent atteindre, produisait un résultat utile à tous.
Mais ce n’est pas seulement dans ces petits duels d’homme à homme que le pamphlet sait combattre; il a une arme plus lourde que celle du ridicule. Dans toutes ces grandes luttes où la liberté des hommes est mise en question, il est au premier rang, armé de sa bonne épée, et son effort est presque toujours décisif. Avant qu’il sût écrire, il faisait déjà des révolutions.
A Rome, une aristocratie avare et insolente a fait tomber le peuple du haut de la souveraineté dans la servitude, et de la servitude dans la misère. Un pamphlétaire seul ose venir en aide à cette foule qu’on tyrannise: c’est Caius, l’aîné des Gracques; il est du sang des oppresseurs, il a sa part de leur autorité usurpée, il est assez grand pour devenir le premier parmi eux; mais ce cœur-là, serviteurs de toutes les autorités constituées, il ne battait pas comme les vôtres.
Tiberius s’arme du pamphlet–du pamphlet parlé, vous entendez–et il le fait éclater et retentir comme la foudre; mais lui, ce n’est pas à des hommes comme les vôtres, comme vos bourgeois parvenus, comme vos notabilités inconnues, comme vos grands seigneurs brodés de laine qu’il s’adresse; c’est au sénat, c’est aux consuls, c’est à tout le corps des patriciens, aux ancêtres des conquérants lu monde. Cette grande personnalité n’est pas trop vaste pour son étreinte, et longtemps il la tient pantelante et tout épuisée d’haleine, contre sa robuste poitrine. Il périt assassiné, mais la lutte n’est pas terminée.
Un autre pamphlétaire, le frère du premier, son rère par la destinée, hélas, ainsi que parle sang, prend sa place; il meurt comme lui, comme sont morts, du reste, la plupart de ceux qui ont pris la défense du peuple.
Qui viendra maintenant au secours de cette mulitude abandonnée! Sa lâcheté et son ingratitude, n’ont-elles point découragé tous ses défenseurs? Non; un troisième pamphlétaire grandit dans l’ombre; mais à cette tribune où il doit monter, il y a deux marches, qui sont des cadavres, les cadavres de ses frères. Il y monte cependant, et...... vous savez le reste. Mais ce sang ne reste point infécond, le peuple est réhabilité, il remonte enfin au rang dont on l’avait fait descendre. O Gracques! Gracques!–et que ne puis-je écrire ce nom comme je le prononce dans mon cœur:–qui n’aimerait mieux mourir comme vous, que d’être gras comme tant d’autres!
Mais cette aristocratie défaillante a besoin, à son tour, qu’on la protège. C’est dans son sein même, comme au sein d’un cadavre éclosent les vers qui le dévorent, que sont ses plus redoutables ennemis. Catilina et un tas de patriciens dégradés, tous gens perdus de dettes et de débauches, conspirent contre la république. Il leur faut, pour payer leurs créanciers, les dépouilles de l’univers et, dans une orgie faite avec le sang d’un esclave, ils ont juré le massacre du sénat et l’incendie de Rome. Ils ont une armée d’assassins à leurs ordres, ils comptent dans le sénat de puissants auxiliaires, à la tête desquels est César, César déjà grand par sa parole avant de l’être par son épée. Ils ont tous cette audace désordonnée qui décuple comme la folie la force des hommes, et lance, ainsi que la poudre lance le boulet, tous les moyens d’action qu’on possède contre un obstacle.
Cette Rome si puissante, tandis que ses armées menacent l’Asie et l’Afrique, que ses aigles sont aux extrémités connues du monde, elle va périr sous des poignards, comme un roi qu’on assassine dans sa chambre, tandis que ses gardes veillent aux portes du palais, et ce grand sceptre avec lequel les patriciens gouvernaient les nations, va tomber tout entier aux mains d’un bandit. Heureusement, elle a pour consul un pamphlétaire. Cicéron monte à la tribune, et il accable Catilina de cet admirable pamphlet connu sous le nom de première Catilinaire. Le brigand vaincu s’enfuit devant ces ardentes personnalités, comme devant l’épée flamboyante de l’ange s’enfuyait le premier homme. La conspiration périt avec son chef sous les coups de Petreius et la liberté peut encore se traîner en boitant et en chancelant jusqu’aux champs de Pharsale.
Maintenant, à la place de Cicéron mettons l’Écho de la Nièvre avec son horreur des personnalités. Le voilà consul; il est à la tribune; écoutez!! D’abord il procède par un pompeux éloge de Catilina; car enfin Catilina peut réussir. Il loue la noblesse de sa naissance, son courage et même la faculté qu’il a de bien supporter le Falerne; puis il ajoute: Pères conscrits, je vous dois la vérité, et j’aurai le courage de la dire tout entière. S’il était vrai que cet illustre patricien eût conçu le dessein de nous massacrer tous et de brûler Rome, il ne serait pas tout-à-fait exempt de reproches. Mais dans ce cas j’ai la confiance qu’il reviendra à des sentiments plus romains; ses hautes vertus et ses antécédents nous en donnent la garantie; quant à ces vils, à ces infâmes, à ces misérables prolétaires qui ont pris une part quelconque au complot, il faut qu’on les égorge jusqu’au dernier; le salut de la république l’exige. Voilà comme l’Écho eut sauvé Rome.
Dix siècles s’écoulent, et le pamphlet s’est fait théologien. C’est dans la bouche de Luther et de Calvin qu’il a mis sa langue de fer. Le pape, ce roi en surplis qui courbait toutes les majestés du monde sous sa main bénissante, il est vaincu et presque détrôné par deux moines pamphlétaires; tandis que la moitié de ses sujets lui échappe, l’autre moitié se désabuse. Car le coup que Luther a porté à son infaillibilité, a retenti d’un bout de la chrétienté à l’autre. Le prestige qui entourait cette mystérieuse puissance est dissipé; cet esprit d’examen qui avait fait triompher la religion chrétienne des absurdités du paganisme, et que les prêtres avaient étouffé lorsqu’ils n’en eurent plus besoin, il se réveille et secoue son flambeau au milieu des ténèbres du monde. L’église, avec tous ses conciles, n’est plus assez forte pour imposer silence à la raison. Les rois agenouillés se relèvent, les peuples se relèvent ensuite. L’excommunication n’est plus qu’un tonnerre postiche qui lance à peine de loin en loin quelques impuissants éclairs, et le maître du monde chrétien, renversé de sa niche sublime, est redevenu, ce qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être, le chef de l’église.
Mais après avoir renversé la puissance des papes, le pamphlet, entre les mains de Blaise Pascal, renverse la puissance des jésuites. Cependant Pascal, cet infâme pamphlétaire, il est un des hommes les plus vraiment chrétiens de son époque. Sa vie est simple et désintéressée comme celle d’un apôtre; quand il parle des grandeurs de la religion chrétienne, cette plume de colibri, avec laquelle il écrivait les Provinciales, se change en une plume d’aigle. Sa pensée s’élève alors à des hauteurs ou Bossuet lui-même n’a pu monter. Les jésuites sont vivaces et ils ont repoussé de leurs racines; mais ces prêtres sinistres portent toujours à leur épaule le stygmate ardent dont les a marqués Pascal; ils sont obligés de dissimuler leur nom. S’ils rentrent en France, c’est à petit bruit, à l’aide de faux passe-ports et par des issues secrètes, et partout où ils se montrent, la clameur publique éclate contre eux. Sans le vieux pamphlet de Pascal, ces avides écornifleurs d’honneurs, d’influence et de richesses, au lieu d’en être encore à essayer, sur la populace de nos églises, l’effet de leurs faux miracles et de leurs saints controuvés, seraient depuis long-temps dans la plénitude de leur puissance, et le monopole de l’éducation publique serait déjà entre leurs mains.
Mais ai-je besoin pour réhabiliter le pamphlet de ces exemples choisis parmi les hommes. Scribes et Pharisiens de notre temps, vous connaissez sans doute l’évangile? N’est-ce pas que la morale de ce divin livre est bien aussi pure que la morale du journal des Débats, et que celui qui l’a écrit pourrait bien être aussi honnête que vos congréganistes. Cependant le pamphlet s’y rencontre de page en page; l’évangile c’est la ruche qui est pleine de miel, mais qui est pleine aussi d’aiguillons. Cette parole si calme, si sereine, quand elle développe les sublimes vérités du christianisme, cette parole qui devient presque tiède quand elle exprime l’amour du ciel pour la terre, tout-à-coup vous l’entendez gronder, et la voici qui éclate en sanglantes personnalités. Jésus-Christ, le meilleur des pères et le plus doux des maîtres, ce roi de tous, qui voulait qu’on laissât les petits enfants venir à lui et qui abaissait, pour les bénir, ses mains jusqu’à leurs blondes têtes, quand les Scribes et les Pharisiens viennent se heurter contre lui, il devient un pamphlétaire inexorable.
Jésus-Christ est beau, certes, quand sur la montagne il instruit cette multitude de pauvres gens qui ont quitté leurs maisons pour le suivre, et se sont enfoncés après lui dans le désert, sans s’inquiéter d’où le pain leur viendrait; mais il n’est ni moins beau, ni moins grand quand, tout resplendissant d’une sainte colère, il chasse du temple ces marchands qui en avaient fait une boutique, qui avaient transformé l’autel de Dieu en un comptoir. Il est beau encore quand, brisant les fils de cette dialectique captieuse où voulaient l’enserrer les docteurs de la loi, il les enferme à leur tour dans ses paraboles, et armant de pointes de fer son inflexible parole, il les fustige jusqu’à ce qu’ils saignent; et encore quand il met à nu toutes leurs hypocrisies, qu’il écarte l’herbe et les fleurs sous lesquelles se cachaient ces hideux sépulcres et qu’il montre au peuple la pourriture qui est au fond. Et que ces colères du christ ne vous étonnent point! il est bon sans doute plus qu’aucun homme ne peut l’être; mais il n’y a point de véritable bonté sans haine des méchants, et de dévouement aux hommes, sans indignation contre ceux qui les oppriment. Délier les chaînes sous lesquelles le genre humain est accablé, et faire en même temps honte à cette poignée de maîtres barbares qui l’ont réduit à ce misérable état, telle est la double tâche que Jésus-Christ s’est imposée.
Qui sait même si ce ne sont point ses victorieuses attaques contre le clergé biblique de Jérusalem qui l’ont conduit à son calvaire. Cette coupe de fiel et de vinaigre qu’on lui fait boire, n’est-ce pas pour le pamphlétaire qu’elle est préparée. Le peuple n’est point féroce quand il est abandonné à lui-même, et le peuple de Dieu ne pouvait être un peuple de barbares. Il refusait de croire à la divinité de Jésus-Christ; mais les vertus de l’homme privé et les enseignements sublimes du philosophe devaient racheter cent fois à ses yeux les torts du faux messie, et quand bien-même, Jésus eut pris le titre de Fils de Dieu pour donner plus d’autorité à sa doctrine, à cette doctrine libératrice qui devait affranchir le genre humain, était-ce un peuple réduit en esclavage qui devait lui en faire un crime?
Otez de cette foule qui le suit à son calvaire, en le poursuivant de ses insultes, quelques Phariséens et deux ou trois docteurs de la loi, et tous ces hommes égarés tomberont à ses pieds, et le supplieront de répandre sur eux ses divines paroles. Non, je ne puis croire autrement, c’est une haine de prêtres démasqués dans leur hypocrisie et froissés dans leur orgueil, qui a poussé les juifs à tremper leurs mains dans le sang du Christ; car les prêtres de tous les cultes–les prêtres catholiques exceptés, cela va sans le dire–sont toujours les mêmes: ils pardonneront plutôt dix insultes faites à leur Dieu, qu’une insulte à leur personne. Malheur, éternellement malheur à qui les touche!
Du reste, si je ne craignais de blesser l’amour-propre de M. Dufêtre, en le comparant à Jésus-Christ, je dirais que, comme ce divin pamphlétaire, notre digne prélat assaisonne toujours de quelques traits de satire les enseignements qu’il nous donne. À mon premier pamphlet je vous en fournirai la preuve.
Auprès des grands pamphlétaires que je viens de dire, M. Dufètre inclusivement, je suis assurément fort peu de chose, et rien si vous le voulez. Mais à quoi me servirait-il d’être Cormenin ou Paul-Louis Courrier pour le résultat que je veux produire? Il n’est pas nécessaire d’avoir une hache pour couper quelques ronces, et qu’est-il besoin d’être ouragan, quand on n’a que quelques cierges à éteindre?
Je ne suis qu’un fétu, soit; mais ce fétu, aucuns quand il s’est logé sous leur paupière, l’ont pris pour une poutre. Vous, cependant, grands écrivains, faiseurs d’enthousiasme commandé, à quoi vos feuilles sont-elles bonnes? Celles qui sont tombées hier de votre arbre, il vous serait aussi difficile de les retrouver que les feuilles des bois que les ouragans du dernier hiver ont emportées. Ce tas d’articles religieux que vous avez faits pour M. Dufêtre, ont-ils ajouté un pouce à sa taille? Vous l’ayez aidé de tous vos efforts à monter sur son grand piédestal, mais il est resté sur la première marche comme une statue que ses câbles rompus ont abandonnée. Parce que vous ouvrez la bouche bien grand, vous croyez que vous faites beaucoup de bruit. Cette cloche, que vous appelez votre journal, il y a dix ans que vous la sonnez, et vous ne vous êtes pas encore aperçus qu’elle na point de battant. Il y a plus, médecins ignares, vos remèdes font un effet contraire à celui que vous en attendez; vos éloges blessent plus que votre blâme; et je suis bien sûr que M. Dufètre s’en priverait volontiers, à la condition que je lui ferais grace de mes critiques.
Mais moi, si petit qu’il soit, mes pamphlets ont un résultat, et voilà ce qui excite votre colère. Que vous importerait, en effet, que votre ennemi parlât mal de vous, s’il s’adressait à un sourd? Votre sainte, qu’est-elle devenue? qui parle encore de ses miracles? qui achète ses médaillons protecteurs? qui récite la prière de M. Gaume? pourquoi se tient-elle, pauvre vierge délaissée, triste et boudeuse, dans sa chapelle? pourquoi M. Dufètre ne lui permet-il plus de voir personne? n’est-ce pas parce que mes pamphlets l’ont réduite à l’expression qu’elle doit avoir, à une pincée de poussière. Pour M. Dufètre, s’il est un peu descendu dans l’admiration publique, je ne m’en attribue point le mérite; il s’élevait sur la pointe des pieds pour se grandir, il ne pouvait long-temps se maintenir dans cette position fatigante: ses talons sont retombés sur le sol; cela devait arriver tout naturellement, et sans que personne s’en mêlât. Mais vous, ses porteplumes, n’avez-vous pas subi un peu, sans vous en apercevoir du reste, l’influence de mes pamphlets. Ces pétarades d’articles religieux que vous lâchiez à chaque instant, ne me semblent plus aussi fréquentes, et vos tartines de pain bénit ont un peu, je crois, diminué de longueur; quand je n’aurais produit que ce résultat, vos abonnés me devraient une couronne.
Ce nom de pamphlétaire que vous me jetez, je le ramasse, je m’en fais un titre de gloire. Dire la vérité aux hommes, c’est, quoique vous en écriviez, un noble métier. Peu m’importe que quelques vieilles cigales et deux ou trois scarabées qui n’ont plus d’ailes, fassent bourdonner autour de moi leurs petites colères, j’ai la conscience d’avoir fait un bon usage du peu d’intelligence que Dieu m’a départi. J’aime mieux être en paix avec moi-même qu’avec autrui, et je préfère mon estime à celle d’un ramas de badauds qui ne me connaissent, ni ne me comprennent.
Comme écrivain, qu’ont-ils à me reprocher? J’ai toujours pris parti pour le faible contre le fort, toujours demeuré sous les tentes déchirées des vaincus et couché à leur dur bivouac. J’ai bien, à la vérité, biffé quelques épithètes trop somptueuses que certains ajoutaient à leurs noms; j’ai bien crevé à quelques amours-propres bouffis leur vessie; mais les gens que j’ai traités ainsi, ils étaient du parti qui nous est opposé, et j’avais le droit de rogner leur importance. Je n’ai point outrepassé envers eux les droits de la guerre: quand ils se plaignent de moi, c’est comme si un vieux kaiserlich se plaignait d’avoir été blessé à Austerlitz par un soldat français.
Ce sont des personnalités, soit; mais chacun a sa manière de faire la guerre; les uns tirent à ceinture d’homme et sur les masses, moi je choisis mon ennemi et je l’ajuste. Quand c’est un personnage empanaché qui passe à ma portée, je lui donne toujours la préférence.
Je n’ai qu’un nom ignoré, perdu parmi ces noms que la cité roule tous les jours dans sa vaste bouche; toutefois, j’ai la prétention de croire que ma plume est utile à quelques-uns. La haie est humble, ses rameaux trempent dans l’herbe, mais elle pique de ses épines le malfaiteur qui veut envahir l’héritage d’autrui; elle donne ses fleurs sauvages à la bergère qui passe, et les petits oiseaux tressent en sureté leur nid entre ses branches: j’aime mieux être une humble haie qu’un grand arbre inutile. Celui qui fait un métier infâme, c’est celui qui vend au pouvoir un vieux couton de plume dont une pauvre femme ne voudrait pas pour balayer son foyer; celui qui dans un intérêt d’argent passe sa vie à mentir et à tromper, et celui-là je ne voudrais pas être à sa place.
Donc je suis un pamplétaire; mais suis-je bien un impie, ainsi que les prêtres voudraient le faire croire à leurs béates? un impie selon la religion des prêtres, je ne m’en défends pas, mais selon celle de Jésus-Christ, je proteste. Et qu’est-ce que le juge suprême, si je comparaissais demain à son tribunal, aurait donc tant à me reprocher. Je n’ai point empli mes mains d’argent? je n’ai point trafiqué de ma pensée, je l’ai donnée aux hommes telle que Dieu me l’envoyait, comme l’arbre leur donne ses fruits. J’ai pris des mains de Dieu ma ration de pain quotidien sans jamais lui en demander une plus grosse; quand ce pain est noir, je ne me plains point, quand il est blanc je le mange de bon appétit; mais blanc ou noir je n’en laisse jamais pour le lendemain; je vais droit devant moi sans regarder en avant, sans regarder en arrière, ne cherchant qu’à éviter le caillou qui est à mes pieds et ne l’évitant pas toujours. Lorsque je rencontre une mauvaise herbe sur mon chemin, je l’arrache, quand c’est une bonne graine, je fais un trou en terre et je l’y dépose; si elle ne vient pas pour moi elle viendra toujours pour un autre; je fais comme le papillon qui jouit de l’été sans songer que l’hiver est au bout, et pour les quelques jours qu’il a à rester sur la terre, ne se donne pas la peine de se bâtir un nid. J’engage mes enfants à faire comme moi, je leur légue mon exemple, c’est la meilleure des richesses, et pour celle-là du moins, ils ne paieront pas au gouvernement de frais de succession. Je prie rarement Dieu, et voici pourquoi: parce que Dieu sait mieux que moi ce qu’il doit faire, parce que je crains de lui demander des choses qui ne me soient pas bonnes, parce que sans que nous le lui demandions, tous les matins il fait lever son soleil, et tous les ans il couvre la terre d’herbes, de fruits et de moissons; enfin parce que Dieu, du moment qu’il nous a créés, est obligé de pourvoir à nos besoins, et qu’il ne peut ressembler à ces mauvais pères qui ayant fait un enfant vont l’abandonner à la porte d’un hospice. Je ne l’adore pas non plus, parce qu’il n’a pas besoin qu’on l’adore, parce que l’homme ne peut rien. pour sa satisfaction, parce que d’ailleurs ces hommages que la foule lui adresse, ce sont les adulations de créatures intéressées, qui veulent aller en paradis; mais quand j’ai un sou qui ne me sert pas, je le donne à un pauvre.
J’ai dit ce que j’étais, que ceux qui m’appellent impie racontent sincèrement ce qu’ils sont, et on verra qu’ils ont moins de religion que moi.
C.T.