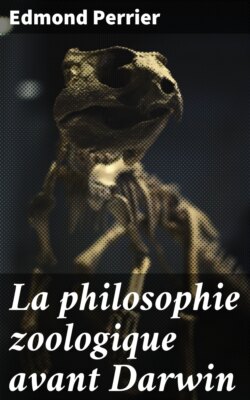Читать книгу La philosophie zoologique avant Darwin - Edmond Perrier - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LE MOYEN ÂGE ET LA RENAISSANCE
ОглавлениеLes médecins arabes.—Les alchimistes.—Albert-le-Grand.—Premiers grands voyages.—Renaissance de l'anatomie.—Belon, Rondelet.—François Bacon.—Progrès de la physiologie et de l'anatomie.—Les premiers micrographes.—Préjugés encore régnants au XVIe siècle.
Galien est la dernière grande intelligence, le dernier philosophe qui jette quelque éclat au milieu de la décadence générale de l'empire. Bientôt les barbares surgissant de toutes parts ruinent la civilisation romaine; le paganisme s'écroule; l'établissement du christianisme absorbe les efforts intellectuels de tous ceux à qui la guerre laisse des loisirs. Toute culture scientifique s'efface dans l'Occident, et ce sont les hommes de l'extrême Orient qui conservent à l'humanité, dans la mesure où il répond aux besoins de leur race, le trésor de connaissances amassé durant l'antiquité. Durant tout le moyen âge, les Arabes conservent la prépondérance scientifique. À partir du IXe siècle, on voit les sciences médicales prendre chez eux un épanouissement remarquable. Hippocrate, Aristote sont traduits en langue vulgaire. El Kindi (860), El Dchâdidh, auteur d'une histoire des animaux, Abou Hanifa, savant botaniste, Ibn Wahchjid sont les plus célèbres de cette période étonnante, où la magie se trouve sans cesse alliée à la science et à la métaphysique. Rhazès (850—923), Avicenne, Avenzoar (1070—1161), Averrhoès (1120—1198), son élève, ont laissé la réputation de médecins fort habiles et fort savants; néanmoins ils s'abandonnent beaucoup plus à la spéculation qu'à l'observation véritable; le philosophe domine ordinairement en eux le savant, et, s'ils ont largement contribué à nous conserver la tradition scientifique des anciens, il faut reconnaître qu'ils n'ont fait faire à l'anatomie, à la physiologie et au diagnostic de maladies que peu de progrès réels. Ils avaient cependant une connaissance approfondie des propriétés des plantes, et on leur doit l'introduction dans la thérapeutique d'un assez grand nombre de médicaments. Kazwyny (1283), Ibn el Doreihim, El Demiri, qui vivaient au XIVe siècle, El Calcachendi (1418), El Schebi et El Sojuti (1445) ont composé sur l'histoire des animaux des traités remarquables. El Demiri en particulier a écrit une sorte de dictionnaire d'histoire naturelle qui comprend la description de 931 animaux.
C'est aux Arabes que les lettrés européens du moyen âge empruntèrent leurs premières connaissances scientifiques; c'est à leur influence en grande partie qu'il faut attribuer le mélange singulier, que l'on observe constamment à cette époque, de l'astrologie et de l'alchimie avec la science véritable, mélange dont les plus grandes intelligences ne surent pas toujours se garder et qui eut pour résultat d'amener dans l'esprit du vulgaire une confusion complète entre les savants et les sorciers. Roger Bacon (1214-1292) lui-même, quoique protestant de la nullité de la magie, sacrifia largement à l'alchimie. C'était un vaste esprit, un chercheur ingénieux, et un expérimentateur habile. À lire certains passages de son Opus majus, on croirait qu'il a deviné les plus belles inventions modernes; il paraît même avoir connu l'art de fabriquer des poudres explosibles. Il compte parmi les hommes qui contribuèrent le plus à ramener les savants à l'observation de la nature. Les investigateurs de cette époque cultivaient d'ailleurs simultanément toutes les sciences: ils unissaient étroitement la pratique de la médecine, les discussions philosophiques ou même théologiques à la recherche de la pierre philosophale et de la transmutation des métaux. La plupart, en histoire naturelle, se bornent à faire sur le texte d'Aristote des commentaires théologiques, et s'ils ajoutent quelques observations de leur cru, elles témoignent d'ordinaire d'une telle conception de la nature, à qui tout semble possible, d'une telle inhabileté à démêler les premières apparences de la réalité, qu'on regrette presque que ces laborieux écrivains ne s'en soient pas tenus aux textes de l'antiquité. Tels sont, malgré la réputation que leur valurent leurs ouvrages et leurs travaux dans d'autres directions, les alchimistes Arnaud de Villeneuve (1238-1314), qui découvrit l'alcool, Raymond Lulle (1235-1315), à qui nous devons l'acide azotique ou eau-forte, Albert le Grand (1153-1280), dominicain, puis évêque de Ratisbonne, dignité qu'il abandonna pour se livrer exclusivement à la culture et à l'enseignement des sciences. Albert le Grand exerce cependant une réelle influence par ses nombreux ouvrages d'alchimie et d'histoire naturelle qui constituent une sorte d'encyclopédie où domine le point de vue théologique. On compte parmi ses disciples le fameux saint Thomas d'Aquin (1227-1274), à qui Pic de La Mirandole attribue un ouvrage d'alchimie et que l'Église catholique place encore au rang le plus élevé parmi ses hommes de science.
Durant le XIIIe siècle, quelques voyages, tels que ceux de Guillaume Rubruquis et de Marco Polo, firent connaître l'Asie orientale; Marco Polo est le premier qui ait pénétré en Chine et au Japon; mais le récit de ses voyages, qui ne cadrait pas toujours avec les affirmations d'Aristote, fut longtemps considéré comme une œuvre d'imagination.
Malgré l'invention de l'imprimerie (1431), malgré les grands voyages de Christophe Colomb et la découverte de l'Amérique (1492), le XVe siècle poursuit encore longtemps les errements scientifiques du XIIIe et du XIVe siècle; mais au XVIe siècle la lumière commence à se faire dans les esprits et d'importantes recherches scientifiques sont entreprises. André Vésale (1514-1564) régénère l'anatomie; Fallope, Eustache, Spiegel, Ingrassias, Botal, Varole ont tous attaché leur nom à la découverte de quelque organe ou de quelque particularité de structure du corps humain. Les recherches de Fabrizio d'Aquapendente (1537-1619), celles de Colombo et de Césalpin, qui fut aussi un botaniste remarquable, préparent la découverte de la circulation; Césalpin en donne même une description générale fort exacte, tandis que la circulation pulmonaire est nettement entrevue par le malheureux Michel Servet (1509-1555), qui fut brûlé à Genève, comme hérétique, par Calvin. À cette époque vécut aussi le célèbre chirurgien de Henri II, Ambroise Paré (1517-1590), qui, en dehors de son mérite comme praticien, songea le premier à comparer le squelette des oiseaux à celui des mammifères. À côté de cette renaissance de l'anatomie se manifeste aussi une renaissance évidente de la botanique et de la zoologie. Jean et Gaspard Bauhin, morts le premier en 1613, le second en 1624, publient, tout en s'occupant de médecine, d'importants ouvrages sur les plantes; Pierre Belon né en 1518, assassiné au bois de Boulogne en 1564, écrivit une Histoire naturelle des animaux marins et une Histoire des oiseaux; il compara entre eux les organes des divers animaux qui avaient fait l'objet de ses études, ouvrit ainsi la voie à l'anatomie comparée, et figurant en tête de son Ornithologie un squelette d'oiseau et un squelette humain, désigna par les mêmes lettres les parties qui lui semblaient se correspondre dans ces deux squelettes. À la même époque, Rondelet (1507-1566) dota l'histoire naturelle d'une fort belle Histoire universelle des poissons, où l'on trouve un véritable essai de classification naturelle. Mais les naturalistes de ce siècle les plus remarquables par leur savoir furent Conrad Gessner (1516-1565) et Aldrovande (1527-1605). Gessner publia, outre divers travaux philosophiques et scientifiques, une Histoire des animaux en 4 volumes in-folio et divers écrits de botanique dans lesquels il établit, sur les organes de fructification, la première classification scientifique des végétaux; il traite aussi des cristaux et dit que les fossiles pourraient bien être les dépouilles d'êtres vivants. Aldrovande est l'auteur d'une vaste histoire naturelle dans laquelle il traite des trois règnes de la nature, et qui fut imprimée, en partie, sous les auspices du sénat de Bologne.
Ce fut aussi un des titres de gloire du grand artiste Bernard de Palissy (1500-1589) d'avoir énergiquement soutenu que les fossiles étaient des restes d'animaux pour la plupart marins, et qu'en conséquence les mers avaient autrefois couvert une vaste étendue des continents, opinion déjà émise au commencement du siècle par Léonard de Vinci. La foi dans l'observation, dans l'expérience, dans la raison, se substitue ainsi peu à peu à la foi dans l'autorité et aux discussions sans fin sur les opinions des maîtres dont la philosophie scolastique nous offre le triste tableau. Résultat nécessairement impuissant de la direction imprimée aux esprits par le christianisme et de la forte constitution que s'était donnée le clergé, gardien des dogmes, la scolastique commence à inspirer un mépris mal déguisé; on comprend enfin combien sont stériles ses vaines disputes; et l'on prêche le retour vers l'observation de la nature qu'Aristote ne contient évidemment pas tout entière. Tandis que de nombreux investigateurs prêchent d'exemple et ajoutent à nos connaissances dans toutes les directions, sans trop de souci de l'autorité, quelques hommes hardis, comme Argentier, proclament leur confiance exclusive dans la raison et préparent ainsi l'avènement de François Bacon (1561-1626), dont l'Instauratio magna rétablit, pour la première fois, depuis Aristote, les vrais principes de la philosophie et de la méthode scientifique.
Bacon déclare que l'homme de science doit avant tout appuyer ce qu'il affirme sur l'expérience, et il étend même la méthode expérimentale à la recherche de l'origine des êtres. Dans sa Nova Atlantis, sorte de projet d'un établissement uniquement consacré au progrès des sciences naturelles, comme l'est notre Muséum d'histoire naturelle, il recommande de tenter les métamorphoses des organes et de rechercher, en faisant varier les espèces, comment elles se sont multipliées et diversifiées. C'est la première expression scientifique de l'idée que les formes des plantes et des animaux ne sont pas immuables et en nombre fini, que le monde vivant n'est parvenu à son état actuel que par une série de lentes et graduelles modifications. L'illustre philosophe put connaître avant de mourir l'une des plus belles découvertes dues à la méthode expérimentale, celle de la circulation du sang, annoncée dès 1619 par Harwey, médecin de Jacques Ier et de Charles Ier et élève de Fabrizio d'Aquapendente, qu'il avait assisté dans ses recherches sur les valvules des veines. Cette découverte donna un nouvel élan aux recherches anatomiques. Aselli retrouve les vaisseaux chylifères. Pecquet montre qu'ils sont destinés à puiser dans les entrailles les matières assimilables et qu'ils les transportent dans le canal thoracique, par lequel elles sont versées dans la circulation. Rudbeck et Bartholin se disputent la découverte des vaisseaux lymphatiques; Wirsung fait connaître le canal pancréatique; Bartholin et Sténon complètent l'étude des glandes salivaires. Wepfer, Schneider, Willis, Vieussens étendent les connaissances acquises sur le cerveau, dont ils précisent le rôle; enfin Ruysch, par l'application aux recherches anatomiques du procédé qui consiste à injecter des liquides colorés dans les vaisseaux et les cavités, fait faire de grands progrès à l'histoire de l'appareil vasculaire.
Vers la même époque, l'application à l'étude des organismes d'une autre méthode d'investigation fut encore plus féconde. Presque en même temps, Malpighi, professeur de médecine à Bologne (1628-1694), Leuwenhoek (1632-1723), de Delft, et Swammerdamm (1637-1680) introduisent l'emploi des verres grossissants dans les recherches d'histoire naturelle; ils sont aussitôt récompensés par de magnifiques découvertes. Malpighi fait connaître un grand nombre de particularités de structure des organes humains, découvre les trachées des insectes et étudie le développement du poulet; on doit à Leuwenhoek d'avoir révélé aux naturalistes l'existence des infusoires et d'avoir coopéré à la découverte des spermatozoïdes; il paraît aussi avoir connu la reproduction des pucerons sans le secours de l'accouplement, dont la réalité fut mise hors de doute, bien plus tard, par Bonnet, de Genève, et il fit sur la génération des polypes par bourgeonnement des observations qui devaient demeurer oubliées jusqu'aux recherches de Trembley. Swammerdamm, qui publia une grande partie de ses travaux sous le titre de Biblia naturæ, est surtout célèbre par ses recherches sur les métamorphoses des insectes.
Dès cette époque se posent les grandes questions qui ont depuis agité le monde savant: Rédi (1626-1698) combat par des expériences d'une réelle précision l'hypothèse, aujourd'hui ramenée à un problème de chimie, des générations spontanées. Il continue cependant à admettre la possibilité de ce mode de génération pour les vers que l'on trouve à l'intérieur des fruits et pour ceux qui vivent dans les viscères de l'homme et des animaux, mais c'est sous l'influence des forces vitales elles-mêmes, d'âmes embryons, d'âmes végétatives, que ces vers sont engendrés. Newton signale déjà à la fin de son Optique cette uniformité de structure des animaux, à la démonstration de laquelle Geoffroy Saint-Hilaire devait consacrer sa vie scientifique, et Pascal, dépassant Bacon, croit que les êtres animés n'étaient à leur début que des individus informes et ambigus, dont les circonstances permanentes au milieu desquelles ils vivaient ont décidé originairement la constitution[5]; Sylvius Leboë, de Leyde, soutient que tous les phénomènes qui se produisent dans les viscères sont analogues aux réactions qu'on voit s'accomplir dans les cornues des laboratoires de chimie; tandis que Vallisneri cherche à expliquer la génération, par la doctrine de l'emboîtement des germes dont Cuvier sera l'un des derniers partisans. Swammerdamm établit les bases de la doctrine du développement des animaux par formation successive des parties, par épigénèse. Mais les esprits sont loin d'être préparés à comprendre la portée de ces découvertes. En 1595, Frey, pasteur à Schweinfurth, considère encore les animaux comme des «précepteurs», qui nous auraient été donnés par Dieu; Wolfgang Franz, en 1612, dans son Histoire sacrée des animaux, qui eut plusieurs éditions et contient une assez ingénieuse classification des animaux, décrit les dragons naturels, qui ont trois rangées de dents à chaque mâchoire, et il ajoute avec une ineffable sérénité: «Le principal dragon est le diable;» le P. Kircher, physicien distingué cependant, recherche quels animaux Noé fit entrer dans l'arche; il figure parmi eux des sirènes et des griffons, et nous sommes en 1675! Il s'agit, à la vérité, d'écrivains religieux plutôt que de savants; mais quel monde de préjugés devait à une pareille époque affronter la moindre découverte!