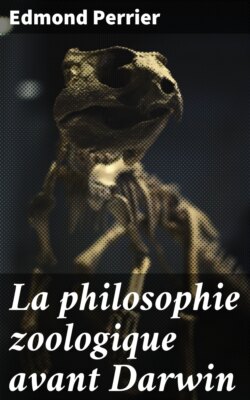Читать книгу La philosophie zoologique avant Darwin - Edmond Perrier - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ARISTOTE
ОглавлениеPremières notions sur les analogies et les homologies des organes.—Formes corrélatives.—Divisions établies parmi les animaux.—Idée de l'espèce.—Principe de continuité.—Degrés de perfection organique.—Possibilité d'une transformation des formes animales.
On a tant écrit sur Aristote, on a tant cité, commenté, interprété les œuvres de ce grand homme, que plus d'un lecteur sera sans doute tenté de nous reprocher de revenir, à notre tour, sur un sujet qui semble épuisé. C'est cependant jusqu'à l'illustre précepteur d'Alexandre qu'il faut faire remonter les origines de la philosophie zoologique. Lui seul, dans l'antiquité, sut allier une observation incessante et presque toujours rigoureuse des faits avec l'art de grouper les connaissances acquises de manière à en faire ressortir toutes les conséquences générales. Plus d'un passage de son Histoire des animaux pourrait être signé Cuvier ou Geoffroy Saint-Hilaire. Ce sont les principes mêmes de l'anatomie comparée, telle qu'on l'entend de nos jours, que développe Aristote lorsqu'il écrit dès les premières pages de l'œuvre mémorable que nous venons de citer les lignes suivantes:
«Il y a des animaux tels que toutes les parties des uns sont semblables aux parties correspondantes des autres; il y en a entre lesquels cette ressemblance ne se trouve pas. Les parties peuvent se ressembler, comme étant de la même forme; par exemple, le nez, l'œil, la chair, les os d'un homme ressemblent au nez, à l'œil, à la chair, aux os d'un autre homme; et ainsi des chevaux et des autres animaux que nous disons être de même espèce… Une autre sorte de ressemblance est celle des animaux qui sont de même genre et qui diffèrent par excès ou par défaut: les oiseaux, les poissons sont des genres dont chacun comprend un grand nombre d'espèces.
«Dans un même genre, les parties ne sont communément distinguées que par des qualités différentes, telles que la couleur et la figure…
«Il y a d'autres animaux dont on ne peut pas dire que les parties soient de même figure ni qu'elles diffèrent entre elles du plus au moins; on peut seulement établir une analogie entre les unes et les autres; c'est ainsi que, la plume étant à l'oiseau ce que l'écaille est au poisson, on peut comparer les plumes et les écailles, et de même les os et les arêtes, les ongles et la corne, la main et la pince de l'écrevisse. Voilà de quelle manière les parties qui composent les individus sont les mêmes et sont différentes. Il faut encore remarquer leur position. Plusieurs animaux ont les mêmes parties, mais ne les ont pas semblablement placées. Aussi les mamelles peuvent être placées sur la poitrine ou dans la région inguinale.»
Et l'on trouve plus loin:
«En général, entre les animaux de genre différent, la plupart des parties ont une forme différente: les unes n'ont entre elles qu'une ressemblance de rapport et d'usage et sont, au fond, de nature différente; d'autres sont de même nature, mais de forme différente; beaucoup se trouvent dans certains animaux et ne se trouvent pas dans d'autres.»
Ainsi ces diverses sortes de ressemblance des animaux que Geoffroy Saint-Hilaire et ses successeurs devaient désigner sous le nom d'analogies et d'homologies sont déjà en partie distinguées et définies par Aristote. Le philosophe de Stagyre n'est pas davantage étranger à ce que Cuvier devait plus tard appeler la corrélation des formes; il cite un grand nombre de ces corrélations qui sont depuis définitivement demeurées dans la science et sont encore employées dans la définition des groupes zoologiques. Voici les plus importantes:
«Tous les animaux ont du sang ou un liquide qui en tient lieu, la lymphe. Les animaux sans pieds, à deux pieds ou à quatre pieds ont du sang[1]. Tous ceux qui ont plus de quatre pieds[2] ont de la lymphe. Les animaux à sang sont plus grands que les animaux à lymphe, car ces derniers grandissent avec le climat.
«Les animaux pourvus de poils, les cétacés, les sélaciens, sont vivipares; ces derniers seuls ont des ouïes; ils produisent d'abord un œuf au dedans d'eux-mêmes.»
Le mode de viviparité des sélaciens, qui sont des poissons, est nettement distingué de celui des «animaux couverts de poils» et des cétacés, qui constituent notre classe des mammifères.
Plus loin, les animaux volants sont répartis en trois catégories, ceux qui ont des ailes garnies de plumes, ceux qui ont des ailes constituées par un repli de la peau, des ailes dermiques, ceux enfin qui ont des ailes sèches, minces, membraneuses. Les ailes dermiques et les ailes à plumes sont propres aux animaux qui ont du sang, et les ailes membraneuses sèches aux insectes. Les insectes peuvent avoir quatre ailes ou deux ailes. Les insectes coléoptères (le mot est dans Aristote), dont les ailes antérieures ont la forme d'étuis, n'ont pas d'aiguillon. Les insectes à quatre ailes ont un aiguillon en arrière: ce sont nos hyménoptères; les insectes à deux ailes ont un aiguillon en avant. Aristote ne se méprend d'ailleurs nullement sur la nature différente de ce qu'il appelle l'aiguillon chez les insectes à quatre ailes et chez les insectes à deux ailes, car il écrit en parlant de ces derniers: «La langue remplace l'aiguillon chez les diptères,» et il remarque que les insectes qui ont une langue n'ont point de mâchoires, comme s'il devinait dans la langue, que nous appelons aujourd'hui une trompe, le résultat d'une transformation des mâchoires.
Voilà donc, dans un seul groupe, celui des insectes, toute une série de corrélations nettement définies. Le mode de constitution de ces animaux est aussi bien saisi; ils sont représentés comme formés de parties, d'anneaux, de segments, paraissant avoir chacun leur vie propre; ces parties, ces segments sont ce qu'on a appelé depuis des régions du corps, des zoonites.
Aristote ne se montre pas moins perspicace lorsqu'il parle des mammifères. Après avoir placé parmi les animaux vivipares tous les animaux couverts de poils, il semble craindre qu'une confusion ne s'établisse entre ces derniers et les lézards, qui sont quadrupèdes comme eux, et fait observer que seuls les quadrupèdes couverts de poils sont vivipares. Les mammifères sont de la sorte nettement distingués des lézards, dont Aristote met d'ailleurs en évidence la ressemblance avec les serpents dépourvus de pieds. Un seul mot à inventer, et le groupe des reptiles se trouverait constitué.
Parmi les quadrupèdes vivipares, d'autres relations non moins remarquables sont établies. Ces quadrupèdes peuvent avoir des cornes ou en être dépourvus. Ceux dont la dentition forme une sorte de scie n'ont jamais de cornes; les cornes manquent encore aux quadrupèdes pourvus de défenses; tous les quadrupèdes cornus manquent d'incisives à la mâchoire supérieure. Tous les quadrupèdes vivipares, cornus, dépourvus d'incisives supérieures, possèdent quatre estomacs et jouissent de la faculté de ruminer. Rien ne manque, à cette caractéristique de l'ordre des ruminants, et la corrélation, si remarquable chez ces animaux, entre l'absence de cornes et la présence de canines, est même exprimée d'une façon précise; elle n'a été expliquée que de nos jours.
Bien qu'Aristote connût un assez grand nombre d'animaux, l'idée de les grouper dans un ordre déterminé, permettant d'exprimer leur degré plus ou moins grand de ressemblance ne paraît pas s'être présentée à son esprit. Il n'a donc pas tenté ce que nous appelons une classification. Il compare de toutes les façons possibles les animaux les uns aux autres et cherche à réduire en propositions générales le résultat de ses comparaisons. Il arrive ainsi à indiquer des rapprochements parfaitement naturels, qui peuvent encore aujourd'hui, prendre place dans nos méthodes; mais, tout à côté, des comparaisons d'un autre ordre le conduisent à de nouveaux rapprochements de moindre importance cette fois, et qui paraissent cependant avoir pour lui autant de valeur que les premiers, à des caractères qui auraient pu être utilisés, à leur tour, si l'idée d'une certaine hiérarchie dans ces rapprochements secondaires s'était dégagée, si les comparaisons, au lieu de s'étendre à l'ensemble des animaux, n'avaient été faites qu'entre organismes présentant la même structure anatomique, entre organismes «de même genre», comme il aurait dit lui-même.
Plus loin notre philosophe ayant épuisé l'étude des ressemblances se préoccupe seulement de rechercher les différences que les animaux présentent entre eux. Ces différences, «relatives à leur manière de vivre, leurs actions, leur caractère, leurs parties,» sont également toutes mises sur le même plan.
Ainsi Aristote distingue des animaux aquatiques et des animaux terrestres, des animaux sociaux et des animaux solitaires, des animaux migrateurs et des animaux sédentaires, des animaux diurnes et des animaux nocturnes, des animaux privés et des animaux sauvages. Les mêmes animaux peuvent se retrouver bien entendu dans ces diverses catégories; relativement aux deux dernières, Aristote fait d'ailleurs remarquer qu'une espèce donnée peut appartenir à toutes deux à la fois.
Il ne s'agit donc point ici de groupes naturels fondés sur des ressemblances que l'on puisse considérer comme fondamentales; aussi bien Aristote ne se propose-t-il pas pour but de faire connaître et de distinguer les différentes sortes d'animaux; son livre est tout à la fois une anatomie et une physiologie comparées plutôt qu'une zoologie, et il ne définit que les divisions qui sont nécessaires à ses comparaisons. Il traite séparément des animaux qui ont du sang et de ceux qui n'en ont pas et divise ces deux groupes principaux en groupes secondaires et remarquablement naturels, dont quelques-uns ont déjà été dénommés dans le langage vulgaire; c'est ce qu'il appelle les grands genres γενη μεγεστα των ζωων: tels sont les oiseaux, les poissons, les coquillages, les mollusques qui sont nos céphalopodes, ou encore les insectes. Pour ces derniers Aristote a créé le nom nouveau d'εντoμα; c'est là une hardiesse qu'il se permet rarement. Il se sert, en effet, des mots de la langue usuelle, et, quand il n'existe pas de mots correspondant aux groupes qu'il définit, il se borne à le regretter. Il signale ainsi l'absence d'une dénomination commune pour les mollusques à coquille, qu'il qualifie, en formant un mot composé, d'Ostracodermes, pour les langoustes, les crabes et les écrevisses qu'il réunit sous le nom, également composé, de Malacostracés. Cette insuffisance de la langue vulgaire l'embarrasse d'ailleurs visiblement. Il a nettement conçu un grand «genre» des mammifères; mais le peuple est en retard sur lui et confond les mammifères avec les autres quadrupèdes, tels que les lézards. Ce mot de quadrupèdes ne saurait être le nom d'un groupe naturel, car il y a des quadrupèdes vivipares et d'autres ovipares; Aristote, après cette remarque, l'abandonne donc sans le remplacer. Parmi les quadrupèdes vivipares, il aperçoit de même des groupes naturels, mais constate qu'ils n'ont pas reçu de nom, sauf un seul, celui des λoφοuροi, correspondant à nos solipèdes, caractérisés par le bouquet de crins qu'ils portent au bout de la queue.
Il semble que cette pénurie de mots ait été le principal obstacle qui ait empêché Aristote d'arriver à une définition claire de l'espèce telle que nous l'entendons aujourd'hui, et d'instituer un système coordonné de divisions zoologiques. La langue usuelle ne fournit, en effet, que deux mots pour exprimer les différents degrés de ressemblance: εiδος, qui veut dire forme ou espèce, et γενος que l'on traduit par genre. Les genres contiennent, en général, un assez grand nombre d'espèces; il y en a de grands γενη μεγαλα et de très grands γενη μεγιστα; mais, les espèces contenues dans ces genres peuvent se subdiviser aussi en espèces d'ordre inférieur et deviennent alors des genres. Quand il considère l'espèce d'une façon absolue sans la rapporter à un groupe plus étendu, Aristote la désigne d'ailleurs, constamment, sous le nom de γενος. On voit quelle confusion doit produire, dans un échafaudage quelque peu compliqué de divisions n'ayant pas la même valeur, l'emploi perpétuel de deux mots dont la signification change suivant le point de vue d'où l'on considère chaque division. Cependant s'il n'a pas pu définir et surtout dénommer l'espèce, Aristote en a bien vu le caractère essentiel, le même que nous employons comme criterium et qui est tiré de la reproduction. Après avoir défini le genre des Lophures λοφουροι, il y place, en effet, le cheval, l'âne, le mulet, le bidet et le bardeau et il ajoute: «Joignez-y les hémiones (demi-ânes) de Syrie qui ne portent ce nom qu'à raison de leur apparence, car ils constituent une espèce distincte puisqu'ils s'accouplent entre eux et que leur accouplement est fécond.» Il est certain, d'autre part, qu'Aristote n'a considéré comme de même espèce que les animaux descendus de parents communs, car il désigne aussi sous le nom d'homophyles les animaux de forme semblable. Voilà donc l'espèce définie par l'accouplement et la fécondité, absolument comme elle l'est de nos jours. Malheureusement Aristote ne tire pas tout le parti qu'il devrait de cette notion évidemment vulgaire; aussi bien, son opinion doit-elle être troublée par sa confiance dans les récits mensongers qui lui ont été faits des mœurs des animaux exotiques. Il admet, par exemple, qu'en Lybie les formes sauvages sont plus sujettes à varier et il ajoute: «En Lybie, où il ne pleut point, les animaux se rencontrent dans le petit nombre d'endroits où il y a de l'eau. Là, les mâles s'accouplent avec les femelles d'espèces différentes μv δμωφυλα, et ces familles nouvelles font souche si la taille des deux individus n'est pas trop différente et la durée de la gestation trop inégale dans les deux espèces.» Un peu plus bas, il accueille la tradition qui fait descendre les chiens de l'Inde d'une chienne et d'un tigre. Quand il s'agit d'animaux habitant les pays lointains, l'attrait du merveilleux a évidemment obscurci, dans l'esprit d'Aristote, l'idée de l'espèce telle qu'elle résulte de l'observation journalière. Quoi d'étonnant à ce que les choses ne se passent exactement comme en Grèce dans cette Lybie qui a la réputation «de produire toujours quelque monstre nouveau». Lorsqu'il se produit, en Grèce, des phénomènes plus ou moins analogues à ces merveilles qu'il signale en d'autres points du globe, Aristote en dit seulement qu'on les considère comme des présages.
Les connaissances d'Aristote relativement aux différents modes de reproduction des animaux sont trop incomplètes pour lui permettre aucune généralisation relativement à l'espèce. En ce qui concerne les animaux inférieurs, malgré des observations précises, il ne réussit pas à s'affranchir complètement des opinions qui ont cours de son temps. Ainsi, il connaît les œufs des papillons, des poux, des mouches, les capsules nidamentaires des pourpres, des murex, etc., et cependant il déclare que ces œufs demeurent stériles. Les ostracodermes, en général, les orties de mer, les éponges naissent des matières demi putréfiées qui forment le fond de la mer et sont différentes suivant la nature de ce fond; les papillons naissent des chenilles, et celles-ci sont formées par les feuilles vertes; il se produit de même, dans le bois, les excréments des animaux, et dans d'autres conditions, des vers qui plus tard se changent en insectes. N'est-il pas étonnant que les métamorphoses des insectes ayant été bien observées, ainsi que leur accouplement et leur ponte, le cycle n'ait pu être fermé, et qu'un observateur aussi patient soit demeuré dans le doute relativement à la véritable origine des vers qui ne sont que le jeune âge, les larves d'animaux qu'il connaissait si bien? Aristote admet d'ailleurs que des animaux qui sont ordinairement produits par des œufs peuvent aussi se former spontanément dans la vase de certains marais.
Ces idées ne laissent pas que d'être parfaitement d'accord avec la doctrine de la continuité des œuvres de la nature, continuité qu'ont toujours plus ou moins cherchée les philosophes de tous les temps et qu'Aristote considère comme une loi fondamentale.
«Dans la nature, dit-il (liv. VIII), le passage des êtres inanimés aux animaux se fait peu à peu et d'une façon tellement insensible qu'il est impossible de tracer une limite entre ces deux classes. Après les êtres inanimés viennent les plantes, qui diffèrent entre elles par l'inégalité de la quantité de vie qu'elles possèdent. Comparées aux corps bruts, les plantes paraissent douées de vie; elles paraissent inanimées comparativement aux animaux. Des plantes aux animaux le passage n'est point subit et brusque; on trouve dans la mer des êtres dont on douterait si ce sont des animaux ou des plantes; ils sont adhérents aux autres corps, et beaucoup ne peuvent être détachés sans périr des corps auxquels ils sont attachés.» Les pinnes, le solens et beaucoup d'autres ostracodermes, les ascidies, les anémones ou orties de mer, mais surtout les éponges sont énumérés parmi ces êtres ambigus, animaux par certains caractères, végétaux par leur apparente inertie.
La recherche des animaux intermédiaires entre les animaux aquatiques et les animaux terrestres conduit Aristote à se demander en quoi ces animaux diffèrent essentiellement les uns des autres; c'est pour lui l'occasion de considérations philosophiques, auxquelles les zoologistes modernes doivent toute leur admiration. Les animaux qui vivent dans l'eau recherchent ce milieu pour différentes raisons: il en est qui ne peuvent respirer que dans cet élément; d'autres qui respirent l'air libre, mais ne trouvent leur nourriture que dans l'eau; d'autres enfin qui ont besoin d'eau pour respirer, mais vont chercher leur nourriture à terre.
«Dans les animaux de ces deux dernières catégories, dit Aristote, la nature est contrariée, si l'on peut parler ainsi. On voit ainsi des mâles qui ont l'air féminin et des femelles qui ont l'air mâle. Une différence réelle dans de petites parties suffit à faire paraître des différences aussi considérables dans l'ensemble du corps de l'animal. L'effet de la castration en est une preuve. On ne retranche par cette opération qu'une petite partie du corps de l'animal; néanmoins ce retranchement change sa nature et fait qu'elle se rapproche de celle de l'autre sexe. Ainsi il est sensible qu'au moment de la formation première un rien dont la grandeur varie dans une des parties qui constituent le principe des corps fera de l'animal un mâle ou une femelle. C'est donc de la disposition de petites parties que résulte la différence d'animal terrestre et d'animal aquatique, dans les deux sens que j'ai distingués.»
Aristote pense donc que les animaux terrestres ont pu devenir aquatiques ou inversement, et il attribue ce changement de mœurs à quelques accidents survenus durant le développement embryogénique des animaux qui l'ont présenté. D'illustres naturalistes de notre temps ont de même admis qu'on pouvait attribuer aux monstruosités accidentelles une part importante dans la diversification des espèces. D'après ce passage, Aristote pourrait être considéré comme transformiste; mais la question du transformisme ne pouvait évidemment être posée à une époque où l'on n'avait pas encore songé à se demander s'il existait des espèces.
Considérant les animaux à tous les points de vue que lui suggère son esprit éminemment philosophique, Aristote effleure bien d'autres idées importantes, sans en tirer cependant toutes les conséquences qu'elles ont fournies quand nos connaissances relatives aux animaux ont été plus étendues. C'est ainsi qu'on peut voir, avec M. Jules Geoffroy, comme une intuition de la loi de la division du travail physiologique, développée seulement en 1827 par M. H. Milne Edwards, dans cette phrase du livre IV des Parties des animaux: «La nature emploie toujours, si rien ne l'en empêche, deux organes spéciaux pour deux fonctions différentes; mais, quand cela ne se peut, elle se sert du même instrument pour plusieurs usages; cependant il est mieux qu'un même organe ne serve pas à plusieurs fonctions.» D'autre part, la «lutte pour l'existence» que se livrent une foule d'animaux ne lui a pas échappé. «Les animaux, dit-il au livre IX, sont en guerre les uns contre les autres quand ils habitent les mêmes lieux et qu'ils usent de la même nourriture. Si la nourriture n'est pas assez abondante, ils se battent, fussent-ils de la même espèce.» Aristote n'a pas vu cependant que de cette lutte pouvait résulter l'extinction d'une ou plusieurs formes vivantes. Il est, au contraire, comme presque tous les philosophes de l'antiquité, pénétré de l'idée que le monde est immuable et que les ressources de la nature sont assez grandes pour rendre impossible la destruction d'une de ses œuvres. D'ailleurs tous les animaux ne sont pas en lutte; il en est qui sont amis, et ce n'est pas un des livres les moins brillants de l'Histoire des animaux que celui où le grand philosophe décrit les mœurs des êtres qu'il a étudiés et se montre aussi patient observateur que nous l'avons vu jusqu'ici habile anatomiste.
En résumé, l'œuvre immense dont nous venons d'esquisser les traits généraux est avant tout de celles auxquelles peut s'appliquer le plus justement le titre de «Philosophie zoologique». Aristote n'y accumule les faits que pour arriver à des lois, et son esprit pénétrant discerne avec un rare bonheur les rapports généraux. Plusieurs de ceux qui sont exprimés dans l'Histoire des animaux sont définitivement entrés dans la science tels qu'Aristote les avait formulés; d'autres ne sont qu'entrevus; mais ce qui est plus merveilleux peut-être, c'est qu'Aristote avait saisi du premier coup les différents points de vue auxquels le règne animal pouvait et devait être étudié. L'anatomie comparée, la physiologie, l'embryogénie, les mœurs des animaux, leur répartition géographique, les relations qui existent entre eux font également l'objet de ses études et ses recherches forment le plus riche trésor de connaissances que l'esprit d'un homme ait jamais possédé.