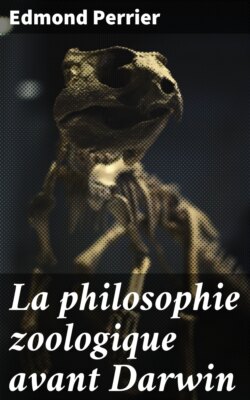Читать книгу La philosophie zoologique avant Darwin - Edmond Perrier - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE VI
ОглавлениеTable des matières
LES PHILOSOPHES DU XVIIIe SIÈCLE
C. Bonnet: la chaîne des êtres; les révolutions du globe; l'état passé et l'état futur des plantes, des animaux et de l'homme; l'emboitement des germes.—Robinet: ses idées sur l'évolution.—De Maillet: les fossiles.—Erasme Darwin: le transformisme fondé sur l'épigénèse.—Transformation des animaux sous l'influence de l'habitude; analogie avec Lamarck et Charles Darwin.—Maupertuis: la sensibilité de la matière et le transformisme.—Diderot: la vie de l'espèce et la vie de l'individu.
Linné était avant tout un savant; s'il avait de brillantes échappées vers la philosophie, il faisait hautement profession de borner son ambition à la connaissance et à la contemplation des œuvres de la nature; Charles Bonnet est avant tout un philosophe qui interroge la nature pour y trouver des problèmes à résoudre, qui expérimente et observe, pour s'élever aussitôt des faits qu'il découvre aux plus hautes spéculations métaphysiques. Comme philosophe, Bonnet est un fervent disciple de Leibnitz: tous ses efforts tendent à démontrer la possibilité d'appliquer aux corps matériels et même aux êtres immatériels dont il admet l'existence, cette loi de continuité que nous avons déjà vue acceptée par Linné. Pour lui, tous les êtres forment une chaîne continue en dehors de laquelle il n'y a que Dieu. Graduellement, les minéraux passent aux êtres organisés et ceux-ci sont reliés entre eux par une foule d'insensibles transitions. Les diverses divisions de nos systèmes et de nos méthodes, les espèces mêmes n'ont qu'en apparence des limites fixes. En réalité, grâce aux innombrables variations que les individus peuvent présenter, les espèces sont étroitement reliées les unes aux autres: «Les intelligences qui nous sont supérieures découvrent peut-être entre deux individus que nous rangeons dans la même espèce plus de variétés que nous n'en découvrons entre deux individus de genres éloignés. Ainsi ces intelligences voient dans l'échelle de notre monde autant d'échelons qu'il y a d'individus. Il en est de même de l'échelle de chaque monde, et toutes ne composent qu'une seule suite, qui a pour premier terme l'atome et pour dernier terme le plus élevé des chérubins[6].» Comme conséquence de ces idées, Bonnet accepte l'opinion qu'il existe plusieurs mondes habités, que ces mondes présentent au point de vue de leur perfection une véritable gradation, qu'il en est d'inférieurs au nôtre et aussi de supérieurs.
«Les êtres terrestres viennent se ranger naturellement sous quatre classes générales: 1° les êtres bruts ou inorganisés; 2° les êtres organisés et inanimés; 3° les êtres organisés et animés; 4° les êtres organisés, animés et raisonnables[7]… L'assortiment d'êtres qui est propre à notre globe ne se rencontre vraisemblablement dans aucun autre. Chaque globe a son économie particulière, ses lois, ses productions. Il est peut-être des mondes si imparfaits relativement au nôtre qu'il ne s'y trouve que des êtres de la première ou de la seconde classe. D'autres mondes peuvent être au contraire si parfaits, qu'il n'y ait que des êtres propres aux classes supérieures. Dans ces derniers mondes, les rochers sont organisés, les plantes sentent, les animaux raisonnent, les hommes sont des anges.
«Quelle est donc l'excellence de la Jérusalem céleste, où l'ange est le moindre des êtres intelligents[8]?»
Bonnet passe, comme on voit, de la science à la théologie, des êtres matériels aux esprits. Ses tentatives de constituer par les inductions que lui inspire la loi de continuité une sorte d'histoire naturelle des créatures célestes peuvent paraître aujourd'hui bien naïves. Mais, si l'application d'un principe tiré de l'étude du monde tangible à un monde qui échappe totalement à nos sens conduit à des conclusions que rien ne saurait distinguer des rêves de notre imagination, l'application de ce même principe à la détermination des rapports réciproques des êtres organisés est, au contraire, féconde en conséquences intéressantes. C'est ainsi que Bonnet, après une comparaison longuement développée de la plante et de l'animal, arrive à cette conclusion, si éloquemment mise en lumière par Claude Bernard dans les dernières années de sa vie, qu'il n'existe entre les deux grands règnes organiques aucun caractère distinctif absolu: «Dites au vulgaire que les philosophes ont de la peine à distinguer un chat d'un rosier; il rira des philosophes et demandera s'il est rien dans le monde qui soit plus facile à distinguer? C'est que le vulgaire, qui ignore l'art d'abstraire, juge sur des idées particulières et que les philosophes jugent sur des idées générales. Retranchez de la notion du chat et de celle du rosier toutes les propriétés qui constituent, dans l'une et dans l'autre, l'espèce, le genre, la classe, pour ne retenir que les propriétés les plus générales qui caractérisent l'animal ou la plante, et il ne vous restera aucune marque distinctive entre le chat et le rosier[9]… Les plantes et les animaux ne sont que des modifications de la matière organisée. Ils participent tous à une même essence, et l'attribut distinctif nous est inconnu[10].»
La plante est donc une sorte d'animal inférieur; on passe par degrés de l'homme à l'animal, de l'animal à la plante, de la plante au minéral. Beaucoup de ces degrés sont encore à découvrir; ceux d'entre eux qui paraissent connus sont résumés par Bonnet dans cette échelle fameuse que nous reproduisons textuellement ci-dessous:
L'homme.
Orang-outang.
Singe.
Quadrupèdes.
Écureuil volant.
Chauve-souris.
Autruche.
Oiseaux.
Oiseaux aquatiques.
Oiseaux amphibies.
Poissons volants.
Poissons.
Poissons rampants.
Anguilles.
Serpents d'eau.
Serpents.
Limaces.
Limaçons.
Coquillages.
Vers à tuyaux.
Teignes.
Insectes.
Gallinsectes.
Tænia ou solitaire.
Polypes.
Orties de mer.
Sensitives.
Plantes.
Lichens.
Moisissures.
Champignons, agarics.
Truffes.
Coraux et coralloïdes.
Lithophytes.
Amiante.
Talcs, gypses, sélénites.
Ardoises.
Pierres.
Pierres figurées.
Cristallisations.
Sels.
Vitriols.
Métaux.
Demi-métaux.
Soufres.
Bitumes.
Terres.
Terre pure.
Eau.
Air.
Feu.
Matières plus subtiles.
Certes, dans cette longue énumération d'êtres entre lesquels sont établies des liaisons basées sur les ressemblances les plus superficielles, on aurait peine à reconnaître l'œuvre de l'ingénieux et sagace observateur, qui sut parfois égaler Réaumur et Trembley, de l'expérimentateur précis auquel la science est redevable d'avoir nettement déterminé les conditions de la parthénogenèse des pucerons, d'avoir découvert et étudié la reproduction des naïs par division et la restauration des parties mutilées chez les vers de terre, d'avoir observé les phénomènes de la reproduction chez les bryozoaires d'eau douce, les vorticelles et les stentors; Bonnet était évidemment peu pénétré de la nécessité de fonder sur la structure anatomique les rapprochements à établir entre les êtres vivants; aussi bien ne s'embarrasse-t-il pas de pénétrer dans le détail des classifications; il prend le règne animal en bloc, et, sans rechercher quels liens pourraient unir entre eux les groupes secondaires, il se pose d'emblée et discute longuement une question que Linné considère comme résolue a priori: Les êtres qui forment la population actuelle de notre globe ont-ils toujours été ce que nous les voyons? demeureront-ils éternellement ce qu'ils sont[11]? Avec une remarquable indépendance d'esprit, le philosophe de Genève se dégage des liens que la lettre de la Genèse avait imposés à Linné. Le globe a été, suivant lui, le théâtre de révolutions dont nous ignorons le nombre et qui peuvent encore se renouveler; le chaos décrit par Moïse est le résultat de la dernière de ces révolutions; la création dont il nous fait le récit n'est autre chose, comme l'avait déjà dit Whiston, que la résurrection des animaux qu'elle a détruits. De même que le monde qui précéda la période de la Genèse était très différent du monde actuel, les animaux anciens ne ressemblaient pas à ceux qui vivent de nos jours; ceux qui habiteront notre planète, lorsque la nouvelle révolution prédite par la Bible se sera accomplie, différeront aussi des animaux des deux périodes précédentes. Les êtres vivants subissent donc à chaque révolution du globe des transformations profondes. À la fin de chaque période, les formes vivantes sont anéanties; des formes différentes leur succèdent; il n'y a pas cependant, à proprement parler, de création nouvelle: les animaux nouveaux procèdent des germes contenus dans les animaux anciens, et ce sont ces germes, supposés indestructibles, qui établissent un lien entre la faune et la flore de chaque période et celles de la période suivante. Que sont eux-mêmes ces germes? En quoi consistent les modifications des formes vivantes? Quel est l'agent de ces modifications? C'est ce que nous avons maintenant à examiner.
Le transformisme de Bonnet, il faut se hâter de le dire, ne ressemble en rien au transformisme moderne. S'il est dit au chapitre IV de la Palingénésie philosophique que lorsque, dans l'œuf, «le poulet commence à devenir visible, il apparaît sous la forme d'un très petit ver;» que, «si l'imperfection de notre vue et de nos instruments nous permettait de remonter plus haut dans l'origine du poulet, nous le trouverions, sans doute, bien plus déguisé encore;» que «les différentes, phases sous lesquelles il se montre à nous successivement peuvent nous faire juger des diverses révolutions que les corps organisés ont eu à subir pour parvenir à cette dernière forme sous laquelle ils nous sont connus,» et qu'enfin «tout ceci nous aide à concevoir les nouvelles formes que les animaux revêtiront dans leur état futur»; si ces phrases rapprochées témoignent que Bonnet songeait déjà à une sorte de parallélisme entre les transformations embryogéniques de l'individu et les transformations subies par l'espèce à laquelle il appartient, l'idée que se fait notre philosophe du développement des êtres vivants est telle qu'elle ne peut apporter aucun éclaircissement sur l'origine des êtres organisés. Il existe entre les diverses parties d'un même animal une si complète harmonie, ces parties «conspirent si évidemment vers un même but général: la formation de cette unité qu'on nomme un animal, de ce tout organisé qui vit, croît, sent, se meut, se conserve, se reproduit,» qu'on demeure convaincu, écrit Bonnet, «qu'un tout si prodigieusement composé et pourtant si harmonique n'a pu être formé, comme une montre, de pièces de rapport ou de l'engrainement d'une infinité de molécules diverses réunies par apposition successive; un pareil tout porte l'empreinte indélébile d'un ouvrage fait d'un seul coup[12].» Bonnet se prononce donc contre tout essai d'explication mécanique des animaux; il se déclare adversaire résolu de l'épigénèse et admet qu'à tout être vivant préexistait un germe organisé. C'est le procédé de raisonnement au moyen duquel on a souvent tenté de démontrer l'impossibilité de l'évolution, en s'appuyant sur l'adaptation parfois si complète des animaux et des plantes à leurs conditions particulières d'existence. Il semble impossible, en effet, quand on se contente de porter à ces questions une attention superficielle, quand on les examine avec des idées préconçues, quand on est décidé à ne tenir compte d'aucune des propriétés fondamentales des animaux et des plantes, que l'admirable harmonie dans laquelle s'écoule leur existence, n'ait pas été soigneusement méditée et organisée, jusque dans ses détails les plus minutieux, par une intelligence d'une profondeur infinie et d'une prévoyance bien propre à confondre notre imagination.
L'hypothèse de la préexistence des germes conduit Bonnet à nier avec raison les générations équivoques; il s'étonne que Rédi ait pu admettre ce mode de génération pour les vers que l'on trouve dans les fruits et pour les helminthes, alors qu'on peut expliquer de bien des façons plus naturelles leur présence dans le lieu où on les observe, et qu'en particulier nombre de faits semblent parler «en faveur des transmigrations du Tænia[13]». Les vers intestinaux, comme tous les autres êtres vivants, sont issus d'un germe, et Bonnet entend par germe «toute préordination, toute préformation de parties, capable par elle-même de déterminer l'existence d'une plante ou d'un animal.» Les œufs, malgré l'extrême simplicité de composition que nous leur connaissons aujourd'hui, rentrent parfaitement dans cette définition[14], d'autant plus que Bonnet ajoute qu'on ne doit pas s'imaginer que «toutes les parties d'un corps organisé sont en petit dans le germe, précisément comme elles paraissent en grand dans le tout développé[15].» Mais ce sont là des concessions faites aux observations nombreuses déjà, qui ont porté sur les métamorphoses des insectes. Au fond, Bonnet voit dans le germe un être organisé fort complexe, et il est manifestement heureux toutes les fois qu'il peut montrer qu'on a découvert dans un œuf ou dans un embryon quelques parties qu'on n'y soupçonnait pas d'abord.
Les germes, étant presque aussi compliqués que les animaux adultes, ne sauraient avoir été formés, comme eux, que d'un seul coup et par un acte de création. Bonnet admet qu'ils ont été créés tous ensemble et enfermés dans des corps vivants, au sein desquels ils sont emboîtés les uns dans les autres, comme Vallisneri l'avait le premier supposé, attendant que leur tour arrive de croître et de se développer.
À proprement parler, il n'y a jamais génération, c'est-à-dire production d'un être vivant nouveau; il n'y a jamais qu'évolution d'un germe préexistant. La nécessité de supposer que les germes des êtres vivants sont, au moins dans un grand nombre de cas, enfermés les uns dans les autres, conduit à supposer aux derniers d'entre eux une petitesse hors de proportion avec tout ce que nous pouvons imaginer. Mais cela n'a rien qui puisse effrayer la raison, et Bonnet supprime d'avance toutes les objections qu'on lui opposera en déclarant que la doctrine de l'emboîtement lui paraît «une des plus belles victoires que l'entendement pur ait remporté sur les sens. J'ai montré, ajoute-t-il, combien il est absurde d'opposer à cette hypothèse des calculs qui n'effrayent que l'imagination et qu'une raison éclairée réduit facilement à leur juste valeur… Il ne faut pas que l'imagination, qui veut tout peindre et tout palper, entreprenne de juger des choses qui sont uniquement du ressort de la raison et qui ne peuvent être aperçues que par un œil philosophique[16].»
Une fois admise cette distinction entre l'œil organique et l'œil philosophique, entre les sens qui peuvent tromper et la raison qui ne saurait nous égarer, les faits n'ont plus rien de bien embarrassant. L'image la plus saisissante de l'épigenèse est celle que nous offrent les Végétaux, avec leurs branches, leurs rameaux, leurs feuilles, véritables individus indépendants, que notre œil organique voit pousser les uns sur les autres. Bonnet ne se fait pas du végétal une autre idée que nous. «Un arbre, dit-il, n'est pas un tout unique; il est réellement composé d'autant d'arbres et d'arbrisseaux qu'il a de branches et de rameaux. Tous ces arbres et tous ces arbrisseaux sont, pour ainsi dire, greffés les uns sur les autres et tiennent ainsi à l'arbre principal par une infinité de communications. Chaque arbre secondaire, chaque arbrisseau, chaque sous-arbrisseau a ses organes et sa vie propre; il est en lui-même un petit tout individuel qui représente plus ou moins en raccourci le grand tout dont il fait partie[17].» Les polypes, dont le bourgeonnement a été si bien étudié par Trembley, le ténia, composé d'anneaux semblables entre eux, les nais, les tubifex, les vers de terre, dont Bonnet a si bien étudié les modes de reproduction et de segmentation, se rapprochent des plantes, à cet égard; ce sont de vrais «zoophytes». La même explication suffit pour ramener les phénomènes de reproduction des zoophytes et des plantes à la théorie de l'emboîtement: des germes sont répandus dans toutes les parties de leur corps, qui est ainsi transformé en une sorte «d'ovaire universel». Dans un végétal qui pousse, dans un polype qui bourgeonne, ces germes se développent spontanément en individus qui peuvent demeurer unis ou se séparer; il faut un accident pour amener leur évolution chez les vers, dont les parties ne deviennent de nouveaux individus qu'après avoir été séparées les unes des autres. Ainsi, grâce à l'hypothèse des germes invisibles, les faits d'épigénèse les plus évidents sont tournés au profit de l'évolution.
On peut douer des corps invisibles, de toutes les propriétés qu'on voudra, sans crainte d'être contredit par les sens. Bonnet suppose donc que ses germes invisibles sont également indestructibles. Quand un corps vivant, fût-ce même un œuf, se détruit, les germes indestructibles qu'il contient sont mis en liberté et se logent où ils peuvent. «Des germes indestructibles peuvent être dispersés sans inconvénient dans tous les corps particuliers qui nous environnent. Ils peuvent séjourner dans tel ou tel corps jusqu'au moment de sa décomposition, passer ensuite sans la moindre altération dans un autre corps, de celui-ci dans un troisième, etc. Je conçois avec la plus grande facilité que le germe d'un éléphant peut loger d'abord dans une molécule de terre, passer de là dans le bouton d'un fruit, de celui-ci dans la cuisse d'une mite, etc.[18]» Ces germes, créés dès l'origine de notre monde, «bravent donc les efforts de tous les éléments, de tous les siècles.» Rien ne s'oppose à ce que «la puissance absolue ait pu renfermer dans le premier germe de chaque être organisé la suite des germes correspondant aux dernières révolutions que notre planète était appelée à subir.» De même que Leibnitz admettait une harmonie préétablie entre les pensées de notre âme et les mouvements de notre corps, de manière que les mouvements de l'un correspondissent en tout temps aux pensées de l'autre, de même Bonnet admet un parallélisme parfait entre le système astronomique et le système organique, entre les divers états de la terre considérée comme planète ou comme monde et les divers états des êtres qui devaient peupler sa surface. Les germes créés pour chaque période attendent, cachés dans les organismes qui les abritent, que l'avènement de ces périodes amène les conditions nécessaires à leur développement. De la sorte, les êtres propres à chaque période sont à la fois reliés à ceux de la période précédente qui ont abrité leurs germes, et ils en sont indépendants puisque tous les germes ont été créés en même temps; grâce à l'harmonie établie entre l'évolution des germes organiques et les révolutions de notre planète, des faunes et des flores nouvelles apparaissent sans qu'il soit besoin d'une création nouvelle.
Malgré sa hardiesse ordinaire, Bonnet croit d'ailleurs devoir se borner à considérer trois périodes dans l'histoire de notre globe, celle qui a précédé la révolution décrite dans la Genèse, celle qui suivra la fin du monde, produite par le feu, qu'ont annoncée les prophètes, et il est important d'ajouter qu'il se fait une étrange idée de l'état futur des animaux. Les germes d'où ils naîtront n'échapperaient pas à la destruction s'ils n'étaient formés d'une matière plus subtile que la matière ordinaire, d'une sorte d'éther; «si nous partons de la supposition du petit corps éthéré qui renferme en petit tous les organes de l'animal futur, nous conjecturerons que le corps des animaux dans leur nouvel état sera composé, d'une matière dont la rareté et l'organisation le mettent à l'abri des altérations qui surviennent aux corps grossiers et qui tendent continuellement à le détruire de tant de manières différentes. Le nouveau corps n'exigera pas sans doute les mêmes réparations que le corps actuel exige. Il aura une mécanique bien supérieure à celle que nous admirons dans ce dernier. Il n'y a pas d'apparence que les animaux propagent dans leur état futur.»
Nous arrivons ainsi dans le monde des esprits et de l'immortalité; nous sommes en pleine fantaisie. Une alliance singulière d'un raisonnement rigoureux, s'appuyant sur des faits mal connus, trop peu nombreux, avec les affirmations bibliques prises au pied de la lettre, conduit un des esprits les plus ingénieux d'une époque où le génie était commun, un observateur éminent, à des rêveries dans lesquelles son imagination ne connaît plus d'obstacle, où non seulement le contrôle expérimental des idées n'est plus possible, mais où les témoignages des sens sont d'avance récusés quand ils sont en désaccord avec les conceptions que le penseur attribue à sa raison.
* * * * *
Bonnet n'est pas le seul philosophe qui se soit engagé dans cette voie. L'origine des animaux, celle de l'homme préoccupaient à juste titre les hommes de science, les philosophes et même les simples rêveurs de son temps.
Robinet, dans ses livres De la nature (1766) et Considérations philosophiques sur la gradation naturelle des formes de l'être (1768), émet des idées qui, bien qu'elles aient été ridiculisées par Cuvier, ne sont pas très éloignées de celles de Bonnet. Son point de départ est aussi la loi de continuité de Leibnitz. Poussant de suite ce principe à l'extrême, il admet que toute la matière est vivante; que les étoiles, le soleil, la terre, les planètes sont des animaux; que tous les êtres forment une chaîne continue; qu'il n'y a ni classes, ni ordres, ni genres, ni espèces, mais seulement des individus que l'imperfection seule de nos sens nous conduit à considérer comme spécifiquement identiques. Les individus naissent de germes qui se développent successivement; ils sont directement formés par la nature. Le monde matériel est gouverné par un monde invisible, composé de forces. La nature ne se répète jamais, et il pourra y avoir un temps auquel il n'y ait pas un seul être conformé comme nous sommes aujourd'hui; les formes vivantes se sont constituées par un perfectionnement progressif, allant du simple au composé; il pourrait y avoir au-dessus de l'homme des créatures immatérielles; mais l'homme se rattache par une infinité de formes présentant une infinité de différences graduelles à un prototype simple. Toutes ces formes intermédiaires sont des œuvres séparées de la nature s'essayant à faire l'homme, son œuvre actuellement la plus parfaite; cette œuvre pourra être perfectionnée dans l'avenir si l'homme, devenant hermaphrodite, réunit les beautés de Vénus à celles d'Apollon. Au demeurant, ce perfectionnement de l'humanité n'est pas beaucoup plus étrange que celui rêvé pour elle par Bonnet.
* * * * *
De Maillet, plus connu sous le pseudonyme choisi par lui de Telliamed, avait cherché, comme Bonnet et comme Robinet, dans la création d'une infinité de germes l'explication de l'origine des êtres vivants; mais il avait fait de la mer le réservoir commun de tous ces germes. Tous les animaux, les hommes même avaient donc été primitivement marins. La mer avait eu d'ailleurs autrefois une beaucoup plus vaste extension, et de Maillet en donnait pour preuve l'énorme quantité de coquilles marines que l'on trouve enfouies dans le sol, jusque sur les plus hautes montagnes. À mesure que les continents s'étaient accrus, un certain nombre d'animaux marins avaient été accidentellement entraînés hors de l'eau, sur des rivages gardant encore une certaine humidité, et de là sur la terre ferme. Les individus ainsi dépaysés s'habituèrent au nouveau genre de vie qui leur était imposé par les circonstances et transmirent à leurs descendants les habitudes et les organes nouveaux qu'ils avaient acquis. Il est inutile d'insister sur les arguments bizarres qu'emploie de Maillet pour soutenir son hypothèse; mais on doit lui laisser le mérite d'avoir reconnu la véritable nature des fossiles et d'en avoir saisi la signification, à une époque où de nombreux savants refusaient encore d'y voir les restes d'êtres ayant jadis vécu; d'avoir pensé que les organismes vivants susceptibles de se modifier, étaient capables de transmettre leurs modifications à leur descendance, et d'avoir compris, par conséquent, l'importance des phénomènes si connus, mais si négligés, de l'hérédité.
* * * * *
En admettant la possibilité de changements héréditaires dans la structure des êtres vivants, de Maillet réalise un progrès sur Bonnet et sur Robinet, qui ne voient dans les modifications présentées par la population de la terre qu'une continuation du miracle primitif de la création. Le Dr Erasme Darwin, grand-père de l'illustre réformateur du transformisme, va, à son tour, plus loin que de Maillet. Il a exposé dans sa Zoonomia un système où l'on trouve soutenues, à l'aide d'arguments qui témoignent d'une grande perspicacité, quelques idées peu différentes de celles que développera plus tard Lamarck. Pour rendre son système intelligible, Erasme Darwin, par une inspiration heureuse, recherche d'abord comment s'accomplit le développement embryogénique de l'individu et suppose que l'espèce à laquelle il appartient a subi, dans la série des temps, une évolution analogue, mais de beaucoup plus longue durée. Il rejette la doctrine de l'emboîtement des germes, qui conduit à supposer l'existence de corps vivants infiniment plus petits «que les diables qui tentèrent saint Antoine et dont 20 000 pouvaient, sans se gêner aucunement, danser une sarabande échevelée sur la pointe de la plus fine aiguille.» L'embryon est, pour lui, un filament constitué probablement par l'extrémité d'une fibre nerveuse motrice. Ce filament est doué de certaines propriétés: les unes lui sont personnelles; les autres lui ont été transmises par ses parents, dont il n'est en réalité qu'une branche, une élongation, puisqu'il a fait, à un certain moment, partie de leur substance. Le filament embryonnaire est doué d'irritabilité, de sensibilité, de volonté; il possède aussi la faculté de se nourrir, et on le voit grandir, se compliquer, se perfectionner par l'addition de parties nouvelles, résultant de ce qu'une quantité plus ou moins grande de matière vivante est venue s'ajouter à la sienne. Cette addition de matière vivante a lieu d'abord sous l'influence des propriétés primitives des filaments embryonnaires; mais, à mesure qu'elle se produit des organes nouveaux apparaissent et avec eux des facultés nouvelles. Ces facultés créent des besoins, ces besoins des façons de vivre, des habitudes qui interviennent, pour une certaine part, dans les transformations que subit chaque individu au cours de son existence.
Telle a été aussi la marche de l'évolution des espèces: les organismes vivants ont été créés sous des formes extrêmement simples, rappelant celle des filaments vivants, qui sont encore la forme première de chaque individu. Ces filaments étaient très peu nombreux en espèces, et, de même que chaque corps chimique est doué d'affinités particulières qui déterminent la nature des composés qu'il produira dans les diverses circonstances où il sera placé, de même les filaments vivants primitifs étaient doués de facultés différentes, qui ont déterminé, dans une large mesure, la marche de leur évolution ultérieure. Étant données les ressemblances manifestes que présentent tous les animaux à sang chaud, il est probable que tous ces animaux descendent d'une même sorte de filament primitif; peut-être les mêmes filaments ont-ils aussi donné naissance aux autres animaux à sang rouge, mais froid. Les habitudes spéciales des poissons semblent autoriser à leur attribuer une origine particulière; mais les intermédiaires qui les unissent aux animaux à sang chaud plaident cependant en faveur de leur parenté avec ces derniers.
«Les insectes sans ailes, de l'araignée au scorpion ou de la puce au homard, les insectes ailés, du moustique ou de la fourmi à la guêpe ou à la libellule, diffèrent, au contraire, si complètement les uns des autres et sont si éloignés des animaux à sang rouge, aussi bien sous le rapport de la forme du corps que sous celui du genre de vie, qu'on ne peut guère admettre qu'ils proviennent d'un filament vivant de même sorte que celui qui a produit les classes diverses d'animaux à sang rouge… Il y a encore une autre classe d'animaux, que Linné a désignés sous le nom de vers, qui présentent une structure plus simple que ceux déjà mentionnés. La simplicité de leur structure n'apporte cependant aucun argument contre l'hypothèse qu'ils aient été produits par un seul filament vivant.» En d'autres termes Erasme Darwin considère les vertébrés, les articulés et les vers comme trois types organiques qui se sont développés simultanément et parallèlement et qui sont, tous les trois, partis de formes organiques également simples, mais douées de propriétés différentes.
Si les trois lignées admises par le savant anglais ne correspondent pas à ce que nous connaissons aujourd'hui des rapports des organismes, l'idée première que plusieurs types organiques se sont constitués et développés d'une façon indépendante doit être encore, de nos jours, considérée comme la seule forme du transformisme qui soit d'accord avec les données de la paléontologie. La réduction de toutes les formes animales à trois lignées distinctes témoigne que, dès 1794, plusieurs années par conséquent avant la publication des premiers travaux de Cuvier, Erasme Darwin avait déjà saisi l'intime parenté des animaux composant les quatre premières classes de Linné et les différences considérables qui les séparent de ceux de la cinquième classe; mais le philosophe anglais laissait la sixième dans le chaos d'où Cuvier devait peu d'années après la tirer.
Chacun des filaments vivants qui est devenu la souche des trois grandes lignées animales avait en lui une sorte de devenir résultant de propriétés dont il avait été originairement doué; mais son évolution, dans chaque cas particulier, a été réglée, en partie, par les sensations éprouvées par l'animal parvenu à un stade déterminé, par la peine ou le plaisir qu'il a éprouvé, les efforts qu'il a faits pour prolonger son bonheur ou se soustraire à ses souffrances. L'eau et l'air étant fournis aux animaux à profusion, trois ordres de besoins ont surtout excité les convoitises des animaux et par conséquent contribué à changer leurs formes: le besoin de se reproduire, le besoin de se nourrir, le besoin de vivre en sûreté. Ils ont acquis les armes nécessaires pour défendre contre leurs rivaux les compagnes, la nourriture, les retraites qu'ils avaient conquises. Erasme Darwin, décrivant cette évolution, s'élève presque à la conception de la lutte par la vie et de la sélection naturelle car il finit par dire: «Le but de ces batailles entre les mâles paraît être d'assurer la conservation de l'espèce par le moyen des individus les plus forts et les plus actifs[19].» Au lieu de dire le but, Charles Darwin aurait dit la conséquence; cette différence doit être signalée. Sur la réalité de la sélection naturelle, le grand-père et le petit-fils sont d'accord; mais le point de vue philosophique auquel ils se placent est fort différent: pour Erasme Darwin, comme pour Lamarck, les animaux acquièrent des organes en vue de la satisfaction de tel ou tel besoin; pour Charles Darwin, ces organes apparaissent accidentellement; la sélection naturelle conserve et perfectionne ceux qui sont utiles et laisse s'éteindre ceux qui ne le sont pas. Ainsi les animaux et les végétaux s'adaptent à des conditions d'existence déterminées sans que ces conditions agissent sur les individus pour les modifier, sans que ces individus eux-mêmes soient soumis à la nécessité de chercher à se mettre en harmonie avec elles.
Si ingénieuses qu'elles soient, les hypothèses d'Erasme Darwin nous laissent profondément ignorants sur la cause première de l'apparition des organismes. Elles nous font remonter jusqu'à la création des filaments vivants primitifs et s'arrêtent là. Une telle solution devait paraître insuffisante à bien des penseurs du XVIIIe siècle. Déjà, au XVIIe, Descartes avait cherché, sans grand succès, il est vrai, à expliquer par la seule étendue et le seul mouvement la formation des animaux et de l'homme. Maupertuis[20] constate cet échec; mais, en dehors de là il n'y a plus pour lui que deux systèmes: douer la matière de propriétés spéciales qui, venant s'ajouter à celles qu'on lui accorde déjà, l'auront rendue capable de produire spontanément les formes vivantes avec toutes leurs facultés y compris les facultés intellectuelles; ou bien admettre que tous les animaux, toutes les plantes sont aussi anciennes que le monde, et que tout ce que nous prenons, dans ce genre, pour des productions nouvelles, résulte simplement du développement et de l'accroissement de parties que leur petitesse avait tenue jusque-là cachées. C'est le système de l'emboîtement des germes adopté par Vallisneri, Leibnitz et Bonnet.