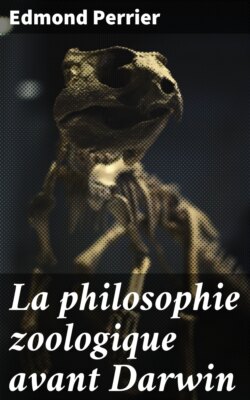Читать книгу La philosophie zoologique avant Darwin - Edmond Perrier - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCTION
ОглавлениеIdées premières sur la place des animaux dans la nature.—Les mythologies et les philosophies de l'antiquité.
De tout temps, l'homme a essayé de pénétrer l'origine des êtres vivants qui l'entourent, de se donner une explication, si grossière fût-elle, des liens qui les rattachent entre eux, des rapports qui les unissent à lui. Dès l'éveil de son intelligence, il a examiné d'un œil particulièrement curieux les animaux qui, sans cesse agités, venaient indiscrètement mêler leur existence à la sienne. Ne pouvant comprendre la raison d'être de ces muets qui n'avaient pour lui que des secrets, tour à tour étonné de leurs merveilleux instincts, effrayé de leur force redoutable, charmé de l'éclat de leurs couleurs, de la grâce de leurs mouvements, de l'élégance de leurs formes, il a commencé par en faire les messagers des puissances invisibles qui régissent l'univers et souvent même des dieux. Dans toutes les mythologies primitives, les animaux jouent un rôle considérable. Obligé à un combat sans trêve par les animaux qui lui disputaient ses moyens d'existence, l'homme, avant de se donner la place d'honneur dans le monde, avait commencé par l'offrir modestement à ses rivaux; les Hindous et beaucoup de peuplades sauvages la leur conservent encore.
Toute l'antiquité, tout le moyen âge demeurent imprégnés de cette idée que les animaux touchent de près au surnaturel. L'imagination païenne en invente de plus terribles encore que tous ceux qui existent: et la renommée de ses Sphynx, de ses Tritons, de ses Centaures, se conserve longtemps dans les contes et dans les fables des peuples chrétiens. Un livre, le Physiologus, qui, malgré l'anathème qui l'accueillit d'abord, est demeuré pendant près de mille ans le seul livre d'histoire naturelle de l'Église, n'est autre chose qu'une sorte de «morale en action» des animaux. Chacun d'eux est l'incarnation d'une vertu, que le vrai chrétien doit imiter ou d'un vice qu'il doit fuir. Le moyen âge conserve du reste la croyance antique que les animaux jouissent d'une puissance occulte particulière, qui n'est pas sans analogie avec celle des sorcières. Roger Bacon croit encore que le regard du basilic est mortel, que le loup peut enrouer un homme s'il le voit le premier, que l'ombre de l'hyène empêche les chiens d'aboyer. À un homme admettant sans difficulté que l'oie bernache naît des glands d'une espèce de chêne, rien ne devait sembler impossible. Cette crédulité est moins étonnante encore que celle de Pierre Rommel affirmant en 1680, il y a deux cents ans à peine, avoir vu à Fribourg un chat qui avait été conçu dans l'estomac d'une femme et avoir connu une autre femme qui avait donné naissance à une oie vivante.
Plus de semblables assertions nous paraissent aujourd'hui burlesques, plus elles sont intéressantes à rappeler, car elles nous montrent combien était encore confuse il y a peu de temps cette notion de l'espèce animale devenue aujourd'hui si vulgaire. On allait souvent plus loin; on n'admettait pas seulement que, sous des influences mystérieuses, un animal pût donner naissance à des animaux tout différents, ou se transformer lui-même à la façon des loups-garous; on douait aussi la matière inerte de la faculté de s'organiser spontanément: les grenouilles pouvaient naître de la vase des étangs; de vieux chiffons, enfermés dans un coffre avec un peu de blé, pouvaient se transformer en souris; les vers intestinaux n'étaient qu'une métamorphose des humeurs de notre organisme, et cette opinion a compté, même de nos jours, quelques partisans.
Ce n'est d'ailleurs pas sans peine que la notion même de la vie arrive à se dégager, que la démarcation s'établit entre ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas. Pour les anciens philosophes, la vie, c'est, avant tout, le mouvement, la force. Tout ce qui se meut est plus ou moins considéré comme vivant.
Thalès de Milet appelle âme tout ce qui est cause de mouvement. L'aimant a une âme comme l'homme; le monde a une âme, qui est Dieu, et il peut y avoir des âmes sans corps, des démons. C'est Dieu qui a fait toutes choses en employant une matière première unique, l'eau.
Au-dessous du Dieu créateur, Anaximandre conçoit des dieux mortels, qui sont les astres.
Anaximène considère l'air, capable de se mouvoir plus aisément encore que l'eau, comme l'origine de toutes choses. L'air est l'âme du monde; il est Dieu; il tient le monde en vie, comme l'âme tient en vie notre corps.
Anaxagore n'admet plus qu'un Dieu coordonnateur de toutes choses dont il se fait une idée très élevée; il considère les végétaux comme ayant toutes les facultés des animaux et voit dans les êtres vivants les enfants de la Terre et du Soleil, astres qu'il suppose par conséquent vivants, mais auxquels il refuse la qualité de dieux. Les âmes des hommes passent après leur mort dans le corps des animaux.
Ainsi, pour la plupart des philosophes de l'antiquité, la conception même de l'être organisé est confuse. Il existe dans l'univers une cause de mouvement, qui est Dieu; tout ce qui se meut possède en soi la vie et est capable de la donner. Les animaux et les végétaux, entre lesquels des points de ressemblance sont entrevus, sont engendrés par l'eau suivant quelques-uns, par l'air suivant d'autres, par les astres suivant d'autres encore. On cherche en même temps à rattacher tout ce qui existe à une cause commune ou à un ensemble de causes communes. Pour Thalès et Anaximandre, tout a été tiré de l'eau; Anaximène et Diogène préfèrent tout faire sortir de l'air. Empédocle met à son tour la terre au rang des causes primordiales; Leucippe et Démocrite admettent une substance primitive, l'éther, en qui Anaxagore voyait déjà la cause de la foudre. Les transformations diverses de l'éther auraient produit tout ce qui est. Pour Héraclite, le principe commun de toutes choses n'est autre que le feu. Ainsi se constitue pièce à pièce cette hypothèse des quatre éléments: la terre, l'eau, l'air et le feu, qui se retrouve jusqu'aux temps modernes au fond de toutes les conceptions scientifiques.
Il n'y avait place dans toute cette philosophie que pour l'observation la plus superficielle. En général, on considère les animaux et les végétaux en bloc. L'imagination tient la place première dans les systèmes; les sciences n'existent pas à proprement parler; les observations justes sont trop peu nombreuses et mêlées de trop de fables pour qu'on en puisse constituer un corps de doctrine; il n'y a pas de zoologie, et il ne saurait être question par conséquent de philosophie zoologique.
Quelques essais d'explication plus précise méritent d'être cités. Telle est cette idée d'Anaxagore que tous les corps sont formés de parties semblables entre elles, ayant existé de toute éternité et que Dieu n'a fait que coordonner. Le mélange de toutes ces parties est ce qu'il appelle le chaos. Dans ce chaos existent des os, des viscères, des muscles, mais avec des dimensions si petites que toutes ces parties sont invisibles; elles ne sont devenues visibles qu'en s'unissant à des parties semblables. Elles ont alors constitué les os, les viscères, les muscles des animaux. Quand un animal meurt, toutes ses parties constitutives se dissolvent, se résolvent en leurs éléments invisibles. Ces éléments divers se mélangent entre eux jusqu'à ce qu'ils redeviennent parties intégrantes de quelque autre organisme. Ainsi les animaux et les plantes sont formés d'éléments permanents et éternels, qui s'associent temporairement pour constituer des organismes, puis se séparent, pour entrer dans des organismes nouveaux. Les éléments propres à entrer dans la constitution des organismes sont en quantité constante; mais ils circulent pour ainsi dire perpétuellement, passant d'un être vivant à un autre et s'associant de toutes les manières possibles.
Les éléments des êtres vivants, comme ceux de tous les autres corps, ayant existé de toute éternité et étant indestructibles, rien d'essentiel ne paraît distinguer la matière vivante de la matière inerte, dans la conception d'Anaxagore, qui n'est pas sans intérêt, car on pourrait lui trouver plus d'un trait de ressemblance avec la célèbre doctrine de l'emboîtement des germes que nous rencontrerons plus tard, avec l'hypothèse des molécules vivantes de Buffon, celle de l'attraction du soi pour soi de Geoffroy Saint-Hilaire et même avec la fameuse théorie de la panspermie de Darwin.
Ces rapports entre les doctrines des philosophes anciens et les doctrines qui ont apparu plus récemment sous d'autres formes se rencontrent plus d'une fois. Pythagore et les pythagoriciens admettaient par exemple, à côté des nombres régulateurs de la nature, divers principes contraires deux à deux et desquels tout résultait: le fini et l'infini, l'impur et le pur, l'unité et la dualité ou la pluralité, la droite et la gauche, le masculin et le féminin, le repos et le mouvement, le droit et le courbe, la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, Dieu et le démon, l'esprit et la matière, etc. Ils étaient en cela les précurseurs de Schelling et des philosophes de la nature; ils avaient vu le monde sous le même point de vue des oppositions et n'ont fait que développer d'une manière appropriée aux connaissances acquises de leur temps la cause première, les liens et les conséquences de ces oppositions. Cette idée des oppositions avait conduit Pythagore à admettre l'existence des antipodes. Héraclite pensait également, comme les philosophes de la nature, que notre âme n'est qu'une émanation de l'âme du monde qui est Dieu. Démocrite croit comme eux que nous avons deux manières d'acquérir des connaissances: par les sens et par la pensée. Les sens peuvent nous tromper, mais la pensée ne nous donne que des connaissances précises; Héraclite et Démocrite eussent été, de notre temps, rangés parmi les membres de «l'école des idées». Cependant pour eux, comme pour les matérialistes modernes, rien n'existe en dehors des atomes et du vide. Les apparences diverses que présente le monde extérieur sont le résultat du mouvement: nous ne percevons que des changements, des oppositions, et non des objets réels.
À côté de ces doctrines générales, de ces tentatives de divination de la nature des choses, si, comme nous le disions tout à l'heure, l'observation tient peu de place, le besoin d'observer a été cependant reconnu. Alcméon de Crotone (520 av. J.-C.) a disséqué des animaux; il compare le blanc de l'œuf des oiseaux au lait des mammifères; mais il croit que les chèvres respirent par les oreilles. Anaxagore considère le cerveau comme le siège de la pensée; il se rend compte de la façon dont se nourrissent les fœtus; mais il prétend que les fouines enfantent par la bouche et que les ibis et les corneilles s'accouplent par le bec. Ces deux philosophes et plus tard Polybe ont fait quelques recherches d'embryogénie. Mais on voit combien leurs affirmations sont encore sujettes à caution.
Démocrite fait plus de progrès que ses prédécesseurs dans la connaissance des organes des animaux et des fonctions qu'ils remplissent; Hippocrate s'applique surtout à la connaissance de l'anatomie humaine; il arrive à définir un certain nombre de maladies et à en reconnaître la marche; mais l'art d'observer comme l'art même de raisonner sont encore dans l'enfance; partout, nous venons de le voir, les erreurs les plus grossières se mêlent aux observations justes et viennent déparer les plus nobles efforts des intelligences qui cherchent à créer une voie dans les régions encore inexplorées de la science. La science demeurant inséparable de la philosophie, chaque progrès des philosophes dans l'art de manier la pensée est suivi d'un progrès dans l'art d'arriver à la connaissance. Peu à peu, l'imagination tient une place moins exclusive dans les spéculations, et l'on apprend à établir entre les idées des distinctions plus rigoureuses. Socrate les enchaîne le premier dans des définitions suffisamment précises et perfectionne la méthode inductive au point qu'on peut lui attribuer l'honneur de sa création. Platon montre tout le parti que l'on peut tirer de la méthode qui s'élève du particulier au général en passant à travers toute une hiérarchie d'idées de plus en plus étendues. Mais sa méthode, il l'applique surtout aux idées et rend ainsi nécessaire une réaction, grâce à laquelle un accord plus rigoureux puisse s'établir entre les faits et les idées. On comprend peu à peu que les faits bien observés sont les véritables générateurs des idées; mais il fallait un génie puissant pour faire redescendre les philosophes aux méthodes ordinaires dont le sens commun ne s'était pas écarté. Ce génie, duquel date la fondation des sciences et de la méthode scientifique, fut Aristote.
Quelques critiques ont dit que la science d'Aristote venait en grande partie de ses devanciers et surtout de Démocrite; qu'il a fait de nombreux emprunts à ses prédécesseurs, sans les citer. De tout temps on a si amèrement reproché à ceux qui ont essayé quelques nouveautés, d'avoir puisé leurs idées dans Aristote ou ailleurs, qu'il est assez piquant de voir accuser, à son tour, de plagiat celui qu'on se plaît d'ordinaire à appeler le père de la philosophie. Aristote s'est-il aidé des travaux de ses devanciers? Cela est possible, probable même; il est incontestable que son érudition était considérable, et l'on peut croire qu'il en a tiré parti. Le nombre des faits qu'il annonce dans ses livres est tel qu'il dépasse, sensiblement, peut-être, ce qu'il lui avait été donné d'acquérir par son expérience personnelle. Doit-on pour cela l'accuser d'avoir cherché à s'approprier le bien d'autrui? De telles insinuations ne sont fâcheuses que pour ceux qui les émettent complaisamment. L'idée est ce qu'il y a de plus personnel à l'homme et surtout à l'homme de science: c'est pourquoi le génie est si admiré; c'est pourquoi tout effort d'une intelligence qui la rapproche du génie est si impatiemment supporté par celles qui s'en reconnaissent incapables; c'est pourquoi tout homme qui possède ou développe une idée doit s'attendre à voir s'élever, parmi tous les obstacles qu'on lui oppose, cette accusation, de tout temps renouvelée, qu'il n'a rien fait de nouveau. En somme, peu importe à l'humanité le degré plus ou moins grand de nouveauté des faits ou des idées; ils ne sont rien pour elle tant qu'ils n'ont pas été embrassés par quelque puissant esprit qui sache lui en montrer la portée et lui dire: «Voici les conquêtes qui ont été faites, voici le parti qu'on en peut tirer.» Tel fut au moins le mérite d'Aristote, qui résuma dans ses œuvres tout ce que savait l'antiquité, sut faire un départ presque toujours judicieux entre le bon et le mauvais, le vrai et le faux, accrut considérablement les limites du savoir humain, indiqua la voie à suivre pour arriver avec plus de certitude à la conquête de la vérité et légua au moyen âge une somme telle de connaissances, que sans lui la science eût été tout entière à recommencer.