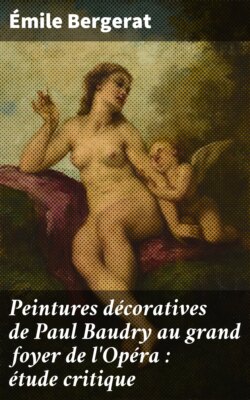Читать книгу Peintures décoratives de Paul Baudry au grand foyer de l'Opéra : étude critique - Emile Bergerat - Страница 14
ОглавлениеL’IDÉE DÉCORATIVE
Suivant d’immortels exemples, c’est dans les développements réguliers d’une idée générique que M. Baudry a cherché les motifs divers des compositions dont l’ensemble forme sa création. Cette idée lui était naturellement imposée par la destination du monument qu’il était appelé à décorer: il n’avait donc qu’à l’accepter telle qu’elle lui était soumise avec les proportions déterminées par l’architecte, c’est-à-dire dans toutes ses données de cadres et de sujets, et c’est ce qu’il a fait. — Qu’est-ce que cet art de l’opéra, auquel M. Garnier a construit un temple nouveau? La réunion de trois arts: Poésie, Musique et Danse, qui, combinées ensemble et participant l’une de l’autre, produisent sur l’homme une sensation puissante et d’un caractère particulier. Il s’agissait donc tout d’abord de les symboliser et d’arrêter ces trois thèmes décoratifs.
Les rôles différents joués dans l’humanité par chacun de ces arts fournissaient les développements les plus clairs à la fois et les plus féconds de ces thèmes, car la Musique, la Poésie et la Danse, datant des origines mêmes de l’homme et du premier échange des sons, des pensées et des gestes, le peintre voyait par eux s’ouvrir devant lui la succession des histoires, des poëmes, des symboliques religieuses, ou, si l’on veut, des mythes, que ces trois arts suivent pas à pas le long des âges; et, poursuivant dans cette triple filière les seules influences musicales, poétiques et chorégraphiques, il se trouvait embrasser, par ses côtés artistiques au moins, l’humanité tout entière. Ainsi ces développements n’étaient-ils restreints qu’à l’espace mesuré au pinceau de l’artiste, et son goût seul lui indiquait les choix auxquels il devait les borner, et par lesquels il devait les synthétiser. Telle était la façon la plus simple et en même temps la plus grandiose de concevoir cette décoration d’un Opéra; c’est aussi celle à laquelle M. Baudry s’est arrêté, sans se dissimuler la vastitude de l’entreprise. Il suffit d’en contempler un instant les résultats pour comprendre qu’il y fallait une organisation exceptionnellement douée, et que ce travail de Titan exigeait de robustes épaules et la sérénité d’un génie véritable.
Le plan, accepté dans toutes ses conséquences et philosophiquement élaboré, restait l’exécution. Le monstre vaincu, il faut sortir du labyrinthe. Il y a en ce cas deux écueils dans la conception des détails: leur valeur propre ne doit pas les soustraire à la loi d’unité qui revêt l’ensemble de son style homogène; et cependant ils n’offrent d’intérêt qu’à la condition de flatter les yeux par des diversités propres. Ou, pour parler plus clairement, les différents tableaux dont l’œuvre se compose doivent être à la fois des parties du tout et des touts eux-mêmes très-distincts. C’est à l’ordre didactique que l’artiste a demandé son fil d’Ariane, et nous croyons que sur les divisions et les choix de sujets adoptés par M. Baudry, tant ils sont naturels et réguliers, un habile rimeur suffirait à produire un poëme complet en l’honneur de l’Opéra. Il est nécessaire de bien se persuader que l’art décoratif, par son rôle même, est limité à l’allégorie et à la symbolisation, et qu’il n’a pas d’autres moyens de s’exprimer, les actualités n’étant pas de son domaine. Ce besoin de modernité, qu’on a baptisé le réalisme, ne peut influer sur lui que de fort loin et d’une façon inavouée sinon inconsciente, forcé qu’il est de demander sa poétique aux éternels lieux communs consacrés par l’usage et seuls tout à fait explicites. Tout veut être généralisé dans la peinture murale, comme tout veut y être idéalisé. Il est évident, par exemple, que l’idée de la force, si elle est personnifiée par Hercule, s’exprimera clairement pour le moins lettré des spectateurs; mais si cette force implique dans la pensée du décorateur un don tout spécial et une mission divine, le mythe de Samson répond à cette nuance et l’indique. Le peintre, d’ailleurs, est libre de satisfaire à ce besoin de modernité dont nous parlons et de dater son œuvre en prêtant à cet Hercule la ressemblance, si l’on veut, d’un athlète contemporain ou son attitude favorite, pourvu que ces particularités demeurent herculéennes et ne troublent point le symbole par trop de précision dans la ressemblance.
M. Baudry, pénétré de cette vérité qu’en dehors des traditions acceptées par les maîtres les plus indépendants, le décorateur ne saurait rien inventer sans risquer de ne pas être compris, ne s’est donc pas arrêté à l’ambition puérile d’imaginer des types nouveaux et de leur créer des milieux énigmatiques; ne se jugeant pas plus poëte qu’Homère et que la Bible, il a pensé que ce qui avait suffi à Michel-Ange, à Raphaël et au Léonard pour s’exprimer ne resterait pas au-dessous de son génie, et que pour parler d’une façon neuve il n’était pas utile d’inventer d’abord un langage. Et c’est à des sources inépuisables et auxquelles les enfants de nos enfants boiront encore dans dix siècles qu’il a tranquillement puisé les formules éternelles du beau qu’il poursuit. La mythologie lui a fourni la moitié de ses sujets, et les deux Testaments le reste. Il faut s’attendre à ce que quelques critiques interprètent à faiblesse de conception cette soumission, si magistrale pourtant et si audacieuse, aux vieilles traditions, tant combattues par les écoles nouvelles.
On demandera à ses dieux et à ses héros ce qu’ils nous veulent, et on criera à ses personnages bibliques: «Que venez-vous faire dans notre Opéra?» On accusera M. Baudry d’avoir rendu inutilement une vie factice à des symboles usés et dont les maîtres chrétiens avaient tiré le suc et la moelle. Il se peut même, et l’artiste doit aussi s’y préparer, qu’il reste incompris de son époque, si follement éprise du nouveau, qu’elle le poursuit jusque dans la laideur; mais qu’importe tout cela? «Le temps,» a dit un poëte, «n’épargne pas ce qu’on a fait sans lui,» mais il donne tôt ou tard leur valeur aux choses qui ne demandent qu’à lui leur consécration. Si par quelques détails perdus dans l’ensemble M. Baudry a tenu à prouver qu’il n’était pas insensible aux événements de ces dernières années, il n’a pas restreint, pour nous flatter, la portée de son œuvre à cette période accidentelle de l’histoire humaine, et il a bien fait, car son poëme décoratif survivra au siècle qui l’a vu naître et il ajoutera une page au Livre d’or et d’airain de ce génie de l’homme qui prélève déjà, en l’attestant, sur notre immortalité.