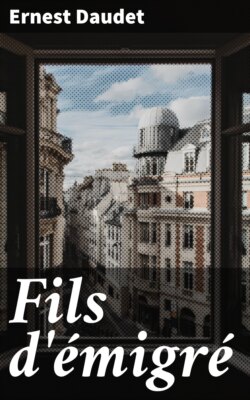Читать книгу Fils d'émigré - Ernest Daudet - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LE FRÈRE DE BERNARD
ОглавлениеÀ la fin du même jour, vers 9 heures, la population de Coblentz était sur les promenades, sous les quinconces, aux devantures des cafés, attirée au dehors par la beauté du ciel et le calme apaisant de cette soirée d'été. À cette époque où la science n'avait encore découvert ni le gaz, ni l'électricité pour éclairer les rues, elles n'avaient pour tout éclairage, la nuit venue, que la flamme pâle des réverbères à huile, et Coblentz, quoique capitale de la principauté de Trêves et résidence de l'électeur régnant, n'était pas mieux partagée que les plus grandes villes. Mais, ce soir-là, très claire était la nuit, de telle sorte qu'on y voyait comme en plein jour, et que nul ne semblait pressé d'aller dormir.
C'était surtout du côté des quais du Rhin, et vers le point où ce fleuve reçoit les eaux de la Moselle, que la foule se portait de préférence avec l'espoir de trouver au bord de l'eau un peu plus de fraîcheur que dans l'intérieur de la ville. De tous côtés elle circulait animée et bruyante, et, aux propos qui se croisaient, à l'accent des voix, aux locutions qu'employaient les parleurs, on se serait cru, non en Allemagne, mais sur les boulevards de Paris. Les costumes des hommes, les toilettes des femmes, les uniformes des soldats ajoutaient encore à l'illusion, car uniformes, toilettes, costumes sortaient de chez les faiseurs de Paris ou avaient été calqués sur les modes de France. Cette particularité ne pouvait surprendre. Si Coblentz, en cette année 1792, était la capitale de l'électorat de Trèves, c'était aussi la capitale de l'émigration, depuis que les frères de Louis XVI étaient venus y chercher un asile auprès de leur oncle l'électeur, et, grâce à sa faiblesse, avaient en toute liberté organisé dans ses États leur gouvernement, leur armée, leur police, en ressuscitant du même coup les élégances des Tuileries et les magnificences de Versailles. Dès ce moment, Coblentz était devenue une succursale de Paris, où des gentilshommes émigrés, accourus en grand nombre autour des princes, avaient imposé aux habitants leurs goûts, leurs habitudes, leurs moeurs. Coblentz n'appartenait plus aux Allemands qui y vivaient, mais aux Français qui y recevaient l'hospitalité et s'y conduisaient à peu près comme en pays conquis.
En même temps que la foule circulait bruyamment à travers les rues, de nombreux consommateurs étaient réunis au café des Trois-Couronnes, le café à la mode. Il y en avait sur la terrasse extérieure; il y en avait dans la salle principale, dont les fenêtres s'ouvraient toutes grandes à la brise du soir. Presque tous étaient gentilshommes; pour la plupart officiers dans l'armée du prince. On les reconnaissait à leurs allures hautaines, à leurs uniformes éclatants, et surtout à leur arrogance envers les rares bourgeois de la ville qu'une vieille habitude conduisait encore au café des Trois-Couronnes, bien que, depuis l'arrivée des Français, ils n'y fussent plus considérés que comme des intrus. Tandis que ces humbles bourgeois se tenaient à l'écart, timides, comme honteux d'oser fumer leurs pipes de porcelaine, peintes, à tuyau recourbé, en buvant de la bière, les gentilshommes, au contraire, allaient et venaient, encombrants, pariant haut, tenant là comme ailleurs toute la place et les meilleures places, affectant de dédaigner la bière allemande et se faisant servir des liqueurs, des sirops, des boissons glacées, toutes choses qui leur rappelaient la France, et, à défaut du vin de Champagne, les vins mousseux du Rhin qui seuls trouvaient grâce à leurs yeux.
À une table placée auprès d'une croisée, trois d'entre eux étaient assis. Indifférents aux bruyantes paroles qui s'échangeaient de table à table dans le tumulte grossissant des appels, des discussions, des entrées et des sorties, ils ne semblaient préoccupés que de ne rien laisser entendre de leur conversation. Penchés les uns vers les autres, ils parlaient à demi-voix.
—Malincourt ne viendra donc pas? dit brusquement le plus jeune, un officier des gardes du comte d'Artois, très élégant sous son costume vert, à parements, revers et collet cramoisi, galonnés d'argent.
—Eh! patience donc, marquis, il est à peine 9 heures. Malincourt était, ce soir, de service auprès du prince. Après le dîner, il aura dû l'accompagner chez Mme de Polastron, et peut-être l'aura-t-elle retenu pour faire la partie de Monseigneur.
Celui qui venait de parler était aussi un jeune homme de belle mine, qui portait avec aisance l'uniforme bleu des chevau-légers.
—Vous êtes heureux d'être patient, vous, mon cher Morfontaine, répliqua son compagnon, moi, je suis loin de vous ressembler. La patience ne fut jamais la vertu favorite de la noble maison de Guilleragues à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir.
—Êtes-vous donc si pressé, mon neveu, de voir le vicomte Armand de Malincourt? demanda le troisième personnage, un vieillard, celui-là, qui n'avait rien d'un soldat, ni l'uniforme, ni les manières, mais dont le fin visage, la taille élancée et toute la personne, des pieds à la tête, révélaient la haute naissance. Aussi vrai que je m'appelle le vidame d'Épernon, je ne vous vis jamais agité comme ce soir.
—On le serait à moins, mon oncle, puisque j'attends une réponse d'une extrême importance pour moi.
—Quelle réponse? reprit le vidame, tout en ouvrant la tabatière ornée de diamants qu'il tournait entre ses doigts fins et blancs et en y prenant une prise de tabac.
Le marquis de Guilleragues regarda rapidement autour de lui pour s'assurer que ses paroles ne pouvaient être entendues, puis, se penchant vers son oncle, il dit:
—Nos princes ont été invités au couronnement de S. M. François II, roi de Bohême et de Hongrie, comme empereur d'Allemagne. La cérémonie, qui doit avoir lieu à Mayence, est fixée au 12 juillet et sera l'occasion de fêtes brillantes. Désireux d'y aller, j'ai sollicité l'honneur d'être attaché, pendant la durée du voyage, à la suite de Mgr le comte d'Artois. Malincourt, qui le voit librement à toute heure, s'est chargé de lui présenter ma requête. Il devait la présenter ce soir et m'en faire connaître ici le résultat.
—Alors, vous allez être fixé sur votre sort, mon cher, fit vivement celui qu'on avait appelé Morfontaine. Voilà le vicomte Armand.
Tous les trois tournèrent la tête vers la porte et virent Malincourt qui les cherchait du regard, et répondait aux obséquieux saluts que lui valaient de tous côtés la bienveillance et la faveur du comte d'Artois.
—Par ici, Malincourt, lui cria Guilleragues en se levant.
Armand s'avança, le sourire aux lèvres. C'était un beau garçon de vingt ans, à l'oeil pur et hardi, dont son uniforme, le même que celui de Guilleragues, mettait en relief les formes sveltes et vigoureuses.
—C'est fait, dit-il à son ami, en tendant la main au vidame d'Épernon et au comte de Morfontaine. Tu viens avec nous à Mayence.
Guilleragues lui sauta au cou.
—C'est entre nous à la vie et à la mort, vicomte. Je n'oublierai jamais ce que tu viens de faire pour moi.
—Adresse surtout tes remerciements à Monseigneur, répondit Armand en s'asseyant. Il a été charmant. À peine j'ai eu prononcé ton nom et formulé ton désir qu'il m'a coupé la parole en disant qu'il était très heureux de saisir cette occasion de te prouver l'estime particulière en laquelle il te tient.
—J'irai lui exprimer ma reconnaissance, fit joyeusement Guilleragues, et, dès demain matin, je m'occuperai de mes équipages.
Le vidame souriait à cet enthousiasme, tout en donnant de la main de petits coups secs sur son jabot de dentelle pour en faire tomber quelques grains de tabac qui en tachaient la blancheur.
—Est-ce de moi que vous souriez, mon oncle? lui demanda Guilleragues.
—De vous, non, mon neveu, mais de votre bonheur. Ah! c'est beau, la jeunesse! Et vous voilà tout content de pouvoir faire sauter vos écus.
—Puisque j'accompagne un prince de sang à un sacre impérial, il est tout naturel que je veuille m'y montrer à sa suite dans une tenue digne de lui.
—Oui, certes, et il est très heureux que votre grand-père maternel ait été fermier général et se soit enrichi. Seulement, mon enfant, si j'étais à votre place, je me contenterais des équipages que vous possédez actuellement et qui sont encore en bon état, et, au lieu de me livrer à une dépense au moins inutile, qui ne réjouira que vos fournisseurs, j'en distribuerais le montant entre les camarades moins fortunés que vous.
—Le fait est que nous ne sommes pas tous sur des roses! soupira
Morfontaine.
—Mais je ne demande qu'à vous rendre service, comte, s'écria Guilleragues, un peu troublé par la petite leçon que venait de lui donner son oncle.
—Eh bien, marquis, je ne vous cache pas que cinquante louis seraient en ce moment les bienvenus dans ma bourse.
—Vous les aurez demain, mon cher, et cela ne m'empêchera pas, tout en tenant compte du conseil de M. le vidame, mon oncle, de m'acheter un cheval qui soit digne de figurer dans le cortège de Monseigneur.
Pendant que s'échangeaient ces propos, Armand de Malincourt, qui s'était fait servir une glace, la dégustait à petites gorgées, silencieux et préoccupé. Tout à coup, du bout de la cuillère en vermeil, il frappa sur la table.
—Assez d'enfantillages! dit-il. J'ai à vous entretenir de choses plus graves.
Et comme les yeux de ses amis, subitement fixés sur lui, l'interrogeaient, il continua:
—De graves nouvelles sont arrivées ce soir, de Paris, de Berlin et de
Vienne, Monseigneur m'en a fait la confidence.
—Qu'est-ce donc? interrogea le vidame d'Épernon.
—À Paris, la situation du roi devient pire de jour en jour. Sa Majesté est réellement prisonnière aux Tuileries, n'ayant plus ni la liberté de ses paroles, ni celle de ses actes. Les scélérats qui gouvernent en son nom viennent de signifier à l'électeur de Trèves l'invitation pressante, presque un ordre, de licencier l'armée des princes, et s'ils résistent, de chasser les émigrés. L'électeur s'est effrayé; il a transmis cet ordre à nos augustes seigneurs, en les suppliant de s'y conformer.
—Il fallait s'y attendre, objecta le vidame. Voici trois mois que le gouvernement de Paris, pressé par l'Assemblée nationale, a fait connaître sa volonté. Il ne se laissera pas braver indéfiniment.
—Par bonheur, les puissances ont enfin mesuré le danger dont les menace la Révolution. Elles sont décidées à agir. L'empereur François II a donné l'ordre à ses troupes des Pays-Bas de marcher sur la frontière de France. D'un autre côté s'avance un Corps prussien. Il traversera Coblentz vers le milieu du mois prochain. Le duc de Brunswick est nommé généralissime des armées alliées. Il arrive ici demain.
—L'impératrice Catherine intervient-elle? demanda Morfontaine.
—Non encore par les armes. Mais le prince de Nassau est arrivé ce soir de Saint-Pétersbourg, apportant un million qu'elle offre à la cause royale. Quant aux émigrés, le général marquis de Bouillé vient d'obtenir du roi de Prusse qu'ils soient employés dans les opérations qui se préparent. Brunswick résistait. Il ne voulait pas de nous. Mais Frédéric-Guillaume s'est prononcé. L'armée des princes et l'armée de Condé seront de la partie. On doit négocier à Mayence les conditions de leur entrée en campagne.
—Enfin, nous allons donc combattre! s'écria Guilleragues dont le visage s'illuminait.
Le vidame intervint.
—Ne vous réjouissez pas, mon neveu, dit-il. Ce sera un triste spectacle que celui de Français mêlés aux armées étrangères pour combattre contre des Français.
Les jeunes gens protestèrent.
—Quoi, Monsieur le vidame, c'est vous qui parlez ainsi? dit
Morfontaine.
—Quand il s'agit de délivrer le roi et de rendre à la noblesse de
France ses antiques privilèges! continua le vicomte Armand.
—Mon oncle a toujours été un peu jacobin, ajouta Guilleragues en riant.
Le vidame allait répondre, mais sa parole fut étouffée sur ses lèvres par un cri de surprise que poussa Malincourt en se précipitant vers la porte, au seuil de laquelle venaient d'apparaître de nouveaux venus. Ces nouveaux venus étaient Bernard et Valleroy, accompagnés ou plutôt guidés par Venceslas Reybach. Quelques instants avant, au moment de quitter le bateau, le peintre leur avait dit:
—À cette heure-ci, c'est au café des Trois-Couronnes que vous êtes sûrs de trouver le vicomte de Malincourt. Je vous y conduirai; si vous le voulez bien.
Et à peine débarqué, après avoir laissé à sa porte tante Isabelle et Nina, auxquelles il avait offert une hospitalité provisoire, en attendant qu'elles trouvassent à se loger, il s'était empressé d'amener Bernard et Valleroy au café des Trois-Couronnes. Au moment où ils y arrivèrent, Armand regardait du côté de l'entrée. Il les vit surgir tout à coup, alors qu'il ne songeait guère à eux. Peut-être, si Bernard se fût présenté seul, il ne l'eût pas reconnu sur-le-champ, tant était complète la transformation qu'avait subie l'enfant depuis une année. Mais il reconnut Valleroy et son jeune frère du même coup. C'est alors que, au grand étonnement de ses amis, il s'était précipité vers la porte.
—Bernard! Valleroy! s'écria-t-il. Vous ici! Quelles circonstances?…
Il ne put achever, Bernard se jetait dans ses bras, secoué jusqu'aux larmes par l'émotion que déchaînait dans tout son être leur soudaine rencontre.
—Armand! mon Armand chéri!
Suspendu au cou de son aîné, il lui prodiguait passionnément de tendres caresses, tandis que Valleroy, respectueux, son chapeau à la main, répétait à demi-voix:
—Ah! Monsieur le vicomte, quelle joie de vous revoir!
—Je vous avais bien dit que nous le trouverions ici, observa Reybach.
—Quoi! mon vieux Reybach, c'est vous qui me les amenez?
—C'est moi, Monsieur le vicomte. Le hasard m'a fait connaître l'aimable Bernard et son digne compagnon sur le bateau qui vient de Mayence et je me suis engagé à les piloter jusqu'à vous.
—Comment vous remercier?
—En me permettant de me retirer et de rentrer chez moi où m'attendent deux charmantes Françaises à qui j'ai offert l'hospitalité.
—J'irai vous voir demain, Reybach, pour vous exprimer ma reconnaissance.
—Et la nôtre aussi, Armand, ajouta Bernard, car depuis ce matin M.
Reybach s'est prodigué en bons soins et en attentions.
—Eh bien, c'est entendu, répondit le peintre; je serai heureux de vous revoir demain, mes gentilshommes, et je crois bien que vous trouverez chez moi une petite personne qui sera enchantée, elle aussi, de retrouver Monsieur le chevalier. Sur ce, je me sauve.
Il s'esquiva, et Armand, qui le suivit d'un oeil reconnaissant, vit son grand feutre penché cavalièrement sur l'oreille et son pourpoint noir se perdre dans la foule pressée aux abords du café. Alors, il entraîna son frère et Valleroy au fond de la salle, et, s'asseyant avec eux à une table, il les interrogea.
—M'expliquerez-vous comment vous êtes à Coblentz tous les deux, quand je vous croyais à Saint-Baslemont?
—Nous avons été contraints de fuir, Monsieur le vicomte, dit Valleroy.
—Contraints de fuir! Et notre père, Bernard? Et notre mère?
—Ils ont été arrêtés, mon frère, et emprisonnés à Épinal.
Depuis qu'Armand vivait éloigné de ses parents, tant de malheurs avaient assailli la France; il avait subi lui-même tant de déceptions, tant d'angoisses, qu'il lui semblait qu'aucune catastrophe, quelle qu'elle fût, ne pouvait plus survenir qu'il ne s'y fût attendu et préparé. Mais celle-ci dépassait ses prévisions et ses craintes. Il s'attendait à tout, sauf à l'arrestation du comte et de la comtesse de Malincourt, qu'il croyait protégés par l'attachement de la population de Saint-Baslemont. Il fut comme écrasé sous cette nouvelle, et, mêlant ses larmes à celles de son frère, il resta pendant quelques instants sans pouvoir prononcer une parole, abîmé dans son silence.
—Comment cela est-il arrivé? demanda-t-il enfin.
Bernard étant hors d'état de répondre, Valleroy fit le récit que voulait connaître Armand, il raconta comment l'arrivée imprévue des gardes nationaux d'Épinal était venue surprendre M. et Mme de Malincourt dans les préparatifs de leur départ; comment lui-même, par l'ordre du comte, avait emporté Bernard, et, après l'avoir mis en sûreté, était revenu sur ses pas pour assister sans être vu à l'arrestation.
—Il y avait là, dit-il, un certain Joseph Moulette, surnommé Curtius Scoevola, qui est un fier bandit. Ah! si jamais il me tombe sous la main…
—Ce n'est probablement pas lui le plus coupable, objecta tristement le vicomte. Les vrais criminels sont ceux qui ont dénoncé mon père, des jacobins, assurément, et ces gens de Saint-Baslemont qui n'ont pas eu le courage de le défendre.
—Oh! ceux-là n'ont fait montre que de couardise. À la première menace du citoyen Curtius Scoevola, ils se sont mis à trembler comme des roseaux et n'ont plus songé qu'à se dérober. Peut-être, s'il s'était trouvé au milieu d'eux un homme énergique, se seraient-ils soulevés. J'ai été au moment de me présenter, de me mettre à leur tête. Mais nous n'avions pas d'armes, tandis que les brigands étaient armés jusqu'aux dents. Et puis, que serait devenu M. le chevalier?
—Oh! moi, je serais mort avec joie pour sauver nos parents! soupira
Bernard.
—Hélas! Monsieur le chevalier, nous aurions bien pu y passer tous; ils n'auraient pas été sauvés. Et puis, j'avais les ordres de M. le comte; j'étais tenu d'obéir.
Armand tendit la main à Valleroy.
—Tu as rempli tout ton devoir, mon brave, lui dit-il, et au nom de ma famille, en mon nom, je te remercie d'avoir sauvé mon frère.
—Vous me remercierez quand j'aurai complété mon oeuvre, Monsieur le vicomte, répondit Valleroy.
—Que veux-tu dire?
—Je veux dire que je partirai dès demain pour Épinal et que, dussé-je y laisser ma peau, je délivrerai nos prisonniers.
—Il a un plan, un plan superbe, ajouta Bernard.
Armand secoua la tête et fit un geste de dénégation.
—Je ne doute pas de la beauté de ton plan, Valleroy, reprit-il, ni du courage que tu mettrais à l'exécuter; mais je doute de son efficacité. Toute la noblesse de France conjurée, soutenue par l'or des puissances, n'a pu délivrer le roi.
—Justement parce que c'est le roi, et peut-être aussi parce qu'elle n'a pas su s'y prendre.
—Tu es libre de le croire; mais tu n'es pas libre d'aller exposer ta vie sans mon consentement, et sans que nous ayons étudié le moyen d'atteindre le but que nous poursuivons. Et puis si nous décidons qu'il y a lieu de tenter cette grande entreprise, n'est-ce pas à moi qu'il appartient d'agir?
—Vous, Monsieur le vicomte, mais vous ne feriez pas trois pas dans l'intérieur du royaume sans être arrêté! Songez que vous figurez sur la liste des émigrés. Ce n'est pas de vous que vos parents peuvent attendre un prompt secours.
—Aussi n'ai-je pas dit que je veux partir: j'ai dit que je ne veux pas que tu partes à la légère, sans accord préalable avec moi. D'ailleurs, en cette circonstance, j'ai le devoir de consulter Mgr le comte d'Artois. Peut-être sera-t-il d'avis qu'il vaut mieux attendre que les armées coalisées soient en marche sur Paris. Alors il me sera facile de m'engager à leur suite, et, en passant à Épinal, de rendre la liberté à nos parents.
—Mais est-il question de la mise en marche des troupes étrangères? demanda Valleroy.
—Elle est décidée, et, du même coup, celle de l'armée des princes.
Avant un mois nous serons à Paris.
—Après avoir combattu sous les drapeaux de l'Autriche et de la Prusse, et Français contre Français! Ce sera une victoire chèrement achetée.
—Et qu'importe, si le résultat final nous dédommage! Si j'étais homme à avoir comme toi des scrupules, crois-tu que les nouvelles que tu viens de m'apporter ne les dissiperaient pas? Catholique, hier, je défendais mon Dieu, et royaliste, je défendais mon roi; fils, je défends aujourd'hui mon père.
—Et la patrie. Monsieur le vicomte?
—La patrie! Elle est là où est le drapeau royal.
Un silence suivit ces paroles que Valleroy n'osa relever. Son dévouement à la maison de Malincourt n'altérait pas l'indépendance de ses opinions. Mais il y puisait l'énergie de ne pas les défendre contre ses maîtres, même lorsque, sans le vouloir, ils les froissaient. Et puis, il comprenait qu'un débat eût été en ce moment inutile et cruel, en présence de deux fils livrés à la plus légitime douleur. Cependant, ce fut une sensation d'une douceur infinie lorsque, après avoir parlé, il sentit la petite main de Bernard se poser sur la sienne et la presser. Il lui semblait que c'était un témoignage d'approbation, et il se réjouit en pensant que, sur ces graves questions de patriotisme et d'honneur, le coeur de l'enfant qu'il aimait battait à l'unisson du sien.
Quant au vicomte, les coudes sur la table, le front dans ses mains, il pleurait de nouveau en se rappelant que quinze jours avant, assis à la même place, il avait son père en face de lui, qu'ils causaient ensemble de leur réunion prochaine, en se leurrant de doux espoirs, et que ces espoirs étaient maintenant détruits. Perdu dans ses souvenirs, que le présent rendait plus affreux, il ne s'apercevait pas que Bernard, énervé par la fatigue autant que par la douleur, s'attendrissait encore au spectacle de celle de son frère, et allait, lui aussi, éclater en sanglots. Ce fut Valleroy qui le rappela à la réalité.
—Monsieur le vicomte, lui dit-il, pour vous-même et pour M. le chevalier, il est nécessaire que vous ne vous laissiez pas abattre. La situation est grave, mais non désespérée. Nous en viendrons à bout.
—Tu as raison, Valleroy. Pleurer est indigne d'un gentilhomme. Désormais, je serai courageux, je serai fort. Par exemple, si jamais les misérables qui, ce soir, ont fait couler mes larmes me sont connus!…
Et il eut un geste de menace.
—Oh! pour cela, je vous aiderai, interrompit Valleroy en essayant de rire, et le nommé Joseph Moulette, dit Curtius Scoevola, passera un mauvais quart d'heure.
À ce moment, le regard d'Armand s'arrêta sur son frère. Il le vit pâle, les traits altérés.
—Mais tu tombes de lassitude, mon pauvre chevalier, fit-il d'un accent de tendre sollicitude. Et moi qui ne m'en apercevais pas, égoïste que je suis! Allons, viens, rentrons.
Il se leva. Alors seulement il s'aperçut que l'explosion de sa douleur avait eu pour témoins les consommateurs réunis au café des Trois-Couronnes, et que, de toutes parts, les yeux étaient fixés sur lui. En même temps, le vidame d'Épernon, le marquis de Guilleragues, le comte de Morfontaine s'approchaient.
—Ne prenez pas en mauvaise part notre curiosité, mon cher Malincourt, lui dit le vidame, mais, en voyant votre désespoir, vos amis se sont inquiétés. Ne nous direz-vous pas quel événement vous afflige et refuserez-vous de mettre à l'épreuve, en cette circonstance, notre dévouement?
—Messieurs, répondit Armand en désignant Bernard, je vous présente mon frère, le chevalier de Malincourt. Chevalier, ajouta-t-il en s'adressant à celui-ci, je te présente les plus brillants gentilshommes de France.
Et les ayant nommés, il leur dit:
—Le comte et la comtesse de Malincourt ont été arrêtés par les jacobins d'Épinal, et le chevalier n'a pu se dérober au même sort qu'en prenant la fuite. En apprenant de sa bouche ce funeste événement, je n'ai pas été maître de mon émotion. Mais c'est fini maintenant, et je ne veux plus songer qu'à délivrer nos parents et à tirer vengeance de leurs persécuteurs. Au besoin, je ferai appel à votre aide, Messieurs.
—Tu peux compter sur moi, vicomte, s'écria Guilleragues.
—Sur moi aussi, ajouta Morfontaine.
—Sur nous tous, reprirent quelques voix.
Seul, le vidame d'Épernon, qui n'était pas soldat, ne s'associa pas à cette manifestation. Mais, tandis qu'Armand se prodiguait en remerciements et en reconnaissantes poignées de mains, il s'approcha de Bernard et lui dit d'un ton affectueux:
—Je vous plains de tout mon coeur, mon cher enfant, car c'est pitié de vous voir, à peine entré dans la vie, en butte à d'aussi rudes épreuves. Si vous voulez me rendre en confiance un peu de l'intérêt que vous m'inspirez, je serai heureux de vous aider à supporter vos peines.
—Oh! merci, Monsieur! s'écria Bernard avec effusion.
À Coblentz, comme dans toutes les villes qui donnaient asile aux émigrés, la plupart d'entre eux étaient réduits à la gêne ou même à la misère. On comptait ceux dont les ressources suffisaient à leurs besoins et qui pouvaient vivre sans faire appel à la générosité des princes ou à la bienveillance des cours étrangères. Armand de Malincourt appartenait à ce petit nombre de privilégiés. Grâce à la sollicitude paternelle, grâce à l'emploi qu'il occupait auprès du second frère de Louis XVI, il vivait dans l'aisance et pouvait même, de temps en temps, s'offrir le luxe de venir en aide à un camarade. Dans le quartier le plus élégant de Coblentz, il avait loué une petite maison, haute de deux étages, où il résidait avec un seul domestique qui devenait tour à tour cuisinier, maître d'hôtel, valet de chambre, palefrenier, selon les exigences du moment. C'est là qu'en quittant le café des Trois-Couronnes, il conduisit Bernard et Valleroy. Son appartement occupait le premier étage. Mais, au second, se trouvaient des chambres où il les installa. Bernard, excédé de fatigue, se mit au lit sans tarder et s'endormit à peine couché.
Le lendemain, quand il ouvrit les yeux, son frère était auprès de lui, debout et déjà en grande tenue.
—Oh! comme vous voilà beau, Armand! lui dit-il. Est-ce donc aujourd'hui que vous partez en guerre?
—Chaque chose vient à son heure, répondit Armand, et la guerre viendra plus tard. Aujourd'hui, j'ai un autre devoir à remplir. Pare-toi de tes plus beaux habits, chevalier, je vais te présenter à Mgr le comte d'Artois.
—Mes plus beaux habits! Hélas! Ils sont restés à Saint-Baslemont.
—N'en as-tu pas d'autre que celui que tu portais hier?
—Pas d'autre, mon frère. Le voilà sur cette chaise, regardez-le et vous comprendrez que je ne puis aller chez un prince du sang en si pauvre équipage.
—Bah! ce n'est que demi-mal. Nous allons passer chez le fripier et peut-être y trouverons-nous un costume à ta taille.
—Mais si nous n'en trouvons pas?
—Alors, nous en commanderons un au tailleur.
—Le tailleur demandera plusieurs jours pour le faire, et ma visite au prince devra être forcément remise.
—Nous ferons notre visite quand même. Une fois n'est pas coutume, et Monseigneur t'excusera, vu la gravité des circonstances. Allons, debout, chevalier, et hâte-toi.
Bernard s'empressa d'obéir. Valleroy étant entré sur ces entrefaites, l'aida à se vêtir, et, quelques instants après, comme sonnaient 9 heures à la cathédrale de Coblentz, les deux frères sortirent ensemble. De même que la journée précédente, celle qui commençait s'annonçait radieuse. Le soleil, déjà haut dans le ciel tout bleu, achevait de boire la fraîcheur de la nuit. Dans les arbres des promenades, les oiseaux piaillaient, mêlaient leurs cris aux chansons des joueurs de vielle et à la musique des orgues de barbarie. Au milieu des places, des charlatans en costumes mirifiques, juchés sur le siège de leurs voitures, récitaient leur boniment, arrachaient les dents «sans douleur» ou débitaient des fioles d'élixir bon à guérir toutes les maladies. Le long des quais du Rhin, quelques compagnies de l'armée des princes s'exerçaient aux manoeuvres militaires, et comme tous n'étaient pas encore armés, beaucoup de soldats se servaient de bâtons. La foule des oisifs circulait lentement, s'arrêtait à des échoppes en bois, dressées tout près du marché aux herbes, où des femmes de la noblesse, obligées de travailler pour vivre, vendaient des broderies, des dentelles, des étoffes, des parfums, des estampes et des livres. Au coin d'une rue, Bernard vit son frère saluer avec déférence un cireur de bottes, et comme il s'en étonnait:
—C'est un bon gentilhomme du Poitou, répondit Armand.
Un peu plus loin, une sémillante jeune femme arrêta le vicomte et lui demanda si son linge n'avait pas besoin d'être ravaudé. Le jeune homme la remercia en l'appelant madame la marquise. Puis il traita de baronne une marchande de fleurs, et, comme Bernard ne pouvait dissimuler sa surprise, il lui dit:
—Ne t'étonne de rien, chevalier, tu en verras bien d'autres. Partout où il y a des émigrés, ils font tous les métiers; cordonniers, cuisiniers, gardes-malades, porteurs d'eau, comédiens, d'autres encore. Avant tout, qu'on soit plébéien ou gentilhomme, il importe de ne pas mourir de faim.
Tout en parlant, ils étaient arrivés devant la boutique d'un fripier, reconnaissable aux innombrables habits accrochés à la devanture et dans l'intérieur; habits de toutes sortes, de toutes nuances et pour toutes conditions: en velours, en soie, en drap; les uns sans ornement, les autres chargés de broderies d'or et d'argent ou agrémentés de dentelles, mêlés à des chapeaux, à des bas de soie, à des souliers à boucles, à des bottes, à des chemises, le tout, neuf ou vieux, étalé au tas dans une confusion bizarre et criarde de formes et de couleurs.
—C'est ici, fit Armand.
Et sur le seuil de la boutique, au moment d'entrer, il ajouta:
—Le propriétaire de toutes ces défroques est un ancien fermier général.
Le voilà qui vient vers nous.
Un petit vieux, propret, turbulent, très affairé, s'avançait à leur rencontre.
—Qu'y a-t-il pour votre service, mes gentilhommes? demanda-t-il.
—Nous voudrions un costume élégant pour M. le chevalier, lui dit Armand en désignant son frère, un costume de cour qui lui fasse honneur et profit, sans coûter un gros prix.
—M. le chevalier est de petite taille, observa le marchand, et je ne sais si nous trouverons… Parbleu, j'ai votre affaire, s'écria-t-il tout à coup, en se frappant le front. C'est la garde-robe des enfants d'un duc, qui me l'a cédée l'an dernier, au moment de partir pour Rome. Il était pressé de se mettre en route, et comme les fonds qu'il attendait n'arrivaient pas, j'ai pourvu aux frais de son voyage. Il m'a laissé ses malles en gage.
Il s'enfonça dans son magasin, disparut un moment derrière un comptoir chargé de marchandises, et revint bientôt, traînant péniblement un immense coffre en bois à ferrures.
—Nous devons trouver là-dedans ce qu'il vous faut, dit-il, en l'ouvrant, après s'être essuyé le front.
Il en tira d'abord toute une toilette de petite fille, une robe en soie rose, une écharpe blanche, en gaze, à paillettes d'or, une guimpe en point de Malines, et enfin une mante en satin, couleur feuille morte, à triple collet, bordée autour du cou d'une fine fourrure de petits gris. Il maniait délicatement ces divers objets et les mit de côté, en faisant remarquer qu'ils avaient appartenu à la fille cadette de M. le duc, une jolie blonde de sept ans.
—L'âge de Nina, pensa Bernard en jetant un regard de convoitise sur la toilette de la petite duchesse.
—Voici ce que je cherchais, ajouta triomphalement le marchand.
Et il présentait à Bernard, en les dépliant devant lui, un habit en soie, couleur chocolat, à boutons en similor, un gilet gris perle en satin, à semis de fleurettes bleues, une culotte de même étoffe et de même nuance, avec les bas assortis, des souliers à boucles et un tricorne à la mode de 1789.
—Ceci doit vous aller comme un gant. Monsieur le chevalier, et c'est neuf, entièrement neuf. Remarquez qu'aucun de ces vêtements n'a été porté.
—Le tout est qu'ils soient à ma mesure, objecta Bernard.
—Nous allons nous en assurer. Venez, mon jeune gentilhomme.
Le marchand entraînait Bernard dans son arrière-boutique, en priant Armand d'attendre. La transformation fut vite opérée, et le vicomte vit reparaître son frère, vêtu selon son rang, charmant dans sa tenue nouvelle.
—C'est à croire qu'on l'a fait pour lui, répétait le petit vieux en s'extasiant; oui, c'est à le croire.
—Et le prix? demanda le vicomte.
—Pour vous, mon officier, c'est soixante-quinze livres, tout au juste.
—Je ne marchande pas; voici votre argent.
Armand jeta trois louis sur le comptoir, et s'adressant à son frère:
—Filons vite, chevalier, Monsieur fera porter chez nous les vêtements que tu viens de quitter.
Mais, au lieu d'obéir à son aîné, Bernard interrogeait le marchand, en lui désignant la robe rose, l'écharpe blanche, la guimpe en point de Malines et la mante à triple collet.
—Combien voulez-vous vendre ceci, Monsieur?
—Vingt-cinq livres seulement, à cause de la difficulté que j'ai à m'en défaire.
—Mon frère, continua Bernard en se tournant vers Armand, permettez-moi d'offrir ces parures à une pauvre petite fille avec qui j'ai fait la route de Mayence à Coblentz?
—Ton amie Nina dont Valleroy m'a parlé? À ton aise, chevalier. Voici un louis de plus, Monsieur le marchand.
Une pièce d'or alla rejoindre les trois autres. Puis, après que Bernard eut donné l'ordre d'apporter chez le peintre Venceslas Reybach, pour Mlle Nina, les objets qu'il venait d'acheter, les deux frères sortirent pour se rendre au château de Schonbornlust, somptueuse résidence située aux portes de la ville et mise par l'électeur de Trêves à la disposition des princes français.
Au fur et à mesure qu'ils avançaient, les maisons s'espaçaient. Ils se trouvèrent bientôt en pleine campagne, sur une route qu'ombrageaient de vieux arbres déjà poudreux de la poussière du jour, et tout au bout de laquelle le château dressait sa masse imposante. Sur cette route, les piétons étaient nombreux, tous des émigrés, à en juger par les costumes des hommes, les toilettes des femmes, les uniformes des officiers. Plus rares étaient les voitures. Cependant, il en passait quelques-unes, antiques et vénérables berlines pour la plupart traînées par de lourds chevaux que conduisaient des cochers à la livrée usée et défraîchie. Parmi ces équipages d'un autre temps, Bernard aperçut un de ces cabriolets, appelés «pots de chambre», qu'ils avaient vus souvent à Paris.
—Un fiacre de Paris à Coblentz! s'écria-t-il.
—Nous en avons une douzaine, répondit Armand. Ils ont amené des émigrés, et les cochers, la course faite, ont trouvé plus simple de rester ici que de retourner en France.
Ainsi, tout était pour Bernard sujet de surprise: des princes français en Allemagne, la noblesse dans l'exil, des gentilshommes vivant du travail de leurs mains, des grands seigneurs et des grandes dames s'en allant à pied par les routes, des fiacres entreprenant des voyages de trois cents lieues, et lui, le chevalier de Malincourt, jeté tout à coup dans cette existence aventureuse et se rendant à l'audience du comte d'Artois, ayant sur le dos des vêtements d'emprunt, la défroque d'un petit duc qui sans doute à cette heure menait la même vie nomade que lui!
Cependant, il continuait à interroger Armand:
—Est-ce que tous ces gens se rendent à Schonbornlust, mon frère?
—Ils vont, comme nous, faire leur cour à nos seigneurs les princes, qui, tous les matins, reçoivent la noblesse.
—Manifeste-t-elle toujours le même empressement?
—Aujourd'hui, l'affluence est plus nombreuse que de coutume. Cela tient à ce que la nouvelle s'est répandue que le prince de Nassau est revenu de Saint-Pétersbourg, apportant un million de livres que l'impératrice Catherine offre aux frères du roi de France pour subvenir aux frais de la campagne qui se prépare. Il y a beaucoup de malheureux parmi les émigrés. Ils se hâtent avec l'espoir qu'en arrivant les premiers ils recueilleront quelques gouttes de cette pluie d'or.
—Mais si on leur distribue le million, objecta Bernard, il ne restera plus rien pour les frais de la campagne?
Armand regarda son frère, comme s'il eût été frappé par la justesse de cette remarque et surpris de l'entendre sortir de la bouche d'un enfant. Mais il n'y répondit pas.
Qu'aurait-il pu répondre, sinon que la misère et l'exil sont choses lamentables et compromettent le succès des meilleures causes. Il ne le savait que trop, lui qui, depuis dix-huit mois, avait vu des sommes énormes se fondre entre les mains des princes, absorbées, sans profit pour la cause de la royauté, par l'entretien de leur maison et les pressants besoins des gentilshommes qui formaient leur cour.
D'ailleurs, on arrivait au château. Deux soldats de la garde des princes se promenaient devant la porte, silencieux, le fusil sur l'épaule. Ils présentèrent les armes au vicomte de Malincourt qui passa, suivi du chevalier.