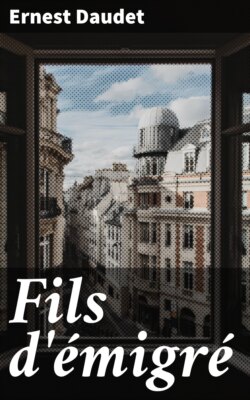Читать книгу Fils d'émigré - Ernest Daudet - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление—Ne voulez-vous pas déjeuner, Monsieur le chevalier? demanda Valleroy.
—Pourrons-nous nous procurer des vivres sur ce bateau? objecta l'enfant.
—Oui, à prix d'argent, un prix très haut sans doute. Mais, grâce à mes précautions, je suis en état de vous servir un repas à peu près convenable.
—Auquel je ne goûterai que si tu en prends ta part, assis à mon côté.
—Je n'oserai jamais, Monsieur le chevalier. Je n'oublie pas que vous êtes mon seigneur et que je ne suis ici que pour vous servir.
—Que parles-tu de me servir, Valleroy, quand mon père m'a confié à toi comme à un protecteur? Il n'y a plus ici ni serviteur, ni maître, mais seulement des amis, entre qui tout doit être commun.
Ce fut dit d'un accent de résolution et de crânerie qui ne permettait ni protestation ni résistance. Valleroy se résigna, sans mot dire, et s'éloigna docilement après avoir enveloppé Bernard d'un regard chargé d'admiration et de sollicitude, qui signifiait que, pour l'enfant remis à sa garde, il était prêt à se faire hacher en morceaux. Après avoir disparu la durée de quelques minutes, il revint. Il portait d'une main une sacoche en cuir, de l'autre, une vieille caisse vide. Il jeta le tout sur le plancher en disant:
—Voici la table et voici de quoi la garnir.
En un tour de main, le couvert fut dressé, une serviette blanche sur la caisse, et, sur la serviette, un poulet froid, un pâté à la croûte luisante, des cerises et une bouteille de vin du Rhin qui, sous le soleil, semblait contenir un flot de rubis.
—D'où vient tout cela? demanda Bernard surpris.
—De chez un traiteur de Mayence, Monsieur le chevalier. C'est moins brillant qu'au château de Malincourt, mais vous jugerez que c'est aussi bon.
Les sièges manquaient. À l'exemple de Valleroy, Bernard en improvisa un à l'aide d'un tas de cordes et, une fois installé, se mit à manger de grand appétit. Autour d'eux, beaucoup de passagers en faisaient autant. Des victuailles apparaissaient de toutes parts. Chacun s'était arrangé à qui mieux mieux, étalant son repas, qui sur ses genoux, qui sur un banc, qui sur un panier. Les menus, par exemple, étaient loin de se valoir; tandis que, pour les uns, ils se composaient de mets choisis, poissons bouillis ou viandes froides, ils se réduisaient pour d'autres à un morceau de pain bis sur lequel, très humbles, ils mordaient à la dérobée, en regardant le paysage, comme honteux d'être contraints de se nourrir pauvrement et comme si la nature radieuse, qui déroulait ses splendeurs sous leurs yeux, eût insulté à leur misère.
À ce moment, l'attention de Bernard fut soudain captivée par l'apparition d'une enfant qui venait de se montrer sur la plus haute marche de l'escalier conduisant dans l'intérieur du bateau. Huit ans à peine, des cheveux noirs épars sur les épaules qu'ils caressaient de leurs boucles soyeuses, des yeux larges et rieurs illuminant le visage d'une blancheur éclatante, une fossette à la joue droite, cette fillette vêtue de blanc était, des pieds à la tête, dans ses traits, ses mouvements, sa démarche, d'une grâce invraisemblable, d'une beauté de rêve. Timide et hardie à la fois, elle circulait à travers les groupes, avec l'attitude envieuse et gourmande d'un jeune chien qui rôde autour d'une table avec l'espoir qu'il en tombera quelque rogaton.
D'où venait-elle, l'adorable enfant? Comment se trouvait-elle là toute seule, ayant l'air de mendier sa nourriture? Qui était-elle? Oh! ce n'était pas difficile à deviner. Une petite Française, probablement une fille d'émigré…
—Peut-être est-elle comme moi, séparée de ses parents, pensa Bernard.
Sous l'empire d'un sentiment qu'il éprouvait pour la première fois, fait de commisération soudaine et d'involontaire attrait, son coeur allait d'un bond vers la mignonne créature dans laquelle il devinait une compagne d'infortune, et que le hasard de sa promenade conduisait vers lui et vers Valleroy. A trois pas d'eux, elle s'arrêta, l'oeil sur les cerises, dont la blancheur de la nappe avivait la couleur vermeille.
—Viens, petite! lui cria Bernard.
Elle obéit avec lenteur, un doigt sur ses lèvres, dévorant les fruits de son regard candide. Alors, il lui dit:
—Veux-tu déjeuner avec moi?
Comme elle ne répondait pas, Valleroy ajouta:
—Puisque M. le chevalier vous invite, acceptez, ma mignonne.
Elle hésitait encore. Mais Bernard tendit la main, attira l'enfant, l'obligea à s'asseoir sur ses genoux, et, lui donnant une aile du poulet déjà dépecée, il reprit:
—Mange donc, ma petite amie, et si tu as soif, bois.
Il lui offrait son verre. Elle y trempa ses lèvres et, sans se faire prier davantage, mordit à belles dents sur le morceau de viande qu'elle tenait au bout de ses doigts. Mais une voix grondeuse se fit entendre:
—N'as-tu pas de honte, Nina? Est-il convenable qu'une demoiselle de bonne maison s'attable avec des inconnus? Remercie ces messieurs et viens près de moi.
À ces mots, Bernard releva la tête pour voir la personne qui venait de parler. C'était une jeune femme, grande, mince et blonde, avec des yeux très doux, coiffée d'un chapeau de paille à larges bords, vêtue d'une robe en soie couleur feuille morte, jadis élégante, mais maintenant usée aux coutures et toute fripée. Surprise et mécontente de la hardiesse de l'enfant, elle la rappelait du geste et de la voix, avec des airs de colère qui n'étaient qu'en surface et ne l'empêchèrent pas de sourire, quand elle vit l'embarras de Nina partagée entre la nécessité d'obéir et le regret de quitter si vite le festin devant lequel elle venait de s'asseoir. Bernard s'était levé, et s'avançant vers l'inconnue:
—Ne la grondez pas, madame: la pauvre petite avait refusé d'abord.
C'est moi qui l'ai obligée à accepter.
—Alors, Monsieur, agréez mes remerciements.
—Je ne les accepterai, Madame, que si vous permettez à votre fille de rester avec nous et si vous vous joignez à elle pour partager notre repas.
Et relevant fièrement la tête, il ajouta, à demi-voix:
—On me nomme le chevalier Bernard de Malincourt.
L'inconnue s'inclina; puis montrant Nina, qui, sûre de son consentement, recommençait à manger:
—Je ne suis pas sa mère, dit-elle, mais, malgré l'apparente humilité de sa condition, elle est fille de gentilhomme. Son père était le baron d'Aubeterre, il commandait une compagnie dans le Royal-Allemand, régiment du prince de Lambesc. Il est mort, le 12 juillet 1789, pour le service du roi.
—Et sa mère? demanda Valleroy.
—Morte aussi, un an après, à Bruxelles, où elle avait émigré. Elle n'a pu résister à sa douleur.
—Si jeune et déjà si malheureuse! murmura Valleroy en couvrant l'orpheline d'un regard de commisération.
—Oui, et bien digne de pitié, continua l'inconnue, car, malgré mes efforts pour lui faire un sort meilleur, je n'ai pu que l'associer à ma misère. Sans vous, Messieurs, la pauvre chérie eût été réduite à déjeuner comme moi d'un morceau de pain… Je ne sais comment vous exprimer ma reconnaissance.
—C'est bien simple, répliqua Valleroy avec enjouement; mettez-vous là,
Madame, et suivez l'exemple de Nina.
Elle résistait encore, malgré la pressante invitation de Valleroy, que charmaient sa réserve, sa discrétion et sa grâce. Mais Nina, qui n'avait encore rien dit, joignit sa prière» à celle de ses nouveaux amis:
—Fais comme moi, tante Isabelle; cela vaudra mieux que de manger ton pain tout sec. N'est-ce pas, Monsieur le chevalier, que tu veux bien? ajouta-t-elle en s'adressant à Bernard.
—Je le veux, à condition que tu m'embrasseras.
Un rire clair et perlé lui répondit. Agitant au bout de ses doigts l'os de poulet qu'elle ne voulait pas lâcher bien qu'il ne restât plus de viande autour, Nina éleva ses lèvres à la hauteur des joues de Bernard et l'embrassa en disant:
—Tu es bien gentil, Monsieur le chevalier, et je t'aime de tout mon coeur.
—Maintenant qu'elle a payé, mettez-vous à table, Madame, reprit
Bernard.
—J'accepte puisque vous le voulez, répondit tante Isabelle souriante, et aussi parce que j'ai grand'faim.
Valleroy, très empressé, l'obligea à s'asseoir sur le rouleau de cordes dont il s'était fait un siège et lui-même resta debout, heureux de la servir, en la regardant. Pendant quelques instants, tante Isabelle mangea en silence. Puis quand sa faim fut rassasiée, elle dit:
—Je vous ai fait connaître qui était cette enfant. Je dois vous avouer mon nom et ma profession. On me nomme Isabelle Lebrun et je suis comédienne.
—Vous jouez la comédie? demanda Bernard, dont la curiosité brusquement s'éveillait.
—Et aussi la tragédie, tout comme la mère de Nina, qui faisait partie de la troupe des comédiens du roi quand le baron d'Aubeterre l'épousa. À cette époque, je ne l'avais jamais vue; je ne savais rien d'elle que son nom, qui était célèbre, car elle s'appelait Mme Dangeau.
—La grande tragédienne? reprit Bernard. Mais je la connaissais; ta maman, ajouta-t-il en embrassant Nina. Elle est venue une fois à l'hôtel de Malincourt, un soir de fête, il y a quelques années. Elle a récité des vers. J'étais tout petit, mais je m'en souviens.
—Puisque, vous l'avez connue, continua tante Isabelle, je ne vous parlerai ni de son talent ni de sa beauté. En épousant M. d'Aubeterre, elle avait quitté le théâtre et s'était fait oublier. Mais lorsque, après la mort de son mari, elle eut émigré, se trouvant à Bruxelles, dénuée de ressources, l'idée lui vint d'utiliser ses talents. Une troupe de comédiens français, dont je faisais partie, donnait des représentations dans cette ville. Elle alla leur offrir ses services, qui furent acceptés avec joie, comme bien vous pensez. Jusqu'à son arrivée, nous avions végété, tant étaient peu nombreux les spectateurs que nous attirions. Mais quand on sut que la célèbre Dangeau nous apportait son concours, ils affluèrent, et ce fut pour elle, pendant une année, sur toutes les grandes scènes de Flandre et des Pays-Bas, une suite de triomphes. C'est ainsi que j'eus l'honneur non seulement de paraître sur les planches à côté de la Dangeau, mais encore de recevoir ses conseils et de conquérir son amitié. Et cela vous explique comment sa fille se trouve aujourd'hui entre mes mains. En mourant, elle me l'a confiée.
Valleroy avait écouté ce récit avec une attention émue et attendrie.
—Et maintenant, comment vivez-vous? fit-il.
—De ma profession, quand je trouve à l'exercer. Je parcours les villes de Suisse et d'Allemagne où se trouvent des Français. S'il y a des comédiens donnant des représentations, je tâche de me faire admettre parmi eux. Malheureusement, ces occasions sont rares, d'autant plus rares que plusieurs dames de l'aristocratie, obligées de gagner leur vie, se sont résignées à monter sur les planches et y tiennent les mêmes emplois que moi. Alors, je vais réciter des vers dans les cafés, dans les auberges, sur les bateaux, partout où il y a des rassemblements. La petite est intelligente; je l'ai dressée à me donner la réplique. Elle s'en acquitte gentiment. Puis elle fait la quête parmi les auditeurs. Quelquefois, elle recueille beaucoup, d'autres fois, très peu. Comment nous vivons? Au hasard des chemins, comme les hirondelles.
—Vous étiez digne d'une existence meilleure, remarqua Valleroy.
—Aussi, suis-je horriblement lasse de celle que je mène, et si ce n'était cette enfant à laquelle je me suis dévouée…
Elle n'acheva pas et demeura rêveuse, tandis que Bernard, pressant plus étroitement contre lui la petite Nina qui s'endormait entre ses bras, interrogeait Valleroy d'un air inquiet comme s'il craignait de comprendre le langage de tante Isabelle.
—Si ce n'était cette enfant, que feriez-vous? s'écria Valleroy, tout à coup anxieux.
Elle regarda le ciel bleu, puis les eaux aux vagues étincelantes, et murmura:
—La mort, c'est la délivrance.
—La mort! À votre âge! Quelle impiété! Il faut vivre, tante Isabelle, surtout maintenant que vous avez des amis…
Valleroy parlait avec véhémence, comme inspiré par une ardente sollicitude. Mais tante Isabelle, un peu surprise, ne comprit pas ce que signifiait ce langage. Elle ne devait le comprendre que bien des années après. Elle y puisa cependant assez de confiance et de courage pour répondre, résignée, au cri de Valleroy:
—Vous avez raison, Monsieur; il faut vivre pour la petite, et je vivrai. Après tout, la vie n'est pas toujours inclémente. Elle est comme la nature, qui nous donne, après les jours d'orage, des jours de soleil. Aujourd'hui est un bon jour puisqu'il nous apporte la sympathie de coeurs généreux et bons.
Le repas était terminé. Valleroy en serra les restes dans la sacoche, jeta les débris par-dessus bord. Puis il se rapprocha de tante Isabelle pour continuer l'entretien commencé, tandis que Bernard, toujours assis à la même place, demeurait immobile, afin de ne pas réveiller Nina, endormie sur ses genoux.
Autour d'eux, le pont du bateau, tout à l'heure vivant, bruyant, animé comme une place publique ou une salle de restaurant, avait pris une physionomie de somnolence. La chaleur battait son plein. Le soleil de midi incendiait l'onde calme et unie, les forêts du rivage, les toitures des maisons, les rochers géants qui dressaient au-dessus d'elles leurs cimes altières, couronnées de ruines. La brise du matin ayant cessé, les voiles pendaient dégonflées, piteusement plates, aux mâts qui craquaient dans l'air brûlant et alourdi. Sous la tente, quelques passagers faisaient la sieste; d'autres lisaient qui des lettres, qui des gazettes. Ceux qui causaient entre eux parlaient à demi-voix comme s'ils eussent subi les effets de l'engourdissement qui pesait sur le paysage et sur les eaux.
Bernard, à l'exemple de Nina, s'était assoupi, et c'était un groupe exquis qu'ils formaient tous deux, lui assis sur le plancher, adossé au cabestan, protégeant de ses bras d'enfant, ainsi qu'un trésor précieux, l'autre enfant qui dormait la tête sur son épaule, mêlant ses cheveux aux siens. Comme si le souci de la petite créature laissée sans sa garde l'eût empêché de s'endormir, de temps en temps, il ouvrait les yeux. Mais il regardait sans voir et, presque aussitôt, ses paupières appesanties se refermaient. Tout en poursuivant sa causerie avec tante Isabelle, Valleroy ne le perdait pas de vue.
—M. le chevalier s'est endormi, dit-il, au bout de quelques instants. Le pauvre enfant tombait de sommeil. Il a passé la nuit dernière à pleurer.
—C'est comme Nina, répondit tante Isabelle. Elle avait des rêves affreux et ne cessait de m'appeler, bien que je l'eusse couchée près de moi sur un banc de l'entrepont.
—Les chères créatures auront connu bien jeunes de dures épreuves, observa Valleroy.
—Et cependant, que n'eussions-nous donné pour les leur épargner!
—Vous aimez tendrement cette petite Nina, tante Isabelle?
—Autant que vous aimez votre maître, Monsieur Valleroy.
Ils se regardèrent. À leur insu, l'identité de leurs sentiments rapprochait leurs coeurs, formait entre eux un lien plus fort.
—Nous avons tous deux ici-bas une tâche égale, reprit Valleroy, un enfant à protéger et à élever.
—Oui, mais celui qu'on vous a confié aura une destinée meilleure que celui dont j'ai la garde.
—Qu'en sait-on? Les parents de M. le chevalier sont en prison, réservés peut-être à quelque mort affreuse.
—S'il a le malheur de les perdre, il aura du moins leur fortune pour assurer son existence, son frère pour l'élever; enfin, à défaut de fortune, à défaut de son frère, il peut compter sur vous.
—Je ne suis qu'un homme, moi; je ne saurais lui tenir lieu de mère si jamais il devenait orphelin; si j'étais chargé de le préparer aux devoirs de la vie, je voudrais une compagne comme vous pour m'aider à remplir ma tâche. Elle serait une mère pour M. le chevalier; je serais un père pour Nina.
—Vous me jugez avec trop de bienveillance.
—C'est mon coeur qui vous juge, et il ne se trompe pas.
Ils restèrent silencieux, accoudés à la balustrade. Tout à coup, tante
Isabelle toucha le bras de Valleroy.
—Connaissez-vous cet homme qui rôde autour de nos enfants?
—Quel homme?
—Ce vieux à longs cheveux blancs.
—Oui, un drôle de particulier et d'allure étrange. Que leur veut-il? Pourquoi les regarde-t-il ainsi? C'est un personnage à surveiller. On rencontre tant de coquins en voyage!
L'individu qui attirait ainsi l'attention de Valleroy et de tante Isabelle ne méritait pas, cependant, à le juger du moins sur les apparences, la sévère appréciation dont il venait d'être l'objet. Son regard doux et clair respirait la bonté et sous les cheveux blancs qui sentaient de son chapeau en feutre, à larges bords, et couvraient ses épaules de leurs boucles en désordre, il avait une physionomie tout à fait vénérable. Par malheur pour lui, l'excentricité de son accoutrement ne prévenait pas en sa faveur. Il portait un vieux pourpoint en velours noir, serré à la taille par une ceinture de cuir, des culottes bouffantes également en velours, des bas de soie et des souliers ornés sur le coup-de-pied de rosettes bouffantes. Comme le fit remarquer tante Isabelle, on eût dit un personnage de Van Dyck, et, ce qui complétait l'illusion, c'était une barbe grise, taillée en pointe, et des moustaches dont les bouts effilés se relevaient menaçants au coin des lèvres, accusant les rides de la peau jaunie comme un vieux parchemin.
—Ce n'est pas un coquin, fit-elle en souriant.
—Un fou, alors?
—Plutôt un artiste, je suppose.
Comme pour justifier cette opinion, le personnage s'arrêta brusquement en face des enfants endormis, tira de la poche de son pourpoint un album auquel attenait un crayon et se mit à croquer rapidement les deux petits dormeurs.
—Que vous disais-je? continua tante Isabelle. C'est un peintre.
Mais, à ce moment, Bernard se réveillait et tournait la tête, cherchant des yeux Valleroy.
—Ne bougez pas, mon jeune seigneur, lui cria l'artiste avec un rude accent tudesque; je n'en ai pas pour longtemps.
D'abord surpris et craintif, mais vite rassuré en apercevant à quelques pas de lui tante Isabelle et Valleroy, Bernard ne remua plus. Ce fut, d'ailleurs, terminé en dix minutes et le peintre ferma gravement l'album en disant:
—Ce n'est qu'un souvenir que j'utiliserai dans mon prochain tableau, mais dont, moi, Venceslas Reybach de Coblentz, peintre breveté de S. A. S. Mgr le prince-évêque, électeur de Trêves, je serai enchanté d'offrir une copie à mes charmants modèles.
Dans ce boniment ampoulé, débité avec emphase, Valleroy n'avait saisi qu'une chose, c'est que Venceslas Reybach était de Coblentz et que, sans doute, il y retournait. Il alla vivement à lui.
—Puisque vous êtes de Coblentz, Monsieur, vous avez entendu peut-être parler du vicomte Armand de Malincourt.
—J'ai fait plus que d'en entendre parler, répliqua Venceslas avec hauteur; je suis son ami comme je suis l'ami de tous les grands seigneurs français émigrés, en résidence sur les bords du Rhin.
—Vous connaissez mon frère, Monsieur? s'écria Bernard d'un mouvement si brusque qu'il réveilla Nina.
—Le vicomte de Malincourt, votre frère!
—Oui, Monsieur, et nous sommes à sa recherche.
—Eh bien! soyez sans inquiétude, je vous conduirai vers lui. Est-ce là votre soeur? ajouta le peintre en désignant Nina qui, tout effarouchée par la soudaineté de son réveil, se réfugiait dans les jupes de tante Isabelle.
—Ce n'est qu'une petite amie, mais je l'aime comme si elle était ma soeur.
Sur cette réponse qui exprimait l'intime et pure pensée de son coeur, Bernard se mit à examiner le vieux Reybach, qui devenait un personnage à ses yeux puisqu'il était l'ami d'Armand, et qui se drapait dans sa défroque comme un paon dans l'auréole de ses plumes étalées, tout fier d'être devenu, grâce à ce petit incident, le point de mire de la curiosité des passagers. Du reste, en dépit de ses allures excentriques et de son costume invraisemblable, c'était le meilleur des hommes. Il eut vite fait d'en convaincre Bernard, tante Isabelle et Valleroy, auxquels, pressé de questions, il parla longuement de Coblentz, des princes frères du roi de France, du vicomte Armand. Bernard apprit ainsi que son frère était attaché, comme officier, à la personne du comte d'Artois, qu'à Coblentz, et partout dans les villes des bords du Rhin, les émigrés étaient si nombreux qu'il n'y avait plus de logements pour les nouveaux arrivants.
—C'est très heureux, dit Reybach à Bernard, que le vicomte de Malincourt soit en état de vous offrir un abri, car je ne sais trop où vous en auriez trouvé un, tant la ville est pleine.
—Mais alors, qu'allons-nous devenir, Nina et moi? demanda tante
Isabelle avec inquiétude.
—Nous ne vous abandonnerons pas, répondit vivement Valleroy.
—Partout où il y aura place pour moi, il y aura place pour Nina et pour vous, Madame, ajouta Bernard.
Venceslas ne voulut pas être en reste et dit à tante Isabelle avec bonne grâce:
—Ma maison n'est pas grande; mais, au besoin, je vous ferai dresser un lit dans mon atelier.
Les heures s'étaient écoulées ainsi. Maintenant, la chaleur s'apaisait et, du fleuve, commençait à monter, autour du bateau, un peu de fraîcheur. Sur le pont, le mouvement des passagers s'accusait dans la confusion de leurs allées et venues, dans le bruit des conversations reprises peu à peu.
—Ma mignonne, dit alors tante Isabelle à Nina, il faut tacher de gagner notre souper. Nous allons donner une séance.
À ces mots, Nina devint très sérieuse. Bernard la vit se recueillir, lever les yeux au ciel avec des airs inspirés et se poser immobile à côté de tante Isabelle. Sur un mot de celle-ci, un homme de l'équipage était descendu dans l'entrepont. Il en revint avec une guitare, que prit tante Isabelle, et dont elle tira quelques accords pour obtenir le silence. La rumeur des conversations tomba aussitôt, un cercle se forma autour des deux femmes, et ce fut dans un calme profond que tante Isabelle éleva la voix.
—Mesdames et Messieurs, dit-elle, je suis comédienne, et je vais avoir l'honneur de vous réciter des vers. Je commencerai par une scène d'Athalie, le chef-d'oeuvre du grand Racine. Mlle Nina, ma nièce et mon élève, me donnera la réplique. Elle sollicitera votre offrande pour elle et pour moi. Je fais appel à votre générosité.
En écoutant ce discours, Bernard sentait son coeur se serrer. Quoi! cette petite Nina, qui venait de le captiver, réduite à ce triste métier! Et tante Isabelle, si douce, si fière, si digne d'être heureuse, obligée d'implorer la charité publique! Cramponné au bras de Valleroy, il les suivait des yeux, secoué par l'émotion, ayant peine à refouler ses larmes, ne sachant s'il devait admirer les infortunées ou les plaindre. Pendant ce temps, tante Isabelle, figurant Athalie, commençait:
—Comment vous nommez-vous?
Et d'une voix douce, grave, ferme, qui paraissait être la voix d'une autre tant elle ressemblait peu à celle que Bernard avait entendue déjà, Nina répondait:
—J'ai nom Éliacin.
—Votre père?
—… Je suis, dit-on, un orphelin…
Et devant les spectateurs attendris, oublieux un moment des misères de l'exil, la scène se déroula dans la beauté radieuse des vers par lesquels ils étaient bercés, comme aux accents d'une musique divine.