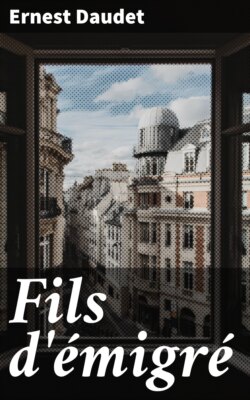Читать книгу Fils d'émigré - Ernest Daudet - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CE QUI SE PASSAIT À SAINT-BASLEMONT EN 1792
ОглавлениеEn juin 1792, à la tombée du jour, dans une chambre du château de Saint-Baslemont, à l'entrée des Vosges, une femme et un enfant sont agenouillés devant un grand crucifix accroché au mur, entre des portraits d'ancêtres. Quoique la femme ait dépassé la première jeunesse, on la devine vieillie par la douleur plus que par l'âge. Ce qui lui reste de beauté resplendit encore sous ses cheveux blonds, dans l'éclat de ses yeux, dans la pureté de ses traits, dans la pâleur de son teint. Habillée d'une robe noire, en laine, sans ornements, toute sa personne, cependant, trahit tant d'élégance hautaine que ce vêtement de deuil la pare à l'égal des habits de cour qu'elle est accoutumée à porter. Elle se nomme la comtesse Louise de Malincourt.
L'enfant est son second fils, Bernard, celui qu'on appelle M. le chevalier. Il a treize ans à peine. Mais, depuis longtemps, il voit autour de lui des visages si tristes, il entend exprimer de si vives alarmes, raconter de si sombres histoires, proférer de si violentes menaces, que son esprit s'est mûri prématurément, et, qu'enfant par l'âge, c'est presque un homme par la pensée. Cette précocité se devine à l'expression inquiète de son regard, à la gravité répandue sur ses traits, au pli contracté de ses lèvres déshabituées du rire. Il est mince et brun, son front haut et large sous la perruque poudrée. Son habit violet, en soie unie, flotte sur les formes de son buste, élégantes quoique un peu grêles, et plus bas que la boucle d'argent qui arrête la culotte au-dessous du genou, la jambe se dessine fine et vigoureuse.
Agenouillé près de sa mère, il s'associe mentalement à la prière qu'elle récite à haute voix.
—Mon Dieu! dit-elle, daignez protéger et soutenir dans leur infortune S. M. Louis XVI, sa famille, les princes ses frères et ses neveux. Je vous implore aussi pour mon mari, pour moi-même, pour mes enfants, surtout pour l'aîné que le service du roi expose, loin de nous, à d'innombrables périls.
Dans l'accent de cette ardente supplication se devinent les angoisses de l'épouse et de la mère. Elles sont cruelles, ces angoisses, cruelles et justifiées par les événements survenus depuis la Révolution: le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille; le 5 octobre de la même année, l'invasion de Versailles et le retour forcé de la famille royale aux Tuileries; en 1790, la fête de la Fédération; en 1791, la tentative avortée de Varennes et l'arrestation du roi fugitif; puis les massacres dans les rues de Paris, le pillage d'un grand nombre de châteaux, la fuite précipitée de plusieurs milliers de nobles, l'arrestation de beaucoup d'autres, l'audace croissante du parti jacobin et de la Commune de Paris. Avec un tel passé, que ne peut-on craindre de l'avenir? Cet avenir, la comtesse de Malincourt, à travers son imagination enfiévrée, le voit troublé, violent et sombre.
Et sa vision n'exagère rien. Ne touche-t-on pas à la journée du 10 août, durant laquelle sera proclamée la déchéance de Louis XVI, et aux journées de septembre, effroyable prologue du 21 janvier et des actes féroces qui suivront? Sans cesse cette vision angoissante la poursuit, lui montre son mari et son fils aîné payant de leur vie leur dévouement à la cause royale. Ne recevant, depuis qu'ils sont partis, que de rares nouvelles, toujours seule avec son fils cadet dans ce grand château où, quoiqu'elle n'ait jamais fait que du bien aux habitants de Saint-Baslemont, elle n'ose se croire en sûreté, elle vit écrasée sous une douleur persistante que les tendres soins de Bernard ne parviennent pas à alléger.
Quand, la prière achevée, elle se lève et va s'asseoir près de la croisée ouverte pour respirer un moment l'air apaisant de cette journée d'été qui finit, des larmes mouillent ses joues.
Bernard s'approche d'elle, se met à ses pieds, les coudes sur ses genoux, les mains croisées, et lui dit:
—Si vous saviez, mère chérie, combien je suis malheureux quand vous pleurez, vous ne pleureriez plus!
Ce reproche affectueux; la rend à elle-même. Elle prend à deux mains la tête de l'enfant, et, l'embrassant passionnément, elle soupire:
—Pardonnez-moi, mon fils. Je voudrais vous offrir toujours un visage souriant. Mais la poussée de mes pleurs est plus forte que ma volonté. Je songe aux malheurs publics, aux malheurs privés, aux nôtres…
—Vous disiez cependant, ma mère, qu'il fallait avoir confiance?
—Oh! je l'ai eue, je l'ai eue longtemps. Même lorsque, l'an dernier, votre frère est parti pour aller rejoindre à Coblentz nos seigneurs les princes, frères du roi, elle ne m'a pas abandonnée. Mais, depuis, tant de catastrophes sont survenues, tant de dangers nous menacent!… Si, du moins, votre père était près de nous…
—Il reviendra, il reviendra bientôt!
—Depuis qu'il est parti, depuis trois mois durant lesquels nous n'avons reçu ni lettres de lui, ni lettres d'Armand, je me suis souvent leurrée du même espoir… Mais on se lasse à la fin!
—Moi, je ne me lasse pas, reprend résolument Bernard. Mon père, vous le savez, a toujours blâmé les émigrés; il a toujours déclaré qu'il ne les imiterait pas, qu'il resterait à Saint-Baslemont, tout prêt à retourner à Paris si le roi faisait appel à son dévouement.
—C'est vrai, dit la comtesse. Quand il est parti pour Coblentz, c'est qu'il voulait voir Armand et mettre un terme à nos inquiétudes. Mais son dessein était de rentrer au plus vite, de reprendre sa place auprès de nous.
—Ayez donc du courage, ma mère. Il fera comme il a dit, et, avant peu, il sera de retour.
—Dieu vous entende, mon fils, et qu'il vous bénisse pour toute la joie que me cause votre tendre sollicitude!
Mme de Malincourt pose de nouveau ses lèvres sur le front de l'enfant, et ils restent ainsi, pressés l'un contre l'autre, immobiles et pensifs, le regard perdu dans le vaste horizon qui se déroule à leurs pieds.
Derrière les Vosges, le soleil décline lentement. À la cime des forêts dont la masse sombre, mouvante comme la mer, s'éclaire, çà et là, de couleurs lumineuses qu'y mettent les toitures de quelques villages, il laisse de longues traînées d'or. Une brise fraîche s'élève, chasse la chaleur, agite les feuilles d'où tombe la poussière qui s'y est amassée depuis le matin. Dans le ciel encore embrasé des feux en train de s'y éteindre, la lune dessine son disque argenté. Tout autour d'elle, de rares étoiles commencent à piquer de leurs pointes étincelantes la blancheur du vide. Une brume empourprée flotte sur les pelouses, caresse les massifs de fleurs, leur dérobe des parfums qu'elle répand ensuite dans l'ombre grandissante. Du fond des prairies qui séparent le parc seigneurial de Saint-Baslemont de la forêt de Relanges, elle a grimpé le long des terrasses étagées qui descendent du château en degrés géants, tout chargés de végétations arborescentes. Maintenant, elle escalade les murailles de l'antique demeure, ses lourdes tours, son faîte ardoisé, sa façade grisâtre, enveloppant comme d'un voile aux tremblantes transparences sa masse altière dressée en avant du village à l'extrémité d'un plateau qui domine la plaine. De tous côtés, à perte de vue, dans l'espace immense compris entre Saint-Baslemont et les coteaux de Darney qui dominent la Saône, dans les vallées, sur les collines, sous les feuillages, ce coin de terre où commencent les Vosges respire tant de paix et de sérénité qu'on ne pourrait croire qu'au delà des régions où règne ce silence auguste éclate une crise tragique.
Cependant, par toute la France, sous l'action des fanatiques et des méchants, la terreur s'est répandue. Elle commence, à travers d'émouvantes péripéties, son oeuvre sanglante. Aux frontières menacées par la coalition des armées étrangères, la guerre se prépare. Dans les campagnes, des châteaux incendiés étalent au soleil leurs ruines fumantes. Dans les villes, persécuteurs et bourreaux marquent la place où fonctionnera la guillotine, et déjà les victimes futures remplissent les prisons. Dans la poussière des routes, la trace des fugitifs que l'on a comptés par milliers depuis trois ans se devine à l'empreinte de leurs pas non encore effacés. Mais à ces agitations des hommes, la nature, comme toujours, demeure indifférente sans cesser d'obéir aux lois immuables qui règlent sa marche, et ce soir-là, comme les autres soirs, le jour, témoin insensible et complice inconscient des crimes qu'a éclairés sa lumière, va se perdre dans la nuit.
Brusquement, un coup discret frappé à la porte de la chambre vient mettre fin à l'étreinte silencieuse de la mère et de l'enfant. Ils se lèvent tous deux.
—Valleroy! s'écrie Bernard.
Celui qu'il nomme ainsi a trente ans. C'est un homme de haute taille, très large d'épaules, avec des yeux bruns qui révèlent une intelligence affinée, des traits à la fois énergiques et doux que couronne une chevelure épaisse et noire, toute crépue. Dans le château, où il est né, il remplit les fonctions d'intendant.
—Je viens rendre compte à Mme la comtesse de l'exécution de ses ordres, dit-il. Je me suis promené cette après-midi par tout le village afin de m'enquérir de l'état des esprits. Je suis entré dans plusieurs maisons, j'ai causé avec leurs habitants; dans la rue, j'ai interrogé les passants, et nulle part je n'ai constaté de défiance. Personne ne se doute de l'absence de M. le comte. On le croit malade, hors d'état de sortir, et on m'a parlé de sa santé avec intérêt.
—Puisse cette croyance durer jusqu'au retour de mon mari, répond la comtesse, et ces braves gens ignorer toujours qu'il est allé à Coblentz!
—En est-il donc parmi eux qui le dénonceraient? demande Bernard.
—Interrogez Valleroy, mon fils.
—La propagande jacobine fait de grands progrès dans nos contrées, dit
Valleroy sans attendre la question de l'enfant; on peut tout craindre.
—Même une trahison de la part de ceux dont mon père a été le bienfaiteur?
—Peut-être de ceux-là, Monsieur le chevalier, non par méchanceté, mais par peur, la peur de se compromettre en cachant la vérité. Heureusement, ils ne la connaissent pas, et, pour cette nuit encore, Mme la comtesse pourra dormir en repos.
Le langage de Valleroy exprime tant de confiance que Mme de Malincourt ne peut contenir l'élan de sa gratitude pour l'honnête serviteur qui s'attache à la rassurer. Elle s'écrie:
—Merci de votre zèle, Valleroy; nous ne perdrons jamais le souvenir des preuves que vous nous en donnez à toute heure.
—Jamais, répète gravement Bernard en mettant sa main petite et fine dans la robuste main de Valleroy.
Très ému, ce dernier s'incline et son geste proteste.
—Valleroy appartient à Malincourt, murmure-t-il.
Et c'est tout. Les quelques paroles qu'il vient d'entendre ont récompensé son dévouement du plus haut prix qu'il ait ambitionné. Il n'en attend rien de plus. Il est tout heureux d'avoir mérité la bienveillante parole de ses maîtres. Pendant cet entretien, les dernières lueurs du jour se sont dissipées; la nuit est venue à grands coups d'ailes. La comtesse et son fils descendent dans la salle à manger pour prendre le repas du soir.
C'est une vaste pièce voûtée, qui s'ouvre sur le parc. Jadis, autour de la table immense, de nombreux convives s'asseyaient gais et bruyants. Alors, tout brillait, tout étincelait, les lumières, les cristaux taillés, l'argenterie massive. Maintenant, sombre est la salle, à peine éclairée par quelques bougies. Les hauts dressoirs sculptés, rangés au long du mur, restent vides, depuis que la crainte d'un pillage a contraint le châtelain à mettre en sûreté les trésors qu'ils contenaient. Sur un bout de la table, deux couverts très simples. Ce n'est pas un domestique portant la riche livrée des seigneurs de Saint-Baslemont qui va servir le souper. C'est Valleroy, qui ne croit pas s'abaisser en se prodiguant pour ses maîtres. Au dedans du château comme au dehors, l'existence quotidienne se déroule sous une impression de terreur, qui en a changé les habitudes et éteint l'éclat. Exposé aux soupçons et à la délation, chacun évite d'attirer l'attention des espions révolutionnaires.
Maintenant, la mère et l'enfant mangent en hâte; ils ne parlent pas, comme s'ils redoutaient que, passant par les croisées largement ouvertes à la brise fraîche du soir, leurs paroles soient entendues au dehors. Valleroy s'applique à marcher sans bruit, pour ne pas troubler le silence qui pèse sur les hommes et sur les choses, traversé seulement par les rumeurs confuses de la nuit, chants d'oiseaux, cris d'insectes, murmures des forêts, qui montent des profondeurs de la vallée. Tout à coup, Mme de Malincourt voit son fils devenir très pâle, se lever et rester debout à sa place, cloué par l'effroi.
—Qu'est-ce donc, Bernard, demande-t-elle.
—Là, là, murmure-t-il en tendant le bras vers l'une des croisées.
La comtesse regarde dans la même direction et ne peut retenir le cri que la peur pousse à ses lèvres. Dans le cadre de la croisée, une ombre vient d'apparaître et se découpe immobile sur le fond des futaies baignées de lumière pâle.
Un peu avant l'heure où, au château de Saint-Baslemont, la comtesse et son fils se mettent à table, un homme a débouché de la forêt de Relanges par l'étroit sentier qui, du fond de Bonneval, conduit au village. Enveloppé, malgré la chaleur, d'un épais manteau à pèlerine, en grossière étoffe de couleur jaunâtre, le visage dissimulé sous les larges bords d'un chapeau brun, en feutre, il marche à pas pressés, enfonçant lourdement, dans la poussière, à chaque enjambée, ses pieds chaussés de gros souliers poudreux, aux semelles hérissées de têtes de clous. À quiconque le verrait passer, il suffirait d'observer son allure pour deviner qu'il ne veut pas être reconnu et qu'à cet effet, il a attendu la nuit et le moment du repas des habitants de Saint-Baslemont pour entrer dans le village. Du reste, il ne fait que le traverser. Au delà de la dernière maison, le chemin monte vers le château. Il le gravit sans ralentir sa marche jusqu'à ce qu'il ait atteint le mur du parc. Là, protégé par l'ombre du mur et des arbres, qui s'allonge sur la route toute blanche sous la lune, il ne peut plus être vu. Il en profite pour reprendre haleine, se découvrir et essuyer son front baigné de sueur. Puis, à la faveur de l'obscurité qui le cache et de la clarté du ciel qui le guide, il s'avance lentement, comme s'il cherchait à s'orienter. Mais ce n'est pas sa route qu'il cherche, c'est une brèche dans la muraille, brèche bien connue de lui. Il l'a vite trouvée et pénètre dans le parc, à travers l'amoncellement des pierres effondrées. Il marche vers le château, conduit par la lumière qui brille aux fenêtres du rez-de-chaussée.
Au fur et à mesure qu'il avance, l'intérieur de la salle à manger, le couvert mis, la comtesse et Bernard assis à table, Valleroy qui les sert prennent corps et se dessinent avec netteté. Son front s'éclaire; au fond de son regard passe un sourire. Sans s'inquiéter de savoir s'il ne sera pas aperçu, il demeure immobile dans le large cadre de la fenêtre ouverte, cloué sur place par l'émotion poignante qui l'étreint! Mais, de l'endroit où il est, il voit soudain Bernard se lever, le désigner à la comtesse et il entend le cri qu'à son aspect pousse celle-ci. Alors, il n'hésite plus et saute d'un bond dans la salle, en disant:
—Soyez sans crainte; c'est moi, Malincourt.
Trois cris simultanément lui répondent:
—Jacques! Mon cher mari!
—Mon père!
—Monsieur le comte!
Les êtres qu'il adore, desquels, depuis trois mois, il vit séparé, se précipitent dans ses bras, l'écrasent sous leurs caresses, tandis que Valleroy ferme les fenêtres et tire les rideaux. Ce n'est, pendant quelques minutes, qu'ardentes effusions, que n'épuisent ni les baisers, ni les étreintes, et qui ne laissent aucune place aux paroles.
—Nous ne vous aurions pas reconnu sous cet accoutrement, mon père, dit enfin Bernard qui, le premier, recouvre le sang-froid.
—C'est bien pour qu'on ne me reconnaisse pas que je l'ai pris, répond
M. de Malincourt.
En même temps, il se débarrasse du manteau qui le couvre, sous lequel il est vêtu comme un paysan, et le jette à Valleroy, dont les yeux sont mouillés de larmes de joie.
—En allant à Coblentz, continue le comte, j'ai couru tant de périls que, instruit par l'expérience, je me suis efforcé de les éviter au retour. J'y ai réussi, puisque me voilà.
—C'est vrai, vous voilà, Jacques! soupire la comtesse dont les traits s'illuminent.
—D'abord, je me suis travesti le mieux que j'ai pu. Puis, la frontière franchie, j'ai fait la route à pied, marchant la nuit, me cachant le jour, ne m'arrêtant pour manger que dans des maisons isolées, évitant, en un mot, d'attirer l'attention. Ce matin, au lever du soleil, j'arrivais aux ruines de Bonneval, bien près de vous, chers aimés; mais, quelque hâte que j'eusse de vous embrasser, j'ai résisté à la tentation et attendu la nuit pour venir vous retrouver. Puisqu'on ne m'a pas su parti, il importait qu'on ne me sût pas revenu. J'espère que mon voyage est resté ignoré.
—On l'ignore encore, répond la comtesse.
—Je m'en suis assuré aujourd'hui même, ajoute Valleroy.
—Alors, Dieu soit loué! reprend M. de Malincourt.
Et comme il est affamé par une longue route, il se met, sans ajouter un mot, à la place que vient de quitter son fils et mange avec avidité. Valleroy lui passe les plats, lui verse à boire, tandis que la comtesse et Bernard, pressés l'un contre l'autre, ne le quittent pas des yeux, affaissés sous le poids de leur soudain bonheur, succédant aux larmes qu'ils répandaient tout à l'heure. Quand elle juge que la faim du cher voyageur est apaisée, la comtesse lui dit:
—Vous ne nous avez pas parlé d'Armand, mon ami. J'espère que vous l'avez trouvé sain et sauf?
—Oui, sain et sauf, et, toujours digne de nous. Le comte d'Artois m'a fait son éloge en ces termes: «Le vicomte de Malincourt connaît son devoir et sait le remplir.» Tous ceux qui m'ont parlé de lui vantent sa courtoisie chevaleresque et son courage. Il fait honneur à notre maison.
—Pauvre cher enfant! soupire la comtesse. Quand le reverrons-nous?
—Plus tôt que vous ne pensez, Louise, car, avant peu, vous serez près de lui.
—Nous quitterions donc Saint-Baslemont?
—Je crois bien qu'il faudra s'y résigner.
—Vous savez, Jacques, que je suis prête à partir avec vous: mais sans vous, non.
Le comte ne proteste pas contre la ferme résolution que trahissent ces paroles.
—Nous reparlerons de ce projet tout à l'heure, se contente-t-il de répondre.
—La situation s'est-elle donc aggravée? demande la comtesse.
—Vous en jugerez quand je vous l'aurai exposée.
Pressée d'entendre les explications auxquelles fait allusion son mari, mais comprenant qu'il ne les lui donnera que lorsqu'il sera seul avec elle, la comtesse change le sujet de l'entretien.
—Vos cheveux ont blanchi, mon cher Jacques, dit-elle.
—Oui; c'est le résultat de mon voyage. Encore un peu, et je passerai pour un vieillard.
—Un vieillard à cinquante-cinq ans! objecte Bernard.
—Qu'importe l'âge, mon fils, si l'on vit plus vite aujourd'hui qu'autrefois?
L'enfant demeure rêveur. Il voudrait pénétrer la pensée de son père. Quant à la comtesse, elle examine son mari, cherchant si les émotions et les fatigues endurées par lui, au cours de l'excursion qu'il vient de faire comme un fugitif et comme un proscrit, n'ont pas causé dans sa personne d'autres dommages que ceux qu'elle vient d'y découvrir. Elle est bientôt rassurée. M. de Malincourt possède toujours au même degré l'élégance de sa jeunesse, sa taille svelte, sa vigoureuse agilité, son énergie physique et morale. Mais, obsédée du désir de s'entretenir librement avec lui, la comtesse dit à son fils:
—L'heure est venue d'aller dormir, Bernard.
—Déjà! quand j'ai à peine vu mon père! s'écrie l'enfant.
—Vous le verrez plus à loisir demain.
Bernard se résigne. Il vient présenter son front aux baisers paternels.
—Rentrez aussi chez vous, Louise, dit alors M. de Malincourt. J'ai diverses instructions à donner à Valleroy. J'irai vous retrouver ensuite.
Mme de Malincourt ne se montre pas moins docile que son fils. Le comte les embrasse tour à tour et les regarde sortir. Puis, quand la porte s'est fermée sur eux, il se tourne vivement vers Valleroy.
—J'ai besoin de toi, mon camarade, fait-il.
Et comme en lui parlant il tend la main, Valleroy la prend, se courbe pour y poser ses lèvres, et, se redressant, répond:
—Je suis à vos ordres, Monsieur, aujourd'hui et toujours.
—C'est que je ne sais si je ne vais pas t'envoyer à la mort, mon pauvre garçon!
—Je tâcherai de vivre pour vous servir. Mais, s'il faut mourir, je mourrai.
—Toi seul peux accomplir la mission dont je vais te charger, continue le comte. Demain, tu partiras pour Paris. Je te laisse maître de décider quelles précautions tu dois prendre pour y arriver sans encombre.
—Monsieur le comte peut s'en fier à moi.
—En y arrivant, tu te rendras à l'hôtel de Malincourt. Tu y pénétreras en veillant à n'être vu de personne, si ce n'est du suisse Kelner à qui j'en ai confié la garde.
—Kelner est un ami. Nous nous comprendrons à demi mot.
—Ecoute-moi bien, maintenant. Tu monteras dans ma chambre. À la tête du lit se trouve un bénitier; derrière le bénitier, un bouton de cuivre, dissimulé sous la tenture; Tu presseras ce bouton et tu découvriras une cachette ménagée dans le mur. Dans cette cachette, il y a un petit coffre en fer qui contient quatre mille louis. Tu me l'apporteras.
—Entendu, Monsieur, et, sauf incident, dans quinze jours je serai rentré à Saint-Baslemont.
—Ce n'est pas à Saint-Baslemont qu'il faudra venir me rejoindre.
—Et où donc, Monsieur?
—À Coblentz.
—C'est donc vrai, s'écrie Valleroy, Monsieur le comte songe à émigrer?
—J'y suis résolu. Oh! ne t'étonne pas, Valleroy. Il y a trois mois, quand je me mettais en route pour l'Allemagne dans l'unique but d'embrasser mon fils et de rapporter de ses nouvelles à sa mère, si quelqu'un m'eût attribué le dessein de vivre hors de France, j'aurais protesté.
—Et vous auriez eu raison, Monsieur. La place des bons Français est en France. Si tant de gentilshommes n'avaient pas émigré, les bandits dont nous subissons le joug ne seraient pas victorieux.
—C'est vrai; mais leur victoire est réalisée. Il en résulte qu'il n'y a plus sûreté dans le royaume pour les familles nobles. Moi-même, qui n'ai rien à me reprocher, j'ai été averti, en traversant Nancy, que le Comité révolutionnaire d'Epinal se propose de réclamer mon arrestation.
—Vous, Monsieur, vous! Que vous reproche-t-on?
—Mon nom, ma naissance, ma fortune, mon vieux dévouement au roi, la présence de mon fils sous l'étendard des princes.
—Alors, vous avez raison; il faut émigrer.
—Nous partirons la nuit prochaine, la comtesse, Bernard et moi. Je me suis procuré des passeports. Je sais quelle route nous devons suivre jusqu'à la frontière pour n'être pas inquiétés. Tandis que tu arriveras à Paris, nous arriverons à Coblentz. C'est là que tu m'apporteras le trésor dont je viens de te révéler l'existence et que je te confie. Sois-en le gardien courageux et vigilant, défends-le au prix même de ta vie, car il ne m'appartient plus; je n'en suis désormais que le dépositaire. Je l'ai offert aux princes frères du roi.
—Vous leur donnez cent mille livres!
—Il le faut bien, puisque leurs ressources sont épuisées.
—Ils peuvent s'en procurer d'autres, tandis que vous…
—Plus un mot, Valleroy, j'ai promis.
—Mais de quoi vivrez-vous dans l'exil, Monsieur? De quoi vivront Mme la comtesse et M. le chevalier?
—Dieu y pourvoira, réplique simplement le comte. Pour toi, ne pense plus maintenant qu'à l'exécution de mes ordres. Va faire tes préparatifs et te reposer, car il importe que tu te mettes en route demain en même temps que nous.
—Je partirai demain et Monsieur le comte peut compter sur moi.
C'est dit d'un ton qui, sous l'invincible dévouement de Valleroy, dissimule mal sa tristesse.
—Tu me désapprouves donc? lui demande M. de Malincourt.
—Vous désapprouver, moi! Je ne l'oserais. Mais, quitter son pays, aller vivre à l'étranger parmi ceux qui s'arment contre la France, au risque d'être confondu avec eux… je vous plains, je nous plains.
—Tu ne seras pas obligé d'y rester. Ta mission remplie, tu pourras revenir ici.
—Non, Monsieur, car ma place est près de vous. Rappelez-vous la vieille devise de mon père, que lui avait léguée le sien: «Valleroy appartient à Malincourt!»
—Si ta place est auprès de moi, la mienne est auprès des princes.
Malincourt appartient aux Bourbons.
Sur ces mots décisifs, Valleroy croit l'entretien terminé. Il va se retirer. Mais le comte le retient.
—Encore un mot, ajoute-t-il. Nous allons courir, l'un et l'autre, de grands périls, Valleroy, toi, pour mon service, moi pour la cause royale et aussi pour mettre en sûreté ma femme et mon fils. Je ne sais ce qu'il adviendra de nous. Mais, quoi qu'il arrive, et si je meurs et si tu me survis, souviens-toi que je remets à ta garde mon fils Bernard, et que, à défaut de son frère, tu dois le protéger jusqu'au jour où il sera devenu un homme.
—Oh! pour cela, Monsieur, la recommandation était inutile. Depuis qu'ont éclaté les tourmentes qui nous emportent Dieu sait où, je me suis dit souvent que si M. le chevalier venait à vous perdre, c'est à moi qu'incomberait la tâche de veiller sur lui. Soyez donc sans crainte, mon noble seigneur: tant que je vivrai, il sera bien gardé!
Cette promesse sincère et généreuse va au coeur de M. de Malincourt. Il ouvre les bras. Valleroy se presse contre lui, et, dans cette étreinte, le maître et le serviteur scellent le solennel engagement que vient de prendre ce dernier.