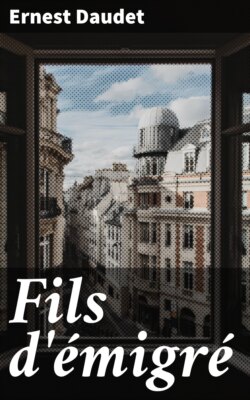Читать книгу Fils d'émigré - Ernest Daudet - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
SUR LE RHIN
ОглавлениеAu lever du soleil, un bateau parti de Bâle et chargé de passagers descendait le Rhin, ses voiles ouvertes, gonflées par la brise. Après avoir dépassé Mayence, il se trouvait maintenant entre Bingen et Coblentz. Le matin était radieux. Sous la fraîcheur de l'air, on sentait pointer la chaleur. Du ciel qui s'embrasait, s'abaissait sur les choses, en les enveloppant, une lumière éblouissante. Aux bords du fleuve, se déroulait un paysage magique. C'étaient, tout au ras de la rive, des bourgs, des vignes, des forêts; au delà, des montagnes boisées, courant parallèlement au Rhin, portant sur leurs flancs ou à leur sommet des châteaux féodaux en ruines, et parfois, accroupies à leur pied, les murailles écroulées de quelque abbaye, percée de fenêtres ogivales qui encadraient, depuis des siècles, les mêmes coins d'azur. Brusquement, à de fréquents intervalles, cette splendeur de nature s'éteignait, dans l'évanouissement des horizons soudain disparus. Au-dessus des berges, des rochers sombres remplaçaient villages, vignobles et futaies. Ils surplombaient le fleuve où se reflétait leur paroi glissante et haute, couronnée de déchiquetures capricieuses, et le bateau, poursuivant sa route, paraissait s'engager dans un défilé sauvage sans lumière et sans issue. Mais bientôt le défilé cessait, et de nouveau le soleil caressait de ses feux la nappe mouvante des eaux s'étalant plus librement dans leur lit élargi.
Pour admirer la grandiose beauté de ce spectacle et goûter le charme infini de ce matin d'été, les passagers, depuis qu'avait commencé à poindre le jour, étaient montés sur le pont, peu à peu. Réunis en groupes, appuyés sur la balustrade en bois qui bordait le bateau, assis sur des bancs, des malles, des tas de câbles enroulés, ils causaient entre eux, en regardant fuir le rivage des deux côtés de l'immense fleuve au courant rapide, ou en se montrant les grands radeaux formés de troncs d'arbres fraîchement coupés, reliés entre eux par des cordes et des clous, et qui s'en allaient, au fil de l'eau, de leur point de départ à leur point d'arrivée.
Dans ces groupes, toutes, les conditions sociales étaient représentées. Il y avait des gentilshommes et des grandes dames que désignaient l'élégance de leurs vêtements et la blancheur de leurs mains; des paysans aux costumes pittoresques et variés, qui trahissaient pour quelques-uns une origine étrangère; des soldats de tous grades, aux uniformes divers, qui n'appartenaient pas tous aux armées de la Confédération germanique, bien qu'on fût en pays allemand; des prêtres en habit noir, reconnaissables à leur petit collet, des moines et des religieuses. Pour la plupart, ils parlaient en français, sans crainte de trahir leur qualité d'émigrés.
Les émigrés, à cette époque, remplissaient l'Allemagne et surtout les contrées du Rhin. On ne pouvait guère voyager sans en rencontrer, dans les villes, sur les routes, aux relais, sur les bateaux, dans les voitures publiques, dans les auberges. Partout ils révélaient leur nationalité par la spirituelle gaieté de leurs propos, par leur courtoisie envers les femmes, par leur générosité s'ils avaient la bourse pleine, et, si elle était à sec, par les bonnes et aimables paroles à l'aide desquelles, à défaut d'argent, ils payaient les services qu'on leur rendait. Les habitants des territoires qu'ils traversaient s'étaient tellement accoutumés à leur présence qu'ils ne la remarquaient plus. Leur rassemblement sur ce bateau, ce matin-là, n'offrait donc qu'une image réduite de ce qui se passait à la même heure, un peu partout, dans les pays suisses et allemands, où, quoique étrangers, ils se considéraient comme chez eux.
Il s'en fallait cependant que, dans cette foule nomade, réunie au hasard des voyages, tous les visages fussent heureux. Même sur ceux où s'affichait l'insouciance et s'épanouissait le rire, il y avait comme un reflet de mélancolie, et, tout au fond du regard, une expression d'inquiétude qui protestait contre la gaieté factice sous laquelle les plus fiers s'efforçaient de cacher leur peine. Comment en eût-il été autrement? D'abord exilés volontaires, les émigrés étaient bientôt devenus des proscrits, par suite des terribles châtiments édictés contre eux par l'Assemblée nationale de France. Cette patrie d'où ils s'étaient enfuis, poussés les uns par la peur, les autres par la colère, ils n'y pouvaient plus rentrer. Tous ou presque tous y avaient laissé des êtres chers, leurs biens, leur fortune, ce qui fait la douceur du sol natal et le charme de la vie. Ces trésors perdus, un ciel étranger ne pouvait les leur rendre; ils étaient condamnés à les pleurer jusqu'au jour où la patrie se rouvrirait devant eux.
Cette intime et cruelle douleur, aucun des passagers réunis sur le bateau allant de Bâle à Coblentz ne paraissait la ressentir au même degré qu'un enfant d'une douzaine d'années, qui affectait de se tenir à l'écart, à l'arrière du bateau, adossé au cabestan, d'où, les yeux fixés devant lui, il semblait suivre, dans le vide, une vision attristante. Son costume était celui d'une condition modeste. Mais la finesse de ses traits, la fierté de son regard, la grâce de sa personne révélaient si clairement la race et la haute éducation, que ses modestes habits en drap noir, où ne se voyaient ni soie, ni broderies, ni dentelles, ni rien de ce qui relevait alors la toilette des nobles, avaient l'air d'un déguisement. À quelque distance de lui, un homme, qu'à sa tenue on pouvait prendre également pour un artisan aisé ou pour un bourgeois de petite ville, ne le perdait pas de vue, tout en respectant son isolement et son silence. À les voir tous deux ainsi, il n'aurait pas fallu une longue observation pour deviner que le plus jeune avait le droit de commander au plus âgé, mais que le plus âgé n'était là que pour veiller sur le plus jeune et le protéger.
Depuis déjà longtemps ils gardaient l'un et l'autre la même attitude, lorsque, tout à coup, l'enfant sortit de sa rêverie, et se tournant vers son compagnon:
—Quand arriverons-nous à Coblentz, Valleroy? demanda-t-il.
Tout en se rapprochant, Valleroy répondit:
—Dans la soirée, Monsieur le chevalier.
—Encore douze heures, soupira Bernard; que c'est long!
—Et ce sera bien plus long encore si vous ne vous armez de résignation et de courage, Monsieur le chevalier; si vous vous obstinez dans votre tristesse, au lieu de vous distraire!
—Me distraire! Est-il donc possible de ne pas songer à mes malheureux parents? Me distraire! Quand ils sont emprisonnés, séparés de leurs enfants, privés de toute consolation!
—Il faut se dire que leur captivité ne durera pas.
—Qu'en sais-tu, Valleroy?
—Il n'est pas d'usage qu'on retienne des innocents sous les verrous.
—Ah! Valleroy, pourquoi m'as-tu emporté? Pourquoi ne m'avoir pas laissé avec eux?
—Parce que j'avais reçu de M. le comte l'ordre de vous sauver. D'ailleurs, même sans ordre, j'aurais agi de même. Nous serions bien avancés si vous étiez en prison! Cela n'eût fait que rendre moins aisée la délivrance de ceux sur qui vous vous hâtez trop de pleurer.
—Tu espères donc les délivrer?
—Oui, certes, je l'espère. Je n'ai cessé d'y penser depuis que nous sommes partis de Saint-Baslemont, Durant l'affreuse nuit témoin de notre fuite, dans la petite voiture qui nous emportait à travers bois, tandis que vous versiez des larmes, moi j'arrêtais les grandes lignes de mon plan. Pendant les quelques heures que nous avons passées à Bâle à attendre le bateau, j'y travaillais encore; j'y ai travaillé depuis, et maintenant je le tiens.
—Parle, parle, mon bon Valleroy, supplia Bernard en entraînant son compagnon plus loin des groupes que formaient les passagers. Confie-le moi, ton plan.
—Oh! il est bien simple. Quand je vous aurai remis à votre frère, à M. le vicomte Armand, je reviendrai sur mes pas; je referai seul le trajet que je fais en ce moment avec vous, et j'irai à Epinal. Là, j'ai des amis, des amis résolus, dévoués, à l'aide desquels je délivrerai M. le comte et Mme la comtesse.
—Comptes-tu forcer les portes de leur prison?
—Je compte acheter leurs geôliers.
—Et tu crois… As-tu de l'argent, seulement?
—Mes économies d'abord, que je portais sur moi quand le malheur est arrivé, puisque, par l'ordre de M. le comte, je me disposais à partir pour Paris.
—Et si tes économies ne suffisent pas?…
—Elles suffiront. Les services des gredins à qui j'aurai affaire ne coûtent pas cher. D'ailleurs, à Epinal on me connaît, j'ai du crédit, et, au besoin, je trouverai à emprunter.
—Mais je ne veux pas que tu y sois du tien…
—Le mien est le vôtre, Monsieur le chevalier. Vous me rembourserez plus tard, si tel est votre bon plaisir.
Bernard prit la main de Valleroy et dit:
—Pourrons-nous reconnaître jamais ce que tu fais pour nous?
—Vous ne me devez rien, Monsieur le chevalier. M. le comte a été mon bienfaiteur, et jamais je ne m'acquitterai envers lui. Et puis, vous le savez, Valleroy appartient à Malincourt.
—Oui, s'écria Bernard, mais si, grâce à toi, mes parents sont sauvés, c'est Malincourt qui appartiendra à Valleroy.
Pendant leur entretien, le soleil qui, tout à l'heure, était encore à son lever, avait poursuivi sa course dans le ciel. Après être sorti de derrière les montagnes qui fermaient l'horizon du côté de l'Orient, il planait maintenant tout en haut du vide immense que ses rayons chauffaient et éclairaient de leurs pointes de feu, en fouillant profondément le paysage. Sous sa lumière vibrante, le vert des arbres et le bleu des eaux étincelaient, chargés de paillettes d'or, que les forêts du rivage envoyaient au fleuve et que le fleuve leur renvoyait. Elles flottaient de toutes parts, ces paillettes lumineuses; elles s'accrochaient aux arbres, se laissaient charrier par les ondes, donnaient aux rochers nus, noyés dans leurs feux, l'aspect de gisements aurifères.
Sur le pont du bateau, on avait tendu des tentes sous lesquelles les passagers cherchaient un abri contre la chaleur. Tous jouissaient de cette matinée vivifiante et saine, si propre à rendre courage et sérénité aux âmes énervées par l'excès des infortunes subies déjà ou redoutées pour un avenir prochain. Les tristesses que la nuit amasse autour des malheureux, en vagues rêves ou en réflexions poignantes, se dissipaient, cédant la place pour quelques heures aux espérances qui soutiennent et consolent, sans lesquelles l'homme serait écrasé sous le poids de ses maux. Bernard lui-même, malgré de légitimes motifs d'angoisses, se sentait allégé, voyait l'avenir moins sombre, revenait à la gaieté de son âge. Oh! le puissant magicien, l'admirable guérisseur de plaies que le divin soleil!