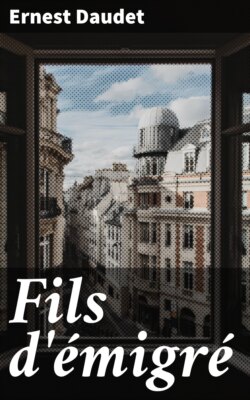Читать книгу Fils d'émigré - Ernest Daudet - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
SUITE DU PRÉCÉDENT
ОглавлениеTandis que M. de Malincourt s'entretenait avec Valleroy, la comtesse, rentrée dans son appartement, attendait impatiente. Rassurée sur le sort de son fils aîné, heureuse du retour de son mari, elle était troublée cependant par le peu qu'elle savait de ses projets. Elle avait hâte de les mieux connaître, et surtout d'en connaître les causes. Elle se disait que si, résolu naguère à ne pas quitter Saint-Baslemont, il avait changé d'avis et voulait maintenant en partir, c'est qu'il ne s'y croyait plus en sûreté; elle tremblait pour des jours qui lui étaient plus chers que les siens.
Afin de tromper son attente, elle présida au coucher de Bernard; elle fit avec lui la prière du soir et ne s'éloigna que lorsqu'elle le vit endormi, après l'avoir tendrement embrassé. Alors, elle revint dans sa chambre. Là, bercée par le silence de la nuit, elle laissa s'en aller librement sa pensée vers les souvenirs d'un passé lointain. Elle se revoyait jeune fille, quand, orpheline et unique héritière de l'antique maison de Saint-Baslemont, elle fut recherchée par le brillant comte de Malincourt, colonel d'un régiment du roi, l'un des favoris de Marie-Antoinette, et alors dans tout l'éclat de sa jeunesse. Devenue sa femme, elle l'adora. Au milieu d'une société sceptique et pervertie, ils donnèrent, le rare exemple d'une fidélité réciproque, qui n'eut d'égale que leur félicité successivement accrue par la naissance des deux enfants devenus la parure et l'orgueil de leur foyer. Elle repassait tous les incidents de sa vie d'épouse et de mère heureuse, ses succès à la cour, sa joie lorsque, à sa demande, la reine accorda à M. de Malincourt un brevet de maréchal de camp, en la nommant elle-même dame d'honneur. Son existence s'était écoulée ainsi sans nuages jusqu'à la Révolution. Alors, autour d'elle, tout s'était assombri, tout était devenu sujet d'angoisses et d'alarmes. Ses amies les plus chères avaient émigré. Elle-même avait dû s'éloigner de la cour, quitter Paris, se réfugier avec son mari et ses enfants au château de Saint-Baslemont où l'attendaient d'autres tristesses. C'est là que, contrainte de se séparer de son fils aîné, elle avait versé d'amères larmes au spectacle des tragiques infortunes de la famille royale et de la noblesse de la France; là qu'elle avait ressenti les angoisses et l'épouvante en voyant s'accroître et s'étendre de toutes parts la puissance inconnue et terrible qui emportait aux abîmes la vieille société française. Et, après avoir jeté un regard doux et attendri sur ce passé mort, douloureusement impressionnée par le présent qu'elle était en train de vivre, elle n'osait interroger l'avenir qu'elle n'entrevoyait qu'à travers un long torrent de sang.
Heureusement, dans le vaste corridor, des pas se firent entendre. Leur bruit sur les dalles coupa court à sa pénible rêverie. C'était son mari qui venait la rejoindre. Elle courut à sa rencontre. Sur le seuil de la porte, brusquement ouverte et vite refermée, elle le reçut dans ses bras.
—Je vous ai fait attendre, mon amie, dit-il, ne m'en veuillez pas. Les instructions que j'étais tenu de donner à Valleroy ne souffraient aucun retard.
Et, sans lui laisser le temps de l'interroger, il lui expliquait pourquoi il avait décidé d'envoyer Valleroy à Paris.
Elle approuva tout ce qu'il avait résolu, tout ce qu'il disait, et surtout le don généreux qu'il avait fait aux princes. Il lui exposa ensuite les motifs pour lesquels il fallait quitter Saint-Baslemont.
—Je me suis convaincu, continua-t-il, que nous n'y sommes plus protégés. On commence à nous surveiller, à tenir sur notre compte des propos malveillants. On a parlé de me dénoncer au Comité révolutionnaire d'Epinal comme entretenant des intelligences avec les émigrés. Si nous demeurions ici plus longtemps, nous y serions arrêtés.
—Oh! partons, partons, s'écria la comtesse.
—Nous partirons demain à la nuit, répondit-il.
—Où irons-nous, Jacques?
—A Coblentz. C'est là qu'est la place de tout bon gentilhomme.
—Mais pourrons-nous y arriver?
—Je l'espère. Durant le voyage que je viens d'accomplir, j'ai constaté que, dans les petites communes comme dans les grandes villes, aux relais, dans les auberges, partout où s'arrêtent les voitures publiques et les chaises de poste des particuliers, les municipalités, excitées par des agents venus de Paris, exercent une surveillance rigoureuse. À chaque arrêt, les voyageurs sont examinés et interrogés par des individus défiants et soupçonneux, devenus les maîtres du pays, disposés à voir dans tout inconnu amené devant eux un royaliste déguisé, un aristocrate, comme ils disent. Tant pis pour celui dont le passeport n'est pas en règle, dont la mine déplaît ou qui perd le sang-froid en répondant aux questions qu'on lui adresse. On le retient jusqu'au jour où le caprice qui l'a fait arrêter lui permet de continuer sa route ou l'envoie en prison comme suspect.
—Mais, alors, comment ferons-nous pour gagner l'Allemagne? demanda la comtesse. Et Valleroy, comment fera-t-il pour gagner Paris?
—Oh! je ne m'inquiète pas de Valleroy. Vous connaissez son courage et sa présence d'esprit. Il est de taille à se dérober aux investigations dangereuses. Et puis, un homme du peuple allant à Paris et voyageant seul ne court pas les mêmes dangers qu'un gentilhomme allant vers la frontière, accompagné d'une femme et d'un enfant. Valleroy saura conjurer ceux qu'il peut redouter. Pour moi, je devais surtout me mettre à même d'éviter ceux qui nous attendent.
—Et vous croyez y avoir réussi?
—Jugez-en, ma chère Louise.
À demi-voix, M. de Malincourt, maintenant, confiait à sa femme les mesures prises pour assurer leur fuite. À une courte distance de Saint-Baslemont et à l'entrée de la forêt, se creusait entre des hauteurs boisées un vallon agreste et mystérieux où existait autrefois un prieuré, le prieuré de Bonneval. De cette antique dépendance de l'abbaye de Relanges, il ne restait plus qu'une chapelle, au milieu de ruines croulantes. Ce site pittoresque où l'on ne passait guère, car on ne pouvait y accéder et on ne pouvait en sortir que par d'étroits sentiers escarpés et sablonneux, perdus sous les arbres, la comtesse le connaissait bien; naguère encore, c'était pour elle un but de promenade. C'est là que, le lendemain. M. de Malincourt devait envoyer, dès le matin, par un homme sûr, une voiture de ferme, légère, juste assez grande pour contenir trois personnes et attelée d'un vigoureux cheval. La nuit venue, les fugitifs quitteraient sans bruit le château pour se rendre à pied au prieuré, où les attendrait leur modeste équipage. De Bonneval à la frontière, la route est longue. Mais le comte, qui venait de la parcourir, savait que sur toute sa longueur elle est côtoyée par des chemins se déroulant à travers bois et montagnes. En suivant cet itinéraire et en évitant les lieux habités, on devait arriver sans encombre au point où sa famille et lui-même seraient hors de danger. Pour le cas où se présenterait quelque obstacle, il s'était procuré, à prix d'argent, des passeports au nom d'un fermier suisse habitant aux environs de Bâle. Un déguisement propre à confirmer la qualité qu'il avait prise devait compléter ces précautions. La comtesse écoutait avec avidité et d'un coeur ferme l'exposé de ce plan. En l'écoutant, elle sentait lui revenir la confiance. Quand s'acheva cette longue veille consacrée à étudier et à combiner les mesures de salut, elle s'endormit apaisée, un ardent espoir dans l'âme, l'espoir d'une délivrance prochaine.
Le lendemain, debout dès l'aube, M. de Malincourt, secondé par Valleroy, s'occupait des préparatifs de leur départ. Il était convenu que Valleroy quitterait Saint-Baslemont à la même heure que lui et marcherait toute la nuit, pour se trouver à Langres dès le matin, au passage du coche qui faisait la route de Nancy à Paris. En même temps, le comte et sa famille se dirigeraient vers Bonneval, où les attendrait la voiture qui devait les conduire à la frontière. Jusqu'au lever du jour, ils pourraient voyager librement, protégés par l'obscurité de la nuit. Lorsqu'à Saint-Baslemont on s'apercevrait de leur fuite, ils seraient déjà loin et hors d'atteinte. Du reste, comme on pouvait compter sur le dévouement des serviteurs, ils reçurent l'ordre de taire le départ des maîtres aussi longtemps qu'il leur serait possible d'en garder le secret. Grâce à tant de multiples précautions, le comte espérait que ses projets s'exécuteraient sans difficulté.
Ces dispositions arrêtées, il était tenu d'en prendre d'autres non moins importantes. En quittant la France, il ne se dissimulait pas que, lorsque son départ serait connu, il deviendrait passible des lois rigoureuses édictées contre les émigrés, qu'il serait condamné à mort et sa tête mise à prix, que ses biens seraient confisqués et vendus au profit de la nation. Ces biens, il ne pouvait les emporter avec lui. Il en avait donc fait le sacrifice, le sacrifice de ses terres, de son château, des richesses mobilières que dix générations y avaient accumulées. Mais il était convaincu que, lorsque, la Révolution finie, il rentrerait en France, la confiscation arbitraire et la vente illégale seraient déclarées nulles et que ses propriétés lui seraient rendues. Il entendait y retrouver alors les objets précieux qu'il était tenu maintenant de laisser derrière lui, les archives de sa maison, les portraits des aïeux, les souvenirs de famille, la vieille argenterie, les diamants de la comtesse. Durant tout le jour, il travailla à enfermer ces trésors dans des coffres, lesquels furent descendus ensuite dans les souterrains du château et enterrés, de telle sorte que les futurs propriétaires de l'antique demeure, qu'ils la démolissent ou la conservassent, ignoreraient toujours que sous ses murailles était cachée une fortune dont ses maîtres légitimes seuls connaissaient l'existence. Cette besogne, commandée par la prudence, s'accomplit sans bruit, sans qu'aucun témoignage extérieur la dénonçât à ceux qui devaient l'ignorer. Quand elle fut terminée, M. de Malincourt alla se montrer aux habitants du village, à l'effet de prévenir leurs soupçons. Il parcourut les rues, entra dans deux ou trois maisons, s'entretint avec diverses personnes. Depuis plusieurs semaines, ces braves gens le croyaient malade et couché. Ils parurent heureux de le revoir, le félicitèrent de sa guérison, le louèrent de n'avoir pas imité d'autres gentilshommes qui s'étaient enfuis depuis les troubles, protestèrent de leur dévouement envers sa famille et envers lui, et lui donnèrent enfin l'assurance qu'au milieu d'eux il était en sûreté. Par malheur, et comme pour démentir ces paroles rassurantes, des hommes étrangers au pays circulaient depuis quelques jours aux environs du château. M. de Malincourt les vit passer et devina en eux des agents Jacobins venus d'Epinal pour le surveiller, pour exciter contre lui ses anciens vassaux. C'en était assez pour justifier ses craintes et fortifier ses résolutions.
Quand il revint au château, la nuit approchait et avec elle le moment du départ. Bernard, à qui dès le matin en avait été confié le secret, guettait le retour de son père, après avoir erré tout le jour dans le parc, comme s'il eût voulu revoir, avant de s'en éloigner les terrains fleuris, les avenues ombreuses, les prairies vertes. Quoique la perspective d'un voyage en pays étranger séduisit son imagination, la tristesse était dans son coeur, au moment de s'éloigner de ce domaine enchanté, son berceau, où si longtemps il avait vécu heureux. Mais cette tristesse, il la dissimulait, et quand son père se pencha sur lui pour l'embrasser, c'est par une caresse presque joyeuse que Bernard lui répondit.
—Allez vous préparer, mon fils, dit M. de Malincourt, et venez me retrouver dans la salle à manger.
Quelques instants après, le père, la mère et l'enfant étaient réunis autour de la table familiale, silencieux, surpris de se voir sous les déguisements qu'ils avaient dû prendre en vue de leur voyage. La comtesse s'était vêtue comme une paysanne. Ses cheveux sans poudre, serrés sur la tête, disparaissaient sous un bonnet de deuil, tel que le portaient alors dans les Vosges les femmes du peuple. À la voir ainsi, personne ne pouvait deviner en elle une grande dame, car seules l'élégance de sa démarche et la blancheur de ses mains l'auraient trahie si elle ne s'était appliquée à les dissimuler. M. de Malincourt avait le costume qu'il portait la veille en arrivant de Coblentz. Quant à Bernard, il était habillé à l'unisson de ses parents.
Le repas fut rapide et silencieux. L'émotion étreignait les poitrines; l'angoisse pesait sur les âmes. Si grave était l'aventure qu'on allait courir! Puis, quand ce fut fini et quand M. de Malincourt eut dit à haute voix une courte prière, il s'adressa à Valleroy qui venait d'entrer, prêt aussi à se mettre en route.
—Fais venir nos gens, mon brave, lui ordonna-t-il. Valleroy ouvrit une porte, et, sur un geste de lui, se présentèrent cinq domestiques, hommes et femmes, les seuls qui, depuis la Révolution, eussent été gardés au château. Serviteurs éprouvés, ils se seraient laissés égorger plutôt que de trahir leurs maîtres, et ceux-ci, qui le savaient, n'avaient pas voulu partir sans leur dire adieu.
—Il faut nous séparer, mes amis, leur dit avec émotion M. de Malincourt. Il le faut, car ici votre seigneur et sa famille sont menacés dans leur liberté et dans leur vie. Nous partons, mais pour peu de temps, je l'espère, et avec l'espoir de vous être bientôt rendus.
Un sanglot lui répondit. Avant qu'il eût pu reprendre la parole, la comtesse, Bernard et lui furent entourés par ces obscurs et fidèles amis de leur maison qui s'inclinaient devant eux, leur baisaient les mains en les baignant de larmes.
—Mes pauvres chers enfants, murmura la comtesse défaillante, épargnez-nous!
En ce moment, au dehors, du côté de la cour d'honneur qui précédait le château, un bruit sourd troubla le silence. On eût dit une marche pesante sur le sol. M. de Malincourt prêta l'oreille.
—N'entends-tu rien, Valleroy? demanda-t-il.
Valleroy écoutait. À son tour il répondit:
—Je n'entends rien, si ce n'est la brise du soir qui se lève.
—Je me trompais, murmura le comte.
Et il reprit à haute voix:
—Madame a raison, mes amis. Ce n'est pas le moment de nous attendrir, et je vous supplie de m'écouter avec le calme que nécessitent les avertissements que je dois vous donner. Je voudrais vous emmener tous avec moi, mais force m'est d'y renoncer. Nous ne pourrions voyager aussi nombreux que nous le sommes sans attirer l'attention, et ce serait notre perte à tous. Je vous laisse donc ici, où votre obscurité vous protège contre les périls auxquels m'exposent ma naissance et mon rang. Si, lorsque je serai parti, le château n'est ni confisqué ni vendu, je vous autorise à y résider. Je souhaite même que vous y demeuriez aussi longtemps que vous le pourrez et que vous en soyez les gardiens. Si vous en êtes chassés, ne vous en éloignez pas et conservez fermement l'espoir d'y rentrer.
—J'y suis né et je veux y mourir, dit le plus âgé des serviteurs.
—Bien, mon brave Chourlot. Ton langage me prouve que je peux compter sur ton énergie et ta fidélité. Alors, écoute-moi, écoutez-moi tous. En mon absence, en l'absence de ma femme et de mes enfants, c'est Valleroy qui commandera sur mes domaines. Mais lorsque, pour me servir, il en sera loin, c'est toi, Chourlot, qui exerceras à sa place mon autorité. Tant que tu n'en seras pas empêché, cultive les terres avec l'aide de tes camarades ici présents; vends les récoltes et partages-en le prix avec eux.
—Je vous le conserverai, Monseigneur.
—Je m'y oppose, et j'entends que les choses s'exécutent ainsi que je viens de l'ordonner. De même, si le château est vendu, efforcez-vous de vous faire engager par les nouveaux propriétaires. Il me sera doux de savoir que vous continuez à vivre à l'ombre des vieilles tours de Saint-Baslemont, plus doux encore de vous y retrouver un jour. Maintenant, mes amis, disons-nous adieu.
Et déjà M. de Malincourt tendait ses mains ouvertes, quand, de nouveau, se fit entendre un bruit au dehors. Mais, cette fois, c'était une rumeur grossissante, une rumeur de foule à laquelle on ne pouvait se méprendre.
—Je ne me trompais pas! s'écria le comte.
Il s'élança vers l'une des croisées donnant sur la cour, souleva les rideaux et regarda. Sous la flamme vacillante et rougeâtre d'une demi-douzaine de torches, un groupe tumultueux s'était formé, au milieu duquel on distinguait des uniformes de gardes nationaux, et s'avançait vers le château.
—Sauvez-vous par le parc, Monsieur, dit vivement Valleroy.
Et il entraîna le comte vers la porte qui s'ouvrait de ce côté, suivi de Mme de Malincourt et de Bernard. Mais, comme ils y arrivaient, des crosses de fusils tombèrent avec fracas sur le sable de la terrasse.
—Les bandits ont cerné la maison, fit Valleroy avec un geste de fureur, et pas une arme pour leur résister!
—Leur résister! objecta le comte. Nous sommes ici quatre hommes valides, et ils sont cinquante.
—Que faire, alors?
—Nous résigner fièrement et sans peur.
Mais ses yeux s'arrêtèrent sur sa femme et sur son fils, qui s'étaient rapprochés de lui.
—Emmène-les, ordonna-t-il à Valleroy. Avec eux, on te laissera passer.
À ces mots, qu'elle entendit, Mme de Malincourt s'empara de son bras.
—Je ne vous quitte pas, Jacques, dit-elle; ma place est auprès de vous.
—Vous vous devez à votre fils, Louise.
—Je me dois d'abord à son père; il le sait.
La parole et le geste révélaient tant d'indomptable volonté que le comte se résigna. Il enveloppa sa femme d'un regard reconnaissant où se trahissaient sa tendresse ardente pour elle et le désespoir où le jetait son impuissance à la défendre. Puis ce regard revint vers Bernard, qui, pressé contre sa mère, portait haut la tête, comme si, dans cette minute critique, il eût voulu élever sa taille d'enfant à la hauteur d'un homme.
—Soit, reprit à voix basse M. de Malincourt. Mais que lui du moins soit sauvé.
Et, s'adressant à Valleroy, il ajouta:
—Souviens-toi de mes recommandations d'hier. Je te le confie. Pars avec lui.
Bernard eut un cri de révolte.
—Je veux rester avec vous, mon père, avec ma mère; je veux vous suivre et partager votre sort.
—Et moi, mon fils, j'exige que vous m'obéissiez et que vous vous éloigniez avec Valleroy.
—Mon père, je vous supplie…
La comtesse l'interrompit d'une voix qu'étranglaient les sanglots.
—Votre père a ordonné, Bernard…
Au même instant, l'enfant se sentit enlevé entre des bras robustes qui paralysèrent ses mouvements, comme l'ordre de son père et la prière de sa mère venaient de paralyser sa volonté. Sur son front renversé tombèrent des larmes et se posèrent des lèvres, tandis qu'à son oreille arrivait, comme une plainte, l'adieu suprême de ses parents auxquels l'arrachait Valleroy.
Il était temps. Par les portes de la vaste salle brusquement ouvertes, des hommes faisaient irruption. Le comte, que cette entrée violente ne détourna pas de la préoccupation paternelle qui le dominait, vit le fidèle Valleroy chargé de son précieux fardeau se jeter de côté pour éviter le choc des arrivants, puis, lorsqu'étant entrés comme un flot tumultueux, ils eurent dégagé la porte du côté du parc, s'élancer dehors et disparaître dans la nuit.
—Ma chère femme, supplia-t-il, de manière à n'être entendu que d'elle, ayez du courage; notre fils est sauvé.
Un éclair de joie traversa le regard de la mère.
—Que Dieu le protège jusqu'au bout! soupira-t-elle. Et, faisant violence à son effroi, elle redressa son front, défiant les nouveaux venus, toujours suspendue au bras de son mari. Ils venaient d'entrer au nombre d'une soixantaine, paysans et gardes nationaux confondus. Les paysans, M. de Malincourt les connaissait tous. Il n'en était pas un, parmi eux, auquel, durant les années de mauvaises récoltes ou au cours des rigoureux hivers, il n'eût tendu la main et porté secours. Quant aux gardes nationaux, étrangers au pays et venus de loin, tout poudreux encore de la poussière des routes, il n'avait jamais vu leur visage pas plus que celui de quelques hommes en haillons et de méchante mine qui s'étaient glissés dans leurs rangs. Après avoir envahi tumultueusement la salle par toutes les portes à la fois, la bande s'était massée dans un coin, tout à coup silencieuse et comme intimidée par le groupe que formaient le comte, la comtesse et leurs serviteurs.
—Que désirez-vous, Messieurs? demanda avec hauteur M. de Malincourt.
Depuis quand envahit-on les maisons des citoyens patriotes?
—Depuis que ces citoyens soi-disant patriotes conspirent contre le peuple.
Le personnage qui venait de prononcer ces paroles sortit de la foule. C'était un homme encore jeune, vêtu d'une carmagnole, coiffé d'un feutre en pain de sucre que décorait une cocarde rouge, et ceint d'une écharpe de même couleur. À sa démarche, à son attitude, on le devinait investi d'une autorité quelconque et chargé de commander aux autres.
—Votre nom, Monsieur! reprit le comte; vos titres, vos qualités?
L'individu se campa non sans arrogance devant le gentilhomme assez téméraire pour l'interroger.
—Mon nom, dit-il: Joseph Moulette, surnommé Curtius Scoevola; mes titres et qualités: membre de la municipalité d'Epinal, délégué par l'accusateur public de cette ville pour procéder à une visite domiciliaire dans ce château et à ton arrestation, Monsieur le ci-devant comte.
—On n'arrête que les coupables. De quoi m'accuse-t-on?
—Je ne suis pas chargé de te le dire, citoyen, et tu t'en expliqueras avec ceux qui m'ont envoyé. Je me figure cependant que, comme la plupart de tes pareils, tu es prévenu de communication avec les ennemis du dehors et du dedans et peut-être aussi d'émigration.
—Prévenu d'émigration quand vous me trouvez chez moi, au milieu de ma famille! s'écria M. de Malincourt. Il y a ici des braves gens qui me connaissent et m'ont vu depuis de longs mois. Qu'ils disent si j'ai émigré!
Du regard comme du geste, il semblait prendre à témoin ses anciens vassaux de la vérité de sa protestation. L'appel qu'il adressait à leurs souvenirs fut entendu. Il put même croire qu'ils étaient disposés à le défendre, car plusieurs voix s'élevèrent en sa faveur.
—Tout le monde à Saint-Baslemont peut affirmer que le citoyen n'a pas émigré, dit l'une d'elles.
—Depuis longtemps il était malade, dans son lit, hors d'état de voyager, dit une autre.
—Il a toujours été bon et compatissant pour les pauvres gens, ajouta une troisième.
—On ne peut l'arrêter, reprirent-elles en choeur, et déjà menaçantes.
Mais, d'un signe, Curtius Scoevola ordonna aux gardes nationaux disséminés dans la foule de se rapprocher de lui, et d'un ton de commandement il cria:
—Silence, et que nul de vous ne s'avise de résister à la loi, s'il ne veut tâter de la prison d'Epinal. J'ai ordre d'emmener le citoyen, et cet ordre je l'exécuterai. Qu'on se le tienne pour dit. Je pourrais borner là mes explications. Mais je veux bien vous en donner de plus complètes, ne serait-ce qu'afin de vous montrer jusqu'où peut aller la perfidie des aristocrates. Celui-ci vous a trompés, braves gens. Alors qu'on vous faisait croire que la maladie le clouait sur sa couche, il était à Coblentz. Il peut nier devant vous. Mais niera-t-il encore quand on le mettra en présence de ceux qui l'ont vu dans cette ville, au café des Trois-Couronnes, assis à la même table que les émigrés et en train de conspirer avec eux?
L'éloquent Curtius s'arrêta pour reprendre haleine et juger de l'effet de ses révélations. Cet effet était tel qu'il, le souhaitait. Se voyant trahi, et répugnant à un mensonge qu'il sentait inutile, devinant à l'attitude des gens de Saint-Baslemont leur surprise et comme un commencement d'irritation, M. de Malincourt se taisait.
—Il ne proteste pas, continua Joseph Moulette, dit Curtius Scoevola; il n'ose protester, et son silence est un aveu.
—Je suis allé à Coblentz avec l'intention d'en revenir, objecta simplement le comte, et j'en suis revenu.
—Avec le dessein d'y retourner, car tu allais partir, à preuve ce déguisement et celui de la citoyenne ton épouse. Depuis quand les riches seigneurs accoutumés au velours et à la soie revêtent-ils la laine et la bure, si ce n'est dans de méchants desseins? Tu déclares n'avoir pas émigré en fait, soit; mais tu as émigré d'intention, et c'est tout comme. Si j'étais arrivé une heure plus tard, j'aurais trouvé la maison vide, avoue-le.
—Eh bien! oui, je l'avoue, s'écria fièrement M. de Malincourt; c'est trop s'abaisser que de mentir. Je fuyais, non seulement pour sauver ma liberté et ma vie, la vie et la liberté de ma famille, mais encore pour ne pas rester dans un pays où l'innocence est persécutée et le crime triomphant.
Joseph Moulette souriait dédaigneusement.
—Vous l'avez entendu, mes amis, dit-il; non content d'avouer, il blasphème. Pensez-vous encore qu'il n'a pas mérité la rigueur des lois?
Et comme personne ne répondait, il ajouta en s'adressant à M. de
Malincourt:
—Citoyen, en vertu des ordres dont je suis porteur et au nom de la loi, je t'arrête. Dans deux heures, nous partirons pour Epinal.
À ce moment, Mme de Malincourt intervint.
—J'espère, Monsieur, que vous me permettrez de partir avec lui, fit-elle.
—C'est que je n'ai pas reçu d'instructions à ton sujet, citoyenne!
—Vous êtes donc libre d'agir à votre gré, et vous ne serez pas assez cruel pour me séparer de mon mari. S'il est coupable, je ne le suis pas moins.
—C'est vrai, ce que tu dis là. Eh bien, c'est entendu, je t'arrête aussi. Si vous avez tous deux quelques dispositions à prendre, je vous autorise à y consacrer le temps qui vous reste avant le départ. Quant à moi, je vais opérer une perquisition dans vos papiers.
Il donna un ordre aux gardes nationaux qui l'entouraient, et ceux-ci firent évacuer la salle, où bientôt le comte et la comtesse se trouvèrent seuls, gardés à vue, après avoir vu sortir lentement et tête basse leurs fidèles serviteurs impuissants à les sauver.
—Nous sommes perdus! dit alors M. de Malincourt.
—Qu'importe! répondit sa femme, si jusqu'à la fin on ne nous sépare pas.
—Mais nos enfants, Louise?
—Dieu veillera sur eux, répondit-elle.
Quelques heures plus tard, deux voitures sortaient du château de Saint-Baslemont, remis à la garde de la municipalité. Elles emportaient vers Epinal les prisonniers et leur escorte, tandis que, non loin de là, au prieuré de Bonneval, se mettait en route, s'en allant vers l'inconnu, sous la conduite de Valleroy, un enfant qui pleurait.