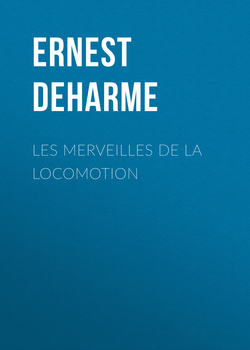Читать книгу Les Merveilles de la Locomotion - Ernest Deharme - Страница 5
CHAPITRE PREMIER
II. – DE LA LOCOMOTION SUR L'EAU
ОглавлениеLa feuille, la branche, le tronc d'arbre et le bateau. – Rivières, fleuves, canaux, lacs, mers, océan. – Les ondulations. Les marées, les courants et les vents. – Les vagues, la tempête et les navires transatlantiques. – Le réseau des voies navigables en France
La sécurité de la locomotion sur le sol, sur cette terre, qui est notre élément, cesse au moment où nous l'abandonnons pour nous lancer sur l'eau. Nous n'avons plus cette base ferme et solide sur laquelle nos pieds, malgré leur faible étendue, trouvaient un appui suffisant, et, pour nous soutenir sur l'eau, nous devons nous développer de tout notre corps et fournir la plus grande surface possible.
Encore ne nous éloignons-nous jamais du rivage auquel nos forces épuisées nous rappellent bientôt. Pour tenter de longs voyages, nous devons emprunter un véhicule et nous demandons à nos bras, au flot lui-même, au vent, à la vapeur, enfin, un secours indispensable. Il est impossible de dire, avec Gessner, quel fut le «premier navigateur.» Le premier homme qui tenta l'aventure vit-il une feuille tombée dans l'eau, emportée par le vent, ou bien une branche, un roseau peut-être, ou un tronc d'arbre entraîné par un courant, et l'idée lui vint-elle de faire comme la fourmi sur la feuille ou l'oiseau sur la branche? On ne sait; mais bientôt il creusa l'arbre pour le rendre plus léger, se fit une voile d'un morceau de toile, imagina la rame et le gouvernail.
Qui saurait dire ce que le sombre gouffre a englouti de victimes et de combien de vies a été payé chaque progrès accompli dans l'art de la navigation!
Les rivières, les fleuves et encore moins les canaux n'offrent, eu égard à leur faible largeur et à leur faible profondeur, aucun danger sérieux dont la navigation ne se soit rendue maîtresse depuis longtemps. Un cours plus ou moins rapide, un lit plus ou moins profond, pas plus de vent que sur la terre et un abordage presque toujours facile à tout moment du parcours, telles sont les conditions générales de la navigation fluviale, qui n'a d'autre inconvénient que sa lenteur; telles sont aussi les conditions de la navigation sur les lacs, à cela près que, sur quelques-uns d'entre eux, le vent soulève parfois des bourrasques, devant lesquelles les légères embarcations doivent fuir et regagner la rive.
Mais, il en est tout autrement de cette grande étendue d'eau salée qui couvre les trois quarts de notre globe, de l'Océan et des mers secondaires.
Combien diffère du sol qui conserve la trace éternelle des travaux de l'homme, cette masse liquide incessamment mobile, incessamment agitée, plissée d'ondulations que le moindre zéphyr gonfle, grossit, et que le vent grandissant fait éclater en tempêtes, vaste champ d'observations que l'homme ne connaît pas encore, vaste corps insondé dont les savants n'ont pu mesurer encore les capricieuses pulsations!
Le problème, que nous avons indiqué, de la recherche des lois du frottement entre deux corps solides, problème dont la solution dernière n'a pas encore été donnée, paraît bien simple à côté de celui du déplacement d'un corps solide à la surface des eaux. Les plus grands géomètres ont cherché à le résoudre: Newton, Lagrange, Laplace, Cauchy, Airy, Fronde, Macquorne Rankine, etc.; et cette question, si elle a été quelque peu éclaircie, ne laisse pas que d'être encore enveloppée de ténèbres épaisses.
Une pierre jetée dans l'eau donne naissance à des courbes dessinant à sa surface des cercles concentriques d'un rayon croissant. L'eau paraît fuir le centre frappé, et pourtant elle ne se déplace pas. Ce phénomène n'est autre que celui qu'on produit avec une corde étendue sur le sol, puis relevée et abaissée brusquement. Les divers points de la corde montent et descendent et, l'action cessant, reprennent sensiblement leur position première. Les cercles concentriques, qui se sont produits sur l'eau, sont le résultat de l'incompressibilité du liquide, de son inélasticité. Comprimées par la chute de la pierre, les molécules aqueuses, placées sous celle-ci, ont soulevé celles qui étaient à l'entour en un cercle saillant. Celles-ci, s'abaissant en vertu de leur poids, ont déterminé la formation d'un second cercle, celui-ci d'un troisième et ainsi de suite; les saillies diminuant, les intervalles augmentant, les ondulations se sont éteintes et, après une série d'oscillations, le calme s'est rétabli.
Quelles sont les lois de ces ondulations dues à la chute d'un corps dans l'eau, dues aussi à la progression d'un corps solide à sa surface?
Il n'y a que trouble dans l'esprit des savants sur la nature, la direction et l'amplitude du mouvement moléculaire dans l'ondulation.
Ils sont à peu près d'accord sur ce fait: que la direction du mouvement est verticale ou sensiblement verticale; mais sur ce point seul ils s'entendent.
Indépendamment de ces mouvements que prend la masse liquide sous l'action du navire qui progresse à sa surface, il s'en produit encore d'autres qui sont dus aux attractions de la lune et du soleil combinées, au mouvement de rotation de la terre, aux différences de densité résultant des différences de température et de salure des eaux, enfin aux courants et aux vents.
Le soleil et la lune exercent sur les eaux une attraction d'autant plus sensible que l'étendue des mers est plus considérable. Telle est la cause du phénomène des marées.
La surface des mers se trouve, dans son immense étendue, soumise à des différences de température, – élévation dans les régions équatoriales, abaissement dans les régions tropicales, – à des différences de salure qui déterminent des différences de densité. L'équilibre cesse tous les jours d'exister dans la masse des eaux, les mêmes causes amenant les mêmes variations de densité. Les parties les plus denses gagnent l'équateur, sous l'influence du mouvement de rotation de la terre; les parties les moins denses ou les plus légères se dirigent, au contraire, vers les pôles, où elles se refroidissent de nouveau.
La masse d'air, qui règne au-dessus des mers, est soumise aux mêmes causes de perturbation que celle des eaux. L'air enlève des quantités de vapeur considérables, qui gagnent les parties supérieures de l'atmosphère où elles se condensent. Les mêmes variations de densité déterminent, à des degrés divers, les mêmes mouvements dans la masse gazeuse et donnent naissance aux vents, d'intensité et de direction fixes ou variables.
Ainsi donc, trois causes, incessamment renaissantes, troublent la surface des eaux: les marées, les courants et les vents.
Les marées ne produisent d'action sensible sur la navigation que dans le voisinage des côtes et passent inaperçues au milieu de l'Océan. Les marins doivent cependant avoir égard aux mouvements d'élévation et d'abaissement des eaux qui se produisent dans certaines mers. «La Manche et la mer du Nord se vident et se remplissent. L'Adriatique subit une différence de niveau à laquelle la Méditerranée semble ne participer que faiblement. La mer Rouge subit des différences de niveau de un à deux mètres, et dans le golfe Persique ces différences sont beaucoup plus fortes2.»
Les courants, aussi bien que les vents, sont des auxiliaires ou des entraves pour la navigation. Aussi, les navires à voile, qui se rendent dans certains pays, ont-ils soin de faire coïncider l'époque de leur voyage avec celle des courants et des vents favorables dans les mers qu'ils doivent parcourir. C'est ainsi, par exemple, que les navires à voile parcourant la mer Rouge, allant de Suez aux Indes, exécutent ce voyage entre avril et mi-septembre, – période durant laquelle soufflent les vents du nord, – et reviennent du détroit de Bab-el-Mandeb à Suez entre octobre et avril, époque à laquelle les vents ont changé de direction et soufflent du sud.
La vitesse des courants généraux varie, en mer, entre 0m,25 et 0m,75 par seconde; les courants locaux, dus aux marées, dépassent rarement 2m,00. En certains points, cependant, cette vitesse peut atteindre 5m,00 par seconde.
Mais la principale cause d'agitation de la mer est l'action du vent, dont l'intensité varie depuis la brise jusqu'à l'ouragan, depuis une vitesse nulle jusqu'à 45 mètres par seconde et peut exercer, dans cet intervalle, des pressions variables de 0 à 277 kilogram. par mètre carré; c'est alors l'ouragan qui déracine les arbres et renverse les édifices, et les navires doivent le fuir.
Jusqu'à quelle profondeur s'étend cette agitation de la mer sous l'action du vent? On ne sait. La vie animale se maintient à 160 mètres. L'extraction du fond de la mer de tronçons de câbles sous-marins a prouvé qu'elle avait lieu à 2,000 et 3,000 mètres, mais il est peu probable que l'agitation de la mer atteigne ces grandes profondeurs et on doit plutôt attribuer les mouvements qui ont été constatés, à des différences de densité dont la fonction est de maintenir un équilibre de composition, une homogénéité constante entre les diverses parties des océans.
L'agitation de la mer se traduit à sa surface par la formation des ondulations que, dans le langage ordinaire, on nomme des vagues. Tant que le vent reste faible, les vagues sont peu accusées, et il ne se produit qu'un phénomène de soulèvement et d'abaissement alternatifs de la surface liquide, phénomène absolument semblable à celui que l'on constate, au moment de la moisson, à la surface d'un grand champ de blé; les épis s'inclinent, se relèvent, puis s'inclinent encore et se relèvent de nouveau, par zones plus ou moins étendues; les oscillations se succèdent à intervalles plus rapprochés, quand la violence du vent augmente; les épis semblent fuir et cependant restent fixés au sol. Il faut une tempête violente pour les en arracher et les transporter au loin. De même, quand sur la mer les ondulations grandissent et les vagues s'élèvent, le vent qui frappe leur crête, la brise et la rejette en une volute d'écume sur le flanc de la vague. Il y a, dans ce cas, un réel mouvement de translation.
Les vagues ne sont pas, d'ailleurs, ces montagnes liquides qu'a cru voir une imagination trop vive au fort de la tempête. Les navigateurs les plus expérimentés, dont les observations méritent le plus de créance, n'ont pas constaté de hauteurs supérieures à 15 mètres. C'est le quart du chiffre indiqué, d'une manière approximative, par certaines personnes dont les yeux seuls ont servi d'instrument de mesure. Les dangers auxquels on est exposé au milieu d'une tempête, sont assez nombreux pour qu'on cherche à détruire les préjugés que l'ignorance ou la frayeur fait naître.
Il ne faut pas juger non plus des secousses que ces vagues peuvent produire sur la coque d'un bâtiment, par les effets qui résultent de leur choc contre les falaises, les jetées ou les murs de quais, obstacles immobiles opposés à la fureur de la mer. Sous un effort trop violent, le bâtiment s'incline, puis, l'effort cessant, se redresse. Mais si la falaise est de roche peu résistante, si le mur n'est pas fait de bons matériaux, reliés par le meilleur mortier, s'il n'est pas suffisamment épais, la vague l'ébranle et bientôt le détruit.
La seule condition à remplir pour que le navire résiste, c'est qu'il constitue une masse parfaitement indéformable et de dimensions assez grandes pour rester insensible aux agitations de l'Océan. Ces dimensions sont celles des bâtiments qui font aujourd'hui le service de l'Amérique et de l'Australie.
Résumons les quelques indications qui précèdent:
L'immense plaine nue de l'Océan est la carrière libre des vents, et les véhicules ou les navires qui se lancent à sa surface n'ont ni un sol solide comme appui, ni une atmosphère calme comme milieu; instabilité constante au-dessous, instabilité constante au-dessus, toutes deux indissolublement unies, mais non pas sans limites dans leurs ébranlements et dans leurs fureurs.
L'homme a su les maîtriser, et l'expérience l'a plus servi dans la lutte que ses calculs, car c'est à peine s'il a entrevu la vérité et pénétré l'un des innombrables mystères qui se passent au sein des eaux.
Peut-on chiffrer l'importance des moyens de communications maritimes offerts à l'activité des nations?
La mer appartient à tous les peuples, et on peut dire que sa surface, presque tout entière, est ouverte à leur commerce et à leur industrie.
Le réseau des voies navigables intérieures qui sillonnent notre pays, comprend:
Soit, en totalité, 12,300 kilomètres.
2
Flachat.