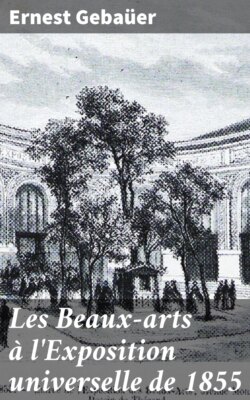Читать книгу Les Beaux-arts à l'Exposition universelle de 1855 - Ernest Gebaüer - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCTION
ОглавлениеTable des matières
Nous voici en présence d’une exposition artistique jusqu’à ce jour sans précédents dans l’histoire des nations, et qui ne se reproduira sans doute pas en France d’ici à un certain nombre d’années.
La France, qui s’était laissée devancer par l’Angleterre et les États-Unis dans la réalisation d’une Exposition universelle de l’industrie, a voulu être la première qui fit appel aux beaux-arts de tous les pays.
L’idée est heureuse de réunir ainsi les arts qui assurent la prospérité d’une nation et les arts qui en sont la gloire, de placer en regard de la charrue qui épargne à l’homme un travail pénible et nourrit son corps, le tableau qui élève son esprit et charme son intelligence.
Plus les nations se perfectionnent, plus l’éducation des individus grandit et se complète, plus le goût des arts se répand parmi les masses. Ce qui n’était que le luxe des riches devient le besoin des plus humbles, et peu à peu le vulgaire lui-même se forme un jugement sain et intelligent.
On a donc bien fait, à ce point de vue, de décréter la réunion de tous les chefs-d’œuvre de l’art dans la capitale du monde civilisé.
Cette réunion, la France était en droit de la provoquer, plus qu’aucune autre nation, car si les pays voisins ont tenu jadis, à tour de rôle, le sceptre de la royauté artistique, personne ne peut aujourd’hui contester notre suprématie à cet égard.
Au commencement du seizième siècle, où la classification des écoles a lieu pour la première fois, l’école flamande apparaît comme la plus ancienne de toutes.
La peinture à l’huile, inventée au quinzième siècle par le flamand Jan Van Eyck, et destinée à remplacer la peinture à la cire et la peinture à la détrempe, se propage en Italie, ce pays favorisé qui possède dans le même siècle Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël, Giorgion, Titien et le Corrège.
L’Italie règne donc, de par le génie de ses peintres. Mais François 1er, noblement jaloux de cette supériorité, attire à lui ces talents remarquables, et Léonard de Vinci, comblé d’honneurs, accompagne en France le roi protecteur des arts.
Raphaël et Michel-Ange, qui ne peuvent quitter Rome, nous envoient leurs chefs-d’œuvre. Enfin André del Sarto, le Rosso, le Primatice abandonnent l’Italie, et, suivis de leurs élèves, viennent décorer le palais de Fontainebleau.
L’école flamande remplace l’école italienne, et les Rubens, les Rembrandt, les Van Dyck, les Philippe de Champagne, les David Téniers, font succéder le genre réaliste au genre esthétique de la peinture italienne.
L’école française prend date au commencement du dix-septième siècle. Les premiers artistes qu’elle enfante se nomment Simon Vouet, Blanchard, Poussin.
En 1648, l’Académie de peinture est fondée en principe. Elle existe réellement en 1655 et de ses premiers concours sortent Claude Lorrain, Stella, Valentin Lahyre, Le Sueur, Le Brun, Mignard, Dufresnoy, Jouvenet, Coypel et Largillière.
Viennent ensuite Watteau et ses pastorales, Vanloo et ses soldats, Boucher et ses amours.
Greuze essaie de réformer un genre arrivé aux dernières limites de l’afféterie et de la prétention. Ses efforts ne sont pas couronnés d’un plein succès.
Joseph Vernet, Vien et Doyen demeurent eux-mêmes dans le genre qu’ils entreprennent. Dessinateurs habiles, peintres éminents, ils transmettent les saines doctrines à David, qui les outre et tente un retour vers l’antique. Constamment préoccupé de la pureté des lignes, David transporte, pour ainsi dire, la statuaire dans la peinture, et sacrifie trop la couleur au dessin. L’accessoire devient avec lui le principal, et sa pureté se change souvent en sécheresse.
Prud’hon, Girodet, quoique de l’école de David, évitent l’écueil contre lequel s’est heurté le talent de leur maître.
Enfin, Gros et surtout Géricault apportent dans la composition et le rendu de leurs tableaux une fougue à laquelle on n’était plus accoutumé depuis longtemps.
A une époque tout à fait moderne, les arts qui, même à leur insu, subissent toujours le contre-coup des révolutions, les arts ont vu combattre dans l’arène les artistes épris de la forme, et les artistes amoureux du coloris, les idéalistes et les positivistes, les spiritualistes et les réalistes, bref ce qu’on a désigné en littérature sous le nom de classiques et de romantiques.
Qui des uns ou des autres a mérité le prix du tournoi. Cette question n’est pas encore tranchée. Le sera-t-elle jamais? Si la solution d’un tel problème est possible, elle aura lieu à la suite de notre Exposition universelle où les deux écoles qui divisent l’opinion en France depuis trente ans, sont représentées par leurs maîtres les plus fameux et leurs productions les plus célèbres.
Le jury d’admission s’est montré animé vis-à-vis des artistes et de leurs œuvres d’un sentiment d’éclectisme qu’on ne saurait trop louer. Nul parti pris d’exclusion, nulle antipathie pour aucun de ces genres divers qui invoquent la publicité et qui rêvent le succès.
On pourra donc prononcer avec toute connaissance de cause en ce qui concerne le génie pictural de la France.
Un pareil jugement sera possible pour l’Angleterre dont les envois sont nombreux.
La Belgique, l’Espagne et la Prusse ne sont pas restées en arrière et nous permettent d’établir d’intéressantes comparaisons entre leurs œuvres et les nôtres.
Tandis qu’une réaction de l’idée vers la matière se produit en France depuis vingt ans, un mouvement en sens inverse s’opère en Allemagne, où la contemplation de la réalité le cède à la poursuite de l’idéal. Une renaissance véritable a lieu, assure-t-on, dans l’école flamande et l’école allemande qui cherchent à se montrer dignes de leur glorieux passé.
Nous regrettons que dans ces circonstances l’école de Dusseldorff, une des premières d’Allemagne, ne soit pas représentée à l’Exposition universelle. Nous déplorons l’abstention d’artistes tels que Lessing, Lohn, Dejer, Jourdan et Comphausen, mais le motif qui les a poussés à cette abstention nous semble trop légitime pour que nous puissions les condamner. Ces artistes demandaient simplement à élire eux-mêmes le jury chargé de l’examen de leurs œuvres; le gouvernement prussien ayant voulu leur imposer des juges de son choix, ils ont refusé de se soumettre aux décisions de ce jury.
Avant de commencer l’analyse de toutes les œuvres que renferme l’Exposition, nous citerons quelques chiffres relatifs à la quantité de tableaux envoyés par les différentes nations, et au nombre d’artistes qui ont concouru à leur exécution.
L’Autriche est représentée par 50 artistes et 107 ouvrages.
Le grand-duché de Bade, le Danemark, les Deux-Siciles, les Etats pontificaux, les Etats-Unis, la Sardaigne, la Saxe, la Suède, la Norvège, le Portugal et le royaume de Wurtemberg figurent ensemble pour un total de 99 artistes et 488 ouvrages.
Le Pérou compte deux exposants, — qui tous deux résident à Paris. —
La Turquie ne possède qu’un seul artiste et et un seul ouvrage.
108 artistes, au nombre desquels MM. Leys, Stevens, Van Schaendel, Robbe, Roffiaen, qui tous ont obtenu des récompenses à Paris dans nos précédentes Expositions, représentent la Belgique.
78 artistes représentent la Prusse. A la tête de ces artistes plaçons bien vite MM. Cornélius et Kaulbach, les deux plus grandes gloires modernes de l’Allemagne. Ils n’ont pu malheureusement nous envoyer que les cartons des peintures à fresque exécutées par eux à Berlin.
La Bavière expose 65 ouvrages émanés de 31 artistes.
Les Pays-Bas fournissent un contingent de 95 ouvrages peints par 57 artistes.
L’Espagne a 69 tableaux de 26 artistes différents.
La Suisse a 97 ouvrages dus à 38 artistes.
La Grande-Bretagne ne compte pas moins de 231 tableaux à l’huile exécutés par 99 artistes, parmi lesquels il faut citer en première ligne Landseer et Mulready, et 143 aquarelles dues à 49 peintres, dont les plus connus sont Fielding, Hunt, Lewis et sir W. Ross.
Enfin la France a envoyé à l’Exposition 1,822 ouvrages composés par 690 de ses artistes.
On voit par ce chiffre respectable que nous sommes bien chez nous, et que nous n’avons pas craint de paraître indiscrets en demandant l’hospitalité pour une pareille quantité de tableaux.
C’est que depuis trente ans l’art ne s’est pas arrêté en France. Nous avons beaucoup produit, et nous tenons, en déployant toutes nos richesses, à prouver que notre réputation artistique n’est point surfaite.
M. Ingres occupe à lui seul une salle entière, dans laquelle on distingue entre autres œuvres remarquables, le Vœu de Louis XIII, la Chapelle Sixtine, l’Odalisque couchée, l’Apothéose d’Homère et le Portrait de M. Berlin aîné.
Dans la salle consacrée à M. Decamps brillent la Défaite des Cimbres, le Boucher turc, les Singes, un Chenil, la Halte de cavaliers arabes, le Singe peintre, l’Histoire de Samson, en 9 dessins, que tous nous avons admirés en 1845, et que personne de nous n’a oubliés; enfin la Sortie de l’Ecole turque.
M. Horace Vernet étale ses meilleurs tableaux de batailles dans une salle qui lui est également réservée.
M. Delacroix nous appelle de nouveau à juger plus de 30 toiles, à propos desquelles bien des controverses ont eu lieu déjà.
M. Lehmann expose 21 tableaux, la partie la plus importante de son œuvre.
M. Couture a, pour quelques mois, dépouillé le Luxembourg de ses Romains de la décadence.
M. Muller nous offre deux grandes toiles, l’Appel des dernières victimes de la Terreur et la Rentrée dans Paris, le 50 mars 1814, des blessés français et des prisonniers russes.
Mlle Rosa Bonheur n’est représentée que par un tableau et ce n’est pas le Marché aux chevaux.
Enfin M. Meissonnier, qui n’exige pas beaucoup de place, a fait choix, dans sa collection, de neuf petites compositions.
Que si, maintenant, vous nous demandez comment nous pourrons, nous qui ne sommes pas peintre, juger l’œuvre de tous ces maîtres, nous vous répondrons par cette citation d’un auteur assez connu, mais digne assurément de l’être davantage, M. Auguste Guyard, l’auteur des Quintessences;
«En général, les hommes spéciaux sont les » plus mauvais juges de leur spécialité.....
» L’homme spécial est ordinairement borné,
» instinctivement jaloux et partial. Sa critique
» n’a souvent d’autre critérium que des règles
» arbitraires ou conventionnelles, et il croirait
» faire preuve d’un moindre talent à trouver les
» qualités d’un ouvrage plutôt que ses défauts.»