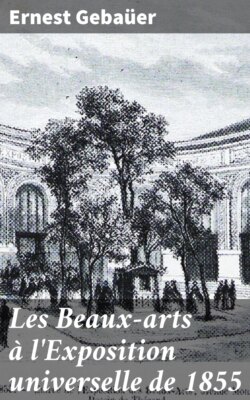Читать книгу Les Beaux-arts à l'Exposition universelle de 1855 - Ernest Gebaüer - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III.
ОглавлениеTable des matières
M. DECAMPS.
Comme M. Ingres, comme M. Delacroix, comme tous les artistes supérieurs, M. Decamps a un genre à lui, une originalité qui lui appartient en propre.
Son individualité est même tellement marquée que l’on ne saurait, à vrai dire, spécifier l’école à laquelle il se rattache, indiquer les maîtres dont il s’est inspiré.
Il semble s’être proposé, dès ses débuts, l’oubli des méthodes consacrées, et il a réussi, grâce à une exécution spirituelle, variée, pittoresque, à se faire une réputation des plus brillantes.
M. Decamps, dans une biographie de quelques pages, écrite par lui-même, s’exprime ainsi sur son propre compte: «J’ai la conviction que la nécessité
» où je me suis trouvé de ne produire que des
» tableaux de chevalet m’a totalement détourné de
» ma voie naturelle.» Le rêve de l’artiste était d’exécuter quelque grande toile murale, quelque plafond immense, aussi dit-il ailleurs:
«Je vis avec » chagrin tous mes confrères chargés successivement
» de quelque travail sur place. Là était mon
» lot, là était mon aptitude: pour moi un tableau à
» l’effet était un tableau fait, un tableau de chevalet
» ne l’est jamais.»
Nous ne savons s’il faut approuver l’artiste quand il regrette de ne pas avoir abordé un autre genre de peinture, et si les succès qu’il eût obtenus dans des compositions plus vastes eussent dépassé ceux que lui ont valu ses petites toiles, mais nous avons peine à croire que M. Decamps y eût gagné beaucoup en renommée.
Tous les tableaux du maître, réunis à l’Exposition universelle, ont attiré l’attention du public, et plusieurs sont considérés comme des chefs-d’œuvre d’agencement, et d’exécution.
Le Singe peintre est de ce nombre. Ce singe, assis par terre, la jambe droite jetée négligemment en avant, près d’un tableau sur lequel il promène le bout de son pinceau, a une expression délicieuse. On lit sur son museau la satisfaction qu’il éprouve à contempler son ouvrage. La pipe, le pistolet et la palette suspendus au mur du fond, le buffet, la bouteille d’huile grasse, tous les accessoires enfin sont d’une étonnante vérité.
L’Ane et les Chiens savants méritent également les plus grands éloges. La composition est pleine de finesse. L’àne, dont le dos supporte des paniers remplis de chiens, consomme, à deux pas de son maître, une pitance sans doute bien gagnée, tandis qu’un jeune enfant partage son déjeûner avec un singe, le premier sujet de la Compagnie. Les chiens, affublés d’habits aux galons fanés, la tète coiffée de petits chapeaux à mentonnière, ont les physionomies les plus vraies et les plus comiques. Ce tableau est sans contredit l’un des meilleurs de M. Decamps. Il est peint avec verve. La couleur en est excellente et moins bistrée que dans ses ouvrages plus récents.
Nous ne ferons pas les mêmes compliments à la Ronde de Smyrne, où, — sauf les murailles dont le ton est remarquable de solidité, et les femmes assises sur la terrasse, dont la pose est heureusement réussie, — des défauts choquants doivent être constatés. Des juges, trop sévères peut-être, ont appelé ce tableau «une véritable caricature » représentant des marionnettes dont on tirerait » démesurément les fils.»
Joseph vendu par ses frères a un mérite évident. Les terrains sont magnifiques, la lumière abondante. Il y a de l’air et du soleil dans ce tableau. Nous lui reprocherons toutefois un titre qui lui donne une prétention non justifiée à la peinture historique. Ce n’est, à parler franchement, qu’un paysage avec figures. Le groupe de Joseph et de ses frères est placé trop loin. Rien enfin dans cette composition ne fait deviner qu’il s’agit d’un événement biblique. Nous préférons cependant Joseph vendu par ses frères à Éliézer et Rébecca, dont les personnages manquent en général de grâce et de souplesse.
Dans la Halte des Cavaliers arabes, l’agencement est remarquable, et les figures, très-nombreuses, sont groupées avec une grande habileté ; au pied d’un immense rocher à pic, se trouve un abreuvoir auquel se désaltèrent de fougueux coursiers, montés par des hommes recouverts des brillants costumes de l’Asie.
L’exécution est très-bonne. Les turbans des cavaliers, les harnais des chevaux sont touchés avec finesse, mais le terrain est d’un ton trop identique: à celui du rocher.
La couleur générale, très-brillante, est cependant cernée d’un trait désagréable et sec à force de fermeté.
Nulle critique à faire au Grand Bazar turc. Le sujet, plus précis que dans beaucoup d’autres tableaux inspirés à M. Decamps par ses voyages en Orient, prête singulièrement à la richesse du coloris, à la variété des tons. Toutes les figures sont expressives, elles vivent, parlent, agissent. Les. types sont divers et originaux. En somme, c’est un excellent tableau.
Nous en dirons autant du Boucher turc dont le mérite, sur quelques points, est cependant contesté par certains critiques.
La boutique, en plein soleil, contient le boucher, debout au fond, et que l’on aperçoit à peine. L’atmosphère qui l’environne est lourde, sans transparence. Il semble qu’on étouffe près de cette muraille sur laquelle frappe le soleil. Cet effet qui nous parait étrange peut néanmoins être exact. Les détails de ce tableau, tels que la balance, le morceau de foie suspendu à la muraille, sont d’un fini, d’une précision admirable sans tomber dans la minutie.
Nous louerons, dans le Mendiant comptant sa recette, la tète blonde et fine de l’enfant qui s’avance craintivement pour regarder le mendiant. Les vêtements de ce dernier nous paraissent faits de couleurs trop brillantes.
Les joueurs de boules ont d’heureuses attitudes. Celui qui lance la boule est dessiné avec une parfaite exactitude de pose. Il y a, ce nous semble, un empàtement de couleur trop appréciable dans le terrain et dans les nuages inférieurs.
La toile des Chevaux de halage a beaucoup de vigueur. Les chevaux tirent de toute la force de leurs muscles, le charretier crie de toute la force de ses poumons. Nous critiquerons la couleur trop verte de l’eau, et le bleu trop prononcé du monticule que l’on aperçoit au loin.
Les manières, les habitudes des amateurs de peinture sont, au point de vue comique, représentées avec un rare bonheur dans le tableau des Singes.
Un des amateurs, orné d’un abat-jour vert, est assis devant un chevalet qui supporte un grand paysage dans le genre classique; un autre amateur, debout près du premier, regarde la toile au travers d’un lorgnon qu’il éloigne de son œil; un troisième, le chef couronné d’un bonnet de soie noire, le corps recouvert d’un habit gris et tenant derrière lui sa canne et son chapeau, se penche vers le chevalet. Tous sont absorbés dans la contemplation ou plutôt dans l’examen de l’œuvre, cherchant à en apprécier au juste la valeur, à en fixer exactement le prix.
L’atelier est encombré de toiles grandes et petites. Un rapport des experts, qui ont examiné déjà le paysage, gît par terre à côté d’une grande bouteille de vernis.
Soit que M. Decamps ait voulu, par son tableau des Singes, protester contre l’inintelligence des jurés académiques, soit qu’il ait voulu critiquer ces bourgeois ignares, qui examinent de trop près une peinture, il a réussi complètement.
Des Singes, si nous passons à une petite toile d’un genre tout différent, nous constaterons dans la Pêche miraculeuse le même défaut de composition que dans Joseph vendu par ses frères. Le principal personnage, Jésus, sur lequel devrait reposer tout l’intérêt, se trouve relégué au second plan. Il faut le chercher, et les deux cavaliers placés, la lance au poing, sur le rivage, sont plus que lui en évidence. La couleur de ce tableau est très-harmonieuse, le soleil darde ses derniers rayons sur la mer et sur le front de Jésus qu’il illumine.
La Rue d’un village en Italie est d’un aspect un peu lourd. Le milieu de la rue, vigoureusement éclairé, contraste d’une manière énergique, trop énergique peut-être, avec le côté droit complètement dans l’ombre.
En dépit de certains critiques, il y a de grandes qualités dans cette composition. Nous regrettons seulement, — détail sans importance, et reproche puéril! — que les étoffes blanche et rouge, placées sur le balcon de bois, forment, avec le ciel bleu foncé, un tricolore désagréable à l’œil.
La petite toile des Poules et Canards est d’une perfection achevée, quoique différant de la manière habituelle du maître; elle est réussie de tous points, et l’on ne sait ce qu’il faut plus louer, de la richesse du coloris ou de l’accent de vérité qui brille dans cette scène de basse-cour.
Puisque nous sommes parmi les animaux, admirons la variété, la justesse qui caractérisent les mouvements des chiens dans un Chenil. Le garde, un fouet à la main, ouvre avec précaution la porte par laquelle doit sortir la bande canine. Plusieurs chiens cherchent à s’échapper. Un autre penche la tête de côté pour éviter le coup de fouet du garde. La couleur de ce tableau a une harmonie remarquable.
Don Quichotte et Sancho Pança s’avancent dans un chemin creux: le maître, à cheval sur l’immortelle Rossinante; Sancho, campé, les jambes pendantes, sur son ànon chéri. La figure vineuse, le ventre rebondi de Sancho font bien ressortir la pâleur et l’efflanquement de son maître.
Mais nous avons hâte d’arriver au tableau de M. Decamps, qui a soulevé le plus de controverses: nous avons nommé la Défaite des Cimbres. Voici en quels termes l’auteur lui-même parle de ce tableau: «Lorsque j’exposai cette grande esquisse de la Défaite
» des Cimbres, je pensais fournir là un aperçu
» de ce que je pouvais concevoir ou faire. Quelques-
» uns, le petit nombre, la parcelle, approuvèrent
» fort, mais la multitude, l’immense majorité qui
» fait la loi, n’y put voir qu’un gâchis, un hachis,
» suivant l’expression d’un peintre, alors célèbre,
» et que la France aujourd’hui regrette, à ce que
» j’ai su quelque part.»
Le petit nombre des admirateurs a-t-il augmenté depuis vingt ans que la Défaite des Cimbres est connue? Malgré le haut prix auquel cette toile s’est élevée dernièrement dans une vente, nous osons affirmer que bien des gens refusent encore d’en reconnaître le mérite. Ces gens-là prétendent que l’auteur, ayant pour but de représenter un espace immense, est arrivé au résultat contraire; que les rochers énormes, placés au troisième plan, sont d’une telle solidité de ton et de couleur, qu’ils écrasent tout ce qui les environne; que les masses d’hommes, se ruant dans la plaine, sont à peine appréciables; que ce ne sont pas des hommes, mais des fourmis; que la couleur générale est bitumineuse, et qu’en somme, c’est un tableau à voir à la loupe et de près.
Tous ces reproches sont-ils fondés? Non, sans doute. Cependant le public, en général, remarque plus aisément les défauts que les beautés de cette œuvre sur laquelle nous avouons franchement ne pas oser nous prononcer. Le tableau étant lui-même conçu et rendu d’une façon tout exceptionnelle, il faut l’admettre et l’admirer de prime-abord ou nier complétement sa supériorité, ce que nous n’aurions garde de faire.
Les neuf dessins qui forment l’Histoire de Samson ont figuré, nous l’avons déjà dit, au Salon de 1845.
Cette belle suite de compositions, «très-diversi-» fiées de contextures et d’effets, présentant cepen- »dant un ensemble homogène dans sa variété,» pour employer les expressions de l’auteur, fut très-appréciée du public. Samson mettant le feu aux moissons des Philistins, Samson et Dalila, Samson tournant la meule, réunirent, toutefois, le plus grand nombre de suffrages. Il y a, comme procédé, dans ces dessins, une puissance et une transparence de tons incroyable. Dans les parties les plus vigoureuses, on aperçoit encore le papier, et néanmoins il est impossible, matériellement, de faire plus noir.
Les Singes boulangers et les Singes charcutiers n’ont pas la même valeur. Ils sont gris et un peu mous.
Nous avons réservé pour la fin la Sortie de l’École turque, cette aquarelle sans égale où la vigueur de la peinture à l’huile se trouve unie à la douceur, à la limpidité de la peinture à l’eau. Nous ne parlerons point en détail de cette composition dont la réputation est universelle et incontestée.
Ces enfants qui se pressent, se bousculent, courent, dansent, rient, chantent; ce vieillard à barbe grise, le nez surmonté de besicles, surveillant le départ des écoliers, tout est d’une justesse parfaite, d’un dessin précis, d’un coloris harmonieux.
M. Decamps, n’eût-il fait que la Sortie de l’Ecole turque, serait un grand peintre. Heureusement pour nous, il n’a point songé qu’à lui, et l’admiration de ses contemporains le récompense de ses nombreux et remarquables travaux.