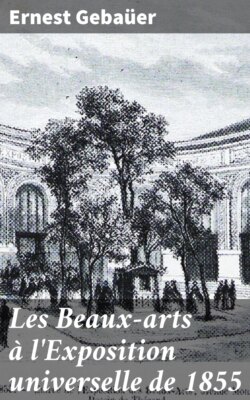Читать книгу Les Beaux-arts à l'Exposition universelle de 1855 - Ernest Gebaüer - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI.
Table des matières
M. INGRES
Pourquoi commencer par la France et par M. Ingres, l’analyse des œuvres de tous les pays et de tous les maîtres, exposées au musée de peinture? vont nous demander certaines personnes désireuses d’avoir l’explication de toutes choses, quoique résolues d’avance à trouver cette explication mauvaise.
Nous commençons par la France, quelque impolie que semble au premier abord cette façon de procéder, parce que la supériorité artistique de notre pays ne peut être sérieusement mise en doute, et nous donnons le pas à M. Ingres parce qu’il est le vétéran de nos peintres modernes et celui dont la réputation est le plus universellement reconnue.
Toutes les gloires sont contestées, de leur vivant surtout, c’est la règle; et, quelquefois, l’homme dont les siècles futurs rediront le nom avec admiration, meurt sans pouvoir pressentir le jugement que portera sur lui la postérité.
Cependant les hommes de génie, auxquels la Providence accorde une existence prolongée, assistent d’ordinaire à l’apaisement des passions qu’ils ont soulevées, et voient la majorité de leurs contemporains croire en eux et leur décerner de leur vivant un brevet d’immortalité.
Telle est la situation dans laquelle M. Ingres se trouve aujourd’hui placé. Après avoir subi les haussements d’épaules, les déclamations et les injures des romantiques forcenés, cet artiste jouit du spectacle d’un public éclairé le jugeant sans prévention, sans parti pris, et qui, s’il n’admire pas également tous ses tableaux, reconnaît du moins les qualités déployées dans chacun d’eux.
Ce n’est pas à dire que M. Ingres soit populaire. Il ne l’a jamais été. Il ne saurait l’être. N’obéissant qu’à l’inspiration et cherchant le sujet de ses compositions dans un passé historique ou glorieux, peu lui importe un présent quelquefois mesquin!
Fort de sa conviction, les discussions d’école n’ont jamais apporté dans son âme qu’un trouble momentané. Des critiques outrées, malveillantes, ont pu, pour un temps, le faire rentrer sous sa tente, mais en sortait-il, c’était avec une œuvre nouvelle sur laquelle n’avaient en rien influé les théories et les systèmes à l’ordre du jour.
M. Ingres, on l’a dit et je le répète, est peut-être le seul artiste en qui le même faire, la même manière et les mêmes idées puissent être constatées du début au déclin de sa carrière. «Chez lui,
» écrit M. de Loménie, il n’y a jamais eu à vrai
» dire commencement ni fin, ni progrès, ni décadence;
» à vingt ans il était aussi complètement
» lui qu’à soixante.»
Ce jugement formulé en 1840, manque peut-être d’exactitude en 1855. S’il est vrai que les gouvernements se perdent par l’abus de leur principe, il n’est pas moins vrai que les artistes se perdent par l’exagération de leurs qualités, et les derniers tableaux de M. Ingres, plus froids, plus gris, moins lumineux encore que ses premières productions, nous semblent leur être inférieurs.
Puisque nous avons parlé des premières œuvres du maître, arrêtons-nous devant Œdipe expliquant l’énigme du Sphinx. Supérieurement dessiné, l’OEdipe indique déjà la voie que suivra l’artiste. La couleur en est bonne et l’ensemble de la composition a la simplicité que le sujet comporte.
Jésus remettant les clés du paradis à Saint-Pierre est une toile qui attire et justifie l’attention.
Au premier plan, Jésus montrant d’une main le ciel, remet de l’autre main les clés du paradis à Saint-Pierre qui, un genou en terre, reçoit ces clés en levant vers Jésus sa figure brunie sur laquelle se révèle, à travers le respect, un certain étonnement.
A droite sont groupés les apôtres. La ville apparaît dans le lointain. Ce tableau, composé pour l’église de la Trinité-du-Mont, à Rome, est bien ordonné. Les lignes en sont harmonieuses et le coloris en est puissant. Toutes les figures ont une remarquable beauté. Celle du Christ pèche seulement par un excès de rondeur.
Si le Jésus mérite ce léger reproche, quelles critiques appliquer à la Chapelle Sixtine? C’est un grand chef-d’œuvre que cette petite toile. Que d’air! que d’espace! Les détails sont finis sans être léchés, précis sans être minutieux. La reproduction des peintures décorant la chapelle est admirablement réussie. Ce sont des tableaux dans un tableau.
A côté de la Chapelle Sixtine il faut placer comme perfection une œuvre d’un genre tout différent, l’Odalisque vue de dos. Quelle pureté de lignes! Peut-on assez louer cette pose gracieuse, ces voluptueux contours et cette transparence merveilleuse de la chair dans la demi-teinte?
Le mérite de l’Odalisque couchée est réel, quoique certaines teintes verdàtres donnent un aspect triste à l’ensemble de cette composition.
Quand fut exposé le Vœu de Louis XIII, dix ans s’étaient écoulés depuis l’achèvement de l’Odalisque couchée.
Après 1814, M. Ingres eut à supporter bien des privations, bien des misères. Sans ressources autres que son talent, il lui fallut lutter contre les difficultés de la vie. Déjà célèbre à Rome, il passait encore en France pour «un artiste bizarre, incomplet» , inexplicable.»
L’apparition du Vœu de Louis XIII provoqua en faveur de l’artiste une réaction admiratrice. Dégoûté de la statuaire en peinture, le public avait perdu tout engouement pour l’école de David, le dessin commençait à se laisser dominer par la couleur. Venise et la Flandre reprenaient faveur, et de la peinture froide et dépouillée d’ornements on allait passer sans transition à l’échevelé et au clinquant, lorque le Vœu de Louis XIII vint se placer comme un intermédiaire entre les deux écoles et les deux systèmes.
La pose de l’enfant Jésus que Marie tient par le milieu du corps et dont une jambe est pendante, tandis que son autre genou s’appuie sur les genoux de la Vierge, a une grâce exquise et une nouveauté remarquable. Le corps de l’enfant est délicieusement modelé. Dans son regard brille une divinité suprême.
On peut reprocher à la figure de la Vierge une rondeur que M. Ingres paraît affectionner. Il y a aussi trop de rose sur ses joues, et sur sa bouche un vermillon trop vif.
L’attitude du roi, élevant vers Marie son sceptre et sa couronne, est très-heureuse. Sa figure exprime bien la foi vive, mais la foi de l’homme faible plutôt que celle du chrétien couvaincu.
En somme, le Vœu de Louis XIII méritait la réputation qu’il a obtenue. Il la méritera toujours.
Dix autres années de la vie de l’artiste avaient passé, quand le Martyre de Saint-Symphorien vint figurer au salon de 1834.
Les passions que l’on croyait mortes, les discussions que l’on croyait épuisées reparurent et s’agitèrent autour de la conception nouvelle, et, si nous en croyons M. de Loménie, «l’œuvre fut brutale» ment conspuée par l’envie et resta incomprise du » public.»
Sera-t-elle mieux comprise aujourd’hui? Je n’oserais certes l’affirmer, et pourtant de grandes qualités, des beautés réelles brillent dans cet ouvrage.
La pose du saint dont les deux bras sont étendus vers le ciel et dont la physionomie calme et placide ne trahit aucune appréhension du supplice, est noble et belle. Les deux licteurs, à moitié nus, frappent par leur musculature colossale. On a blâmé ce développement prodigieux de leur corps, mais on a loué unanimement le proconsul placé derrière le saint, et sur les traits impassibles duquel on ne saurait lire ni colère ni pitié.
Le Martyre de Saint-Symphorien a été vivement critiqué. Nous croyons qu’on a trop cherché les défauts de cette toile et qu’on n’a pas assez voulu en voir les qualités. — M. Ingres s’était imposé une tâche immense en entreprenant de rendre à la fois les lieux, les temps, les races et de réunir toute une époque autour du martyr gaulois du deuxième siècle. Aussi sa composition est-elle vaste et d’un ordre élevé, mais trop complexe et trop surchargée d’accessoires.
La Naissance de Vénus anadyomène n’est pas exempte de défauts. Si le corps de Vénus est d’un beau modelé, sa figure est trop ronde, comme presque toutes les figures de femme du même auteur. Nous critiquerons aussi le ciel d’un bleu trop prononcé et le caractère généralement mou de cette peinture.
Mais voici une œuvre capitale, Homère déifié, toile énorme où l’artiste a voulu représenter Homère couronné par l’Univers et recevant l’hommage de tous les grands hommes des temps anciens et des temps modernes.
Comme composition, Homère déifié ne le cède à aucun des autres tableaux du maître. La disposition générale en est grandiose. L’agencement des détails répond au mérite de l’ensemble. L’attitude d’Homère assis est simple et digne. Les figures du Poussin, de Racine, de Lafontaine, placées sur le devant du tableau respirent et vivent: Molière va parler.
Ce tableau nous semble en tout bien préférable à l’Apothéose de Napoléon 1er. Sans entrer dans beaucoup de détails sur cette conception toute moderne, disons que l’austérité du style remplace en elle l’originalité de l’invention. Le coloris manque de richesse et de chaleur.
La Némésis terrassant l’Anarchie, détruit l’unité de l’œuvre, tant cet épisode se rattache peu directement au sujet principal. L’Apothéose de Napoléon 1er laisse le spectateur froid et indécis, aussi quitterons-nous vite l’allégorie pour la réalité et passerons-nous au portrait de M. Bertin aîné, portrait dont le mérite est consacré depuis longues années.
D’une simplicité remarquable dans sa composition, ce tableau n’attire par aucun accessoire. Pas le moindre pan de velours, pas la moindre décoration. M. Bertin, vêtu d’une simple redingote, est assis dans un fauteuil, voilà tout.
Mais quelle perfection dans le dessin! quelle vérité dans la pose! quelle puissance dans le coloris! Evidemment, c’est là un chef-d’œuvre. Ajoutons néanmoins qu’il est regrettable de voir dans ce tableau, comme dans plusieurs autres, M. Ingres peindre avec autant d’amour le bras d’un fauteuil que les bras de son modèle. Il y a en ceci un excès de perfection qui devient puéril et nuit à l’ensemble de certaines compositions.
La Vierge à l’hostie, peinte en 1854, a les mêmes qualités que la Vierge du Vœu de Louis XIII; elle a aussi les mêmes défauts: de la bouffissure, la bouche en cœur et les extrémités petites et maniérées.
Une grande quantité de tableaux, et surtout de portraits, figurent encore dans la salle réservée à M. Ingres. Le portrait de Chérubini, celui de M. Molé, celui de la comtesse d’H..... sont les plus remarquables.
Les cartons des vitraux peints à Dreux et dans la chapelle Saint-Ferdinand sont d’un beau style et révèlent la touche du maître. C’est ici que l’on peut admirer en elle-même cette science du dessin qui caractérise à un si haut point le talent de M. Ingres.
Plusieurs de ses portraits et de ses autres ouvrages sont généralement gris et froids, surtout les modernes. Leur coloris varie du jaune au brun rouge, pour aboutir à une Jeanne d’Arc, couleur d’étain.
Pour nous résumer, il est peu d’artistes qui puissent, comme M. Ingres, offrir au jugement de leurs contemporains les travaux d’un demi-siècle passé tout entier dans l’amour de l’art et dans la poursuite de leur idéal.
M. Ingres n’entendra pas dire que son œuvre ait vieilli, et en cela apparaît l’avantage de n’avoir jamais eu qu’une manière.
Cependant, s’il y a profit d’un côté, il y a perte de l’autre, et peut-être eût-il mieux valu que l’on dit de M. Ingres comme de Raphaël: On compte dans sa manière trois périodes, une première dans laquelle il ne fait qu’imiter son maitre; une deuxième où il devient original, et une troisième où il se surpasse lui-même.
M. Ingres n’a imité personne; mais s’est-il surpassé lui-même?