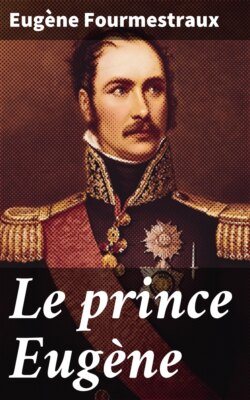Читать книгу Le prince Eugène - Eugène Fourmestraux - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеTable des matières
Eugène de Beauharnais est né à Paris le 3 septembre 1781.
«Mon père, dit le prince Eugène dans ses Mémoires, était le vicomte Alexandre de Beauharnais. Il s’était fait remarquer de bonne heure par les grâces de son esprit et de sa personne autant que par son mérite et son amabilité.
«Entré fort jeune dans la carrière militaire, il avait eu occasion de s’y distinguer. Ma mère, Joséphine Tascher de la Pagerie, était née à la Martinique. Sa famille et celle de mon père étaient unies depuis longtemps par les liens de l’amitié. Mon grand-père, chef d’escadre de la marine royale, avait été autrefois gouverneur des Antilles. Ma mère avait à peine quatorze ans lorsqu’elle épousa le vicomte de Beauharnais.»
Alexandre de Beauharnais, il faut le dire, aimait moins sa femme qu’il n’en était aimé. Il l’avait épousée un mois à peine après la première entrevue, et par déférence surtout pour sa marraine, Mme de Renaudin, femme d’un grand cœur et de beaucoup d’esprit.
Mme de Renaudin était la tante, du côté paternel, de Joséphine qu’elle chérissait comme sa propre fille. Pendant les premières années de cette union, ses bons conseils ne cessèrent de s’adresser à ses deux enfants, ainsi qu’elle se plaisait à les appeler, pour les ramener tous deux à la confiance mutuelle qui devait leur rendre le bonheur domestique.
La naissance d’un fils eut du rapprocher de sa femme le vicomte de Beauharnais. Il ne tarda pas néanmoins à reprendre les habitudes mondaines qui l’éloignaient de son foyer, et Joséphine n’eut plus qu’à s’enfermer dans les joies intimes de la maternité.
«Embarrassée, hésitante entre sa nièce et son filleul qu’elle aimait presque également, Mme de Renaudin proposa un moyen qui lui parut, ainsi qu’à son frère et au marquis de Beauharnais, devoir ramener l’accord dans cet intérieur. Elle conseilla au vicomte d’entreprendre un voyage dont le résultat serait de rompre ses mauvaises habitudes et de lui faire apprécier mieux sa femme au retour. Alexandre, aussi docile aux bonnes impressions que faible devant les mauvaises, accepta ce parti; et ayant obtenu du colonel de son régiment un congé de quelques mois, il se décida pour l’Italie, où la vue des belles choses, l’étude des objets d’art dont il avait la connaissance et le goût, devaient produire sur lui une diversion heureuse, en même temps que ce voyage mûrirait son esprit et sa raison. Il s’embarqua donc à Antibes, le 25 novembre 1781, et après une traversée pénible, dans laquelle sa petite embarcation faillit périr, il arriva à Gênes.»
Après avoir parcouru l’Italie, le vicomte de Beauharnais revint à Paris. Il se montra d’abord affectueux et empressé pour sa femme; mais, quelques mois plus tard, il retourna à son régiment qui tenait garnison à Verdun, et là, il recommença à mener une vie dissipée.
En septembre 1782, fatigué de son oisiveté, le vicomte de Beauharnais s’embarqua pour la Martinique, où il se proposait de servir comme volontaire sous les ordres du marquis de Bouillé, gouverneur de cette île, dans une expédition tentée contre les colonies anglaises.
Mais la paix, signée le 20 janvier 1783, arrêta dès le début l’accomplissement de ce projet, et plaça de nouveau le vicomte de Beauharnais dans une inaction funeste.
Une liaison contractée par lui avec une créole dangereuse, ennemie de la famille Tascher de la Pagerie, l’entraîna dans les plus tristes écarts. Rentré quelque temps après à Paris, à la suite de cette femme, il ne craignit pas de saisir le parlement d’une demande en séparation de corps contre Joséphine, basée sur les griefs les plus invraisemblables.
En attendant l’arrêt de cette cour, Mme de Beauharnais alla demeurer à l’abbaye de Pentemont. Elle n’en sortit qu’un an après, et lorsque le Parlement lui eut donné complètement gain de cause.
Aux termes de cet arrêt, qui la justifiait d’une manière éclatante des imputations dirigées contre elle par son mari, Joséphine fut autorisée à ne plus habiter avec le vicomte de Beauharnais, qui était condamné à lui payer une pension suffisante pour elle et sa fille Hortense, née le 10 avril 1783.
Eugène resta confié aux mains de son père.
«Je fus placé fort jeune, dit le prince Eugène dans ses Mémoires, avec un gouverneur au collège d’Harcourt , et j’y restai jusqu’au moment où, par suite des événements de la révolution, les collèges furent dissous. Je crois me rappeler que c’est à l’époque du 14 juillet 1790. Quoique je fusse alors bien jeune et que trente-quatre années se soient écoulées depuis, j’ai encore présents à l’esprit, et tous les préparatifs de la fédération du Champ-de-Mars, et la pompe de cette fête, et l’exaltation qui était alors dans toutes les têtes. Je me rappelle aussi avoir assisté à plusieurs séances de l’Assemblée constituante, où mon père, qui avait embrassé les principes de la révolution, siégeait au côté gauche, tandis que le comte François de Beauharnais, son frère ainé, siégeait au côté droit. Il m’était arrivé quelquefois de me trouver près du poêle qui était au centre de la salle des séances, donnant une main à mon père et l’autre à mon oncle sans qu’ils s’adressassent la parole entre eux.»
Depuis l’arrêt rendu par le parlement, Joséphine avait repris son existence auprès de sa tante, Mme de Renaudin, et du marquis de Beauharnais, son beau-père, qui lui donnait les témoignages de la plus profonde affection.
Vers le mois d’août 1785, le marquis de Beauharnais avait quitté l’hôtel qu’il habitait rue Thévenot, n° 12 et était allé demeurer à Fontainebleau, où il avait loué une maison pour sa belle-fille et pour lui. Joséphine passa là trois années, au milieu des soins de la famille de Beauharnais.
Mais quels que fussent les égards dont elle était entourée, Joséphine se disait que tant que son mari, qu’elle aimait toujours tendrement, resterait éloigné d’elle, la place la plus digne qu’elle pût occuper, était au sein de sa propre famille, à la Martinique.
A la veille de la Révolution, au mois de juin 1788, elle s’embarqua au Havre, emmenant avec elle sa tille, âgée alors de cinq ans.
Après une traversée très-tourmentée au point de départ, Joséphine revit avec une sorte de joie ces beaux lieux où s’était écoulée son enfance.
Mais les événements se pressaient en France.
Envoyé aux états généraux par la noblesse du bailliage de Blois, pays de sa mère et siège de sa fortune, le vicomte de Beauharnais, alors major d’infanterie, s’était associé avec élan au mouvement des esprits, en abdiquant les droits qu’il tenait de sa naissance.
Élu d’abord secrétaire de l’Assemblée constituante, puis membre du comité militaire, il fut porté ensuite au fauteuil de la présidence de cette assemblée.
Ramené à la vie sérieuse par le cours des événements, Alexandre de Beauharnais se reprochait amèrement sa conduite à l’égard de sa femme, et réclamait d’elle pardon et oubli.
A cet appel, Joséphine crut devoir se dérober à la tendresse des siens pour accourir avec sa fille auprès de son mari et de son fils.
Elle arriva à Paris en octobre 1790, et alla habiter rue de l’Université ; n° 47, un hôtel où le vicomte Alexandre de Beauharnais recevait alors l’élite de la société parisienne.
Le 20 juin 1791, au moment où Louis XVI quittait Paris dans l’intention de se retirer à l’étranger, le vicomte de Beauharnais présidait l’Assemblée nationale.
«Le rôle que mon père se trouvait jouer dans ce moment, dit le prince Eugène, attira l’attention sur nous. En effet, il se trouvait, par l’absence du gouvernement royal, le premier personnage de la France, et je me rappelle qu’on me montrait dans les rues de Fontainebleau en disant: Voilà le Dauphin!
«Mon père, d’abord employé à l’armée du Nord, passa à l’armée du Rhin qu’il commanda après le départ de Custine. Il profita de cette circonstance pour me rappeler auprès de lui, et me mit au collège à Strasbourg. Je fis plusieurs courses au quartier général de Wissembourg. Tout y respirait l’amour de la gloire et de la patrie, et c’est là que se développèrent en moi, pour la première fois, les impressions de ces sentiments.
«Pendant le régime de la Terreur, mon père quitta l’armée et se retira dans ses terres . Mais la faction cruelle qui désolait la France ne l’y laissa pas longtemps. Je revins à Paris pour être témoin du plus grand malheur qui pouvait m’arriver. Mon père et ma mère furent successivement emprisonnés, et quatre jours avant la chute de Robespierre, c’est-à-dire le 6 thermidor an II mon père perdit la tête sur l’échafaud. Il était, dans toute l’acception du mot, ce que l’on nommait alors un patriote constitutionnel. Il avait embrassé avec chaleur les principes de la Révolution, parce qu’il connaissait les abus qui l’avaient amenée. Il périt, comme une partie de l’élite de la France, victime de son attachement à des principes dont tant d’honnêtes gens se promettaient pour leur pays un bonheur et une gloire sans taches. Ses derniers vœux furent pour le retour de l’ordre et de la justice dans sa patrie, et pour la réhabilitation de sa mémoire et de celle de tant d’autres illustres victimes de cette époque; l’histoire s’est chargée d’accomplir ce dernier vœu.
«Ma mère ne fut rendue à la liberté que quelque temps après, et il m’est permis de nommer ici l’homme aux bontés duquel nous dûmes ce bienfait: ce fut le député Tallien. J’en ai conservé une profonde reconnaissance, et j’ai été assez heureux pour lui en donner constamment des preuves dont, à l’époque de sa mort, d’autres ont voulu se faire un mérite.
«J’étais trop jeune alors pour apprécier dans toute leur étendue les malheurs de ma patrie, mais je sentais bien vivement la perte que je venais de faire. Par suite d’un arrêté du gouvernement qui obligeait les enfants des nobles à apprendre un métier, je fus mis en apprentissage chez un menuisier, et ma sœur Hortense chez une couturière. Je ne sortis de là que pour être placé près du général Hoche, auquel mon père m’avait recommandé quelque temps avant sa mort. Je fis pendant plusieurs mois le service d’officier d’ordonnance près de ce général, et je commençai alors, pendant qu’il commanda l’armée des côtes de Cherbourg, et, plus tard, celle de l’Ouest, à pratiquer la vie de soldat.
«Le maître était sévère, et l’école, pour avoir été dure, n’en a pas été moins bonne.
«Quelque temps avant l’affaire de Quiberon, le général Hoche m’envoya près de ma mère, qui avait témoigné le désir de me voir. Dans l’année qui suivit, il se passa un événement qui eut la plus grande influence sur mon avenir. Ma mère songea à se marier avec le général Bonaparte, qui commandait alors à Paris, et dont les destinées rempliront tant de pages glorieuses dans l’histoire. Il n’avait pas encore la réputation qu’il s’acquit peu de temps après, et qui lui valut le surnom de héros de l’Italie. Je fus moi-même l’occasion de sa première entrevue avec ma mère. A la suite du 13 vendémiaire , un ordre du jour détendit, sous peine de mort, aux habitants de Paris de conserver des armes. Je ne pus me faire à l’idée de me séparer du sabre que mon père avait porté et qu’il avait illustré par d’honorables et éclatants services. Je conçus l’espoir d’obtenir la permission de pouvoir garder ce sabre, et je fis des démarches en conséquence auprès du général Bonaparte. L’entrevue qu’il m’accorda, fut d’autant plus touchante qu’elle réveilla en moi le souvenir de la perte encore récente que j’avais faite. Ma sensibilité et quelques réponses heureuses que je fis au général, firent naître chez lui le désir de connaître l’intérieur de ma famille, et il vint lui-même, le lendemain, me porter l’autorisation que j’avais si vivement désirée. Ma mère l’en remercia avec grâce et sensibilité. Il demanda la permission de revenir nous voir, et parut se plaire de plus en plus dans la société de ma mère. Je dois dire que peu de mois après, Hortense et moi nous nous aperçûmes de l’intention où le général Bonaparte pourrait être d’unir son sort à celui de notre mère, et toute la splendeur qui, depuis, environna Napoléon, alors général Bonaparte, n’a pu me faire oublier toute la peine que je ressentis quand je vis ma mère décidée à former de nouveaux liens.»
Nous avons cru devoir reproduire dans son entier ce passage des Mémoires du prince Eugène, qui, sous une forme aussi précise que sommaire, rétablit la vérité de faits qui ont été, ou contestés, ou présentés d’une manière assez dissemblable pour laisser l’incertitude dans l’esprit de beaucoup de personnes.
Ce qui cependant paraît incontestable d’après tous les documents qui viennent à l’appui de la déclaration formelle du prince Eugène, c’est que le général Alexandre de Beauharnais fut arrêté à La Ferté-Imbault, dans les premiers jours de janvier 1794, et qu’il fut d’abord écroué au Luxembourg.
Joséphine, arrêtée le 20 avril suivant, fut renfermée dans l’ancien couvent des Carmes, qui, depuis deux ans, était converti en prison.
Le vicomte de Beauharnais obtint, peu de temps après, la faveur d’être enfermé dans la même prison que sa femme, quoique dans un quartier différent.
Confiés aux soins de leur gouvernante, Mme Lanoy, Eugène et Hortense étaient restés à Paris.
Une note que nous trouvons dans les mémoires publiés en 1833, par la reine Hortense, et une lettre de Joséphine, datée de la prison des Carmes, an II (1794), ne laissent aucun doute à cet égard.
A la suite de la déclaration du prince Eugène lui-même, en ce qui concerne l’obligation imposée à ces enfants d’apprendre un métier, le témoignage de M. le comte de La Valette, leur parent, est aussi des plus affirmatifs. Il dit dans ses Mémoires qu’Hortense fut placée chez la couturière de sa mère, et qu’Eugène fut mis en apprentissage chez un menuisier.
Nous croyons pouvoir d’ailleurs nous référer sur ce point à notre étude sur la reine Hortense. Après avoir pris connaissance des Notices historiques du baron Darnay, compagnon d’enfance, puis secrétaire, chef du cabinet du prince Eugène, conseiller d’État et directeur général des postes du royaume d’Italie; après avoir également recueilli les déclarations de parents ou amis de la famille de Beauharnais, nous avons été autorisé à écrire dans cette publication les lignes suivantes, que nous croyons devoir maintenir jusqu’à ce que des preuves contraires et authentiques nous soient opposées.
«Par suite d’un arrêté qui obligeait les enfants des nobles à apprendre un métier, Eugène fut mis en apprentissage chez un menuisier nommé Cochard, domicilié à Croissy, non loin du château de la Malmaison, et Hortense fut placée chez la couturière de sa mère. Dans cette humble condition, Mme Lanoy ne les perdait pas de vue; elle les conduisait, vêtus en ouvriers, à la prison des Carmes, où leur mère était enfermée.»
Enfin, Joséphine nous apprend qu’après l’arrestation du général de Beauharnais, un membre du comité de salut public se présenta à son domicile et y fit subir un long interrogatoire à Eugène et à Hortense. Mme de Beauharnais, craignant que ses deux enfants ne fussent arrêtés comme leur père, les plaça en apprentissage, autant pour les mettre à l’abri des dangers auxquels leur nom pouvait les exposer à cette époque, que pour se conformer à un arrêté qui obligeait les enfants des nobles à apprendre un métier.
L’autre fait, qui est relatif à la réclamation si touchante d’Eugène pour conserver le sabre de son père, est confirmé d’une manière irréfragable par l’Empereur lui-même dans le Mémorial de Sainte-Hélène. Le mouvement de piété filiale et de noblesse d’âme qui avait dicté la démarche du jeune Beauharnais, impressionna vivement le général Bonaparte, qui ne put s’empêcher de le lui exprimer dans les termes les plus flatteurs.
Le général de Beauharnais s’était retiré dans ses terres, à La Ferté-Imbault; il s’y trouvait depuis quelque temps, avons nous dit déjà, lorsqu’il y fut arrêté en exécution d’un ordre du comité de sûreté générale en date du 12 ventôse an II (2 mars 1794), pour s’être livré, disait cet ordre, à des manœuvres contre-révolutionnaires.
Après quatre mois et demi de détention, il périt sur l’échafaud, le 6 thermidor an II (24 juillet 1794). La veille de sa comparution devant le tribunal révolutionnaire, le général de Beauharnais écrivit à sa femme la lettre suivante, datée de la Conciergerie, le 4 thermidor an II.
«Toutes les apparences de l’espèce d’interrogatoire qu’on a fait subir aujourd’hui à un assez grand nombre de détenus, sont que je suis la victime des scélérates calomnies de plusieurs aristocrates, soi-disant patriotes, de cette prison. La présomption que cette infernale machination me suivra jusqu’au tribunal révolutionnaire, ne me laisse aucun espoir de te revoir, mon amie, ni d’embrasser mes chers enfants. Je ne te parlerai point de mes regrets; ma tendre affection pour eux, l’attachement fraternel qui me lie à toi, ne peuvent te laisser aucun doute sur le sentiment avec lequel je quitterai la vie sous ces rapports.
«Je regrette également de me séparer d’une patrie que j’aime, pour laquelle j’aurais voulu donner mille fois ma vie, et que non-seulement je ne pourrai plus servir, mais qui me verra échapper de son sein en me supposant un mauvais citoyen. Cette idée déchirante ne me permet pas de ne te point recommander ma mémoire; travaille à la réhabiliter en prouvant qu’une vie entière consacrée à servir son pays et à faire triompher la liberté et l’égalité, doit, aux yeux du peuple, repousser d’odieux calomniateurs, pris surtout dans la classe des gens suspects. Ce travail doit être ajourné, car, dans les orages révolutionnaires, un grand peuple qui combat pour pulvériser ses fers, doit s’environner d’une juste méfiance, et plus craindre d’oublier un coupable que de frapper un innocent.
«Je mourrai avec ce calme qui permet cependant de s’attendrir pour des plus chères affections, mais avec ce courage qui caractérise un homme libre, une conscience pure et une âme honnête, dont les vœux les plus ardents sont pour la prospérité de la république.
«Adieu, mon amie, console-toi pour mes enfants, console-les en les éclairant, et surtout en leur apprenant que c’est à force de vertus et de civisme qu’ils doivent effacer le souvenir de mon supplice, et rappeler mes services et mes titres à la reconnaissance nationale.
«Adieu, tu sais ceux que j’aime; sois leur consolateur, et prolonge par tes soins ma vie dans leurs cœurs.
«Adieu, je te presse ainsi que mes chers enfants pour la dernière fois de ma vie contre mon sein.»
Le général de Beauharnais était depuis près de deux mois en prison lorsque, le 2 floréal an II (21 avril 1794), Joséphine fut arrêtée à son tour, rue Saint-Dominique-Saint-Germain, n° 43, où elle demeurait alors, par ordre du comité révolutionnaire de la section des Tuileries, et conduite à la prison des Carmes, où elle resta enfermée pendant cent huit jours, du 2 floréal au 19 thermidor an II.
L’ancien couvent des Carmes, que le gouvernement révolutionnaire avait transformé en maison de détention pour y jeter ses nombreuses et innocentes victimes, était situé rue de Vaugirard, n° 70.
La pièce ou Mme de Beauharnais fut enfermée avec Mme d’Aiguillon, est située au premier étage; c’est une cellule voûtée, d’une largeur de 2 mètres 30 centimètres, sur 10 mètres environ de longueur. Elle prend jour sur le jardin par une croisée garnie de barreaux en fer, et on la désigne aujourd’hui sous le nom de Chambre aux Épées. Nous dirons tout à l’heure l’origine de cette dénomination.
Du côté opposé à la croisée, il existe une armoire au fond de laquelle se trouve l’inscription suivante écrite sur le mur et garantie par un petit châssis vitré :
«Oh! liberté, quand cesseras-tu d’être un vain mot? Voilà aujourd’hui cinquante-sept jours que nous sommes enfermées. On nous dit que nous sortirons demain, mais ne serait-ce pas un vain espoir?
. «Citoyenne Tallien, Joséphine, veuve Beauharnais, d’Aiguillon.»
Il nous serait difficile d’expliquer comment la signature de Mmc Tallien se trouve au bas de cette inscription. Mme de Fontenai (Thérésa Cabarrus), fut arrêtée à Versailles dans la nuit du 11 au 12 prairial an II (nuit du 3J au 31 mai 1794), et conduite immédiatement à la Force, où elle resta enfermée pendant soixante jours. Elle ne fut mise en liberté que le 12 thermidor an II (30 juillet 1794), trois jours après la chute de Robespierre, et ce ne fut que peu de temps après qu’elle épousa Tallien.
Quant aux signatures de Mmes de Beauharnais et d’Aiguillon, leur authenticité ne saurait être contestée.
Nous n’avons pas aperçu de date à côté de ces trois signatures.
Au milieu de cette même pièce, et à droite en faisant face à la croisée, on lit encore, tracés sur le mur, ces deux vers:
«J’ai servi mon pays, voilà ma récompense,
«La liberté, souvent, coûte plus qu’on ne pense.
«C. DESTOURNELLES.
«9 thermidor an II.»
Tout à côté de ce distique, on voit l’empreinte de trois épées ou de trois poignards que les septembriseurs avaient sans doute jetés là après l’horrible massacre des cent vingt prêtres qui se trouvaient dans cette prison. L’empreinte des manches se distingue très-bien, mais il n’en est pas tout à fait de même de celle de trois lames, qui se confond avec la marque faite par le sang qui les couvrait et qui, en s’en détachant, ruissela sur le mur. De là, le nom de Chambre aux Épées donné à cette cellule.
Au fond du jardin, et dans la partie la plus rapprochée du mur de clôture donnant sur la rue d’Assas, on voit une chapelle qui disparaîtra lors du percement que nécessitera le prolongement de la rue de Rennes. On lui a donné le nom de Chapelle des Martyrs, en souvenir des malheureux ecclésiastiques qui y furent massacrés le 2 septembre 1792.
Le couvent est maintenant affecté à l’école normale des hautes études ecclésiastiques, qu’y fonda peu de temps avant sa mort Mgr Affre, archevêque de Paris, afin de former des professeurs pour enseigner les études littéraires et scientifiques dans les petits séminaires de France; mais l’église est desservie par la communauté des frères Prêcheurs, que dirigea pendant près de quinze ans le R. P. Lacordaire.
Nous allons reprendre notre récit en suivant pas à pas, jusqu’en 1805, les mémoires dictés par le prince Eugène, nous attachant à compléter les pages malheureusement trop brèves de ce travail, où la réserve et la modestie du Prince se font constamment jour, par des informations puisées aux sources les plus authentiques.
Un des premiers soins de Joséphine, depuis qu’elle se trouvait libre, avait été de se préoccuper de l’éducation de ses enfants. Eugène fut envoyé, vers la fin de septembre 1795, à Saint-Germain-en-Laye, chez un professeur de beaucoup de talent, M. Mestro, et Hortense fut confiée aux soins de Mme Campan, qui, ayant perdu, depuis la mort de la reine Marie-Antoinette, la position qu’elle occupait auprès de cette noble et malheureuse souveraine, dirigeait un pensionnat dans la même ville.
Cette digne institutrice fut chargée, six mois après, d’apprendre à Eugène et à Hortense que leur mère allait devenir madame Bonaparte. En effet, les publications du mariage eurent lieu à la mairie du deuxième arrondissement de Paris, et la célébration en fut fixée pour le 19 ventôse an IV (9 mars 1796).
Madame de Beauharnais avait alors son domicile rue Chantereine ( anciennement Ruellette-aux-Porcherons, et actuellement rue de la Victoire ). C’est au n° 60 de cette rue que se trouvait le petit hôtel, devenu historique, que Mme de Beauharnais habitait à cette époque, et que le général Bonaparte acheta à son retour de l’armée d’Italie, pour le prix de 180,000 francs.
Cet hôtel, que l’on désigna depuis sous le nom d’hôtel Bonaparte, était situé à l’extrémité d’une longue avenue, assez étroite, il est vrai, mais plantée d’arbres centenaires. Il fut bâti par Ledoux pour le marquis de Condorcet, et en 1791 il était habité par Julie Carreau, lorsqu’elle épousa Talma. En 1860, cet hôtel a complétement disparu, ainsi que le jardin et l’avenue, pour faire place à de belles constructions modernes. La porte enchère qui précédait l’avenue se trouvait a la place qu’occupe aujourd’hui la croisée du rez-de-chaussée la plus rapprochée du n° 58. Il ne reste donc plus rien, plus le moindre vestige de cette ancienne habitation du général Bonaparte.
L’administration municipale de Paris, voulant rendre hommage au jeune vainqueur d’Italie, décida, par un arrêté du 8 nivôse an VI ( 28 décembre 1797 ), que la rue Chantereine porterait désormais le nom de rue de la Victoire. En 1816, les Bourbons voulurent qu’elle reprît le nom de rue Chantereine; mais sa glorieuse dénomination lui fut rendue le 25 novembre 1833, comme un hommage à la mémoire du plus grand capitaine des temps modernes.
Avant son mariage, le général Bonaparte avait occupé à Paris plusieurs autres demeures. Ainsi, lorsqu’il quitta l’école de Brienne, il logea d’abord à l’École-Militaire, dans une toute petite chambre située à l’étage le plus élevé, et n’ayant qu’une fenêtre qui donnait sur l’une des cours intérieures de l’École . Il alla ensuite occuper dans la maison du quai Conti, n° 5, en face le Pont-Neuf, une mansarde dont la fenêtre était en saillie sur le toit. Une plaque de marbre noir, placée au-dessus de la porte de cette maison, indique le séjour qu’y fit le futur empereur. Cette plaque porte l’inscription suivante:
SOUVENIR HISTORIQUE.
Ex 1785
L’EMPEREUR NAPOLÉON BONAPARTE,
OFFICIER D’ARTILLERIE,
SORTANT DE L’ÉCOLE DE BRIENNE,
DEMEURAIT AU CINQUIÈME ÉTAGE DE CETTE MAISON.
AUTORISATION SPÉCIALE
DE S. M. NAPOLÉON III.
En date du 14 octobre 1853.
Plus lard, en 1792, lorsqu’il était capitaine d’artillerie, il logea rue du Mail, dans une maison meublée qui n’existe plus maintenant, et qui portait alors le nom d’hôtel de Metz, En 1794, Bonaparte, alors général d’artillerie, revint demeurer rue. du Mail, mais, celte fois, ce fut à l’hôtel des Droits de l’homme, où il prit, au quatrième étage, un appartement qu’il partagea avec son frère Louis, futur roi de Hollande, et Junot, futur duc d’Abrantès.
L’année suivante, il alla loger rue de la Michodière, dans une maison meublée qu’il quitta peu de temps après pour aller s’établir à l’hôtel Mirabeau, rue de la Convention . C’est là que, sur la désignation de Carnot, Barras envoya chercher le jeune général pour lui confier le commandement des troupes à la tête desquelles il devait, le 13 vendémiaire an IV ( 5 octobre 1795), défendre le Directoire contre l’insurrection des sections terroristes et royalistes de Paris.
Après sa victoire, Bonaparte fut nommé général de division et commandant en chef de l’armée de l’intérieur. Il établit alors son quartier général rue Neuve-des-Capucines, à l’hôtel dit de la Colonnade, qui fut depuis occupé par les archives des affaires étrangères, et qui a disparu pour faire place à la rue Saint-Arnaud.
Quinze jours avant son mariage, Bonaparte avait été nommé général en chef de l’armée d’Italie, et Joséphine n’eut plus qu’à partager sa fortune. Il quitta Paris le 22 mars 1796, et fit venir auprès de lui Eugène, qui devint l’un de ses aides de camp.
«Nous ne tardâmes pas, dit le prince Eugène, à apprendre à la fois, et le mariage de ma mère avec le général Bonaparte, et la nomination de ce général au commandement de l’armée d’Italie, et enfin le prochain départ de ma mère pour suivre son mari. Toutes ces nouvelles m’auraient peu satisfait si le général Bonaparte, en partant pour l’Italie, ne m’eût laissé entrevoir une consolation bien flatteuse. Il promettait de m’appeler auprès de lui dès que, par un travail assidu et fructueux, j’aurais réparé le temps que les circonstances m’avaient fait perdre. Je me mis au travail avec une nouvelle ardeur pour obtenir la récompense tant désirée, car, dès ma plus tendre jeunesse, j’ai eu une vocation décidée pour l’état militaire. Pendant quinze mois que je restai à Saint-Germain, les mathématiques, l’histoire, la géographie et la langue anglaise furent l’objet de mes occupations les plus vives; et j’appris enfin avec une joie inexprimable que j’allais recevoir incessamment le prix de mes efforts et de mon assiduité. Je reçus en effet, avec l’ordre de mon départ pour l’armée d’Italie, un brevet de sous-lieutenant au premier régiment de hussards sous la date du..... J’avais alors quinze ans.»