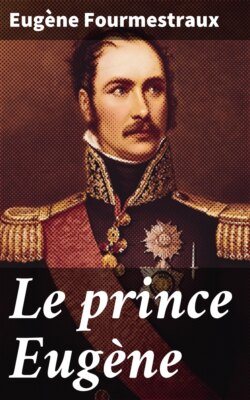Читать книгу Le prince Eugène - Eugène Fourmestraux - Страница 5
II
ОглавлениеCette date d’entrée dans la carrière militaire, qui échappait au prince Eugène au moment où il dictait ses mémoires, nous sommes en mesure de la donner ici, en reproduisant la teneur d’un état de services écrit par le Prince lui-même, à la date du 1er nivôse an XIII.
Voici cette pièce, que nous avons copiée aux archives de la guerre, dans le dossier du prince Eugène.
Services successifs de M. EUGÈNE-ROSE BEAUHARNAIS, colonel général des chasseurs à cheval, et général de brigade commandant ceux de la garde impériale, né à Paris, département de la Seine le 3 septembre 1781.
Certifié par moi, général de brigade, colonel général des chasseurs à cheval, commandant ceux de la garde impériale.
BEAUHARNAIS.
Paris, le Ier nivôse an XIII.
Voici maintenant la proposition faite par le général Bonaparte, pour garder auprès de lui le jeune Beauharnais en qualité d’aide de camp:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
LIBERTÉ.
ÉGALITÉ.
ARMÉE DE TERRE.
Proposition d’Aide de camp.
Le général Bonaparte, commandant en chef l’armée d’Italie, propose pour remplir sous ses ordres les fonctions d’aide de camp.
Le citoyen EUGÈNE BEAUHARNAIS,
sous-lieutenant au 1er régiment d’hussards, aide de camp depuis le 12 messidor an V.
Le Ministre est prié d’approuver cette demande et de vouloir bien signer la commission ci-jointe.
BONAPARTE.
Cette proposition a été approuvée par le ministre de la guerre, le 22 brumaire an vi (12 novembre 1797 ).
Quant à la nomination d’Eugène de Beauharnais au grade de sous-lieutenant, elle a été confirmée par Barras, président du Directoire exécutif, le 17 frimaire an VI ( 7 décembre 1797 ), en en faisant remonter l’ancienneté au 10 messidor an v (28 juin 1797), date de la nomination provisoire faite par le général en chef.
«Eugène arriva à Milan après Léoben . Il fit immédiatement le service d’aide de camp du général en chef, qui avait pour lui une grande tendresse, justifiée par ses bonnes qualités. Eugène avait un cœur excellent, un beau courage, une morale pure, beaucoup de loyauté, de franchise, d’obligeance et d’amabilité.»
«Ce n’était plus un enfant, mais ce n’était pas encore un homme . Son instituteur l’avait déclaré n’être bon à rien parce qu’il ne faisait ni un thème sans solécisme, ni une version sans contre-sens..... L’enfant reparaissait lorsque, dans la galerie du palais Serbelloni, au milieu des dames qui visitaient sa mère, il plaisantait et riait comme un page; mais, déjà, sa bravoure précoce et sa sérieuse loyauté attestaient l’homme en lui.»
Le traité de Campo-Formio, signé le 17 octobre 1797, suivit de quelques mois l’arrivée d’Eugène Beauharnais à l’armée d’Italie. Pendant le temps que durèrent les négociations préliminaires de ce célèbre traité, Eugène fut chargé de diverses reconnaissances et levées de terrain, tant sur l’Isonzo que dans les montagnes qui séparent la Drave du Tagliamento. Il fut ensuite chargé d’une mission près du gouvernement des îles Ioniennes que le nouveau traité reconnaissait comme république des Sept-Ilés.
Après vingt-quatre jours d’une traversée difficile, Eugène aborda à Corfou, où un sabre d’honneur lui fut offert.
«Durant mon séjour dans cette île, je m’étais répandu dans la société, dit-il, cherchant le plaisir, comme cela était naturel à mon âge. J’étais logé dans la maison du gouverneur, dont l’entrée donnait sur une espèce de cul-de-sac. Un soir que j’étais dans la société, trois individus inconnus, mais qui, à leur mine, pouvaient être pris pour des forçats, s’introduisirent dans mon appartement à l’aide de fausses clefs. Mon domestique, qui couchait dans la première pièce, effrayé de cette apparition, se tint immobile dans son lit. Les trois hommes, armés de poignards, traversèrent cette chambre, sans s’inquiéter du domestique, pour entrer dans la seconde que j’habitais. Voyant que mon lit était vide, ils se retirèrent sans mot dire et sans toucher à rien.
«Lorsque je rentrai, dans la nuit, mon domestique, encore plein d’effroi, me fit le récit de cette aventure que je m’empressai de communiquer le lendemain au gouverneur. J’appris de lui que l’action de ces trois hommes était probablement une vengeance méditée contre un officier français qui habitait cet appartement avant moi, et qui, depuis deux jours seulement, avait dû quitter l’île par ordre du gouverneur. Cette circonstance singulière m’aurait rendu victime d’une erreur, si je m’étais trouvé dans mon appartement lorsque les assassins s’y introduisirent.»
Le même brick de guerre qui avait transporté Eugène à Corfou fut chargé de le débarquer sur la côte du royaume de Naples. Ses ordres lui prescrivaient de rejoindre le général Bonaparte en passant par Naples, Rome et Florence.
Après avoir séjourné quelques jours à Naples, Eugène partit pour Rome. Il y trouva Joseph Bonaparte, alors ambassadeur de la République française près cette cour. Joseph avait avec lui sa femme et sa belle-sœur, Mlle Désirée Clary, qui devait épouser quelques jours plus tard le général Duphot.
Sur les instances qui lui furent faites, Eugène retarda son départ, afin d’assister à ce mariage.
Il survint à ce moment, à Rome, un événement qui produisit la plus vive sensation.
«Le gouvernement le plus près de sa ruine, dit M. Thiers , était le gouvernement papal. Ce n’était pas faute de se défendre; il faisait aussi des arrestations; mais un vieux pape, dont l’orgueil était abattu, de vieux cardinaux inhabiles, pouvaient difficilement soutenir un État chancelant de toutes parts. Déjà, par les suggestions des Cisalpins, la marche d’Ancône s’était révoltée et s’était constituée en république anconitaine. De là, les démocrates soufflaient la révolte dans tout l’État romain. Ils n’y comptaient pas un grand nombre de partisans, mais ils étaient assez secondés par le mécontentement public.....
«Les artistes français qui étaient à Rome, excitaient beaucoup les démocrates; mais Joseph Bonaparte tâchait de les contenir en leur disant qu’ils n’avaient pas assez de force pour tenter un mouvement décisif, qu’ils se perdraient et compromettraient inutilement la France; que, du reste, elle ne les soutiendrait pas et les laisserait exposés aux suites de leur imprudence. Le 26 décembre 1797, ils vinrent l’avertir qu’il y aurait un. mouvement. Il les congédia en les engageant à rester tranquilles, mais ils n’en crurent pas le ministre français. Le système de tous les entrepreneurs de révolutions était qu’il fallait oser engager la France malgré elle. En effet, ils se réunirent le 28 décembre pour tenter un mouvement.»
Ici, n’en déplaise à l’illustre historien que nous venons de citer, laissons parler le prince Eugène, témoin oculaire de cette échauffourée. Ce ne sera pas la seule fois, du reste, que nous trouverons l’occasion de rencontrer dans le récit ou dans la correspondance du Prince-soldat, quelque chose qui manque parfois aux grandes et belles pages écrites par M. Thiers, c’est-à-dire la simplicité qui exclut toute forme oratoire, toute réticence, et n’aime que le naturel.
«Les républicains, lisons-nous dans les Mémoires du prince Eugène, s’assemblèrent en tumulte et se portèrent en masse sous les fenêtres du palais de l’ambassade de France. Leur dessein était de proclamer la république, persuadés qu’ils étaient que le gouvernement pontifical n’était point instruit de leurs menées, et serait renversé par surprise. Mais ce gouvernement les suivait et les surveillait de près. Il envoya tout de suite vers le lieu du rassemblement un détachement d’infanterie et un piquet de cavalerie avec ordre de le dissiper et de faire main basse dessus en cas de résistance. La cavalerie, arrivée la première, fut reçue aux cris de: Vive la République! auxquels elle répondit en chargeant sur l’attroupement et sabrant tout ce qui se trouvait à sa portée. Environ quarante personnes furent blessées. La foule alors se précipita dans les cours du palais de l’ambassadeur de France pour y trouver un refuge. Les officiers français présents à Rome se trouvaient en ce moment réunis chez l’ambassadeur, et nous allions nous mettre à table pour dîner, lorsque cette scène tumultueuse eut lieu. Le général Duphot, qui était d’un caractère bouillant, crut y voir une insulte pour son gouvernement. Il mit le sabre à la main, nous ordonnant d’en faire autant et de le suivre. Chacun de nous, et l’ambassadeur lui-même, était persuadé qu’il ne s’agissait de notre part que de faire des efforts pour apaiser le tumulte et concilier les esprits; mais l’infanterie papale, qui avait pris poste à la porte de Transtevère, n’en jugea pas de même, et, voyant arriver vers elle cinq officiers français, le sabre à la main (suivis, il est vrai, par l’attroupement qui avait reflué dans le palais), elle nous accueillit par une fusillade assez vive qui atteignit mortellement le général Duphot et blessa une vingtaine de personnes parmi celles qui étaient derrière nous.
«Voyant qu’il n’y avait pas moyen de se faire entendre, l’ambassadeur se retira avec nous dans son palais, en profitant, pour opérer sa retraite, d’une petite ruelle qui communiquait avec les jardins. Rentrés dans l’hôtel de l’ambassade, nous fimes barricader les portes et préparer nos armes, craignant d’avoir à soutenir une espèce de siège. Cependant, les portes du palais furent respectées; seulement, quelques coups de fusil furent tirés contre les fenêtres. Pendant la nuit, l’ambassadeur fit demander ses passe-ports au gouvernement romain, et, les ayant obtenus, non sans peine, nous partimes de Rome avant le jour. Une particularité assez remarquable dans la scène de la veille, c’est qu’en voulant contenir les républicains exaltés qui s’étaient réfugiés dans les cours du palais de France, je frappai plusieurs fois du plat de mon sabre sur un des plus furibonds, nommé Céracchi, qui, plus tard, périt sur l’échafaud pour avoir attenté à la vie du Premier Consul.»
La violation du droit des gens commise contre la légation française par le gouvernement papal, avait excité la plus grande indignation en France. Le Directoire ordonna au général Berthier, qui commandait en Italie, de marcher sur Rome. Le 10 février 1798, nos troupes entrèrent dans la ville éternelle, et le pape, traité avec les égards dus à son àge, fut conduit en Toscane, où il reçut asile dans un couvent.