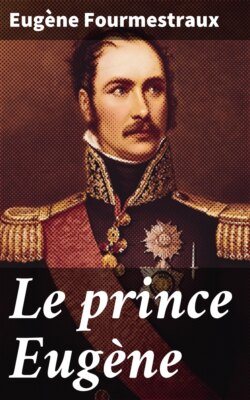Читать книгу Le prince Eugène - Eugène Fourmestraux - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV
ОглавлениеTable des matières
Après quarante jours de traversée, Bonaparte débarqua à Fréjus le 9 octobre 1799. De ce port, jusqu’à Paris, ce ne ╎fut qu’une acclamation populaire, une marche triomphale. A Lyon, surtout, l’enthousiasme fut porté jusqu’au délire. Le 16, Bonaparte était déjà dans son hôtel de la rue Chantereine, sans que personne se doutât de son arrivée à Paris. A partir de Lyon, il prit une autre route que celle qu’il avait indiquée à ses courriers, afin d’arriver incognito dans la capitale.
On a beaucoup parlé d’une scène conjugale qui eut lieu rue Chantereine, lors de ce retour d’Égypte. Le prince Eugène s’en explique avec sa franchise habituelle dans les termes suivants:
«Par un contre-temps fâcheux, ma mère, qui, à la première nouvelle de notre débarquement, était partie pour venir au devant de Bonaparte jusqu’à Lyon, prit la route de Bourgogne, tandis qu’il passait par le Bourbonnais. Nous arrivâmes à Paris quarante-huit heures avant elle, en sorte que les ennemis de ma mère eurent le champ libre et mirent ce temps à profit pour lui nuire dans l’esprit de son mari. J’en jugeai ainsi à la froideur de l’accueil qu’il lui fit, et je vis avec chagrin qu’il avait conservé les mauvaises impressions que je m’étais efforcé de détruire lors des confidences qu’il me faisait en Égypte.
«De très-bonne heure, en effet, l’on vit se former contre Joséphine une ligue (le mot ne dit pas trop) dans laquelle entrèrent, à diverses reprises, quelques membres de la famille Bonaparte, qui, depuis, l’ont regretté. Le général n’eut pas de peine à démêler ce qu’il y avait au fond de cette insistance. Aussi, après un premier emportement bientôt calmé, il rendit à sa femme sa confiance et son affection, et à partir de ce moment, il ne cessa de vivre avec elle dans la plus entière union et la plus parfaite estime.»
Trois semaines après son retour à Paris, le général Bonaparte allait devenir l’arbitre des destinées de la France. M. Thiers a retracé le 18 brumaire dans des pages inimitables, et cependant, c’est avec le plus vif intérêt, qu’après avoir admiré ce grand tableau de maître, nous nous plaisons à retrouver dans les notes dictées par le prince Eugène, le récit des impressions personnelles du jeune et fidèle aide de camp du général Bonaparte.
«J’étais trop jeune alors, dit le prince Eugène, et trop peu initié aux affaires publiques pour avoir pu suivre dans tous leurs détails les circonstances qui précédèrent et amenèrent la révolte du 18 brumaire; j’étais d’ailleurs uniquement occupé, comme je l’ai été toute ma vie, du soin de remplir mes devoirs sans chercher à m’immiscer dans des objets qui leur étaient étrangers. Je me bornerai donc à dire ce que mon service me mit à même de remarquer.
«Dès les premiers jours de brumaire, de fréquentes entrevues eurent lieu entre le général Bonaparte et d’autres personnages marquants, soit du gouvernement, soit de l’armée. Une correspondance secrète et active, dont j’étais souvent l’intermédiaire, me fit soupçonner qu’il se préparait un grand événement. L’ordre que nous reçûmes immédiatement de tenir nos armes et nos chevaux prêts ne me laissa plus aucun doute à cet égard. Dans les nuits qui précédèrent le 18 brumaire, je fus envoyé chez le général Moreau et chez M. Garat, et le 18 brumaire au matin, le général Bonaparte m’envoya au conseil des Anciens, pour lui annoncer qu’il allait se rendre dans son sein. Je m’acquittai de cette commission avec le trouble que la présence d’une assemblée aussi importante devait faire éprouver à un jeune homme qui parlait en public pour la première fois.
«Le général Bonaparte arriva, bientôt, et après un discours dans lequel il peignait la malheureuse situation de la France et la faiblesse du gouvernement, il fit sentir la nécessité de porter remède à cet état de choses, et finit par proposer la déchéance du Directoire et la translation des deux conseils à Saint-Cloud. Cette proposition fut adoptée à une grande majorité par le conseil des Anciens, dont presque tous les membres paraissaient d’accord avec le général. Le commandement des troupes lui fut confié, ainsi que des pouvoirs pour mettre à exécution la mesure qui venait d’être décrétée.
«En sortant de la séance, le général harangua les troupes avec force, et leur dit que la patrie n’espérait plus qu’en elles pour son salut. Les troupes répondirent avec enthousiasme à cet appel. Un détachement commandé par le général Moreau avait déjà été envoyé au palais du Luxembourg pour s’en emparer et en expulser les membres du Directoire.
«Le lendemain, 19 brumaire, nous marchâmes sur Saint-Cloud, où les deux conseils étaient assemblés. Tout ce qui s’y passa est connu. Je pus juger combien la discussion était animée au conseil des Cinq-Cents par les continuelles allées et venues de plusieurs de ses membres du lieu des séances au cabinet du général Bonaparte. Enfin, on vint lui annoncer que les choses étaient arrivées à un tel point, que sa présence devenait indispensable. Il sortit aussitôt pour se rendre au conseil des Cinq-Cents. En traversant les cours, il fut entouré par des groupes de militaires qui paraissaient fort animés. Quelques grenadiers qui se pressaient autour de lui m’en séparèrent de quelques pas, en sorte que je ne pus voir qu’imparfaitement son entrée dans la salle. La seule chose qui me frappa, ce fut les cris de: Hors de la salle! A bas! Hors la loi le général Bonaparte! Je n’ai point vu de poignard levé sur lui, mais je ne puis néanmoins affimer que le fait n’ait pas eu lieu.
«Le général Bonaparte se retira de la salle dans un grand état d’agitation. Ses traits étaient altérés, et la situation critique dans laquelle il se trouvait, explique assez cette altération. Il s’agissait de réussir ou de périr ignominieusement sur l’échafaud. Rentré dans les cours, il harangua les troupes avec véhémence et donna l’ordre de faire évacuer la salle par la force armée, ce qui fut exécuté. Le gouvernement des consuls provisoires fut ensuite proclamé par le conseil de Anciens, et accepté par la minorité du conseil des Cinq-Cents qui était restée à Saint-Cloud. Le reste s’était sauvé à travers les jardins, abandonnant toges, bonnets et écharpes, qu’on trouva semés partout.
«Vers minuit je fus envoyé près de ma mère pour la rassurer et lui rendre compte du résultat de cette journée.
«Le nouveau gouvernement ayant été proclamé, nous allâmes nous installer au Petit-Luxembourg. Le service d’aide de camp devint alors peu agréable pour moi, qui avais toujours servi militairement et qui étais passionné pour mon métier. Nous passions les journées dans un salon d’attente avec un huissier, et nous remplissions à peu près les mêmes fonctions que lui. Cela ne pouvait me convenir, et je cherchai à sortir de cette situation. La création d’une garde pour les consuls m’en fournit bientôt l’occasion. Je fus trouver le général Bonaparte et lui demandai à entrer dans cette garde, en lui expliquant franchement les motifs qui me portaient à lui faire cette demande et sans lui déguiser la répugnance que j’avais alors pour mon service d’aide de camp. Il ne m’en sut point mauvais gré ; il applaudit, au contraire, à ma résolution ainsi qu’aux sentiments que je lui manifestais, et me donna, avec le grade de capitaine, le commandement de la compagnie des chasseurs à cheval de la garde. Rien ne pouvait m’être plus agréable, et je me livrai à l’étude de mon état avec autant d’amour que d’ardeur,»
Dès le 11 novembre 1799, les consuls provisoires Bonaparte, Siéyès et Roger-Ducos avaient remplacé au Luxembourg le Directoire, et ils s’occupèrent sur-le-champ de préparer la constitution qui devait régir la France.
Cette nouvelle constitution, dite constitution de l’an VIII, ne tarda pas à paraître. En vertu de ses dispositions, le général Bonaparte était nommé premier consul, Cambacérès et Le Brun deuxième et troisième consuls. Le sénat conservateur s’établit au Luxembourg, le Corps législatif au Palais-Bourbon, le tribunat au Palais-Royal, et les Tuileries furent assignées aux consuls pour leur résidence.
«Le choix de ce lieu n’était pas indifférent. Ancienne demeure des rois, symbole de la puissance souveraine, le palais des Tuileries, restitué à sa destination primitive, indiquait à tous qu’en France l’autorité était véritablement reconstituée. Il fallut d’abord rendre habitable ce vaste palais qu’avait traversé plusieurs fois depuis dix ans le torrent populaire. Dès qu’il eut été convenablement approprié, le Premier Consul se décida à y transporter sa résidence. Cette détermination n’était pas sans hardiesse. Il voulut l’exécuter franchement, même avec apparat, comme un homme qui prend possession du rang qu’il sait et sent lui être dû.
«Le 19 février 1800, il sortit du Luxembourg avec ses collègues dans un carrosse attelé de six chevaux blancs, présent de l’empereur d’Autriche au négociateur de Campo-Formio; vingt-six autres voitures contenant les principaux personnages de l’État suivaient la sienne. Ce cortège était précédé et escorté par quatre mille hommes pris dans les anciennes troupes d’Italie et d’Allemagne, et commandés par Lannes, Murat et Bessières. La foule accueillit son passage par de vives acclamations. Arrivé dans la cour des Tuileries, le Premier Consul monta à cheval pour passer la revue des troupes, pendant que Joséphine, qui l’avait précédé avec la famille Bonaparte, jouissait de ce spectacle des fenêtres du palais.»
Bonaparte s’établit au premier étage du palais des Tuileries, dans les appartements occupés autrefois par la famille royale.
Cet hiver de 1799, fut mis à profit par Eugène pour s’initier à tous les détails de la carrière à laquelle il s’était voué avec tant d’ardeur. «Les années du consulat, dit M. de Norvins, furent la troisième époque de l’instruction militaire d’Eugène de Beauharnais. Il étudia la pratique de son métier, et y acquit cette habileté qui le fit bientôt remarquer parmi les premiers colonels de l’armée.»
C’était en vain que le Premier Consul avait adressé, dans le langage le plus élevé, des instances aux cabinets de l’Europe pour obtenir la paix. Cette paix, réellement et sincèrement désirée, lui était refusée; il ne lui restait plus qu’à faire la guerre à la coalition.
Une armée sous les ordres du général Moreau devait passer le Rhin pour pénétrer en Allemagne, tandis qu’une armée de réserve commandée par le Premier Consul en personne, devait se porter sur les Alpes.
Au mois de mai 1800, Eugène reçut l’ordre de partir avec l’armée de réserve qui s’était rassemblée pour effectuer le passage du mont Saint-Bernard.
Le 13 mai, le Premier Consul était à Lausanne. Le général Marescot, chargé de la reconnaissance des Alpes, s’était prononcé pour le passage du Saint-Bernard, tout en considérant l’opération comme très-difficile. — «Difficile, soit, répondit le Premier Consul; mais est-elle possible? — Je le crois, répliqua le général Marescot, mais avec des efforts extraordinaires. — Eh! bien, partons,» fut la seule réponse du Premier Consul.
Tout le monde sait comment s’effectua ce passage à jamais célèbre dans l’histoire. Les arts ont dépeint Bonaparte franchissant les neiges des Alpes sur un cheval fougueux. La simple vérité, comme le dit M. Thiers, c’est qu’il gravit le Saint-Bernard monté sur un mulet, et revêtu de cette redingote grise qu’il a toujours portée depuis. Il était conduit par un guide du pays, montrant dans les passages les plus difficiles la distraction d’un esprit tout occupé des plus vastes pensées.
Tandis que les pièces de notre artillerie, traînées à bras, passaient sous le feu du fort de Bard, le général Lannes marchait à la tête de son infanterie. Eugène assista au combat de Buffalora, ou commandait Murat, qui fit preuve d’une grande vigueur dans cette affaire. L’armée suivit tout entière ce mouvement général sur Milan, et nos troupes poussèrent vigoureusement l’ennemi devant elles. On resta trois jours à Milan, où le Premier Consul s’occupa de réorganiser le gouvernement républicain. Après quelques jours de repos, il dirigea toutes ses colonnes jusqu’à l’Adda et jusqu’au Pô.
La bataille de Montebello, qui eut lieu le 9 juin 1800, fut pour Lannes une journée de triomphe. Eugène, qui avait été envoyé dans la direction de Plaisance pour établir une communication avec Murat, témoigna à son retour le plus grand regret de n’avoir pu assister à cette brillante affaire.
Le Premier Consul arriva dans le moment même où finissait cette bataille, dont il avait prévu à l’avance, dans son plan de campagne, le lieu et le jour. Lorsqu’il arriva près du général Lannes, il le trouva couvert de sang, mais ivre de joie, et les troupes enchantées de leurs succès. Les conscrits s’étaient montrés dignes de rivaliser avec les vieux soldats, et cette journée coûta à l’ennemi quatre mille prisonniers et trois mille hommes tués ou blessés. La victoire avait été pour nous difficile à remporter, puisque douze mille combattants, tout au plus, en avaient rencontré dix-huit mille.
Le 11 juin, arriva au quartier général l’illustre Desaix, qui venait de quitter l’Égypte. Il avait pour le Premier Consul l’attachement le plus dévoué, et celui-ci le considérait comme un frère. Ils passèrent toute une nuit à s’entretenir dans les termes les plus affectueux et les plus intimes. Eugène put aussi serrer la main de Dessaix qui, semblant pressentir sa fin prochaine, dit à son jeune compagnon d’armes: «Autrefois, les balles autrichiennes me connaissaient; j’ai bien peur qu’elles ne me reconnaissent plus maintenant.»
Le Premier Consul donna sur-le-champ à Desaix le commandement de deux divisions.
Le 13 juin, l’armée française passa la Scrivia et déboucha dans l’immense plaine qui s’étend entre cette rivière et la Bormida, plaine que le nom de Marengo a rendue à jamais célèbre. «Là, avait dit le Premier Consul, là, à cette place, je battrai le général Mélas.» Comme il l’avait prévu dans les immortelles conceptions de son génie, ce fut sur ce point que le choc des deux armées eut lieu le 14 juin 1800.
Le 13 au soir, veille de l’une des grandes journées de l’histoire, le Premier Consul coucha au village de Torre-di-Garofolo, et il s’endormit paisiblement.
«Le lendemain matin, dit le prince Eugène, une forte canonnade se fit entendre du côté d’Alexandrie. Bientôt le Premier Consul apprit que l’ennemi débouchait en force dans la plaine d’Alexandrie, et qu’une grande bataille était inévitable. On peut juger de l’inquiétude du général Bonaparte et de la colère qu’il éprouva des faux rapports qu’on-lui avait faits la veille. Des ordres furent expédiés en toute hâte pour rappeler le général Desaix, qu’on trouva près de Novi, et qui, malgré cet éloignement, arriva encore assez à temps pour prendre part à l’action et décider le gain de la bataille.
«Notre mouvement de retraite commença vers midi et continua jusqu’à quatre heures. C’est dans cet intervalle de temps que la garde commença à prendre une part plus active à l’affaire. Les troupes de ligne étaient fatiguées et découragées. Le Premier Consul nous envoya pour les soutenir. Le général Lannes, pressé un peu vivement par l’ennemi, voulut faire exécuter une charge qui ne réussit pas; il avait devant lui deux bataillons et deux pièces d’artillerie, derrière lesquels était une masse de cavalerie en colonnes serrées; ses troupes se retiraient en désordre, en sorte que pour avoir le temps de respirer et de les rallier, il ordonna au colonel Bessières, qui nous commandait, de charger sur la colonne ennemie. Le terrain était peu favorable, car il fallait traverser des vignes; cependant, nous passâmes et arrivâmes à portée de fusil de ces deux bataillons qui nous attendaient l’arme au bras et dans la plus belle contenance; le colonel Bessières nous ayant formés, se préparait à commander la charge, lorsqu’il s’aperçut que la cavalerie ennemie se déployait sur notre gauche et allait nous tourner. En conséquence, il fit faire demi-tour à gauche, et nous traversâmes la vigne sous le feu de la mitraille et de la mousqueterie. Mais arrivés de l’autre côté, nous fîmes assez bonne contenance pour en imposer à la cavalerie ennemie. Le général Lannes fut très-mécontent de cette opération et s’en plaignit amèrement. Cependant, il est probable que si nous avions exécuté ses ordres, peu d’entre nous en seraient revenus. Pendant la retraite, mes chasseurs furent chargés de détruire les munitions que nous étions forcés d’abandonner, et ils s’acquittèrent de cette mission avec une grande intrépidité, attendant souvent qu’ils fussent joints par l’ennemi pour mettre le feu aux caissons et sauter ensuite à cheval.
«Enfin, vers cinq heures, le général Desaix nous joignit, et le Premier Consul put reprendre l’offensive. Les troupes du général Lannes, encouragées par ce renfort, se reformèrent, et bientôt l’attaque commença, ainsi que la marche rétrograde de l’ennemi. La cavalerie du général Kellermann fit une fort belle charge à notre gauche, et vers le soir, la cavalerie de la garde en fit une non moins brillante. Quoique le terrain ne nous favorisât pas, puisque nous eûmes deux fossés à franchir, nous nous précipitâmes avec vigueur sur une colonne de cavalerie beaucoup plus nombreuse que nous, au moment où elle se déployait. Nous la poussâmes jusqu’aux premiers ponts des eaux de la Bormida, toujours sabrant. La mêlée dura dix minutes. Je fus assez heureux d’en être quitte pour deux coups de sabre sur ma chabraque. Le lendemain, le Premier Consul, sur le compte qui lui fut rendu de cette affaire, nie nomma chef d’escadron. Ma compagnie avait souffert, car de cent quinze chevaux que j’avais le matin, il ne m’en restait plus que quarante-cinq le soir; il est vrai qu’un piquet de quinze chasseurs était resté près du Premier Consul, et que beaucoup de chasseurs démontés ou blessés légèrement, rentrèrent successivement.»
C’est dans ces termes simples que le prince Eugène a constamment l’habitude de parler de tout ce qui lui est personnel. Cette fois, enfin, l’historien du Consulat et de l’Empire veut bien accorder une mention honorable à cet intrépide jeune homme.
«Les corps des généraux Kaim et Haddick, dit-il, veulent en vain tenir au centre. Lannes ne leur en laisse pas les moyens, les jette dans Marengo et va les pousser dans le Fontanone, et du Fontanone dans la Bormida. Mais les grenadiers de Weidenfeld tiennent tête un instant pour donner à O’Reilly, qui s’était avancé jusqu’à Cassina-Grossa, le temps de rebrousser chemin. De son côté, la cavalerie autrichienne essaye quelques charges pour arrêter la marche des Français, mais elle est ramenée par les grenadiers à cheval de la garde consulaire que conduisent Bessières et le jeune Beauharnais.
«Lannes et Victor, avec leurs corps réunis, se jettent enfin sur Marengo, et culbuttent O’Reilly ainsi que les grenadiers de Weidenfeld. La confusion sur les ponts de la Bormida s’accroît à chaque instant. Fantassins, cavaliers, artilleurs s’y pressent en désordre. Les ponts ne pouvant pas contenir tout le monde, on se jette dans la Bormida pour passer à gué. Un conducteur d’artillerie essaye de la traverser avec la pièce de canon qu’il conduisait. Il y réussit. L’artillerie tout entière veut alors suivre son exemple, mais une partie des voitures reste engagée dans le lit de la rivière. Les Français, ardents à la poursuite, prennent hommes, chevaux, canons, munitions, vivres et bagages. L’infortuné baron de Mélas qui, deux heures auparavant, avait laissé son armée victorieuse, était accouru au bruit de ce désastre et n’en pouvait croire ses yeux. Il était au désespoir.
«Cette sanglante bataille de Marengo exerça une immense influence sur les destinées de la France et du monde; elle donna, en effet, dans le moment, la paix à la République, et un peu plus tard, l’Empire au Premier Consul. Elle fut cruellement disputée, et elle en valait la peine, car jamais résultat ne fut plus grand pour l’un et pour l’autre des deux adversaires. M. de Mêlas se battait afin d’éviter une affreuse capitulation; le général Bonaparte jouait en ce jour toute sa fortune. Les pertes, vu le nombre des combattants, furent immenses et hors de toutes les proportions habituelles. Les Autrichiens perdirent huit mille hommes en morts ou blessés, et plus de quatre mille prisonniers. Leur état-major fut cruellement décimé ; le général Haddick fut tué ; les généraux Vogelsang, Lattermann, Bellegarde, Lamarsaille, Gottesheim furent blessés; et, avec eux, un grand nombre d’officiers. Ils perdirent donc, en hommes hors de combat ou pris, le tiers de leur armée, si elle était de trente-six à quarante mille hommes, comme on l’a dit généralement. Quant aux Français, ils eurent six mille tués ou blessés. On leur enleva un millier de prisonniers, ce qui présenta encore une perte d’un quart sur vingt-huit mille soldats présents à la bataille. Leur état-major était aussi maltraité que l’état-major autrichien. Les généraux Mainony, Rivaud, Malher, Champeaux étaient blessés, le dernier mortellement.
«La plus grande perte était celle de Desaix. La France n’en avait pas fait une plus regrettable depuis dix ans de guerre. Aux yeux du Premier Consul, cette perte fut assez grande pour diminuer chez lui la joie de la victoire. Son secrétaire, M. de Bourrienne, accourant pour le féliciter de ce miraculeux triomphe, lui dit: «Quelle belle journée! — Oui, bien belle, répondit le Premier Consul, si ce soir j’avais pu embrasser Desaix sur le champ de bataille. J’allais le faire ministre de la guerre, ajouta-t-il; je l’aurais fait prince si j’avais pu.»
Le vainqueur de Marengo ne se doutait pas encore qu’il pourrait bientôt donner des couronnes à ceux qui le servaient.
L’infortuné Desaix était gisant auprès de San-Giuliano au milieu de ce vaste champ de carnage. Son aide de camp Savary, qui lui était depuis longtemps attaché, le cherchant au milieu des morts, le reconnut à son abondante chevelure. Il le recueillit avec un soin pieux, l’enveloppa dans le manteau d’un hussard, et, le plaçant sur son cheval, le transporta au quartier général de Torre-di-Garofolo.
Le lendemain de la bataille de Marengo un armistice fut conclu, ainsi qu’une convention pour l’évacuation de l’Italie.
Le Premier Consul retourna à Milan, où il fut accueilli avec un enthousiasme indescriptible, enthousiasme que nous avons vu se reproduire dans des conditions presque identiques lorsque, après Magenta, Napoléon III fit son entrée dans cette ville.
Le 28 juin, Bonaparte fit route vers la France, mais la garde était déjà partie de Milan le 22 du même mois, avec ordre d’arriver à Paris le 14 juillet, anniversaire de la première fédération, qui, à cette époque, était encore une fête nationale.
Eugène choisit pour sa troupe la route du petit Saint-Bernard. Sa marche fut très-rapide, et il fut obligé, presque sur tout son itinéraire, de doubler et de tripler les journées d’étapes. A Genève, les autorités lui donnèrent un grand repas dont Mme de Staël fit les honneurs.
«Nous étions chargés, dit le prince Eugène, de conduire et d’escorter les drapeaux pris à Marengo. Nous arrivâmes à Paris de manière à entrer dans cette ville à dix heures du matin, et fûmes droit aux Tuileries, d’où nous nous rendîmes aux Invalides, avec le Premier Consul, pour y déposer les drapeaux. On alla ensuite au Champ-de-Mars, où la grande fête avait lieu. Les troupes des dépôts de la garde, par leur propreté et leur belle tenue, offraient un contraste frappant avec celles qui revenaient de l’armée d’Italie, maigres, harassées et couvertes de poussière. Mais ce contraste ne fit que redoubler l’enthousiasme et la vénération qu’inspirait aux Parisiens la présence de nos braves soldats. Nous fîmes le tour du Champ-de-Mars devant la foule innombrable qui couvrait les talus et qui nous accueillit partout avec un tonnerre d’applaudissements et d’acclamations. Ce fut un des plus beaux moments’ de ma vie. Ces témoignages de l’estime et de la reconnaissance publiques me paraissaient la plus belle et la plus douce récompense de nos fatigues. Ils m’inspiraient un noble orgueil et une vive émotion. L’armée avait en moins de deux mois accompli de grands travaux et sauvé la patrie.
«Aussitôt après notre retour à Paris, le Premier Consul augmenta sa garde. Les deux escadrons de grenadiers à cheval furent portés à quatre. Ma compagnie de chasseurs à cheval devint un escadron, et l’ordre fut donné pour qu’au bout d’un an cet escadron devînt un régiment. Je continuai pendant cet hiver à m’occuper avec ardeur des détails de mon métier pour m’efforcer de devenir de plus en plus digne du commandement qui m’attendait. Mon couvert était toujours mis chez le Premier Consul, mais j’usais discrètement de cette faveur. Cependant, je venais tous les jours pour prendre ses ordres et pour embrasser ma mère. Un jour que j’avais dîné avec Bessières, je me rendis comme de coutume avec lui chez le Premier Consul qui devait aller ce soir même à l’Opéra. Ma mère était déjà sortie pour faire sa toilette lorsque nous entrâmes. Le Premier Consul vint à nous et nous dit avec un air riant et du visage le plus calme: «Eh! bien, vous ne savez pas, on veut m’assassiner ce soir à l’Opéra.» Nous nous récriâmes d’horreur, lui témoignant en même temps notre étonnement sur ce qu’il persistait à se rendre au spectacle; mais il nous dit de nous tranquilliser et nous assura que toutes les mesures étaient prises par la police pour déjouer cette tentative. Ensuite, il dit à Bessières de faire de son côté ce qu’il jugerait nécessaire pour sa sûreté. Celui-ci, qui commandait la cavalerie de la garde, m’ordonna de me rendre à l’Opéra avec un piquet de chasseurs, et de prendre les mesures convenables à la circonstance. Arrivé sur les lieux, je fis mettre pied à terre à la moitié des chasseurs, et après avoir donné la consigne aux autres, j’entrai à l’Opéra, précédant le Premier Consul de cinquante pas, et précédé moi-même de mes chasseurs, de manière à faire croire aux personnes qui étaient dans l’intérieur que j’étais le Premier Consul. Tout d’un coup je fais faire halte à mes chasseurs, front à droite et à gauche. Je me range, et le Premier Consul passe tranquillement au milieu d’eux et entre dans sa loge. Au même moment, les conjurés, au nombre desquels étaient Aréna, corse, et Céracchi, romain, furent arrêtés dans la salle. On trouva sur eux des poignards et des pistolets. Ils furent jugés, reconnus coupables, et portèrent leur tête sur l’échafaud.»
Si nous nous reportons un instant à la vie intérieure de Joséphine et de ses deux enfants à l’époque du Consulat, nous voyons que cette existence, que nous avons décrite dans un autre livre , était aussi simple que digne.
Ses réceptions étaient alors très-suivies. «Il ne fut pas très-facile de discipliner le salon du Premier Consul et de classer les amours-propres qui s’y rencontraient. Pour toutes les femmes qui en formaient la société ordinaire, la transition avait été brusque comme pour leurs maris. La grâce et la bienveillance de Mme Bonaparte apprivoisèrent celles qu’effarouchaient l’étiquette naissante d’un palais et surtout le rang et la gloire du Premier Consul. La Cour était alors ce qu’elle devait être, peu nombreuse mais décente. Le titre de Madame fut généralement rendu aux femmes chez le Premier Consul et dans les billets d’invitation qu’il leur faisait adresser. Ce retour à l’ancien usage gagna bientôt le reste de la société.»
«Outre ses réceptions du soir, Joséphine avait l’habitude d’inviter de temps en temps à des déjeuners tout à fait intimes, les plus jeunes de ses assidues dont la timidité redoutait la supériorité des hommes distingués que l’on voyait au palais, et qui. avaient encore besoin d’encouragements et de conseils. En causant avec Mme Bonaparte pendant ce déjeuner, repas toujours sans aucune cérémonie, de modes, de spectacles, de petits intérêts de société ; ces jeunes femmes s’enhardissaient et devenaient bien moins tapisserie pour le salon du Premier Consul lorsqu’il venait y chercher quelque distraction. Mme Bonaparte faisait les honneurs de ce déjeuner avec une grâce charmante.»
C’est dans le salon de famille que Bonaparte était véritablement lui-même, saris préoccupation de son rôle et sans contrainte. C’est là qu’il était surtout intéressant de le voir et de l’entendre, au milieu d’une société plus restreinte où il se laissait aller à tout l’élan de sa pensée, à toute l’inspiration de sa parole. Mais c’est à la Malmaison que le Premier Consul passait tous les moments qu’il pouvait dérober aux affaires. C’était surtout la veille de chaque décadi que le château s’apprêtait pour le plaisir et pour les fêtes.
Un des délassements les plus recherchés et les plus en faveur à la Malmaison à cette époque, c’était la comédie. Au nombre des acteurs les plus habituels, Eugène Beauharnais brillait au premier rang.
«Le Premier Consul, dit Bourrienne, nous avait fait construire une fort jolie petite salle de spectacle. Nos comédiens ordinaires étaient Eugène Beauharnais, Hortense, Mme Murat, Lauriston, Didelot, quelques autres personnes de la maison du Premier Consul, et moi. Les pièces que le Premier Consul aimait le plus à voir représenter par nous étaient le Barbier de Séville et Défiance et Malice. Dans le Barbier de Séville, Lauriston jouait le rôle du comte Almaviva; Hortense, Rosine; Eugène, Bazile; Didelot, Figaro; moi, Bartholo, et Isabey, l’Éveillé. Notre répertoire se composait encore des Projets de mariage, de la Gageure, du Dépit amoureux, où je jouais le rôle du valet, et de l’Impromptu de campagne, où je représentais le baron, ayant pour baronne la jeune et joliè Caroline Murat.
«Hortense jouait à merveille, Caroline médiocrement, Eugène très-bien, Lauriston était un peu lourd, Didelot passable, et j’ose assurer que je n’étais pas le plus mauvais de la troupe. Si, d’ailleurs, nous n’étions pas bons, ce n’était pas faute de bonnes leçons et de bons conseils. Talma et Michot venaient nous faire répéter, tantôt en commun, tantôt séparément».
Tout en prenant sa bonne part à ces douces récréations de l’esprit, Eugène travaillait sérieusement à acquérirles connaissances les plus étendues dans la science militaire. Le Premier Consul le nomma colonel en 1802 (21 vendémiaire an XI), et lui confia des inspections successives. Eugène était toujours chargé de commander les manœuvres sous ses ordres, et il s’en acquittait parfaitement. Il ne tarda pas à être nommé général de brigade, et il fut chargé, au moment où la conspiration de Pichegru fut découverte, de la garde des barrières et des boulevards extérieurs de Paris. Ce service pénible demandait une grande activité ; Eugène fit preuve, dans ces circonstances, d’une vigilance que rien ne put tromper.
Lorsque le procès de Pichegru fut terminé, les parents et amis des condamnés affluèrent à Saint-Cloud pour demander leur grâce; c’était surtout à la bonne Joséphine qu’ils s’adressaient, et Eugène fut souvent témoin de ces sollicitations. Il dit à ce sujet dans ses Mémoires: «Ma mère fut assez heureuse pour obtenir du Premier Consul la vie de plusieurs condamnés, parmi lesquels je me rappelle MM. de Rivière et de Polignac. Le premier a saisi, depuis, la première occasion qui s’est présentée pour m’en témoigner sa reconnaissance.»
Toutes ces tentatives faites contre le pouvoir et la vie du Premier Consul n’avaient servi qu’à accroître sa puissance et à augmenter, s’il était possible, son immense popularité.