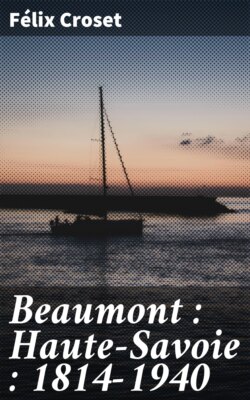Читать книгу Beaumont : Haute-Savoie : 1814-1940 - Félix Croset - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Quelques mésaventures et tribulations de syndics et maires
ОглавлениеTable des matières
Un syndic bien «emmouscaillé »
On a volé le cachet (sceau) communal détenu par le syndic. Par lettre adressée à l’intendant à Saint-Julien, province de Carouge, le syndic, M. Grivet, relate les faits:
J’ai l’honneur de vous prévenir que hier, le 23 du mois d’août 1830, les voleurs sont entrés chez moi sur les dix heures et demie du matin pendant que la maison était seule. Ils ont forcé les barrots (sic) d’une fenêtre, ils m’ont pris six cents livres avec le cachet de la paroisse, et ce vol a été fait pendant que ma femme assistait à un service funèbre qui se faisait à la paroisse. J’ai l’honneur d’être, avec un profond respect, votre obéissant et fidèle serviteur.
Puis le malheureux syndic, très ennuyé, fait adresser une lettre à l’intendant par le secrétaire communal, dont voici le texte:
Monsieur l’Intendant,
Vous avez été informé, Monsieur, qu’il s’est commis dernièrement un vol chez e sieur Grivet, syndic de la commune de Beaumont et que dans le nombre des objets volés se trouve le cachet de la commune, d’où il peut résulter plusieurs inconvénients. D’abord par le motif qu’il ne peut plus être apposé sur les pièces qu’il est appelé à délivrer. Si les voleurs avaient commis ce vol dans l’intention e s’en servir et faire de fausses pièces, ce dernier motif me fait imaginer qu’il serait prudent de faire une remarque (sic) à celui que l’on fera faire, par exemple en faisant figurer le millésime.
Comme il est urgent de remplacer le cachet, Monsieur le Syndic m’a chargé e vous consulter à ce sujet. Veuillez bien me faire part des mesures que vous croirez les plus convenables en cette circonstance.
Dans l’attente...
Une affaire embarrassante aux conséquences inattendues
Durant cinq ans, un bien curieux litige a opposé un propriétaire terrien à la commune.
En 1832, pour permettre l’élargissement du chemin du Châble à Beaumont par Jussy, un poirier a dû être abattu. Bien évidemment, le propriétaire a réclamé une indemnité... par devant le tribunal de préfecture de Saint-Julien. Une forte somme aurait été accordée au demandeur.
Cette affaire à rebondissements, avec un véritable chassé-croisé de correspondances, délibérations du conseil, etc., ne connaîtra son épilogue qu’en 1837.
Le 31 mars 1837, l’intendant a mandé l’adjudant du Génie Mollot de faire un rapport avec consultation de témoins sur l’emplacement, la taille, la grosseur, l’ancienneté, la valeur du bois et la production annuelle de cet arbre, abattu depuis cinq ans. Voici quelques-unes des estimations des “experts” :
Le syndic a dit que cet arbre était bien âgé, qu’il pouvait avoir cinq pieds de circonférence ce qui fait 1 pied 7 pouces de taille, que le produit de ce poirier était de beau fruit quoique sauvage et pouvait faire cinq seytiers de cidre lors d’une bonne récolte, et comme ces arbres saisonnent et en égard au gel on peut évaluer cette récolte à tous les quatre ans, ce qui produirait cinq seytiers dans trois ans (...) le bois peut avoir produit un moule valant trente livres et cinquante fascines valant huit livres; il observe en outre que l’usage du pays lorsque l’on donne à faire le cidre est de laisser un tiers du liquide à celui qui a ramassé, pilé et pressé le fruit, en sorte que les deux tiers forment le revenu net.
Paul Marin dit que cet arbre pouvait avoir quatre pieds et demi de circonférence, qu’il pouvait durer encore douze ans avant de péricliter (...) que lui-même a un poirier plus gros qui, la meilleure année ne lui a produit que cinq seytiers mais que les deux années suivantes, il n’en récoltait pas, soit par rapport qu’il saisonne et au gel (...). Cet arbre peut avoir produit trois quart de moule de bois (...).
Claude Pillet (...) Il peut avoir produit un demi moule de bois évalué à vingt livres et porte à trois livres cinquante centimes le seytier de cidre; cet arbre pouvait produire pendant 20 ans, les branches nuisaient au champ et gênaient sur le chemin pour le passage d’un homme à cheval [...]. Cet arbre était un peu vieux, mais pouvait produire pendant plus de trente ans (...). Symphorien Duchâble dit que l’arbre avait de cinq pieds et demi à six pieds de circonférence (...). Tous s’accordent à dire que cet arbre n’était pas très élevé, son tronc pouvait avoir de huit à neuf pieds jusqu’aux branches (...).
Les experts évaluent ensuite, suivant de savants calculs, le montant que devra toucher le propriétaire. Il accepte la somme de 36 L 90 à titre de dommage et demande que la commune prenne à sa charge les frais entraînés par la procédure que l’intéressé évalue à 72 L. Le conseil double, en juillet, à l’invitation de l’intendant, conteste cette note de frais et déclare ne vouloir payer que les frais du rapport Mollot, soit 21 L.
Pour clore ce litige, l’intendant, au vu de cette délibération, déclare le 5 juillet que la commune devra payer 25 L 27 à titre d’indemnité du dommage causé et 18 L 20 pour frais de procédure. A partir du 15 janvier 1851, en signe de protestation, le docteur Despré, syndic depuis près de quatre ans et qui fut contesté à plusieurs reprises, décide de «boycotter» les séances du conseil communal. En avril, il résilie le bail de location de la salle consulaire, située chez lui, puis démissionnera de ses fonctions de syndic.
Son successeur, après environ trois ans de mandat, sera violemment critiqué ; des propos injurieux sont même tenus à son égard, à tel point que l’intendant-régent, le 19 mars 1855, note au bas d’une délibération:
«Les termes de cette délibération auraient dû être plus mesurés!»
L’accalmie après la tempête
Sans doute dans un but d’apaisement, un décret royal daté du 24 janvier 1856 nomme un nouveau syndic en la personne de François Tapponnier du Châble, remplacé au terme de son mandat par Joseph-Marie Greffier de Beaumont.
La tempête après le calme
Le syndic doit faire face à des attaques sournoises, comme le 24 juillet 1859. Les séances des conseils, tant communal que délégué, deviennent houleuses.
Le 14 juillet, le syndic se rend à Annecy auprès de l’intendant général pour s’entretenir des affaires communales en instance. Rien d’anormal à cela semble-t-il.
Le 24 du même mois, au matin, les habitants, surpris, ont pu voir affichée en divers points de la commune une caricature représentant le syndic. Bien évidemment, cela alimente les conversations. Dans les cabarets ou auberges, les discussions vont bon train, souvent passionnées, les opinions étant divisées. Certains font des gorges chaudes, d’autres sont scandalisés.
Sans plus attendre, le syndic met au courant le bureau de la Sûreté Publique de Saint-Julien. Dès le lendemain, l’intendant général est informé. Des noms circulent...
Attendu que de forts soupçons tomberaient sur le secrétaire communal M. Pellet, individu très hostile à M. le Syndic ainsi que sur le conseiller Blanc Jules, le soussigné se rendra demain sur le lieu pour prendre des informations et recevoir la déposition de plusieurs individus dont M. le Syndic a témoigné le désir qu’ils soient entendus. S’il parviendra à découvrir les auteurs, il ne manquera pas de les signaler à M. l’Intendant Général et de les dénoncer à l’autorité judiciaire pour la procédure voulue.
Le Délégué A. Biglione
Le 8 août, le syndic demande à l’intendant général la poursuite de l’instruction de cette affaire. Il semble qu’il n’en fut rien.
Nous donnons ci-après de larges extraits de délibérations qui témoignent de l’état d’esprit qui régnait.
Le 13 novembre, durant une longue séance du conseil communal, diverses factures de créanciers pour travaux et fournitures de gravier pour les chemins sont vérifiées. Un différend surgit à l’examen de la créance du syndic, qui est sérieusement épluchée: on lui reproche d’avoir subtilisé du gravier appartenant à la commune. En juillet 1859, un stock de 88,898 m3 de pierres cassées et de gravier a été constitué. Lorsqu’on a voulu les faire transporter sur les chemins, le conseil délégué a fait mesurer le cubage de ce tas afin d’en permettre la mise aux enchères. Il ne restait plus que 63,887 m3. Où donc sont passés les 25 m3 manquants? Par de savants calculs, on essaye de le savoir.
Tout d’abord, le syndic reconnaît avoir pris, sans autorisation, 2,50 m3. Ensuite, le carrier qui a extrait le gravier à raison de 0,60 L le mètre cube, s’étant plaint de n’avoir pas gagné pour le travail effectué «l’eau qu’il avait bue», le vice-syndic lui en avait porté 5 m3 de plus.
Entre les deux mensurations, il s’est écoulé un an; durant ce laps de temps, les tas de pierres se sont affaissés, affaissement évalué à 5 m3. Le gravier, qui est presque de la terre glaise, s’est fortement resserré, d’où une diminution évaluée à 6 m3. On évalue également la “bonne mesure” à 3,50 m3, cela donne un total en diminution de 22 m3. Il manque encore 3 m3? Le syndic ayant reconnu avoir distrait 2,50 m3, rien ne prouve qu’il n’en ait pas pris davantage! Par ailleurs, le syndic a déjà perçu une somme de 12 L pour 4 m3 de pierres transportées sur un chemin de dépouille non classé et entretenu par les propriétaires riverains. On fait remarquer que le syndic a aussi un champ desservi par ce chemin!
Pourquoi accorder au syndic, qui n’a pas pris l’avis du conseil délégué avant de mettre quelques tombereaux de pierres sur ce chemin, ce qu’on refuserait à un particulier? Ce serait donner l’exemple du scandale...
Le triste rôle joué par le syndic dans ces réparations de chemins – on le voit abandonner ses fonctions pour se faire entrepreneur de gravier – disputant quelques misérables intérêts avec la commune au lieu d’imprimer une direction intelligente aux travaux, va motiver un blâme que le conseil va lui adresser. Sept conseillers se sont prononcés pour cette sanction, deux se sont abstenus, deux autres avaient quitté la salle au milieu de la séance.
Le 17 novembre de cette même année 1859 a lieu une séance particulièrement agitée. Les conseillers communaux sont appelés à procéder à l’élection des deux conseillers délégués et des suppléants. Le syndic propose de voter pour un conseiller au Châble et un à Beaumont. Si les conseillers acceptent sa proposition, il veut que l’on vote en premier pour Le Châble et ensuite pour Beaumont. Huit conseillers protestent et veulent un vote libre.
Se faisant autoritaire, le syndic proclame que, si le dépouillement des votes ne donne pas un résultat conforme à sa proposition, il annulera le vote. Alors le secrétaire fait lecture d’un article de loi sur la nomination des conseillers délégués: on peut les nommer indifféremment dans l’une ou l’autre section. A plusieurs reprises, le syndic répète qu’il voulait l’exécution de sa volonté. Si on lui désobéissait, il annulerait tout.
On passe néanmoins au vote pour un premier conseiller délégué. 14 votants: 8 voix à Jules Taponier du Châble, qui est déclaré élu.
On passe au scrutin pour le deuxième conseiller. Le dépouillement commence. Il s’avère que François Conversy du Châble a déjà 5 voix, alors que deux autres conseillers de Beaumont n’ont chacun qu’une voix. Le syndic, irascible, d’un mouvement subit et violent, prend les bulletins dépouillés et ceux restant dans l’urne, les fait jeter au feu, puis lève la séance en disant qu’on ne se conformait pas à ses ordres. Il refuse de signer le procès-verbal, paraphé par tous les conseillers.
Au vu de cette délibération, l’intendant général nomme un délégué pour se rendre à Beaumont à la séance du conseil communal pour «faire en sorte de ramener l’union parmi les membres du dit conseil et, cas échéant, prendre toutes mesures qu’il jugera convenables dans l’intérêt public».
Lors de la séance du 22 novembre, il est procédé à un vote pour élire le deuxième conseiller délégué ainsi que les deux suppléants. Il y a 13 votants sur les 14 conseillers présents. François Conversy du Châble est élu avec 7 voix. Pour les suppléants, 9 conseillers ont voulu prendre part au vote, les 5 autres ont refusé en signe de protestation parce qu’il n’y avait pas de conseiller délégué à Beaumont. Notons que la présence du délégué de l’intendant général a été efficace.
Il semble qu’une certaine suspicion continue à se manifester envers le syndic. En effet, au cours de sa séance du 27 novembre, le conseil revient sur sa gestion. Une commission, composée de trois conseillers, a “épluché” un compte de déboursés et de quelques voyages et dressé un rapport. Ce dernier fait ressortir que le syndic n’a pas fait, ou ne devait pas faire, tous les voyages portés dans sa note; et que, notamment, la requête des habitants de Jussy pour s’adjoindre à la section de Beaumont étant une affaire privée, les frais ne doivent pas être à la charge de la commune.
Les sept voyages à Saint-Julien sont réduits à trois, etc. Le conseil unanime, moins le syndic, approuve la note de frais ainsi réduite à 32 livres:
Le nombre des conseillers municipaux, égal dans chacune des deux sections, créa des difficultés au sein de l’assemblée communale, notamment lors d’élections des maires et adjoints. L’égalité des voix favorisait, après trois tours de scrutin , le candidat le plus âgé. Ce fut le cas lors de l’élection du maire en mai 1900. Ce dernier démissionne l’année suivante, abandonnant également ses fonctions de conseiller municipal de la deuxième section (Le Châble). Pour élire un maire, le conseil municipal doit être au complet. En conséquence, les électeurs du Châble sont convoqués le dimanche 4 août afin d’élire un conseiller.
Le bureau n’ayant pu être formé, le scrutin n’a pas eu lieu. L’élection a été reportée au dimanche suivant 11 août.
Le journal satirique de Genève Le Guguss s’est emparé de l’événement pour en faire un pamphlet reproduit ci-après.
Le 25 du même mois, par acclamation, les conseillers nomment le sénateur A. Folliet au poste de maire . Son autorité et sa grande expérience apportent la quiétude au sein du conseil municipal trop longtemps divisé.
MAIRES, AGENTS MUNICIPAUX, SYNDICS DE 1792 A 1940
Nous relevons que trois syndics se sont succédé au cours de l’année 1860. Cela appelle un commentaire. M. Greffier, syndic depuis février 1859, sera remplacé, suite aux élections du 4 février, par François Taponier. Ce dernier sera révoqué et remplacé par Marie Mabut.
Pamphlet du «Guguss».