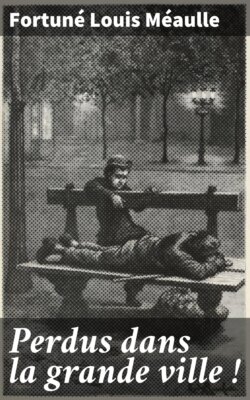Читать книгу Perdus dans la grande ville ! - Fortuné Louis Méaulle - Страница 5
LA DIPLOMATIE DE KERVEN
ОглавлениеBonvin, le peintre des intérieurs calmes et des jeux de lumière, aurait rendu merveilleusement la scène que je vais essayer de décrire.
A Leslen, village dépendant de Saint-Ideuc, par les premiers jours du mois d’avril, dans une salle assez vaste, éclairée par une seule croisée à petits carreaux irrisés de vert et de jaune, et d’où partaient des rayons d’or, une petite vieille allait et venait avec une vivacité extraordinaire. Elle portait une coiffe cancalaise bien blanche et très serrée sur son front jauni et ridé ; elle avait un corsage noir, une lourde jupe de futaine et, aux pieds, de gros sabots qui rythmaient d’un petit bruit sec sa marche sur les dalles de granit.
L’ameublement de cette pièce était bien simple: une table de chêne, un lit à deux étages, un dressoir rempli de vaisselle enluminée, deux chaises et un fauteuil de paille; n’oublions pas quelques images saintes, qui se détachaient sur un mur recrépi à la chaux.
Tout était propre, brillant, bien ordonné. Ce n’étaient pas des toiles d’araignées qui pendaient du plafond, mais de beaux épis de maïs aux jolis tons vieil or.
La petite vieille allait au milieu de tout cela, traversant les rayons de lumière, disparaissant dans l’ombre avec des aspects de féeries, comme la doyenne des fées légendaires.
«Il ne viendra donc pas! disait-elle en parlant haut, comme beaucoup de vieillards en ont l’habitude. Oh! le méchant enfant! Il est encore, j’en suis sûre, avec ce petit Kerven, ce vilain drôle qui fait le désespoir de son père et qu’on ne voit jamais à la messe. En voilà un qui finira mal! En attendant, il me change mon Yvonnec. Oui, je lui trouve un air rêveur à mon garçon. Il n’a plus ses jolies chansons sur les lèvres, rien ne l’amuse: la nuit, je l’entends se remuer si longtemps avant de s’endormir, que j’ai toujours envie de lui demander s’il est malade. Il est si beau, lui, si robuste, si brave! Il n’a pas son pareil pour traîner un filet; tous nos patrons le voudraient sur leurs barques. Oui; mais cela, je ne le veux pas. Non! tant que je serai sur cette terre, il ne s’embarquera pas. C’est assez d’un.»
Et en disant ces mots, elle avait un petit air qui n’était pas doux, la pauvre grand’mère!
Le père d’Yvon, son fils, était de ceux qui faisaient la saison de Terre-Neuve. Un jour il ne revint pas: le bateau s’était perdu corps et biens, avec d’autres barques, dans un coup de tempête.
L’enfant resta à sa charge, la mère s’étant remariée et ayant quitté le pays. Elle avait bien, en partant, promis d’aider la vieille, mais on n’entendit jamais plus parler d’elle.
La mère Jean, ou la mère Jeannic, comme on l’appelait dans le pays, possédait un peu de bien, et elle avait en outre une pension de six cents francs comme veuve d’un quartier maître de la marine. Avec cela et beaucoup d’économie, elle avait élevé son Yvon jusqu’à l’âge de treize ans; elle était persuadée de lui avoir donné une excellente éducation. Du reste, s’il ne savait pas très bien lire, si son écriture était restée incorrecte, personne dans le pays ne remmaillait un filet avec autant d’adresse et ne faisait les casiers avec autant de perfection; bref, les pêcheurs le citaient avec admiration à leurs enfants.
Tandis que ce petit Kerven, qu’est-ce que c’était que celui-là ? le fils du maître d’école, un brave homme certainement, mais qui ne ferait jamais un vrai gars de son enfant, cet être frêle, délicat, qu’on prendrait pour une fille avec ses petites mains, ses petits pieds, ses manières fines.
Quel travail pouvait-on lui demander? Ce n’était bon à rien, ni aux champs ni à la mer. Et pendant que dans sa pensée elle établissait avec orgueil ce parallèle, la vieille se pencha sur l’âtre, où chauffait depuis longtemps une soupe au poisson qu’elle devait trouver excellente; car chaque fois qu’elle y goûtait, elle repassait sa langue sur ses lèvres avec satisfaction.
Tout à coup la porte s’ouvrit, et dans l’encadrement de cette porte, sur ce fond que le soleil illumina soudain de lueurs d’apothéose, la robuste silhouette d’Yvon fit son apparition.
— Bonjour, grand’mère, dit-il avant d’entrer; ne gronde pas, ou je retourne d’où je viens.» Puis d’un ton câlin, avec un bon rire: «Veux-tu ne pas me gronder?
— C’est bon, viens, méchant gamin,» fit-elle, et elle mit la soupe sur la table.
«Tu trouves qu’il fait meilleur dehors que dedans, c’est de ton âge. D’où viens-tu?
— J’étais sur la falaise.
— Tout seul?
— Non, avec Kerven.»
A ce nom de Kerven la pauvre mère leva ses deux bras au ciel.
Yvon, habitué à ces démonstrations réprobatrices quand il s’agissait de son ami, continua:
«Nous étions à regarder une belle frégate qui vient de jeter l’ancre dans la baie; elle était si près de la falaise, qu’on entendait les commandements. Être marin de l’État, ce doit être beau!
— Veux-tu encore un peu de soupe?» dit la pauvre mère, qui n’aimait pas ce sujet de conversations, et avant qu’il eût pu répondre elle lui remplit de nouveau son assiette.
«Tu sais, lui dit-elle, on est venu pour des casiers; nous n’en avons plus et nous manquons la vente.
— C’est bon, grand’mère, on va en faire, mais... demain; aujourd’hui je voudrais retourner voir la frégate, on dit qu’elle repartira cette nuit, et puis Kerven m’attend.
— Kerven, Kerven! Il m’ennuie, ton Kerven! il est toujours là à te monter la tête; s’il aime tant la mer, il n’a qu’à se faire marin: en voilà un que je verrais partir avec plaisir!
«VEUX ENCORE UN PEU DE SOUPE?»
— Mais il n’aime pas la mer du tout; il a d’autres projets...
— Ah! et lesquels?
— Je te dirai cela plus tard, grand’mère.»
Et l’embrassant tendrement, il lui cria dans l’oreille: «C’est un mystère!» et il disparut.
— Vilain gamin! cria la vieille, moitié fâchée, moitié rieuse, me voilà sourde pour toute la journée.»
Yvon gagna la campagne en suivant un sentier qui passait derrière la maison, et qui par une pente très douce conduisait au sommet de la falaise. Le terrain, mélangé de sable et de terre grasse, était couvert d’une herbe jaunie, brûlée et, à cette heure, glissante; mais l’enfant, qui allait pieds nus, courait là-dessus avec facilité.
Yvon approchait de sa quinzième année. Grand déjà, le torse développé , l’ossature grosse, indice d’une solide charpente, il promettait d’être sous peu un matelot brave et robuste; car, en dépit des appréhensions, des projets, de la volonté de la pauvre grand’mère, Yvon serait marin.
Ces enfants du littoral, qui passent la moitié de leur vie dans l’eau salée, s’en imprégnant, en nourrissant leurs muscles, ne peuvent jamais s’arracher à cette mer, qui peut-être un jour les engloutira, mais qu’ils aiment comme la berceuse de leurs premiers sommeils.
Yvon sentait si bien que cet inéluctable n’était pour lui qu’une affaire de temps, qu’il ne songeait pas à contrarier sa vieille grand’mère, et tout simplement il «espérait », mot qui serait cruel s’il ne signifiait, en Bretagne, «attendre.»
Pour le moment, sans préoccupation, il marchait rapidement, les cheveux au vent. De temps en temps une alouette s’élevait près de lui, en poussant ce cri plaintif qui se change en un tireli joyeux sitôt qu’elle escalade le ciel. Une petite brise caressait les bruyères et les ajoncs couverts de fleurs.
Il rejoignit bientôt son camarade.
Kerven, par son physique du moins, justifiait le portrait qu’en avait tracé la grand’mère d’Yvon. C’était un enfant petit pour son âge, et dont les membres grêles paraissaient avoir été arrêtés dans leur développement.
Il eût été excessif de dire qu’il avait l’air sournois et méchant; mais, sur son visage pâle, au lieu de l’épanouissement insouciant et gai de l’enfance, se lisait l’inquiétude assombrie de quelqu’un mécontent de son sort.
Fils de l’instituteur du village, il avait quelque instruction. Peut-être avait-il mal compris les enseignements reçus, peut-être en tirait-il de fausses conséquences; mais, à mesure qu’il avançait en âge, il paraissait de plus en plus prendre en mépris et en aversion le milieu où il vivait, au grand désespoir de son père, qui vaguement le sentait envahi et troublé par de pernicieuses chimères.
Les deux amis, du lieu où ils se trouvaient, avaient une vue ravissante. La rade était sillonnée de bateaux de pêche qui allaient et venaient en tous sens, traînant leurs filets, tandis qu’au pied de la falaise un navire de guerre était à l’ancre; une flottille de canots évoluait autour de lui. Les deux enfants considéraient ce spectacle avec des impressions bien différentes.
Pendant que Kerven, dont aucun objet ne captivait spécialement le regard distrait, semblait ne suivre que le développement de ses pensées intérieures, Yvon, de ses yeux brillants d’admiration et d’enthousiasme, ne quittait pas le navire.
«Mais regarde donc, Kerven, dit-il enfin, regarde cette belle frégate.»
Le vaisseau qu’Yvon désignait sous le nom de frégate était une corvette qui dressait fièrement dans les airs ses trois mâts et son beaupré.
«Ah! si tu pouvais voir ce bateau courir sous ses voiles, tu comprendrais qu’il n’y a pas d’autre bonheur au monde que d’être marin! Ce sont ces bateaux-là qui font les beaux voyages. Mon grand-père était sur l’Uranie, et il a fait plusieurs fois le tour du monde.»
En disant cela, le pauvre Yvon avait les yeux agrandis et les narines dilatées: il était en arrêt devant ce joli vaisseau, comme un chien de chasse devant une perdrix.
«Oui, c’est joli, consentit enfin à répondre Kerven, et, prison pour prison, il vaut peut-être mieux en choisir une qui marche!»
Yvon le regarda avec stupeur. Il n’avait pas compris un mot: il comprenait rarement, du reste, les phrases prétentieuses de son compagnon, mais il ne l’en admirait que davantage. L’incompréhensible, c’est le sublime pour les naïfs.
Yvon se coucha sur le gazon, les yeux tournés vers la mer, tandis que Kerven, dédaigneux, laissait tomber quelques mots de temps en temps.
«Tu n’as donc pas assez de misère, mon pauvre Yvon, que tu penses encore à t’embarquer: crois-tu donc que tu serais plus heureux à bord de ce navire? Tu ne serais pourtant ni mieux vêtu ni mieux nourri qu’à cette heure, et quand tu aurais passé vingt ou trente ans de galère, on te jetterait comme retraite de quoi t’acheter un peu de pain, juste de quoi ne pas mourir de faim. Du pain! la belle affaire, est-ce qu’on en manque jamais? Non, non, vois-tu, ce n’est pas une vie, ce n’est pas un but, nous sommes jeunes, et l’avenir est à nous.
— L’avenir! répétait Yvon ahuri, qu’est-ce que c’est que ça?
— Je veux dire, mon pauvre Yvon, que si tu voulais m’écouter, nous partirions.
— Et où donc, mon Dieu, puisque grand’mère m’a dit que si je m’embarquais, elle en mourrait de chagrin?»
Pour Yvon, partir c’était s’en aller par mer vers les régions lointaines auxquelles il rêvait si souvent.
«Nous irions à Paris, à pied, dit froidement Kerven.
— A Paris! Qu’est-ce que tu veux que je fasse à Paris? J’ai été une fois à Rennes; eh bien! j’étouffais, perdu dans ces rues entourées de hautes maisons, d’où on ne voyait le ciel que comme s’il était très loin.
— Crois-tu donc le ciel plus près de toi ici? dit Kerven en riant.
— Mais beaucoup plus près: il me semble même parfois, quand le soir descend, que je marche dans le ciel, que j’y suis plongé.
— Mais c’est le brouillard qui t’enveloppe et te mouille, mon pauvre Yvon.
— C’est possible, dit l’enfant; mais je n’aime pas les villes.
— Tu ne veux donc pas devenir riche, célèbre; tu ne veux donc pas vivre enfin, voir des palais, des gens en riches toilettes, des équipages, des théâtres où l’on joue des pièces qui font rire, pleurer et trembler tout à la fois?
— Heu! heu!...
— Te souviens-tu de M. Corvin, qui est venu prendre des bains l’année dernière, et qui avait loué la maison de bois qu’ils appellent le chalet des ajoncs?
— Oui, eh bien?
— Il me racontait un jour qu’il était venu à Paris tout jeune, en sabots, avec cinq francs dans sa poche, et que maintenant il pouvait vivre sans rien faire et avoir des domestiques.
— Seigneur Jésus, fit Yvon, si nous avions des domestiques, qu’est-ce que nous en ferions?»
Kerven ne répondit rien: il se promenait, irrité d’avoir encore manqué son effet. Il entrait dans ses projets d’emmener Yvon. Il le voulait justement comme domestique pour porter les fardeaux, pour le défendre si on l’attaquait, pour partager le travail avec lui en lui laissant la plus forte part. Voilà longtemps déjà qu’il cherchait à éveiller chez lui la curiosité de voir Paris; mais il se heurtait toujours à la plus profonde indifférence.
Il enrageait, le petit homme! A quoi donc lui servait d’être plus intelligent que son camarade, plus instruit, s’il n’en pouvait faire ce qu’il voulait?
«Tiens, tiens, dit Yvon en lui prenant les mains, regarde, voilà l’état-major qui descend à terre.
— Qu’est-ce que ça te fait? tu n’en seras jamais, toi, de l’état-major.»
Et Kerven mit avec rage ses mains dans ses poches.
Yvon se leva, et, regardant son ami avec curiosité, il lui dit de sa bonne voix douce:
«Tu as donc bien envie d’aller à Paris?
— Si j’en ai envie! mais j’en mourrai si je n’y vais pas.».
Et en même temps que ce cri de convoitise sortait du cœur de Kerven, de grosses larmes coulaient de ses yeux.
Yvon, incapable, dans sa très simple et très bonne nature, de pénétrer les véritables sentiments de son camarade, ne vit que sa douleur et en fut touché.
Il en fut même étonné ; car si, lui, pour des raisons diverses, ne pouvait quitter le pays, il lui paraissait que rien n’empêchait Kerven de partir; au contraire.
Il se rappelait sur ce chapitre certains propos de sa grand’mère, dont il se fit de suite innocemment l’écho.
«Eh bien! mais..., si tu y tiens tant, il faut y aller à Paris: ton père ne s’y opposera pas. Peut-être même qu’il préférera encore te sentir au loin que de te voir passer tes journées sans travailler, comme tu le fais depuis quelque temps, où on ne rencontre que toi dans les rues du village.»
Après un moment d’apparente réflexion, Kerven reprit:
«Et à toi..., ça ne te ferait donc rien de me voir m’en aller?
— Je ne dis pas ça... Oh! non.
— Moi, je sens que j’aurais beaucoup de peine à te quitter; voilà pourquoi je voudrais t’emmener. Mon rêve était de ne jamais nous séparer; et, comme quelque chose me dit que j’arriverai à une haute position, je voudrais t’associer à mon succès, faire ton bonheur en même temps que le mien.
— Mon bonheur, répondit Yvon en souriant, mon bonheur, tiens, regarde...»
Et de la main il montrait la corvette, à ce moment dans tout le branle-bas de sa manœuvre.
«Mon bonheur serait là..., mais jamais dans les villes.»
Kerven eut un sourire un peu dédaigneux.
«Tu dis cela, parce que tu n’as jamais eu sous les yeux que des navires ou des champs; que tu n’as vu qu’une ville vieille et triste. Mais si tu étais à Paris, où il y a de tout, des palais, des jardins, des bois et même des bateaux à vapeur, tes idées changeraient vite. Nous vois-tu, toi, chef ouvrier dans une grande fabrique; moi, à la tête d’une maison de commerce, avec de l’argent dans nos poches, gagné sans fatigue, et du temps pour nous promener? C’est alors que tu connaîtras le bonheur et que tu me remercieras... Et puis, tu sais, rien ne t’empêcherait de revenir au pays plus tard avec une fortune comme M. Corvin et tant d’autres... Allons, c’est dit, tu viens.»
Yvon, ébranlé par le mirage de cette ville étonnante dans les rues de laquelle on pouvait rencontrer des forêts et des navires, répondit:
«Si cela peut te faire bien plaisir et si grand’mère y consent, ça m’est égal de t’accompagner; mais je te préviens, pas pour longtemps!...»