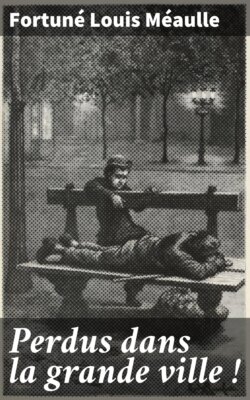Читать книгу Perdus dans la grande ville ! - Fortuné Louis Méaulle - Страница 7
LES BONS CONSEILS
ОглавлениеQuand Yvon, rentré à la maison, se trouva en présence de la pauvre grand’mère, déjà si usée par l’âge et les chagrins, si débile, et à laquelle il allait faire tant de peine, il eut comme une révolte contre lui-même; mais il s’était engagé et ne voulait plus s’en dédire. Il était lâche vis-à-vis de Kerven. Certes, il eût agi plus librement avec tout autre camarade qu’avec le fils du maître d’école, par qui il se sentait dominé.
Quand ce dernier, pour vaincre ses scrupules ou le persuader, le regardait d’une certaine façon, il éprouvait quelque chose de singulier. C’était comme si Kerven eût marché sur lui. Allons, il fallait en finir. S’armant de tout son courage, il débita son petit discours d’une seule haleine:
«Grand’mère, je vais vous quitter pour un peu de temps, j’ai envie de voir du pays et...» Il s’arrêta, effrayé.
La pauvre Jeannic, en l’entendant parler de départ, était devenue si pâle, si tremblante, qu’elle avait été forcée, pour ne pas tomber, de s’appuyer sur la table de chêne.
«Eh bien, continue, mon enfant, fit la vieille, l’émotion dans les yeux et la colère dans la voix.
— Et j’ai pensé qu’un petit voyage à Paris ne vous déplairait pas trop, mais je vois bien...
— A Paris! s’écria joyeusement la vieille femme, changeant subitement de ton et d’allure, que ne le disais-tu tout de suite?... Ah! je respire, je croyais que tu voulais t’embarquer.
— Mais non, grand’mère, puisque je vous ai promis de ne pas aller sur mer, je tiendrai ma promesse; mais il me semble qu’un petit voyage me ferait grand bien.
— Et, tu irais seul... à Paris?
— Non, grand’mère, c’est avec Kerven que je partirais.
— Ce n’est pas le compagnon que je t’aurais souhaité ; il te sera plus gênant qu’utile; mais je ne discuterai pas ton compagnon, t’ayant déjà dit cent fois ce que j’en pensais. Souviens-toi seulement que tu pars pour peu de temps, que je suis bien vieille, et que si tu tardais trop, tu ne trouverais plus ta pauvre grand’mère. Ce serait bien mal de me laisser mourir seule, moi qui depuis ta naissance t’ai entouré de soins. Si la chose arrivait, tu te préparerais un grand remords pour toute ta vie.
— Ah! grand’mère, fit l’enfant tout ému en l’embrassant, vous savez bien que je vous aime de toutes mes forces. Non, je pars pour deux mois, et j’espère rapporter assez d’argent pour payer au retour bien des petites dettes qui nous tracassent.»
La bonne femme ne mit pas un instant en doute que son petit-fils ne gagnât beaucoup d’argent à Paris: un garçon qui faisait si bien les casiers de homards ne pouvait passer inaperçu dans la grande ville.
LA JEANNIC
— C’est convenu, mon Yvonnet, tu partiras demain matin; mais je veux voir Kerven et lui parler avant. Va le chercher.»
Et comme Yvon avait l’air inquiet, sachant les préventions assez justifiées de la vieille grand’mère contre son ami, et qu’il s’arrêtait indécis, la vieille femme ajouta:
«Va tranquille, ne crains pas de reproches; je veux seulement lui faire quelques recommandations à ton sujet. Je devine bien que c’est lui qui t’entraîne; mais, puisque j’ai consenti à ton voyage, je ne veux pas en gâter les débuts par des gronderies de vieille femme. Va!»
Yvon partit, pour revenir peu d’instants après avec son futur compagnon de route.
Kerven n’en menait pas large, comme on dit vulgairement. La Jeannic, en voyant sa mine confuse, ne put s’empêcher de sourire et de s’amuser quelques instants de son embarras.
Cet enfant, avec son aspect ennuyé, un peu farouche, avec des phrases prétentieuses, son indifférence pour les occupations, les amusements, les joies et les peines qui constituaient la vie dans ce village de pêcheurs, était devenu comme un être à part: on le regardait, dans son isolement volontaire, ainsi qu’un éternel étranger.
«Asseyez-vous, monsieur Kerven, dit la vieille femme en enflant un peu sa voix; vous avez le temps d’être debout, puisque vous voulez marcher jusqu’à Paris. C’est un bien long voyage pour des petits pieds comme les vôtres, mais vous emmenez peut-être Yvon pour vous porter.»
Puis, s’adressant à son petit-fils, elle lui dit:
«Va reporter les filets que tu as raccommodés, et n’oublie pas de faire tes adieux à tes pratiques; ne te presse pas, j’ai à causer avec monsieur.»
En sortant, Yvon fit un geste de prière, en montrant du doigt Kerven, qui regrettait presque d’être venu.
«Sois tranquille,» dit la grand’mère, et elle se mit à rire. Puis à Kerven:
«Ainsi, vous allez quitter votre père, courir le monde; et vous trouvez bon d’emmener mon petit-fils?» Et sur un geste de l’enfant: «Hé bien! je le veux bien, ça ne me contrarie pas.»
Kerven ne s’attendait pas à voir la conversation prendre cette tournure, et pour la première fois depuis son arrivée il leva les yeux sur la Jeannic.
«Voilà la chose, continua celle-ci. Je ne veux pas que mon Yvon se fasse matelot; mes rêves ne sont faits que de tempêtes et de navires brisés, et j’espère qu’en voyant d’autres outils que des bateaux, qu’en vivant avec des hommes qui ne sont pas des marins, il en viendra à prendre du goût pour une autre profession. Vous allez partir, soit; mais voici maintenant ce que je tenais surtout à vous dire, et je fais ici un appel à votre honnêteté, monsieur Kerven. Je n’ai aucun titre pour vous faire des remontrances, ni pour vous demander les raisons qui vous guident, mais vous n’allez plus à l’église.»
Et comme l’enfant rougissait, elle continua d’une voix moins sévère:
«Mon Yvon, vous le savez, a l’habitude de m’y accompagner chaque dimanche, et chaque dimanche, vous entendez bien, il continuera à entendre la messe partout où il sera: Vous allez me promettre que vous ne vous moquerez jamais de lui, et, si l’envie vous en venait, vous songeriez à la vieille grand’mère qui, en vous confiant son petit-fils, vous a adressé cette suprême prière, de lui laisser suivre une ancienne coutume qui est et restera toujours la bonne. Croyez-moi, monsieur Kerven, consulter Dieu de temps en temps n’est pas mauvais pour apprendre à vivre avec les hommes.»
En disant cela, la pauvre vieille femme était comme transfigurée. Elle avait la voix si douce, si persuasive en ce moment, que le cœur de l’enfant, desséché par l’orgueil, s’attendrit, et ce fut presque les larmes aux yeux qu’il répondit:
«Je vous promets de laisser Yvon vivre à sa guise. Jamais je ne dirai un mot pour combattre les bons conseils que vous lui avez donnés, ou changer les habitudes qu’il a prises près de vous, la Jeannic, qui êtes respectée dans le pays comme une ancienne ayant toujours fait honnêtement son devoir.
— Oui, mon enfant, et je m’en vante, répondit la Jeannic. Ah! ça n’a pas toujours été facile, avec mes faibles ressources, de mener à bien la tâche que Dieu m’avait donnée: eh bien! je n’ai jamais eu de défaillance, parce que je ne me suis jamais sentie seule; quelqu’ un veillait sur moi, et ce quelqu’un c’est Dieu. Or je ne veux pas que cet appui manque à Yvon; et si je le vois partir sans inquiétude, c’est que j’en ai fait un bon chrétien.»
En ce moment Yvon rentrait, la figure rouge, les yeux brillants, heureux maintenant qu’il savait pouvoir voyager, voir du pays, sans trop déplaire à sa grand’mère.
«Eh bien! la mère, dit-il en entrant, vous ne l’avez pas mangé le pauvre Kerven!»
Ce fut Kerven qui répondit lui-même.
«Non, mon cher Yvon.» Et, se tournant vers la vieille Jeannic, il lui dit:
«Permettez-moi de vous embrasser et de vous répéter que vous serez contente de moi.»
Il s’en alla tout rêveur, et quand il passa devant la petite église, sans se rendre compte de ce qu’il faisait, par un mouvement impulsif il retira son chapeau.
«Dis donc, grand’mère, fit Yvon, il me semble tout attendri, mon camarade; qu’est-ce que tu as bien pu lui dire? car il n’est pas facile à émouvoir.
— C’est un enfant à qui il a manqué une mère; il vaut peut-être mieux que je ne me le figurais. Voyons, que vas-tu emporter? C’est que tu n’as rien pour t’habiller à la ville!»
Elle regarda sa paire de souliers. Quoique achetée depuis longtemps, elle était encore presque neuve, Yvon ne se chaussant que le dimanche. Sa garde-robe se composait de deux tricots en état, d’une veste et de deux culottes.
Oh! ces culottes d’enfants pauvres à la campagne, quel poème de travail et d’industrie! Depuis combien de temps le drap primitif, celui de la première culotte, était-il disparu, la Jeannic n’aurait pu le dire. A force d’y mettre des pièces, de la rallonger, de l’élargir, il ne restait plus un fil de celle qu’avait vendue le marchand. Yvon en avait deux ainsi; il pourrait donc en changer quand il irait dans le monde.
La pauvre femme était assez mélancolique devant le bagage de son enfant.
Elle n’avait jamais prévu, du reste, qu’il aurait un jour la fantaisie d’aller à Paris, et la pensée de voir son bel Yvon faire ses débuts dans la grande ville avec si peu d’éclat, n’était pas sans la mortifier un peu.
«Mais bah! dit-elle après un moment de réflexion, on m’a dit qu’il y avait là-bas des magasins dans lesquels on trouvait des vêtements tout faits et pour toutes les tailles... Eh bien! avec le premier argent que tu gagneras, tu te feras aussi beau que tu voudras. En somme, pour la route, tu n’as pas besoin de vêtements neufs.»
Ayant ainsi trouvé arrangement à tout, la vieille grand’mère ouvrit le seul tiroir qui fermait à clef dans la maison; il formait l’un des compartiments d’un placard construit dans la muraille et qu’on ouvrait rarement: c’était comme une sorte de reliquaire. Yvon y jeta un regard presque respectueux. Il vit une belle coiffe qui avait été une coiffure de mariée, quelques lettres, celles du défunt fils, son père, quelques bijoux aux formes anciennes et enfin quatre pièces d’or, les seules économies que la pauvre vieille femme eût jamais pu réunir.
Elle prit deux de ces pièces d’une main tremblante et les remit à Yvon, qui ne voulait absolument pas les recevoir.
«Mais je n’en veux pas, s’écriait-il en se défendant, qu’est-ce que j’en ferais de votre argent? Croyez-vous qu’avec ces deux bras-là j’aie besoin de quelque chose?
— Prends, insistait-elle, heureuse de voir le courage de son enfant, prends; si tu ne trouves pas à les dépenser, eh bien! tu me rapporteras quelque chose en souvenir de la grande ville. Puis il faut tout prévoir, tu peux être malade. Je ne veux pas non plus que tu voyages comme un gueux. Je sais bien qu’à Paris tu n’auras besoin de rien, mais avant d’y être!...»
Yvon, puisque la vieille le voulait absolument, prit les deux pièces et les fit coudre dans l’intérieur de sa ceinture, fermement décidé, du reste, à n’y jamais toucher.
«Je ne veux pas vous contrarier, grand’mère, disait-il, mais vous avez bien tort de vous priver; enfin, vous verrez à mon retour qu’ils auront fait des petits, vos jaunets.
— Tant mieux, mon enfant, tant mieux! travaille, réussis!» Et la figure de la bonne vieille était presque joyeuse.
Yvon n’y comprenait rien; lui qui s’attendait à des pleurs, à des reproches, il se trouvait en face d’une femme qui cachait à peine son plaisir de ce départ.
Il se souvenait d’un jour où il avait demandé à sa grand’mère de le laisser partir pour un voyage d’un mois à bord d’un bateau au cabotage. Grand Dieu! de quelle façon différente elle l’avait reçu! Avec quelles supplications et quels torrents de larmes elle avait empêché ce voyage! On l’aimait donc moins qu’autrefois. Quelques larmes au départ faisaient partie de son programme: on lui faisait tort de quelque chose.
Aussi ce fut avec une certaine amertume qu’il dit à sa grand’mère:
«Allons, je vois avec plaisir que vous vous faites une raison. J’avoue que je craignais de vous faire de la peine, mais il paraît que je me trompais.»
La vieille alors, se jetant à son cou, lui dit en le couvrant de baisers:
«Oui, je te vois partir avec plaisir; je sens que tu m’aimeras davantage là-bas qu’ici; tu penseras plus à moi et tu comprendras mieux pourquoi je t’éloignais du métier de marin. Quand tu seras devenu un bon ouvrier et que tu gagneras de l’argent, tu me remercieras d’avoir contrarié tes coups de tête.»
L’enfant eut alors un sourire que la pauvre mère ne vit point, et qui voulait dire: Comme vous me connaissez peu!
Puis, ayant fait un paquet de tout ce qu’il voulait emporter, il le mit dans un coin et dit: «Me voilà paré.»
Une explication d’un caractère bien différent avait lieu à la même heure chez les Kerven.
Le père et le fils ne faisaient pas ce qu’on nomme un bon ménage.
Le père, homme d’un grand bon sens, avait deviné de bonne heure chez son fils une ambition disproportionnée avec ses facultés et ses moyens d’action; aussi, n’ayant pas de fortune, était-il rempli d’inquiétude pour l’avenir de cet enfant.
Qu’en ferait-il?...
Resté faible, après une première enfance constamment maladive, il ne fallait pas songer pour lui à des professions exigeant des muscles et une santé solide.
Le maître d’école eut un moment d’espoir quand, ayant apprécié l’intelligence de son fils, il le vit assidu, laborieux, devenir le modèle de la classe, et même, disons-le, le seul élève qui lui fit honneur.
«Eh bien, pensa-t-il, il me succédera; ma destinée, en somme, n’a pas été si malheureuse.»
En effet, bien qu’issu d’une race de paysans, le vieux Kerven, comme son fils, était né chétif, impropre comme lui aux durs travaux physiques; mais lui n’avait pas rougi de son origine, il n’avait pas pris prétexte de sa faiblesse pour aspirer à des destinées supérieures.
Il s’était, dès les premiers ans, accommodé de son sort, n’avait désiré que les satisfactions possibles. Il avait cherché à se rendre utile par des travaux compatibles avec ses forces, sachant que dans toutes les conditions tout laborieux se fait sa place, que chaque effort trouve sa récompense.
Puis un protecteur était venu, qui, remarquant son esprit ouvert, lui avait fait donner de l’instruction et l’avait poussé vers l’enseignement.
Cette situation, qui semblait le relever socialement, l’avait laissé sans orgueil. Il n’en avait vu que les devoirs et s’était efforcé de les remplir avec zèle et modestie.
Aussi espérait-il trouver pour ses derniers jours une consolation en son fils; mais l’enfant, après la mort de sa mère, enlevée de bonne heure, avait été élevé un peu à l’aventure au point de vue moral; son intelligence avait été peut-être trop cultivée au détriment de son âme, et ses premiers succès à l’école n’éveillèrent en lui qu’une vanité présomptueuse.
Plus tard, gâté par les compliments, Jean Kerven rêva un théâtre plus vaste pour ses triomphes; et son père, trop indulgent, flatté du reste, comme tous les pères, lui fit passer à Rennes des examens pour obtenir une bourse au collège.
L’enfant fit de son mieux, mais échoua. On ne pouvait songer à tenter, l’année suivante, une deuxième épreuve; les ressources manquaient.
Dès lors Jean s’aigrit. Considérant son avenir comme compromis, sinon perdu, par le manque de quelques sous, son cœur se laissa aller à l’envie et à la haine.
Il passa par des crises de découragement, de dégoût, de tristesse, détourné du travail, usant ses journées en flâneries vagues qui désespéraient son père.
Chose étrange! son ambition grandissait à mesure que paraissaient devenir plus problématiques les moyens de la satisfaire.
Dans son imagination déréglée les projets les plus baroques s’entassèrent, et c’est alors qu’il eut cette idée du voyage à Paris pour y tenter la fortune.
Restait à obtenir le concours d’Yvon, précieux auxiliaire, et le consentement de son père.
Ce jour-là donc, en quittant son camarade, il était revenu dans l’humble salle à manger de l’instituteur; et, avec ce sérieux qui le rendait si énigmatique, i] avait demandé à son père quelques moments d’entretien.
«Que veux-tu encore? demanda le maître d’école en se mettant sur la défensive.
— Mon père, dit Jean, je viens vous prier de vouloir bien me permettre d’aller passer quelques mois à Paris. Je sais que mon oisiveté vous afflige, et je veux tenter de faire quelque chose.
— Mais, malheureux enfant, dit le pauvre Kerven, je n’ai pas d’argent, tu le sais bien: notre séjour à Rennes, si court qu’il ait été, a absorbé toutes mes économies. Ce voyage ne me déplairait pas si je pouvais y subvenir, mais tu connais mes ressources.
— Je ne vous demande rien que la permission de m’absenter quelques mois. Si je réussis, et je réussirai, continua-t-il avec fierté, j’aurai eu la joie de vous faire revenir sur la mauvaise opinion que vous avez de moi. Si je ne réussis pas, eh bien, je reprendrai et j’achèverai mes études, pour me mettre à même de continuer, dans ce coin oublié, l’œuvre que vous avez faite si modestement; mais je veux avant tenter quelque chose. Que voulez-vous, mon père! votre abnégation m’épouvante.
— Mais tu ne sais pas vers quelle misère tu t’achemines, enfant. Enfin, tu pourras toujours revenir près de moi.»
Puis, comme l’avait fait la grand’mère d’Yvon, il prit deux pièces d’or, les seules qui lui restaient sans doute, et les glissa dans les mains de son fils, qui les accepta, tout en promettant de les lui rendre au centuple.
«Et tu pars seul?
— Non, Yvon, le fils de la Jeannic, part avec moi.
— Y songes-tu, malheureux enfant! Tu entraînes, dans ton égoïsme, le seul soutien d’une pauvre femme.
— Elle m’en remercie, au contraire.
— Et comment cela?
— Yvon aussi est un ambitieux à sa manière. Eh! mon Dieu! quel est l’enfant ayant un peu de cœur qui ne caresse une chimère? Celle d’Yvon serait d’être marin. C’est le grand désespoir de sa grand’mère. Aussi a-t-elle accueilli avec joie cette diversion à l’ambition de son enfant. Elle espère qu’ainsi il abandonnera, pour quelques temps du moins, l’idée de ce métier que la pauvre bonne femme considère comme le plus périlleux de tous, non sans raison, hélas! Vous savez que le père d’Yvon est mort en mer, et vous n’ignorez pas qu’il n’est pas une famille dans ce village qui, en vingt ans, n’ait perdu l’un des siens dans un naufrage. Et puis, ajouta le jeune Kerven avec quelque amertume, la mère Jeannic est moins incrédule que vous; elle est certaine que son petit-fils réussira là-bas.
— Que veux-tu, mon enfant, la mère Jeannic est une simple femme, toute à son idée fixe, et qui ignore comme les choses vont en dehors de notre village. Moi qui sais mieux, je me demande si les périls qui menacent les marins ne sont pas moins effrayants que les dangers que vous allez courir dans les villes: il y a tant de sortes de naufrages! Crois-tu que je n’aimerais pas mieux apprendre ta mort, que de te savoir riche dans un métier malhonnête ou dans une industrie douteuse?
— M’en croyez-vous capable, mon père?
— Je ne sais, dit l’honnête professeur.
— Je n’ai pas sur la conscience une seule action malhonnête.
— Tu as des lâchetés, tu rougis de notre médiocrité. L’adversité fortifie les grands cœurs, dit-on, c’est possible; mais elle accable les petits, et je frémis en te voyant rêver la fortune sans travail, sans lutte: car, je le vois depuis longtemps, l’argent est ta seule préoccupation.
— Eh bien! oui, je veux être riche. Non pas par tous les moyens, mon père, comme vous paraissez le craindre, mais par mon travail.
— Laissons cela, mon enfant, et fais–moi grâce de tes discours. Va, tu n’as aucun programme, aucune ligne de conduite; tu as senti qu’il y a des gens riches et des gens pauvres, et tu veux être du côté des riches à tout prix. Soit! j’attendrai; mais souviens-toi que si tu reviens un jour, que ce soit la tête haute, ou je n’aurai plus de fils! Je ne sais si le diable te tente...
— Je n’ai jamais vu le diable, mon père, et vous ne m’avez jamais beaucoup parlé de Dieu; mais je vous promets de rester honnête; et si la tentation de voler me prenait jamais, je penserais aussitôt au pauvre maître d’école de Binnic, à ses trente ans passés dans la même école sans un moment de découragement, sans un mot de plainte ni de regrets, et je resterais toujours le digne fils du plus honnête des hommes.»