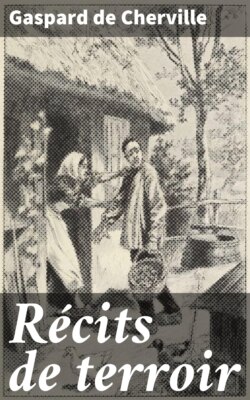Читать книгу Récits de terroir - Gaspard de Cherville - Страница 5
ОглавлениеL’ÉTOURNEAU
Si peu que vous ayez pratiqué les flâneries à travers champs, il vous sera probablement arrivé d’apercevoir, mêlé à quelque troupeau de vaches, plus souvent de moutons, un vol d’oiseaux dont la familiarité avec ces quadrupèdes vous aura semblé assez singulière pour que vous perdiez votre temps — puissiez-vous ne l’avoir jamais plus mal employé — à les contempler.
De taille moyenne, un peu moins gros qu’une grive et plus effilés, remarquables par les reflets verts, violets, dorés du satin de leur plumage et par les mouchetures tantôt rousses, tantôt d’un gris d’argent qui le ponctuent, ces oiseaux allaient et venaient affairés par leur glane dans le pré, ou dans l’herbe roussie du guéret, plus souvent à terre qu’à l’essor, passant et repassant entre les groupes et jusque sous le ventre du peuple ruminant ou bêlant, et poussant à chaque instant l’audace jusqu’à prendre pour perchoir le dos de l’un de ces êtres, qui doivent pourtant leur apparaître comme des mastodontes, et à y poursuivre leur cueillette d’insectes. Il est juste d’ajouter que ces privautés semblent encouragées par l’indifférence du piédestal qui, lui, continue de paître. Ces amis un peu effrontés de notre bétail, ce sont les étourneaux.
La sagesse des nations a gratifié l’étourneau d’une cervelle légère. C’est le moment de vous assurer que tous ces dictons ne sont pas articles de foi. Si vous approchez, tous les oiseaux épars sur le sol ouvriront leurs ailes et s’éloigneront d’un vol tourbillonnant. Avant de se décider à rejoindre leurs compagnons, ceux qui fourragent dans quelque toison vous laisseront, au contraire, avancer à courte distance. Nous estimons que c’est un peu parce qu’ils ne quittent qu’à regret un gîte aussi agréable, mais beaucoup parce que l’expérience a démontré aux étourneaux qu’en pareil cas la crainte d’endommager leur support vous condamne, bon gré mal gré, à la clémence, et le calcul n’est pas d’une tête folle.
D’ailleurs, l’espèce a le don de sociabilité qui ne va jamais sans une certaine intelligence. L’étourneau s’isole, il est vrai, pendant la saison des nids; un isolement à deux, bien entendu. Après avoir fait son nid dans quelque trou d’arbre, de rocher et plus souvent de vieux mur, après avoir élevé les quatre oisillons qui sont sortis des œufs d’un bleu verdâtre que la femelle a pondus, et couronné ses devoirs de père de famille en les initiant à l’art du vol, l’étourneau rejoint ses amis en leur amenant ce renfort.
La bande se reforme, elle est de vingt jusqu’à une centaine d’oiseaux qui, dès lors, ne se quittent guère, traversant les airs à d’assez grandes hauteurs, quêtant, picorant, digérant de compagnie, partageant en frères la bonne et la mauvaise fortune et jusqu’à la grêle de mitraille qu’un chasseur plus enragé qu’avisé ne craindra pas de faire pleuvoir sur le groupe tumultueux, mais serré, qu’ils forment en volant.
Meurtres inutiles et que nous ne cesserons pas de condamner; la chair de l’étourneau n’est pas mangeable. Des industriels ont essayé de lui faire perdre son amertume caractéristique. Ils ont enfermé des étourneaux dans des volières en leur prodiguant une nourriture exclusivement végétale. Ils n’ont réussi qu’à accentuer la maigreur pro verbiale de l’oiseau. Lous estournagalhs non baden pas gras, disent les Gascons, les étourneaux ne deviennent pas gras.
Les Étourneaux.
On prétend encore qu’en leur coupant la tête immédiatement après les avoir abattus ils deviennent très comestibles; il est douteux que le régal mérite tant de peine.
L’instinct sociable des étourneaux se révèle encore d’une manière plus curieuse.
Pendant la journée, ils se réunissent en petites bandes, ce qui leur permet de pourvoir plus aisément à leur nourriture; le soir venu, toutes ces bandes obéissant soit à une attraction commune, soit à leur prédilection pour un gîte particulier, se rassemblent, pour passer la nuit, en une véritable armée, que l’on peut évaluer de cinq mille à vingt mille oiseaux; ces soi-disant étourdis, qui branchent un peu partout pendant la belle saison, choisissent toujours pour auberge d’hivernage les massifs des roseaux des grands marais, dont l’épaisseur leur ménage un excellent abri contre le froid et la bise.
Nous avons assez souvent assisté au coucher et au réveil des étourneaux, aux abords d’un vaste marécage, en Normandie.
Aussitôt que le soleil s’abaissait à l’horizon, on voyait leurs pelotons ponctuer tous les coins du ciel. Après avoir décrit quelques ellipses au-dessus de l’hôtellerie, ils se posaient sur les arbres des alentours, qui en étaient littéralement chargés. Probablement quand ils se voyaient en nombre suffisant, ils se remettaient à l’essor, puis, après avoir plusieurs fois tournoyé, ils prenaient possession de la chambre à coucher.
Les bandes qui survenaient répétaient cette manœuvre; jusqu’à la nuit, il en arrivait toujours et de la forêt de roseaux s’élevaient des gazouillements assourdissants qui allaient en s’éteignant, à mesure que les ombres s’épaississaient; enfin, tout se taisait dans la jonchée, et le silence de la nuit n’était plus troublé que par les appels des canards que dominait, de loin en loin, le cri rauque du butor.
Le lever de ce petit peuple n’était pas moins original.
Aux premières lueurs de l’aube, le murmure gazouillant reprenait; mais cette fois, il s’y mêlait des cris aigres et aigus, car l’organe de l’étourneau de la sauvagerie est loin d’être agréable.
Tout à coup, comme s’ils eussent tous obéi à un signal, cette énorme agglomération d’oiseaux se levait d’un seul jet, d’un seul vol, formant un nuage qui obscurcissait les fauves clartés montant à l’orient; cette trombe ailée passait et repassait sur la nappe on doyante des roseaux avec un bruit qui s’entendait à plus d’un kilomètre, puis elle s’élevait par des vols toujours concentriques, montait dans la direction du zénith et se désagrégeait; chaque bande se reformait, et les braves petits compagnons s’enfonçaient aux quatre points cardinaux et disparaissaient dans le lointain, allant à de très grandes distances, sans aucun doute, poursuivre leur combat pour la vie, la glane laborieuse et l’aide mutuelle pour résister aux tyrans de l’air.
Ce n’était pas seulement la beauté de son plumage qui désignait l’étourneau aux capricieuses prédilections du maître de la création, c’était surtout son aptitude à retenir le chant qu’on lui enseigne et à prononcer quelques paroles.
Mais cette aptitude, il n’a guère lieu de s’en féliciter; comme il arrive à bien d’autres encore qu’à lui, ses petits talents lui coûtent souvent sa liberté et lui valent les cruels honneurs de la cage.
Élevé à la dignité de notre commensal, il échange généralement son nom d’étourneau contre celui de sansonnet qu’il portait dans le vieux français, et est, par-dessus le marché, qualifié de «perroquet de savetier».
Il ne faut pas croire que cette transformation de l’étourneau criard en sansonnet chanteur puisse se faire à tout âge: non, le sujet dont on veut essayer l’éducation doit avoir été pris dans le nid; chez les bêtes comme chez les gens, l’habitude est une seconde nature, contre laquelle les efforts les plus persévérants risquent de se briser: si le jeune prisonnier a déjà répété le ramage et le cri désagréable de ses parents, on ne les lui fera pas oublier; au lieu d’un concert en chambre, on aura un charivari.