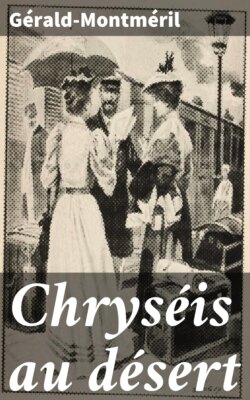Читать книгу Chryséis au désert - Gérald-Montméril - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LE TRAIN DE TOMBOUCTOU, S. V. P.?
Оглавление«Dieu dont l’arc est d’argent dieu de Claros, écoute!»
Il dardait toutes ses flèches à la fois ce jour-là, le dieu de Claros. Par ce soleil à nul autre semblable dont l’Afrique a le secret, le paquebot venu de France abordait au port de Saint-Louis, dans le chenal vaseux et allongé que forment les bouches du Sénégal. Il apportait avec lui des munitions et des armes, des nouvelles de la mère patrie, et maintes autres choses nécessaires à la colonie.
Il apportait aussi, marchandise rare, deux passagères, objet des attentions de tout l’équipage, d’ailleurs peu blasé. L’une était longue, mince, jaune, fanée, prétentieuse de mise et de langage: on a nommé Mlle Rosita Verduron. L’autre, toute, jeune, toute fraîche, toute coquette: un bouton de rose... Mais que d’épines à cette rose! et combien peu de parfum! La pauvre Chryséis était figée, confite, dans la profonde admiration qu’elle avait pour sa propre personne, et cette admiration n’avait d’égale que son dédain pour les autres: elle commençait «les autres» à son propre père, car le bon colonel ne se souvenait guère qu’approximativement des primes études de sa jeunesse, et avait peu de souci de tout ce qui n’était pas son cher métier de soldat.
Du reste, pour être impartial, il faut dire que si Catherine-Chryséis stupéfiait les officiers du bord en les entretenant de la généalogie, débrouillée par elle, de Noefil, de la race des Ases, fondateur de la première dynastie des Burgondes d’outre-Rhin — conversation qui ne les intéressait que relativement, — elle n’eût pas moins stupéfié le maître-coq par son ignorance touchant le pot-au-feu et les pois au lard, comme elle stupéfia un jour la maîtresse lingère par sa parfaite indépendance en matière de reprises. Décidément Annette avait eu raison, et Chryséis ne considérait toutes ces choses que comme des besognes inférieures que l’on devait laisser aux malheureuses privées des dons intellectuels.
La traversée s’était effectuée sans incidents graves; Mlle Rosita avait eu le mal de mer et n’avait pas paru à table; sa nièce, invulnérable aux coups de Neptune, n’avait pas manqué un repas, et avait charmé les convives par son aplomb, ses dissertations et son bel appétit.
On débarqua: Mlle Rosita recouvra ses sens, descendit à terre avec Chryséis, et accepta d’un air royal les ovations que faisaient aux arrivants les porte-faix de toutes les couleurs, hôtes du port. Elle daigna leur confier ses bagages pour les conduire à la gare: ce qu’ils firent avec une promptitude, un empressement, un enthousiasme qui donnèrent à la digne tante une haute idée de leurs mœurs hospitalières.
Cette idée diminua quand ils réclamèrent leur pourboire.
Si exagéré qu’il fût, pourtant elle s’exécuta sans trop rechigner. Mais son ravissement disparut tout à fait à la suite de son entrevue avec le chef de gare. Celui-ci, en effet, à qui elle demanda avec sérénité «deux premières pour Tombouctou», lui apprit que la ligne ferrée dont il faisait les honneurs allait, non à Tombouctou, mais à Dakar, dans une direction fort différente de celle qu’elle désirait suivre.
«Je te l’avais bien dit, fit Chryséis très calme.
— Comment! s’écria Mlle Rosita, et le transsaharien? Il est là, sur ma carte! voyez, monsieur!
— Je vois, madame, mais cela ne suffit pas. Votre carte avance, hélas!... le transsaharien, à l’étude... est-ce bien à l’étude qu’il faut dire?... d’Ouargla à Tombouctou, n’est qu’à l’état de vague aspiration de Tombouctou à Saint-Louis. Il a déjà coûté cher... et je pense qu’on achèvera de le construire avec les fonds qui resteront du canal de Panama.»
Le chef de gare était facétieux, mais cette plaisanterie, que Chryséis jugea d’un goût déplorable, ne consola pas Mlle Rosita.
«Mais alors que faire? monsieur, que faire? gémit-elle tout éplorée. Aller à Dakar m’est inutile... Je ne comprends pas que mon frère — le colonel Verduron, monsieur, à Tombouctou, — que mon frère, ayant reçu ma lettre et prévu mes embarras, ne m’ait pas envoyé une voiture et une escorte!»
«Il sst là, sur ma carte: voyez, monsieur.
Le chef de gare, touché par cet appel à ses lumières, devint sérieux et demanda paternellement:
«Voyons, savez-vous quand votre lettre a dû arriver?
— Je l’ai mise à la poste de Passy le 15 août, monsieur, six jours avant notre départ. Nous avons pris le paquebot à Bordeaux le 21 du même mois.
— Ah! fort bien! je comprends! dit le fonctionnaire en hochant la tête avec satisfaction. Votre lettre est arrivée à Saint-Louis en même temps que vous, et, naturellement, n’est pas encore partie pour le désert.
— Pas partie! sursauta Mlle Rosita... Mais comment le service des postes est-il donc fait ici?
— Par des paquebots qui partent de Bordeaux deux fois par mois, — je ne parle pas des services anglais; — et, une fois arrivées ici, les lettres sont portées par des méharistes; mais les départs des convois n’ont guère lieu qu’autant que le transport des marchandises, munitions, envois de toutes sortes, en vaut la peine. Ils desservent les postes français jusqu’à Bakel, et quelquefois plus loin encore; puis ils s’engagent dans le pays insoumis, essayant d’atteindre Tombouctou sans encombre. Cela n’arrive pas toujours...
— Ma pauvre lettre! gémit la tante qui n’avait pas écouté. Mais les voyageurs, mon bon monsieur, les voyageurs, comment font-ils?
— Il n’y a pas de voyageurs, répondit le chef de gare avec une noble simplicité.
— Mais enfin!... ma nièce et moi, monsieur?... Trouve-t-on seulement une voiture, dans ce pays perdu?... la plus élémentaire diligence?
— Une diligence, je ne crois pas. Mais enfin on pourrait vous transporter jusqu’à Kayes ou même Nioro; il y a même un tronçon de voie ferrée, par là, si les dernières pluies ne l’ont pas emportée.
— A la bonne heure! fit la tante rassérénée. Et combien y a-t-il de là à Tombouctou, monsieur? la route est-elle possible pour deux jeunes dames?
— Il y a plusieurs centaines de kilomètres dans les sables, à travers les peuplades ennemies. »
Les cheveux de Mlle Rosita se hérissèrent d’horreur. Elle ne put que balbutier d’une voix étranglée:
«Et il n’y a pas d’autre route?»
Mais le chef de gare en avait assez. Il fit poliment comprendre à son interlocutrice que l’heure du train arrivait, que ses devoirs le réclamaient, et il s’esquiva, promettant de leur envoyer «quelqu’un pour les conduire au palais du gouverneur».
«O Chryséis! ma Chryséis! qu’allons-nous devenir?» gémit la vieille demoiselle.
La fillette, assise dans un coin, prenait des notes en silence. Elle leva les yeux, et très tranquillement:
«Cela ne me regarde pas. Tu es ma tutrice: c’est ton affaire.»
C’est au palais du gouvernement que nous retrouvons nos deux héroïnes. Le gouverneur, tout en trouvant, à part lui, que le colonel Verduron avait une singulière idée de faire venir sa famille dans une pareille garnison, s’était mis, en véritable représentant de la chevalerie française, au service de Mlle Rosita et de sa jolie nièce. Il réussit à leur persuader de se joindre au convoi qui devait partir dans quelques jours: le même, oui, le même qui devait porter leur lettre. Seulement cette idée-là ne leur vint pas, et elles restèrent très persuadées, même Chryséis, plus forte en théorie qu’en pratique, que leurs épîtres allaient partir le lendemain.
Pour occuper les jours d’attente, Chryséis eut une idée utile, contre son ordinaire: il faut dire que cette idée rentrait un peu dans celles qui lui étaient familières, sans quoi elle ne lui fût sans doute pas venue. Ce fut d’étudier le sabir, cette langue éminemment composite et fantaisiste, où entrent, comme dans le célèbre thé de feu Mme Gibou, beaucoup d’éléments hétérogènes: français, anglais, arabe, espagnol, nègre, etc., etc., langue indispensable à qui veut voyager en Afrique, langue qu’on avait oublié d’enseigner à Catherine parmi toutes celles qu’elle avait apprises. Elle chercha d’abord un dictionnaire et une grammaire dans tout Saint-Louis. N’en trouvant pas, elle dut se résigner à suivre les conseils de Mme la gouvernante, et se rabattre sur la négresse, nourrice des enfants de cette dernière.
L’institutrice improvisée ne fut pas peu fière de ses nouvelles fonctions; mais sa jubilation diminua vite, et si elle conçut une haute idée de la vive intelligence de son élève, elle ne pensa pas de même de sa douceur et de sa bonne grâce.
Pendant ce temps, le gouverneur s’occupait de leur départ, et donnait des ordres pour qu’elles pussent, sans trop de fatigue, faire un si long et si pénible trajet: c’est ainsi qu’il leur procura une de ces litières fermées par des rideaux de cuir, qui sont en usage pour les femmes qui voyagent à dos de chameau; c’est ainsi également qu’il les recommanda, sans les nommer pourtant, à la sollicitude du sergent Jubier, qui rejoignait le régiment avec l’escorte. Jubier promit de veiller sur ces dames «avec tout le respect et les soins qu’il en serait susceptible, puisque ces dames elles s’offraient l’agrément de venir voir mon colonel».
Pendant ce temps aussi, Mme la gouvernante, enchantée de voir des Françaises, les conduisit partout, leur faisant tout voir, tout apprécier. Elle leur racontait en même temps, en femme qui possède son sujet à fond, les transformations de la colonie, «la plus ancienne de toutes celles de la France».
«Songez, disait-elle, que c’est en 1368, sous le règne de Charles V, que les hardis marins de Dieppe abordèrent à Dakar! Ah! les vieux Normands de France! que d’exploits ils ont accomplis que l’histoire ne sait plus, que d’autres ont pris pour leur compte, que nous, ingrats, nous avons oubliés!»
Puis elle continuait, disant la ruine des comptoirs normands pendant la guerre de Cent Ans, et leur envahissement par les Portugais. Puis, au XVIe siècle, la France reparaît. Et, à travers les attaques des Anglais et des Portugais, la colonie végète, passant de main en main, de gouverneur en gouverneur, tour à tour dévastée, brûlée, rançonnée par tous les roitelets voisins, abandonnée par la mère patrie qui la méprise. Cela jusqu’à notre siècle, jusqu’au jour tout proche de nous où le général Faidherbe, alors colonel, y consacra toutes ses forces, transforma tout en six ans, rétablit l’ordre, le travail, la justice: si bien qu’on peut prévoir le moment où «le royaume de sable», que les Anglais dédaignèrent de nous disputer en 1815-1817, sera l’une des plus florissantes parmi nos colonies africaines.
Cette dissertation fit, ce jour-là, beaucoup remonter la charmante femme dans l’esprit de Chryséis, qui, l’ayant vue s’occuper de sa maison et de ses enfants, avait commencé par la regarder avec son dédain habituel. Elle eut occasion peu d’heures après de s’apercevoir qu’on pouvait, sans cesser d’être une maîtresse de maison accomplie, s’occuper des «mœurs des indigènes», et que le pot-au-feu ne bannissait pas toute poésie. Elles étaient arrivées, dans leur promenade, à la pointe de l’île où est bâti Saint-Louis; les bras du fleuve et le reflux de l’Océan confondaient les eaux, et sur le sable brillaient au soleil couchant, comme un écrin de fée, des coquillages de toutes formes, de toutes couleurs, irisés, rosés, splendides. Si bien que Chryséis jeta un cri de joie:
«Oh! les beaux échantillons que voilà ! quel coup de fortune pour ma collection conchyliologique! »
Elle se baissait en même temps, rapide, et ramassait une poignée de conques étincelantes...
Des cris d’indignation retentirent tout à coup autour d’elle; des noirs se la montraient du doigt avec colère, et une horrible vieille négresse, à mine de sorcière, levait les bras au ciel avec des exclamations gutturales.
Une horrible vieille négresse levait les bras au ciel.
La gouvernante, qui écoutait en ce moment des vers improvisés par Mlle Rosita, se retourna vivement, jeta un cri à son tour, et montrant à la fillette les indigènes menaçants:
«Cachez un seul coquillage, un seul! vite! dit-elle, et posez avec précaution les autres à terre; il y va de votre sûreté !»
Surprise, Chryséis obéit, ce qui ne lui arrivait pas souvent, tandis que la gouvernante disait quelques mots à la vieille négresse qui s’apaisa. Mais Mlle Rosita était froissée du manque d’égards dont on s’était rendu coupable envers sa muse.
«Nous expliquerez-vous?... fit-elle assez sèchement.
— Oui, mademoiselle, dit en souriant la jeune femme. Les habitants du littoral croient la mer habitée par des génies puissants...»
Chryséis avait tiré son block-notes et griffonnait déjà fiévreusement.
«Ils y demeurent dans des palais éblouissants, et ceux qu’ils y entraînent ne veulent plus les quitter. Mais lorsqu’ils sont morts, les génies les changent en coquillages, et les renvoient sur les rives pour chanter aux hommes, dans leur murmure mystérieux, les merveilles de l’Océan. Pour les pêcheurs de la côte, ces conques sont des ancêtres, et ils ne souffrent pas qu’on les traite sans respect.
— Merci, madame, dit Chryséis en fermant son carnet.
— Je ferai un poème là-dessus et je vous le dédierai, dit Rosita avec âme en serrant la main de l’aimable femme. Quelle poésie puissante dans l’élément perfide!
«O flots! que vous savez de lugubres histoires...».