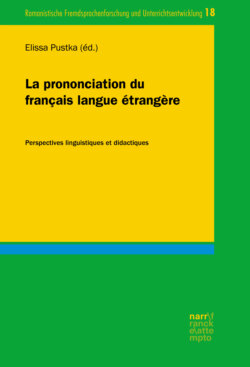Читать книгу La prononciation du français langue étrangère - Группа авторов - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 L’apprentissage de la prononciation française par des apprenant.e.s plurilingues
ОглавлениеDans leurs études sur les propriétés temporelles de l’anglais, du français et de l’espagnol comme langues étrangères chez des apprenant.e.s bilingues allemand-chinois et allemand-turc, Gabriel/Rusca-Ruths (2015) et Gabriel et al. (2015) ont constaté de légers indices d’un avantage bilingue. Leurs mesures du rythme prosodique ont révélé que les apprenant.e.s plurilingues qui font preuve d’un degré élevé de conscience phonologique et interlinguistique et qui affichent une attitude positive à l’égard de leur langue d’origine et de la langue étrangère respective ont obtenu des résultats plus proches de la cible que leurs pairs monolingues. Ceci, à son tour, suggère que certains facteurs extralinguistiques peuvent faciliter le transfert positif de la langue d’origine vers la L3. Enfin, les mesures de VOT faites par Gabriel et al. (2016) suggèrent qu’en plus de la conscience phonologique et des attitudes des apprenant.e.s, l’enseignement de la prononciation en classe de FLE joue un rôle important : ni les apprenant.e.s bilingues (allemand.e.s-chinois.es) ni les apprenant.e.s allemand.e.s monolingues n’atteignent des valeurs cibles pour les occlusives en FLE, tandis que la majorité des apprenant.e.s monolingues chinois.es (enregistré.e.s à Pékin) à qui les enseignants chinois ont explicitement signalé d’éviter l’aspiration des occlusives /p t k/ en français, produisent des valeurs de VOT similaires à celles du groupe de contrôle monolingue français. La production d’occlusives en termes de VOT a également été abordée par Llama/López-Morelo (2016). Les auteures ont analysé des données recueillies auprès de locuteurs bilingues espagnol-anglais qui avaient participé à un programme d’immersion en français au Canada anglophone et ont montré que les valeurs de VOT produites par les bilingues en français L3 étaient influencées par l’anglais, bien que leur langue d’origine, l’espagnol, ne montre pas cette influence. Ce résultat suggère que la langue environnante (l’anglais), qui est aussi la langue de l’enseignement scolaire, surpasse la langue d’origine (l’espagnol) comme base de transfert positif vers la langue étrangère (le français). Cette opinion est appuyée par les travaux de Gabriel et al. (2018a) et de Dittmers et al. (2018) qui étudient la production des occlusives sourdes et sonores anglais, français et russe comme langues étrangères produites par de jeunes bilingues turc-allemand et russe-allemand : alors que pour /p t k/, les multilingues produisent en français L3 des valeurs de VOT plus proches de la langue cible que les apprenant.e.s monolingues allemand.e.s, ils/elles ne réussissent pas à pré-voiser /b d ɡ/. Pourtant, leurs langues d’origine respectives (le turc et le russe) ont conservé ce trait qui aurait donc pu être positivement transféré vers le français. Un effet positif du turc sur l’apprentissage de l’anglais et du français a également été constaté par Ösazlan/Gabriel (2019). Les auteur.e.s ont montré que les apprenant.e.s bilingues allemand-turc réussissaient mieux à éviter le transfert négatif du dévoisement final (all. Auslautverhärtung) vers les langues étrangères que les apprenant.e.s allemand.e.s monolingues. Ce processus, qui neutralise le contraste de voisement entre occlusives et fricatives sourdes et sonores en position de coda syllabique (p. ex., Kind [kɪnt] ‘enfant’ vs Kinder [ˈkɪn.dɐ] ‘enfants’), mène couramment à des erreurs de segmentation dans l’anglais et le français des apprenant.e.s monolingues telles que angl. bad ‘mauvais’, prononcé avec un /d/ final dévoisé (donnant *[bæt]) ou fr. gaz, prononcé avec une réalisation sonore du /z/ final (*[ɡas]). L’étude de Gabriel et al. (2021), finalement, a mis en évidence que les apprenant.e.s bilingues allemand-turc arrivent également à éviter, dans la plupart des cas, le transfert négatif d’une autre règle phonologique de l’allemand vers le FLE : lorsque les monolingues tendent à vocaliser le /ʁ/ français en position de coda syllabique selon le modèle de l’allemand (ce qui donne des productions comme [kʏlˈtyɐ̯] (culture), calquées sur l’allemand Kultur [kʊlˈtuɐ̯]), les plurilingues semblent se pencher plutôt sur le turc (où le r maintient son caractère consonantique en position finale : kültür [kyltyɾ̥]) et, par conséquent, tendent à prononcer correctement culture [kyltyʁ].1 Reste à souligner, pour finir, que la présence ou l’absence du transfert négatif de la vocalisation du r a un impact sur le rythme prosodique, c’est-à-dire sur la distribution des intervalles vocaliques et consonantiques (cf. Abercrombie 1967 ; Pike 1945 ; Auer/Uhmann 1988 ; Ramus et al. 1999 ; White/Mattys 2007 ; Kinoshita/Sheppard 2011). C’est ainsi que dans l’étude de Gabriel et al. (2021) les données produites par les apprenant.e.s plurilingues sont caractérisées par une variabilité vocalique moins élevée (et plus conforme à celle du français natif) que celles des apprenant.e.s monolingues. Cela signifie que le rythme des données du premier groupe est également plus conforme à celui de la langue cible.
En résumé, les recherches sur l’apprentissage de la prononciation du FLE dans le contexte plurilingue ont mis en évidence certains signes d’un avantage bilingue au niveau de la phonologie segmentale. De tels résultats vont au-delà non seulement d’un « avantage bilingue » général souvent mentionné dans la littérature2, mais aussi au-delà des propriétés générales de la parole non native telles qu’un débit de parole plus lent (cf. Gut et al. 2008 : 10–11), un registre tonal réduit (cf. Jenner 1976 ; Mennen 2008 : 55) et une utilisation moins variable de la fréquence fondamentale (cf. Zimmerer et al. 2014).