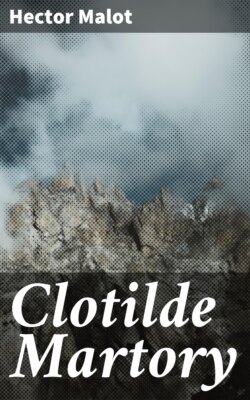Читать книгу Clotilde Martory - Hector Malot - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
ОглавлениеTable des matières
Depuis que j'avais aperçu Clotilde se préparant à monter en voiture jusqu'au moment où j'avais arrêté ma place pour Cassis, j'avais agi sous la pression d'une force impulsive qui ne me laissait pas, pour ainsi dire, la libre disposition de ma volonté. Je trouvais une occasion inespérée de la voir, je saisissais cette occasion sans penser à rien autre chose; cela était instinctif et machinal, exactement comme le saut du carnassier qui s'élance sur sa proie. J'allais la voir!
Mais en sortant du bureau de la voiture et en revenant chez moi, je compris combien mon idée était folle.
Que résulterait-il de ce voyage en tête-à-tête dans le coupé de cette diligence?
Ce n'était point en quelques heures que je la persuaderais de la sincérité de mon amour pour elle. Et d'ailleurs oserais-je lui parler de mon amour, né la veille, dans un tour de valse, et déjà assez puissant pour me faire risquer une pareille entreprise? Me laisserait-elle parler? Si elle m'écoutait, ne me rirait-elle pas au nez? Ou bien plutôt ne me fermerait-elle pas la bouche au premier mot, indignée de mon audace, blessée dans son honneur et dans sa pureté de jeune fille? Car enfin c'était une jeune fille, et non une femme auprès de laquelle on pouvait compter sur les hasards et les surprises d'un tête-à-tête.
Plus je tournai et retournai mon projet dans mon esprit, plus il me parut réunir toutes les conditions de l'insanité et du ridicule.
Je n'irais pas à Cassis, c'était bien décidé, et m'asseyant devant ma table, je pris un livre que je mis à lire. Mais les lignes dansaient devant mes yeux; je ne voyais que du blanc sur du noir.
Après tout, pourquoi ne pas tenter l'aventure? Qui pouvait savoir si nous serions en tête-à-tête? Et puis, quand même nous serions seuls dans ce coupé, je n'étais pas obligé de lui parler de mon amour; elle n'attendait pas mon aveu. Pourquoi ne pas profiter de l'occasion qui se présentait si heureusement de la voir à mon aise? Est-ce que ce ne serait pas déjà du bonheur que de respirer le même air qu'elle, d'être assis près d'elle, d'entendre sa voix quand elle parlerait aux mendiants de la route ou au conducteur de la voiture, de regarder le paysage qu'elle regarderait? Pourquoi vouloir davantage? Dans une muette contemplation, il n'y avait rien qui pût la blesser: toute femme, même la plus pure, n'éprouve-t-elle pas une certaine joie à se sentir admirée et adorée? c'est l'espérance et le désir qui font l'outrage.
J'irais à Cassis.
Pendant que je balançais disant non et disant oui, l'heure avait marché: il était trois heures cinquante-cinq minutes. Je descendis mon escalier quatre à quatre et, en huit ou dix minutes, j'arrivai au bureau de la voiture; en chemin j'avais bousculé deux braves commerçants qui causaient de leurs affaires, et je m'étais fait arroser par un cantonnier qui m'avait inondé; mais ni les reproches des commerçants, ni les excuses du cantonnier ne m'avaient arrêté.
Il était temps encore; au détour de la rue j'aperçus la voiture rangée devant le bureau, les chevaux attelés, la bâche ficelée: Clotilde debout sur le trottoir s'entretenait avec sa cousine.
Je ralentis ma course pour ne pas faire une sotte entrée. En m'apercevant, madame Lieutaud s'approcha de Clotilde et lui parla à l'oreille. Évidemment, mon arrivée produisait de l'effet.
Lequel? Allait-elle renoncer à son voyage pour ne pas faire route avec un capitaine de chasseurs? Ou bien allait-elle abandonner sa place de coupé et monter dans l'intérieur, où déjà heureusement cinq ou six voyageurs étaient entassés les uns contre les autres?
J'avais dansé avec mademoiselle Martory, j'avais échangé deux ou trois mots avec la cousine, je devais, les rencontrant, les saluer. Je pris l'air le plus surpris qu'il me fut possible, et je m'approchai d'elles.
Mais à ce moment le conducteur s'avança et me dit qu'on n'attendait plus que moi pour partir.
Qu'allait-elle faire?
Madame Lieutaud paraissait disposée à la retenir, cela était manifeste dans son air inquiet et grognon; mais, d'un autre côté, Clotilde paraissait décidée à monter en voiture.
—Je vais écrire un mot à ton père; François le lui remettra en arrivant, dit madame Lieutaud à voix basse.
—Cela n'en vaut pas la peine, répliqua Clotilde, et père ne serait pas content. Adieu, cousine.
Et sans attendre davantage, sans vouloir rien écouter, elle monta dans le coupé légèrement, gracieusement.
Je montai derrière elle, et l'on ferma la portière.
Enfin.... Je respirai.
Mais nous ne partîmes pas encore. Le conducteur, si pressé tout à l'heure, avait maintenant mille choses à faire. Les voyageurs enfermés dans sa voiture, il était tranquille.
Madame Lieutaud fit le tour de la voiture et se haussant jusqu'à la portière occupée par Clotilde, elle engagea avec celle-ci une conversation étouffée. Quelques mots seulement arrivaient jusqu'à moi. L'une faisait sérieusement et d'un air désolé des recommandations, auxquelles l'autre répondait en riant.
Le conducteur monta sur son siége, madame Lieutaud abandonna la portière, les chevaux, excités par une batterie de coups de fouet, partirent comme s'ils enlevaient la malle-poste.
J'avais attendu ce moment avec une impatience nerveuse; lorsqu'il fut arrivé je me trouvai assez embarrassé. Il fallait parler, que dire? Je me jetai à la nage.
—Je ne savais pas avoir le bonheur de vous revoir sitôt, mademoiselle, et en vous quittant l'autre nuit chez madame Bédarrides, je n'espérais pas que les circonstances nous feraient rencontrer, aujourd'hui, dans cette voiture, sur la route de Cassis.
Elle avait tourné la tête vers moi, et elle me regardait d'un air qui me troublait; aussi, au lieu de chercher mes mots, qui se présentaient difficilement, n'avais-je qu'une idée: me trouvait-elle dangereux ou ridicule?
Après être venu à bout de ma longue phrase, je m'étais tu; mais comme elle ne répondait pas, je continuai sans avoir trop conscience de ce que je disais:
—C'est vraiment là un hasard curieux.
—Pourquoi donc curieux? dit-elle avec un sourire railleur.
—Mais il me semble....
—Il me semble qu'un vrai hasard a toujours quelque chose d'étonnant; s'il a quelque chose de véritablement curieux, il est bien près alors de n'être plus un hasard.
J'étais touché: je ne répliquai point et, pendant quelques minutes, je regardai les maisons de la Capelette, comme si, pour la première fois, je voyais des maisons. Il était bien certain qu'elle ne croyait pas à une rencontre fortuite et qu'elle se moquait de moi. D'ordinaire j'aime peu qu'on me raille, mais je ne me sentis nullement dépité de son sourire; il était si charmant ce sourire qui entr'ouvrait ses lèvres et faisait cligner ses yeux!
D'ailleurs sa raillerie était assez douce, et, puisqu'elle ne se montrait pas autrement fâchée de cette rencontre il me convenait qu'elle crût que je l'avais arrangée: c'était un aveu tacite de mon amour, et à la façon dont elle accueillait cet aveu je pouvais croire qu'il n'avait point déplu. Je continuai donc sur ce ton:
—Je comprends que ce hasard n'ait rien de curieux pour vous, mais pour moi il en est tout autrement. En effet, il y a deux heures je me doutais si peu que j'irais aujourd'hui à Cassis, que c'était à peine si je connaissais le nom de ce pays.
—Alors votre voyage est une inspiration; c'est une idée qui vous est venue tout à coup... par hasard.
—Bien mieux que cela, mademoiselle, ce voyage a été décidé par une suggestion, par une intervention étrangère, par une volonté supérieure à la mienne; aussi je dirais volontiers de notre rencontre comme les Arabes: «C'était écrit», et vous savez que rien ne peut empêcher ce qui est écrit?
—Écrit sur la feuille de route de François, dit-elle en riant, mais qui l'a fait écrire?
—La destinée.
—Vraiment?
J'avais été assez loin; maintenant il me fallait une raison ou tout au moins un prétexte pour expliquer mon voyage.
—Il y a un fort à Cassis? dis-je.
—Oh! oh! un fort. Peut-être sous Henri IV ou Louis XIII cela était-il un fort, mais aujourd'hui je ne sais trop de quel nom on doit appeler cette ruine.
Une visite à ce fort était le prétexte que j'avais voulu donner, j'allais passer une journée avec un officier de mes amis en garnison dans ce fort; mais cette réponse me déconcerta un moment. Heureusement je me retournai assez vite, et avec moins de maladresse que je n'en mets d'ordinaire à mentir:
—C'est précisément cette ruine qui a décidé mon voyage. J'ai reçu une lettre d'un membre de la commission de la défense des côtes qui me demande de lui faire un dessin de ce fort, en lui expliquant d'une façon exacte dans quel état il se trouve aujourd'hui, quels sont ses avantages et ses désavantages pour le pays. Vous me paraissez bien connaître Cassis, mademoiselle?
—Oh! parfaitement.
—Alors vous pouvez me rendre un véritable service. Le dessin, rien ne m'est plus facile que de le faire. Mais de quelle utilité ce fort peut-il être pour la ville, voilà ce qui est plus difficile. Il faudrait pour me guider et m'éclairer quelqu'un du pays. Sans doute, je pourrais m'adresser au commandant du fort, si toutefois il y a un commandant, ce que j'ignore, mais c'est toujours un mauvais procédé, dans une enquête comme la mienne, de s'en tenir aux renseignements de ceux qui ont un intérêt à les donner. Non, ce qu'il me faudrait, ce serait quelqu'un de compétent qui connût bien le pays, et qui en même temps ne fût pas tout à fait ignorant des choses de la guerre. Alors je pourrais envoyer à Paris une réponse tout à fait satisfaisante.
Elle me regarda un moment avec ce sourire indéfinissable que j'avais déjà vu sur ses lèvres, puis se mettant à rire franchement:
—C'est maintenant, dit-elle, que ce hasard que vous trouviez curieux tout à l'heure devient vraiment merveilleux, car je puis vous mettre en relation avec la seule personne qui précisément soit en état de vous bien renseigner; cette personne habite Cassis depuis quinze ans et elle a une certaine compétence dans la science de la guerre.
—Et cette personne? dis-je en rougissant malgré moi.
—C'est mon père, le général Martory, qui sera très-heureux de vous guider, si vous voulez bien lui faire visite.