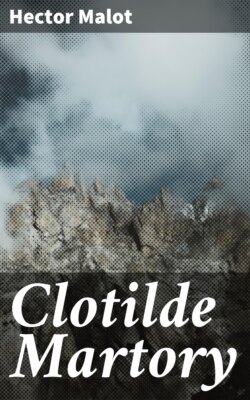Читать книгу Clotilde Martory - Hector Malot - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XII
ОглавлениеTable des matières
Si la présence de ce Solignac au dîner du général Martory m'avait tout d'abord inspiré une certaine inquiétude, maintenant elle me révoltait. A la pensée de me trouver à la même table que cet homme, je n'étais plus maître de moi; des bouffées de colère m'enflammaient le sang; l'indignation me soulevait.
Et cependant je ne croyais pas un mot de ce que m'avait dit Vimard. Pas même pendant l'espace d'un millième de seconde, je n'admis la possibilité que ce propos infâme eût quelque chose de fondé. C'était une immonde calomnie, une invention diabolique dont se servait le plus misérable des hommes pour masquer ses cheminements souterrains.
Mais enfin une blessure profonde m'avait été portée; le souffle empoisonné de cette calomnie avait passé sur mon amour naissant comme un coup de mistral passe au premier printemps sur les campagnes de la Provence: les plantes surprises dans leur éclosion garderont pour toute leur vie la marque de ses brûlures; sur leurs rameaux reverdis il poussera de nouvelles feuilles, il s'épanouira d'autres fleurs, ce ne seront point celles qui ont été desséchées dans leur bouton.
Et j'allais m'asseoir près de cet homme; il me parlerait; je devrais lui répondre.
Sous peine de me voir fermer la maison dont la porte s'ouvrait devant moi, il me faudrait arranger mes réponses au gré du général, au gré même de Clotilde, qui partageait les idées de son père, ou qui tout au moins voulait qu'on ne les contrariât point.
La situation était délicate, difficile, et, quoi qu'il advînt, elle serait pour moi douloureuse. Ce ne fut donc pas le coeur joyeux et l'esprit tranquille que le dimanche matin je me mis en route pour Cassis.
Le général me reçut comme si j'étais son ami depuis dix ans; quand j'entrai dans le salon il quitta son fauteuil pour venir au-devant de moi et me serrer les mains.
—Exact, c'est parfait, bon soldat; en attendant le dîner, nous allons prendre un verre de riquiqui; je n'ai plus mon rhumatisme: vive l'empereur!
Il appela pour qu'on nous servît; mais, au lieu de la servante, ce fut Clotilde qui parut. Elle aussi me reçut comme un vieil ami, avec un doux sourire elle me tendit la main.
Les inquiétudes et les craintes qui m'enveloppaient l'esprit se dissipèrent comme le brouillard sous les rayons du soleil, et instantanément je vis le ciel bleu.
Mais cette éclaircie splendide ne dura pas longtemps, le général me ramena d'un mot dans la réalité.
—Puisque vous êtes le premier arrivé, dit-il, je veux vous faire connaître les convives avec lesquels vous allez vous trouver; quand on est dans l'intimité comme ici, c'est une bonne précaution à prendre, ça donne toute liberté dans la conversation sans qu'on craigne de casser les vitres du voisin. D'abord, mon ami le commandant de Solignac, dont je vous ai déjà assez parlé pour que je n'aie rien à vous en dire maintenant; un brave soldat qui eût été un habile diplomate, un habile financier, enfin, un homme que vous aurez plaisir à connaître.
Je m'inclinai pour cacher mon visage et ne pas me trahir.
—Ensuite, continua le général, l'abbé Peyreuc. Que ça ne vous étonne pas trop de voir un prêtre chez un vieux bleu comme moi; l'abbé Peyreuc n'est pas du tout cagot, c'est un ancien curé de Marseille qui s'est retiré à Cassis, son pays natal; autrefois il pratiquait, dit-on, la gaudriole, maintenant il entend très-bien la plaisanterie. Pas besoin de vous gêner avec lui. Enfin, le troisième convive, César Garagnon, négociant à Cassis, marchand de vin, marchand de pierre, marchand de corail, marchand de tout ce qui se vend cher et s'achète bon marché, un beau garçon en train de faire une belle fortune qu'il serait heureux d'offrir à mademoiselle Clotilde Martory. Mais celle-ci n'en veut pas, ce dont je l'approuve, car la fille d'un général n'est pas faite pour un pékin de cette espèce.
Au moment où le général prononçait ce dernier mot, la porte s'ouvrit devant M. César Garagnon lui-même, et ma jalousie, qui s'éveillait déjà, se calma aussitôt. Il pouvait aimer Clotilde, il devait l'aimer, mais il ne serait jamais dangereux: le parfait bourgeois de province avec toutes les qualités et les défauts qui constituent ce type, qu'il soit Provençal ou Normand, Bourguignon ou Girondin. Puis arriva un prêtre gros, gras et court, la figure rouge, la physionomie souriante, marchant à pas glissés avec des génuflexions, l'abbé Peyreuc, ce qu'on appelle dans le monde «un bonhomme de curé.»
Enfin j'entendis sur les dalles sonores du vestibule un pas rapide et sautillant qui me résonna dans le coeur, et je vis entrer un homme petit, mais vigoureux, maigre et vif, le visage noble et fait pour inspirer confiance s'il n'avait point été déparé par des yeux perçants et mobiles qui ne regardaient jamais qu'à la dérobée, sans se fixer sur rien. Avec cela une rapidité de mouvements vraiment troublante, et en tout la tournure d'un homme d'affaires intrigant et brouillon plutôt que celle d'un militaire; un vêtement de jeune homme, la moustache et les cheveux teints; des pierres brillantes aux doigts; une voix chantante et fausse.
Je n'eus pas le temps de bien me rendre compte de l'impression qui me frappait, car il vint à moi amené par le général, et une présentation en règle eut lieu. Il me semble qu'il me dit qu'il était heureux de faire ma connaissance ou quelque chose dans ce genre, mais j'entendis à peine ses paroles; en tous cas je n'y répondis que par une inclinaison de tête.
Comment allait-on nous placer à table? M. de Solignac serait-il à côté de Clotilde? lui donnerait-il le bras pour passer dans la salle à manger? Ces interrogations m'obsédaient sans qu'il me fût possible d'en détacher mon esprit. Déjà je n'étais plus tout au bonheur de voir Clotilde; malgré moi le souvenir des paroles de Vimard me pesait sur le coeur; en regardant Clotilde et M. de Solignac je me disais, je me répétais que c'était impossible, absolument impossible, et cependant je les regardais, je les épiais.
Heureusement rien de ce que je craignais ne se réalisa: Clotilde entra la première dans la salle à manger, et comme la femme n'était rien dans la maison du général, celui-ci plaça à sa droite et à sa gauche l'abbé Peyreuc et M. de Solignac. Assis près de Clotilde, frôlant sa robe, je respirai. Pourvu qu'on n'entreprît pas ma conversion politique, je pouvais être pleinement heureux; après le dîner, si M. de Solignac m'emmenait dans le jardin pour me catéchiser, je saurais me défendre. Mais un mot dit par hasard ou avec intention ne nous entraînerait-il pas dans la politique pendant ce dîner? la question était là.
Tout d'abord les choses marchèrent à souhait pour moi, grâce au général et à l'abbé Peyreuc, qui s'engagèrent dans une discussion sur «le maigre.» Le général, qui avait connu chez Murat le fameux Laguipierre, racontait que celui-ci lui avait affirmé et juré qu'au temps où il était cuisinier au couvent des Chartreux, la règle traditionnelle dans cette maison était de faire des sauces maigres avec «du bon consommé et du blond de veau.» L'abbé Peyreuc soutenait que c'était là une invention voltairienne, et la querelle se continuait avec force drôleries du côté du général, qui tombait sur les moines, et contait, à l'appui de son anecdote, toutes les plaisanteries plus ou moins grivoises qui avaient cours à la fin du XVIIIe siècle. L'abbé Peyreuc se défendait et défendait «la religion» sérieusement. Tout le monde riait, surtout le général, qui méprisait «la prêtraille» et n'admettait le prêtre qu'individuellement «parce que, malgré tout, il y en a de bons: l'abbé, par exemple, qui est bien le meilleur homme que je connaisse.»
Mais au dessert ce que je craignais arriva: un mot dit en l'air par le négociant nous fit verser dans la politique, et instantanément nous y fûmes plongés jusqu'au cou.
—Il paraît qu'on a encore découvert des complots, dit M. Garagnon.
—On en découvrira tant que nous n'aurons pas un gouvernement assuré du lendemain, répliqua M. de Solignac; tant que les partis ne se sentiront pas impuissants, ils s'agiteront, surtout les républicains, qui croient toujours qu'on veut leur voler leur République. Ces gens-là sont comme ces mères de mélodrame à qui l'on «a volé leur enfant.»
Pendant que M. de Solignac s'exprimait ainsi, je remarquai en lui une particularité qui me parut tout à fait caractéristique. C'était à M. Garagnon qu'il répondait et il s'était tourné vers lui; mais, bien que par ses paroles, par la direction de la tête, par les gestes, il s'adressât au négociant, par ses regards circulaires, qui allaient rapidement de l'un à l'autre, il s'adressait à tout le monde. Cette façon de quêter l'approbation me frappa.
—Voilà qui prouve, conclut le général, qu'il nous faut au plus vite le rétablissement de l'empire, ou bien nous retombons dans l'anarchie.
—Je crois que la conclusion du général, reprit M. de Solignac, est maintenant généralement adoptée; je ne dis pas qu'elle le soit par tout le monde,—le regard circulaire s'arrondit jusqu'à moi,—mais elle l'est par la majorité du pays. Ce n'est plus qu'une affaire de temps.
—Et comment croyez-vous que cela se produira? demanda l'abbé Peyreuc.
—Ah! cela, bien entendu, je n'en sais rien. Mais peu importent la forme et les moyens. Quand une idée est arrivée à point, elle se fait jour fatalement; quelques obstacles qu'elle rencontre, elle les perce pour éclore.
—Vous prévoyez donc des obstacles? demanda l'abbé Peyreuc, qui décidément tenait à pousser à fond la question.
—Il faut toujours en prévoir.
—C'est là ce qui fait le bon officier, dit le général; il voit la résistance qu'on lui opposera, et il s'arrange de manière à l'enfoncer.