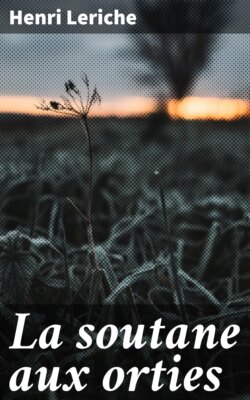Читать книгу La soutane aux orties - Henri Leriche - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV
ОглавлениеLaure Lefort, aujourd’hui baronne de Comberouse, était née dans la bonne grosse bourgeoisie du Périgord. Malgré l’amour-propre qui porte l’homme à se reconnaître et à se mirer complaisamment dans ses œuvres, M. et Mme Lefort ne pouvaient saisir entre eux et leur charmante enfant le moindre trait de ressemblance; son tempérament fin et délicat contrastait sans pitié avec la nature épaisse et plantureuse des auteurs de ses jours.
Le pensionnat dans lequel on avait placé Laure, à l’âge de neuf ans, était un rendez-vous d’éducation pour les vieilles familles de la province et les bourgeois huppés, jaloux de coudoyer les grands noms. M. Lefort, par sa position de fortune et par les tendances de son esprit, rentrait dans la catégorie de ces derniers.
Un des travers cultivés dans la noble institution, tenue par de braves religieuses bien intentionnées mais absolument ignorantes de la vie réelle, consistait à rehausser outre mesure l’importance de la particule aux yeux des jeunes personnes qui en étaient décorées. De là, pour les roturières, humiliation, envie, désir maladif de sortir de leur infériorité. Aussi, le dirons-nous? dans le nombre s’en trouvait-il quelques-unes qui n’hésitaient pas à se décerner à elles-mêmes des lettres «latentes» de noblesse, et improvisaient discrètement, sur leur table à toilette, une mignonne savonnette à vilaine pour leur usage personnel. Ce singulier caprice n’était d’ailleurs gravement contrarié ni par les maîtresses ni par les élèves; pour si peu que la chose fût présentée en douceur, elle passait presque sans contrôle. Bien mieux, nos petites comtesses de fantaisie, nos petites marquises de contrebande finissaient par se prendre elles-mêmes au sérieux. Et ce n’était pas sans d’affreux serrements de cœur, sans indignation péniblement refoulée, que d’aucunes, pendant les vacances, voyaient certains parents irrespectueux ou quelques amies d’enfance, par trop grossièrement familières, manquer en leur personne’aux égards dus aux gens de qualité.
Lorsque, à l’âge de seize ans, Mlle Laure Lefort fit son entrée dans le monde périgourdin, il ne fut bruit que de ses talents et de sa beauté. Le paintre qui, à cette époque, fut chargé de faire son portrait, se trouva être un artiste.
–Jamais, a-t-il souvent répété depuis, je n’ai mieux senti l’impuissance de la peinture à rendre certains contrastes.
Représentez-vous deux épais bandeaux de cheveux noirs comme le jais, formant un cadre sévère au visage le plus charmant. Les sourcils bruns étaient trop fièrement dessinés peut-être; mais les yeux, d’une indicible douceur, en tempéraient l’expression un peu rude. Mollement duveteuses comme la pêche, les joues semblaient inviter les baisers; colorées fraîchement d’une innocente rougeur, elles faisaient rêver aux anges. Quant à la bouche, oh! c’était une vraie bouche d’enfant: elle avait oublié de grandir! Chaque fois que le sourire l’entr’ouvrait, cette vivante grenade laissait voir un joyeux écrin de dents fines et étincelantes. Bref, cette tête adorable, d’un ovale parfait, et terminée par un menton orné d’une fossette particulièrement mignonne, était l’enchantement du regard et le désespoir de la palette.
A ces avantages physiques, mis en valeur par une taille des mieux proportionnées et une démarche pleine d’un noble abandon, Laure joignait, sous le rapport de l’esprit, les plus heureuses dispositions heureusement cultivées. Elle possédait ce germe de l’intelligence et des talents qui, pour se développer seul ensuite, n’a besoin que des premières leçons des maîtres même les plus vulgaires. Selon la nature de l’objet, son esprit était, tour à tour, intuitif ou inspiré. En musique surtout, depuis que, sortie de pension, elle étudiait à sa fantaisie, elle réalisait les progrès les plus étonnants. Lorsque, sans se faire trop prier, elle venait se mettre au piano pour s’accompagner elle-même, on ne savait ce qu’on devait le plus-admirer, de la portée riche et sonore de sa voix ou de l’expression naïve et dramatique qu’elle donnait naturellement à ce qu’elle chantait.
Et ce qui rehaussait encore cette supériorité, qu’aucune mère ni aucune fille ne songeaient à contester un instant, c’était la modestie simple et sans affectation qui ne l’abandonnait jamais. En acquérant, à son insu, quelque chose de la verve et du piquant d’une artiste merveilleusement douée, Laure avait gardé la candeur d’une pensionnaire.
–Quel dommage, disait à M. Lefort un conseiller de préfecture en retraite, qui venait passer, chaque année, un mois d’hiver à Paris, quel dommage que vous soyez millionnaire!… quelle perle de prima donna nous aurions dans votre «ravissante demoiselle»!
A cette flatterie périgourdine, et aux autres du même genre, M. Lefort s’efforçait de sourire modestement, en se rengorgeant dans son orgueil paternel.
On pense bien que, le jour venu pour les parents de Laure de songer à son établissement, les prétendants ne firent pas défaut. Les adorateurs tourbillonnaient autour d’elle, comme une légion d’insectes dorés dans un rayon de soleil. D’ailleurs, une dot de cent mille écus sonnants, étayée de riches «espérances» en perspective, n’avait rien de bien effrayant pour les amoureux. Mais M. Lefort était d’un caractère positif et peu pressé en affaires.
–Ma fille est assez fraiche pour attendre, pensait-il, et sa dot assez ronde pour que je me donne le temps de choisir à l’aise…
Quant à Laure, son cœur était littéralement sourd et muet: il n’avait encore ni entendu ni parlé. Son œil confiant et limpide laissait la curiosité descendre jusqu’au fond de son âme; son âme ne renfermait aucun secret. Elle était heureuse de se sentir vivre, de s’éblouir de luxe, de s’enivrer de musique. L’insoucieuse enfant! les malheureux qu’elle faisait chaque jour n’obtenaient pas plus sa pitié que le papillon celle du flambeau qui lui dévore les ailes!…
Cependant, vers la fin de l’hiver de1847, parmi les servants d’amour attirés par la joûte matrimoniale dont M. Lefort se donnait la joie, Laure avait fini par accorder quelque attention aux assiduités du baron Théodore de Comberouse, récemment revenu de Paris en Périgord. Et ce n’est pas, on le pense bien, sans une vive satisfaction d’amour-propre que M. Lefort l’avait vu se ranger au nombre des soupirants. L’espoir d’une pareille alliance chatouillait agréablement la démangeaison secrète qu’il s’était toujours sentie de se frotter à la noblesse.
L’amour, chez les jeunes personnes, chez celles surtout que l’on dénomme «bien élevées», s’allume spécialement dans l’imagination. Cette folle du logis est assez riche en elles pour prêter, au besoin, des charmes même aux futurs les moins charmants. Or, le danger perfide de cette faculté, sans contre-poids sérieux dans l’éducation mondaine qui s’élabore dans les couvents, c’est de faire naïvement confondre le principal avec les accessoires, l’homme avec son entourage. Ainsi, tel prétendant est «fort bien» parce qu’il a un château magnifique, de belles relations, des chevaux superbes. Certes, il n’y a pas que les fillettes qui se montrent sensibles à ces avantages; nombre de personnes d’âge raisonnable s’y laissent volontiers toucher; mais celles-là n’ont plus pour elles l’excuse de la naïveté.
Le baron Théodore de Comberouse, élevé au collège de Fribourg par les RR. PP. Jésuites, était environné de ce prestige extérieur qui frappe les jeunes filles et leur va au cœur par les yeux et par les oreilles. Jeune encore, d’une désinvolture fringante et tant soit peu prétentieuse, il passait pour ce qu’on appelle banalement un «cavalier accompli»; et le monde, qui juge sur les apparences, proclamait par avance la plus heureuse des femmes celle dont il daignerait demander la main.
Le seul péché mignon que la chronique scandaleuse lui reprochât à la sourdine et à bas bruit, c’était une certaine légèreté dans deux ou trois liaisons sentimentales dont le mystère, du reste, n’avait jamais clairement transpiré, au grand honneur de sa discrétion.
Mais, aux yeux du monde léger et frivole, est-ce bien là un vice rédhibitoire? La plupart du temps, les hommes, même les papas, ne font qu’en rire. Quant aux femmes, elles sont, en général, pleines d’indulgence pour les écarts dont elles ne sont pas personnellement victimes. La vanité, ce rusé serpent qui trompa Eve, dit tout bas traitreusement à chacune d’elles: «Toi, tu saurais fixer le plus inconstant!»
Madame Lefort, incarnation vivante de la soumission légalement imposée à l’épouse, essaya bien d’adresser à son mari quelques observations relatives à cette réputation de don Juan. «Il faut que jeunesse se passe fut la seule réponse qu’elle obtint.
Mais s’il était peu ombrageux à l’endroit de la morale, le père de Laure était plus exigeant en ce qui touche aux intérêts matériels. C’est pourquoi, s’autorisant d’une vieille coutume encore en vigueur dans une partie du midi de la France, il tenait à stipuler au contrat, en faveur de sa fille, une dotalité de deux cent mille francs à prélever sur sa succession. Cette précaution prise, il crut avoir surabondamment pourvu à toutes les éventualités.
Donc, au beau mois de mai de cette même année 1847, Laure, âgée de dix-sept ans à peine, adroitement circonvenue par les sollicitations paternelles, et l’esprit hanté par les ambitions héraldiques du pensionnat, avait passé avec insouciance, son joli doigt dans l’anneau nuptial. Douce insouciance, qui avait trop tôt fait place aux larmes amères! Hochet terrible, qui avait enchaîné à jamais sa jeunesse et sa liberté!.
Le pauvre M. Lefort n’avait joui que bien peu de temps des triomphes de vanité résultant pour lui du brillant mariage de sa fille. Une chute, dont les médecins apprécièrent mal les suites, le conduisit rapidement au tombeau. Mais il avait eu la consolation de mourir entouré, par son gendre le baron, des marques du plus ostensible intérêt et des regrets les plus expansifs. Quant à Mme Lefort, le mariage n’avait guère été pour elle qu’un esclavage déguisé de chaque jour, esclavage que sa nature molle et timide acceptait, non seulement avec résignation, mais avec une sorte de reconnaissance. Bientôt même la vie lui devint insupportable par suite des inquiétudes que lui causèrent les premiers désordres de son gendre. En effet, méconnaissant le trésor qu’il possédait, Théodore de Comberouse avait recommencé, de plus belle et presque au grand jour, l’odyssée, autrefois clandestine, de ses folles équipées.
Laure avait été la dernière à s’apercevoir de son malheur. Sa candeur native, sa complète ignorance du mal maintenaient son âme dans une région inaccessible au soupçon. Ce qui contribua surtout à lui ouvrir les yeux, ce fut, comme toujours, le chapelet de demi-mots équivoques, de réticences perfides, de condoléances félines, égrené par ces prétendues amies, généralement dévotes, qui se font un devoir cruel, et parfois une jouissance secrète, de jeter le doute et le trouble au milieu des illusions d’autrui.
Est-il besoin de le dire? le réveil de la jeune femme fut terrible. Elle comprenait enfin que le luxe et le bruit ne suffisent pas longtemps à remplir une âme délicate comme la sienne. Révélation navrante qui, en éveillant en elle le besoin de l’amour, lui laissait voir clairement qu’elle n’était pas aimée!. Et, comme si le malheur avait hâte de prendre des arrhes avec elle, Laure sentit qu’elle allait devenir mère.
Cependant Mme Lefort, abattue par la perspective du funeste avenir de sa fille et brisée par le sentiment de son impuissance à le conjurer, voyait ses forces décliner de jour en jour. A peine vécut-elle assez longtemps pour être marraine de la petite Louisa. Ah! quelle triste cérémonie que le baptême de cette enfant débile, tenue sur les fonts par une mourante pressée de rej oindre un mort!.
Anéantie sous la rude étreinte de sa destinée, Laure éprouva longtemps une sorte d’engourdissement moral. La perte de ses parents, quelque chagrin qu’elle en ressentit, ne fit pas couler de ses yeux ces flots de larmes qui semblent intarissables. La naissance de sa fille n’excita pas en elle ces indicibles ivresses, ces orgueils sublimes, qui font de la femme la rivale de Dieu dans la création des âmes. Tout se taisait en elle, jusqu’à ces voix mystérieures qui soufflent le courage à la femme chrétienne. Ce n’était pas de la résignation, c’était de la stupeur.
Mais, pour une jeune mère, il n’est pas de nuit si sombre, que les yeux de son enfant ne parviennent à l’étoiler; pas de solitude si morne et si désolée, que ce petit être ne la peuple de son sourire et de ses cris. Sur le bord d’un abîme dont elle n’osait sonder la profondeur, Laure avait senti, en regardant sa fille, s’éveiller vivement en elle le devoir de la conservation et le droit de légitime défense contre le sort. Involontairement, elle s’était prise à songer que tout n’était pas perdu peut-être et qu’elle pouvait rattacher ses espérances à un berceau.
Tout sentiment tendre dispose à l’indulgence. Quand le cœur de la mère se fut renoué à la vie, l’imagigination de la femme irritée se détendit peu à peu. Elle en vint même à tâcher d’atténuer à ses propres yeux les torts de son mari. Il avait été léger et frivole, sans doute; mais cette petite créature aimée, qui lui donnait, à elle, la force de dompter ses ressentiments, ne pouvait-elle aussi inspirer au père de salutaires réflexions?. Pauvre cœur humain qui, avant de disparaître dans le gouffre, se raccroche désespérément à toutes les branches!.
L’instant fatal était arrivé pourtant, où le baron de Comberouse avait dû faire à sa femme de pénibles aveux sur la situation de ses affaires. Si, chez M. Lefort, la vanité eût moins endormi la prudence, il se fût aperçu sans peine, en temps utile, que la fortune de son gendre futur était plus apparente que réelle. Quelques semaines seulement avant le mariage, ce gentilhomme aux abois avait dû prendre, en secret, des engagements onéreux, dont les échéances successives étaient venues pratiquer de larges brèches dans la succession à peine ouverte du beau-père.
Laure avait reçu la confidence avec impassibilité, presque tentée même de bénir cette épreuve, dans la pensée que la résignation avec laquelle elle l’acceptait pourrait lui ramener le cœur de son mari. Elle avait vécu obstinément dans cet espoir pendant une année bien longue, au bout de laquelle elle était devenue mère pour la seconde fois. Mais il avait bien fallu renoncer enfin à la chimère qui la soutenait jusqu’alors. Aigri par des pertes considérables au jeu, le baron devenait de plus en plus irascible et brutal. Bref, l’épouse légitime avait subi l’humiliation incomparable de se voir mépriser jusque dans sa maison, où le maître, à titre de gouvernantes, installait effrontément ses maîtresses.
La coupe était-elle assez remplie!. Sa fierté de femme foulée aux pieds, sa dignité de mère traînée dans la fange!. Un soir, après un violent orage domestique, dont le scandale avait transpiré au dehors et qui avait mis sa vie en danger, Laure était partie avec ses enfants et une femme de chambre, sans savoir où Dieu la conduirait. C’est deux ans plus tard que nous l’avons rencontrée à Nevers.