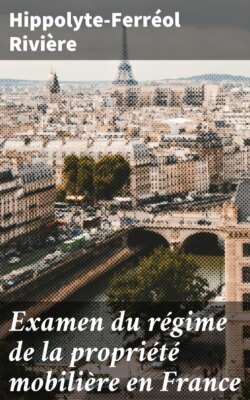Читать книгу Examen du régime de la propriété mobilière en France - Hippolyte-Ferréol Rivière - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PROLÉGOMÈNES.
ОглавлениеTable des matières
Aperçu sur la propriété mobilière dans l’ancienne France.
La propriété mobilière, cette propriété si fortement empreinte du sceau de la personnalité, occupe le premier rang dans l’ordre historique. Non-seulement elle doit pourvoir aux besoins, pendant l’attente des fruits provenant du travail de la terre, mais elle doit encore aider à ce travail. Toutefois, elle a une bien faible importance à son origine. Sans remonter à des temps plus éloignés, rappelons-nous ce qu’elle était chez les Germains: des bestiaux, des armes, des vêtements, du blé et quelques autres fruits de la terre, tels étaient les seuls objets dont elle se composait(). Ce n’est pas, en effet, chez un peuple barbare, dont la guerre est pour ainsi dire l’unique occupation, que la propriété mobilière peut se développer. Si elle apparaît la première dans l’ordre des dates, elle ne s’accroît qu’avec la liberté et la civilisation.
Les principaux progrès de la propriété mobilière sont contemporains de nos libertés. L’affranchissement des communes, la révolution de 1789, sont deux ères remarquables dans ses développements successifs.
L’agriculture, les manufactures, le commerce, sont les trois sources de la propriété mobilière.
L’industrie agricole fournit les matières premières. Mais combien le travail de l’homme n’ajoute-t-il pas de valeur aux productions de la terre par les nombreuses métamorphoses qu’il leur fait subir pour les approprier aux besoins que la civilisation et les lumières font naître! Le commerce, opérant sur les capitaux cédés par les deux autres industries, produit peut-être des richesses plus grandes encore.
Il sera sans doute facile d’apprécier l’état de la propriété mobilière dans l’ancienne France, en rappelant rapidement quelques faits principaux, qui influèrent sur les destinées de l’industrie manufacturière et commerciale.
Nous ne dirons rien des temps antérieurs à Charlemagne. Maître des mers, Charlemagne fit fleurir le commerce, accueillit les Italiens qui portaient leur industrie dans ses Etats. Au retour de ses conquêtes en Italie, ce monarque crut nécessaire d’arrêter les progrès du luxe, et en l’année 808 parut la première ordonnance somptuaire que nous connaissions.
Mais l’industrie ne pouvait avoir alors que de bien faibles commencements. L’art de la fabrication était encore relégué presque entièrement dans la demeure des femmes et dans les couvents. La théologie, l’étude de l’Ecriture sainte et des Pères, faisaient l’occupation principale de ceux qui s’adonnaient aux sciences. Les arts mécaniques étaient complètement ignorés().
Le peu d’industrie qui avait commencé à germer sous le règne puissant de Charlemagne disparut pendant trois cents ans environ. Ce n’est guère qu’au XIIe siècle que l’industrie manufacturière fit quelques nouveaux essais.
Les croisades, cet immense enthousiasme,
«qui sembla détacher l’Europe de ses fonde-
» ments pour la précipiter sur l’Asie,» eurent des résultats heureux pour le commerce et l’industrie: elles affaiblirent la féodalité, rapprochèrent les peuples, et ouvrirent de nouveaux chemins au commerce. Les négociants se frayèrent par la Syrie la route d’Alep, et se mirent en communication directe avec l’Asie orientale. On connut des productions nouvelles, des procédés utiles auparavant ignorés, et la magnificence orientale commença à briller dans les armures et sur les vêtements.
Les franchises obtenues par les communes et le régime des corporations augmentèrent de plus en plus l’importance de la société industrielle. C’est surtout de ces premières idées de liberté que l’industrie reçut son essor.
Des établissements d’industrie se propagèrent dans diverses contrées de la France septentrionale, et grandirent à mesure que les relations commerciales prirent de l’extension. Rouen, Saint-Lô, Caen, Cherbourg, Dieppe, Harfleur, Arras, Beauvais, Amiens, Laval et Reims occupèrent le premier rang dans ce mouvement industriel, dont la Normandie était le centre.
Plus tard, Jacques Cœur devint célèbre par son génie commercial, ses immenses richesses et sa disgrâce.
Toutefois, au moyen âge, le commerce n’avait aucune sécurité. Le commerçant qui osait approcher du manoir était toujours victime de toute sorte d’avanies et d’extorsions. Le commerce était rançonné, pillé, découragé. Dans ce temps, où les communications étaient si difficiles, les routes si peu sûres, l’activité du commerce était pour ainsi dire toute concentrée dans les foires. C’était dans les foires que les marchands réglaient leurs comptes, liquidaient et compensaient leurs créances et leurs dettes depuis la dernière foire où ils s’étaient rencontrés, faisaient leurs commandes et leurs offres de services. Quelquefois les rois, pour encourager les étrangers à se rendre dans ces lieux de réunion les affranchirent de certaines rigueurs; mais ils restèrent encore soumis à de nombreuses taxes. Ce n’est guère qu’au milieu du XIVe siècle qu’ils furent autorisés à amener et vendre leurs marchandises en franchise de droits (voyez ord. de juillet 1315 et de juillet 1344). Avant Louis XI, le commerce était encore sous la dépendance complète du pouvoir féodal. Non-seulement Louis XI, «dont la » raison était supérieure quand elle n’était » pas aveuglée par ses passions,» rendit plus de liberté au commerce en affaiblissant la féodalité , mais il le favorisa par la création de nouvelles foires, par la concession de quelques faveurs aux étrangers (voyez lettres patentes de 1462); il donna plus d’activité au commerce maritime, en accordant des franchises à presque tous les marchands étrangers qui apportaient leurs produits dans nos ports (voyez lettres de février 1461 et ordon. avril 1464).
Le désordre qui régna au moyen âge dans l’économie monétaire, paralysa longtemps aussi le mouvement régulier des transactions commerciales. La monnaie n’était pour les rois de cette époque qu’un signe fictif, qu’ils abaissaient ou élevaient, en altérant le titre, en diminuant lepoids, en surhaussant la valeur numéraire. «Cette violation de la foi publique, dit un auteur érudit(), ne s’accomplissait pas sans quelques précautions, et le coupable tâchait d’en dissimuler, autant que possible, la laideur et le vice. C’est ainsi qu’en ordonnant la fabrication de nouvelles espèces en tout semblables à la monnaie courante, excepté dans le titre qu’on affaiblissait, comme pour les distinguer des bonnes qu’elles remplaçaient, on y mettait une marque désignée sous le nom de différence. Le mandement recommandait «d’y mectre la différence la moins apercevant que l’on pourrait,» ou bien «de n’en mectre aucune et pour cause,» ou il s’expliquait en ajoutant: «pour tenir la chose plus secrète (ord. 27 juin 1360 et autres). »
Puis, on ramenait ensuite les monnaies à bon estat, c’est-à-dire que le prince réduisait la valeur numéraire des mauvaises monnaies, afin que le trésor, qui ne les recevait plus que pour leur valeur réelle, pût gagner tout ce que le public perdait à la dépréciation.
C’était par des moyens semblables que les rois augmentaient la valeur de leurs revenus.
Que devait-il en résulter? On le comprendrait, même à défaut de tous documents historiques(): cherté des denrées et marchandises, difficulté dans les payements. perturbation dans le cours des opérations commerciales, telles étaient les principales conséquences de ces fraudes.
En effet, si on annonçait une réduction future de valeur numéraire, les marchands conservaient les denrées de première nécessité pour ne les vendre qu’en bonne monnaie. Ce fut l’effet produit par le mandement du 22 août 1343, et qui motiva l’ordonnance du 26 octobre de la même année, dont le préambule porte: «Depuis ce, par le grand clameur de nostre peuple, soit venu à notre cognoissance que pluseurs groz marcheanz et autres qui sont garnis de blez et vivres et d’autres marchandises, recellent leurs diz blez et vivres, et ne les veulent exposer à vendre au fuer de la monoye courante à présent, en attendant que nos dites monoyes fussent venues à leur droit cours et abaissiées().»
Maintenant, voici ce que dit Secousse sur les effets produits dans les payements, par la variation des monnaies: «A mesure qu’elles baissaient ou haussaient, ceux qui avaient fait des marchez entre eux, ceux qui avaient presté de l’argent, ceux qui en devaient, etc., souffraient des pertes ou faisaient des gains, à proportion de ce que l’argent valait lorsqu’il s avaient contracté, et du prix qu’il avait à l’échéance du terme des payemens. Ainsi, un homme qui pour prester six livres, avait donné un marc d’argent qui valait alors ce prix, perdait la moitié de ce qu’il avait donné, si on le payait lorsque l’argent valait douze livres; car on ne lui rendait qu’un demi-marc d’argent. Mais aussi il gagnait le double, s’il avait fait ce prest lorsque l’argent estait à douze livres, et qu’on le payast lorsqu’il ne valait plus que six livres: c’était la même chose pour les débiteurs. Pour remédier à ces inconvéniens, le public s’estait accoustumé à ne plus contracter à livres et à sols, mais à marcs d’or ou d’argent, à florins ou autres espèces, etc.().»
A ces causes, qui s’opposaient à la marche du commerce, il faut joindre l’absence du crédit. Le crédit était ignoré non-seulement de peuple à peuple, mais encore de ville à ville. On cite, il est vrai, un Ordre puissant, l’Ordre du Temple, qui, pendant les XIIe, XIIIe siècles, et au commencement du XIVe, se livra aux opérations de banque. Les rapports entre commanderies permettaient aux Templiers de procurer des lettres sur l’Europe et sur l’Asie. Le nombre des valeurs déposées dans les caisses de l’Ordre grossissait chaque jour. C’était dans les maisons de l’Ordre que souvent s’effectuaient les payements entre souverains étrangers. Mais le procès des Templiers, «cet objet éternel de doute et d’infamie,» anéantit cette puissance financière, qui d’ailleurs était plutôt hospitalière que commerciale et industrielle.
Pendant le moyen âge, on ne pouvait faire la banque que par concession du prince, qui la retirait selon son bon plaisir. Il n’y avait que les juifs et des compagnies de Lombards, de Caorcins, qui faisaient le commerce de l’argent. On a souvent décrit les charges qui leur étaient imposées, les privilèges qu’on leur accordait, et les proscriptions qui les frappaient, selon le besoin que l’on avait de leur argent, les plaintes du peuple, et la cupidité des souverains. Nous n’en parlerons pas().
Mais, s’il est vrai, comme le dit Turgot, que ce soit l’abondance des capitaux qui anime toutes les entreprises, et que le bas intérêt de l’argent soit à la fois l’effet et l’indice de l’abondance des capitaux, on pourra avoir une idée de la situation de l’industrie et des capitaux à l’époque qui nous occupe, en considérant le haut intérêt que les juifs et les Lombards prenaient légalement: «Notre volonté, disait Louis X, n’est mie, qu’ils puissent prester à usure, ainçois le deffendons expressément; et se ainsint estait que il avenist par aventure que prestassent, ils ne porraient prendre plus de deux deniers pour livre par semaine (art. 12, ord. 28 juillet 1315). C’était, dit M. Leber, 8S 8d p. livre par an, plus de 43 pour cent, et les juifs allèrent plus loin. Par le traité qu’ils firent avec Louis X, moyennant 122,500 livres qu’ils versèrent dans ses coffres, et l’abandon au roi des deux tiers de ce qui leur était dû en France, il leur fut permis, en l’année 1315, d’exiger douze deniers pour livre par semaine().
Un autre fait, qui eut une influence pernicieuse sur le commerce, et qui, d’ailleurs, ne doit pas être séparé de celui, qui précède, c’est la prohibition du prêt à intérêt. A cette époque, on appelait usure tout ce qui accroissait le capital: usura est quidquid sorti accrescit. La prohibition du prêt à intérêt passa du droit canonique dans la loi civile. De sorte que l’ancienne société nous offre ce singulier exemple d’une proscription de l’intérêt par la loi, et d’une permission par privilége d’une usure exorbitante.
On sait comment le commerce parvint à se soustraire à la prohibition qui, en étouffant l’action des capitaux, paralysait sa marche: c’est sous le manteau du change, et principalement dans les foires, que le prêt à intérêt s’exerça. A cette époque où les transports d’argent étaient difficiles et fort périlleux, le commerce trouva dans la lettre de change le moyen de. simplifier par virements des parties les règlements de compte dans les foires. Le contrat de change précéda de plusieurs années l’édit de 1462, dont l’art. 8 porte: «Si par occasion d’aucunes lettres touchant lesdits échanges faits èsdites foires, pour payer et rendre argent autre part, ou des lettres qui seront faites ailleurs pour rendre argent èsdites foires de Lyon, etc.»
Mais la voie de l’ordre n’était pas encore connue. Il parait que cette grande innovation, qui facilite si merveilleusement la circulation de la lettre de change, ne date que du XVIIe siècle. Avant 1620, les cambistes n’employaient pas ce mode de transmission (voy. Savary, parère 82).
Tels sont, en résumé, les principaux faits qui influèrent sur le sort de l’industrie et du commerce au moyen âge. Ajoutons que les ordonnances somptuaires, qui se renouvelaient sans pouvoir détruire l’empire du luxe, vinrent plus d’une fois, dans l’ancienne France, arrêter l’essor de l’industrie. Il faut dire que ces ordonnances intervenaient assez souvent à des époques calamiteuses, et lorsque le luxe étalait toutes ses pompes au milieu, des misères et des souffrances du pays.
Quoi qu’il en puisse être, et malgré le mouvement industriel, dont nous avons parlé plus haut, les productions de l’industrie étaient encore loin de satisfaire à toutes les fantaisies du luxe et de la mode. La rareté des matières premières et les procédés de fabrication élevaient considérablement les frais d’un grand nombre d’objets, devenus ensuite d’un usage assez commun. La rareté de la soie était encore très-grande au XIVe siècle. La soie se vendait alors 3 livres 13 sous la livre, environ 330 de nos francs. Le velours valait environ 234 francs l’aune. Un prince de la première moitié du XIVe siècle payait environ 136 francs l’aune d’un tissu de laine. Les ornements de broderie, de passementerie fine, étaient d’un prix aussi élevé().
Ce n’est pas à dire que l’existence de l’homme riche du moyen âge soit restée étrangère aux raffinements et aux superfluités du luxe: «Il avait ses haquenées et ses litières, ses bisettes et ses pierreries, ses récamures et ses orfrois. Ce n’était point assez des couronnes d’or, des chapelets de perles, des fermaulx de diamant, des émaux de Bysance, des pennes africaines, de l’hermine, présent du nord, dont s’emplissaient les coffrets de sa dame; on voit encore figurer dans ses inventaires, on retrouve dans ses comptes de dépenses, ses fourrures, ses passements, ses samits, ses velours, ses cendaux et ses camocas: ses velours, dont une pièce représentait jusqu’à vingt de ses marcs; ses samits, tissus d’or et de soie, que Venise et Marseille tiraient à grands frais d’outre-mer. Le mobilier devait répondre à la toilette du banneret et de la châtelaine; l’ivoire, la nacre, les bois et les métaux précieux suffisaient à peine à la splendeur de leurs marqueteries, à l’exquise variété de leurs incrustations; et enfin, sur un dressoir déjà chargé d’une vaisselle plus pesante que leur revenu, entre une nef d’argent massif et des aiguières de vermeil ou de pourcelaine, sans doute orientale, pouvaient déjà briller d’un éclat jusqu’alors inconnu, ces délicieux produits de l’orfévrerie florentine, l’une des premières gloires de l’art moderne, et dont l’excellence nous dit assez le prix().»
Mais l’écrivain auquel nous empruntons ces détails, démontre fort bien que les éléments de ce luxe absorbaient la plus forte part de la richesse qui les supportait. Ce savant auteur établit qu’à fortune égale, mesurée au poids et au pouvoir de l’argent, le sire du XIVe siècle était beaucoup moins riche que le riche actuel. On nous permettra de citer encore le passage, dans lequel il développe cette thèse, et qui contient des aperçus d’une critique remarquable: «Je ne prétends pas, dit-il, en induire que le premier (le riche du XIVe siècle) fût moins heureux, ou en thèse absolue, plus à l’étroit, dans le rapport de ses ressources avec sa condition. Son revenu pouvait, devait lui suffire; mais il ne lui représentait pas en facultés somptuaires ce que représente aujourd’hui une fortune équivalente. Je sens tout le poids de l’objection qu’on tirerait de la différence des usages et des mœurs. J’admets que la famille ancienne était doublement riche, et de ce qu’elle possédait en valeur réelle, et de tout ce que coûtent les superfluités de la société moderne, dont l’usage lui était inconnu. Sans doute le cercle des dépenses où se mouvait une fortude du XIVe siècle ne peut se comparer au cercle du mouvement de la richesse actuelle; il n’y a guère de commun entre les deux époques que les mêmes instincts et les mêmes passions. Comme le riche ancien avait moins de besoins, sa dépense, ainsi que ses désirs, s’étendaient à un plus petit nombre d’objets; il ne pouvait désirer ce qu’il ne connaissait point, et conséquemment, quoiqu’il manquât de mille moyens de commodité et de jouissance, que nous devons à une civilisation plus qu’accomplie, on ne peut pas dire qu’il en fût réellement privé. Les frais d’une éducation compliquée de l’enseignement de toutes choses; le goût des collections scientifiques et littéraires, les musées, les bibliothèques, les cabinets de curiosités de la nature et de l’art, les plaisirs du théâtre, le luxe des carrosses, des glaces, des dentelles proprement dites, des innombrables joyaux de l’horlogerie et de l’optique perfectionnées; les délicatesses habituelles de la table, la mobilité fastueuse des salons, les prodigues magnificences des réunions privées; ce qu’il en coûte à la nullité opulente pour être quelque chose, au riche ambitieux pour arriver quelque part, à l’homme du monde, né pour bien mériter de ce monde, qui lui vend si chèrement ses distinctions et ses joies: tous ces besoins de la richesse contemporaine n’entraient pour rien dans les charges d’une existence nobiliaire du moyen âge.
Mais alors, comme à présent, sous le frac ou le surcot du riche des cités et des cours, on retrouve le fils d’Eve, gouverné par sa nature, soumis aux inspirations de la vanité et de l’orgueil, homme avant tout, et imposant à la société, qui le modifie sans le changer, le principe qui le confond avec les hommes de tous les temps().»
Aux XVe et XVIe siècles, l’industrie en France, malgré les progrès qu’elle avait déjà faits, ne rivalisait pas encore avec l’industrie de plusieurs pays étrangers. Il est certain que l’extension des établissements industriels n’était pas assez grande pour fournir abondamment des choses que nous pourrions considérer aujourd’hui comme étant en quelque sorte de première nécessité().
L’industrie n’avait point encore changé en palais somptueux les maisons de bois et de plâtre qui formaient les rues de Paris().
La somptuosité et la magnificence du camp du drap d’or n’étaient qu’un effort passager de luxe inspiré par la vanité d’un monarque et par l’orgueil ridicule des courtisans().
C’est ce même roi qui, devenu économe sur la fin de sa carrière, rendait des ordonnances somptuaires.
Cependant au XVIe siècle, une grande révolution économique s’opérait par suite de la découverte de l’Amérique (1492). L’influence des métaux précieux du Mexique et du Pérou ne tarda pas à se faire sentir: «le pouvoir de l’argent, qui s’était maintenu, dans le premier quart de ce siècle, à l’ancien rapport de 6, descend dans le deuxième quart à 4, dans le troisième quart à 3, et dans le quatrième, y compris la fin du règne de Henri IV, au rapport de 2, où il est resté jusqu’à la révolution de 1789().»
L’intérêt diminua, sans pouvoir revenir à son ancien taux, en raison de l’augmentation successive de la quantité d’argent(). Les capitaux ne furent plus exclusivement concentrés dans la main des Lombards ou des juifs. Le change les porta des lieux où ils étaient plus abondants dans ceux où la rareté se faisait sentir().
La bourgeoisie, qui, par suite des croisades, s’était enrichie des dépouilles de l’aristocratie, et dont la puissance avait été inaugurée par l’affranchissement des communes, et successivement développée par la royauté, sans doute à son insu, fit des pas de plus en plus rapides dans la voie de son émancipation().
Les arts s’associèrent à ces progrès. Les artistes italiens firent connaître les chefs-d’œuvre des anciens: Léonard de Vinci, Le Rosso, Primatice, André del Sarto, Cellini, Salviati, avaient été appelés en France.
Les foires devenaient plus importantes et plus fréquentées. Le commerce, en même temps qu’il avait plus d’activité, était moins ambulant. Dès l’année 1549, il avait été permis aux marchands de Toulouse d’élire un prieur et deux consuls. En 1563, le droit d’élire des juges consuls était aussi accordé à la ville de Paris; et en 1566, ce droit était étendu à toutes les capitales des provinces. La création de ces juridictions atteste assez l’extension des opérations commerciales.
Toutefois, à la fin du XVIe siècle, et au commencement du XVIIe, tandis que l’industrie et le commerce de plusieurs nations prenaient une nouvelle direction vers l’Amérique, la France était encore dépendante des étrangers pour la plupart de ses besoins.
La marine reçut ensuite un grand essor, surtout pendant le XVIIe siècle. Déjà on avait fondé une colonie au Canada, pêché le corail sur les côtes de Barbarie, créé des établissements sur les côtes d’Afrique. On autorisa successivement les compagnies de Saint-Christophe, de la Nouvelle-France, d’Orient. On organisa plus tard les vastes compagnies des Indes occidentales et orientales, du Bastion de France, du Sénégal, de Guinée, entreprises dont nous ne retracerons pas ici les vicissitudes ou les revers.
Des manufactures s’établirent en France. En janvier 1607, on créait les manufactures de tapisseries de Flandres; on établissait en juillet 1646 celle de drap de Sédan; dès 1656, les métiers à bas, dérobés à l’Angleterre, se multipliaient. En 1665, des lettres patentes accordaient à Nicolas Dunoyer le privilège exclusif pour vingt ans de souffler des glaces. La manufacture de tapisseries des Gobelins était fondée en novembre 1667. C’est à peu près à la même époque que l’on créait la manufacture de Beauvais. Le 14 septembre 1688, des lettres patentes donnaient un privilège à la compagnie Thevart pour couler les glaces. Les manufactures de serges, de tanneries et de corroieries furent aussi augmentées et perfectionnées. Des savants furent attirés en France. Van-Robais et Hindret y formèrent des élèves. Des artistes célèbres y apportèrent leur industrie, et notre pays commença à rivaliser avec les autres nations pour la belle draperie, les dentelles, les soieries, les glaces, la bonneterie, le fer-blanc, les armes blanches et les toiles().
Enfin, on publia les ordonnances célèbres sur le commerce terrestre et maritime.
Ici s’arrête le mouvement progressif de l’industrie. Dans les années qui suivent, on la voit presque anéantie; on voit aussi le peuple dans la misère; une refonte de monnaies qui, en portant de quatorze livres à vingt la valeur numéraire du louis d’or, impose une perte certaine aux créanciers de l’Etat et des particuliers; la fureur du jeu et de l’agiotage de la rue Quincampoix; le dépérissement de notre marine; puis, plus tard, un grand ministre qui lutte sans succès contre toutes les résistances des hommes du passé ; l’établissement à Paris d’une caisse d’escompte; ensuite, de nouvelles frénésies de l’agiotage, des jeux de bourse; le traité de commerce du 26 septembre 1786.
Dans l’ancienne société le commerce fut, jusque dans les derniers temps, opprimé par les droits seigneuriaux.
L’industrie manufacturière, si on en excepte les grandes manufactures dont nous avons parlé, et quelques autres que l’on pourrait peut-être encore citer, était loin d’avoir l’extension et de produire les merveilles dont nous sommes témoins aujourd’hui.
L’ancienne civilisation n’avait pas compris l’importance sociale du travail. Il fut trop méprisé.
Les corporations, qui avaient été dans l’origine une arme destinée à résister à l’oppression, étaient à leur tour tyranniques, et ne laissaient aucune ressource à ceux qui, n’ayant que l’usage de leurs bras, ne pouvaient acheter le droit de travailler. Cette noble faculté n’eut pour toute protection que le principe illusoire formulé par la royauté en ces termes: Le droit de travail est un droit domanial et royal(). Les corporations arrêtaient toute concurrence, étaient un obstacle à toute innovation utile, paralysaient les efforts de l’industrie. En 1776, Turgot attaquait de front cet abus; il en signalait les déplorables résultats. Mais l’heure d’une réforme complète n’était pas encore venue.
Les doctrines théologiques sur le prêt à intérêt entravaient toujours l’action des capitaux. Ce n’était que par des subterfuges qu’on parvenait à éluder les prescriptions de la jurisprudence. Quelques ordonnances permirent bien, à diverses époques, les stipulations d’intérêts entre marchands; mais ces ordonnances restaient inexécutées, faute d’enregistrement, ou bien par suite des arrêts de règlement des parlements().
En vain Turgot montra-t-il la rigidité des lois cédant à la force des choses, et le prêt toléré ouvertement; sa lutte contre la prohibition du prêt n’eut pas plus de succès que celle qu’il soutint au sujet des corporations. Les idées marquées du sceau de la justice et de la raison n’ont-elles pas souvent à combattre contre l’intérêt ou l’ignorance?
L’industrie et le commerce, d’ailleurs, dans ces temps, «où ne rien faire s’appelait vivre noblement,» étaient dédaignés. Ceux qui possédaient les capitaux préféraient les faire valoir par le moyen des constitutions de rentes, plutôt que de les employer dans l’industrie. Ils craignaient de déroger en se livrant aux spéculations commerciales et industrielles.
Au XVIe siècle, il fallait des lettres patentes à la noblesse pour lui permettre de faire le commerce(). Il était encore défendu, dans le XVIIe siècle, aux gentilshommes de faire la banque, à peine de déchéance de la noblesse (art. 198 ord. 1629).
Cependant plusieurs fois les rois déclarèrent solennellement que le commerce en gros ne faisait pas déroger; il leur arriva même d’accorder des lettres de noblesse à plusieurs commerçants. Ces déclarations et encouragements ne pouvaient détruire l’ancien préjugé. Par son édit de 1669, Louis XIV, après avoir fait observer que «le commerce, et particulièrement celui qui se fait par mer, est la source féconde qui apporte l’abondance dans les Etats, et la répand sur les sujets, à proportion de leur industrie et de leur travail, et qu’il n’y a point de moyen pour acquérir du bien qui soit plus innocent et plus légitime, » se plaint de ce que, malgré les ordonnances de ses prédécesseurs sur le commerce, et l’estime qu’ils lui ont marquée, la noblesse craint encore de ne pouvoir s’en occuper sans déroger. Puis il déclare: «afin de ne rien omettre de ce qui peut le plus exciter la nation à s’engager au commerce et à le rendre florissant, que tous gentilshommes pourront par eux-mêmes, ou par personnes interposées, entrer en société et prendre part dans les vaisseaux marchands, denrées et marchandises d’iceux, sans qu’ils soient censés déroger à la noblesse, pourvu toutefois qu’ils ne vendent point en détail.»
Au XVIIe siècle, de semblables déclarations étaient toujours nécessaires (voyez l’édit de 1701).
Disons que, tandis que la noblesse méprisait ainsi le travail et l’industrie, la bourgeoisie acquérait des richesses, et augmentait de plus en plus sa puissance. Mais poursuivons:
Dans l’ancienne France, on ignora presque entièrement les précieuses ressources du crédit, de cette puissance qui doit produire de si grands résultats dans les sociétés modernes.
Les opérations de banque étaient entravées par la prohibition du prêt à intérêt. Cette industrie était bien affranchie du joug des maitrises(); mais le commerce de banque resta assez longtemps soumis à la condition de l’octroi royal. Nous avons vu les rois accorder autrefois ce privilège aux juifs et aux Lombards. Voici maintenant ce que porte l’ordonnance de 1581: «Enjoignons que inhibitions et défenses de par nous à son de trompe et cry public soient faites à toutes personnes quels qu’ils soient de faire aucun change et trafics de deniers, sous le nom de banque, compagnie et communauté, ni autrement, sans avoir au préalable pris congé et permission. »
Les étrangers n’étaient admis à se livrer en France aux opérations de la banque, sans avoir préalablement donné une caution de cinquante mille écus (art. 38, ord. 1563), qui fut ensuite réduite à 15,000 écus sol par l’art. 357 de l’ord. de 1579.
La coutume commerciale l’emporta sur la loi: ces ordonnances tombèrent en désuétude. Savary disait qu’il n’avait point vu, ni ouï dire que ces ordonnances aient été exécutées parles étrangers(), et Jousse ajoute que de son temps on pouvait s’établir banquier sans permission().
Au surplus, les fonctions de la banque ne consistaient guère que dans les opérations du change.
Dans les pays même où les institutions de crédit ont pris naissance, à Venise, Gènes, Amsterdam, Hambourg, Nuremberg et Rotterdam, l’office des banques, jusqu’au XVIIe siècle, se bornait à faciliter les payements des particuliers, en les effectuant par de simples écritures et sans aucun transport de numéraire. Venise, cependant, avait, dès le XVe siècle, adopté le principe de la circulation des billets; mais les guerres lointaines l’obligèrent à se servir de sommes considérables en monnaie effective, et à abandonner cette voie si féconde du crédit.
En France, ce n’est qu’au XVIIIe siècle que l’on voit s’établir une banque qui, par sa nature, était destinée à rendre de grands services au commerce et à l’industrie. C’est la fameuse banque de Law. Mais on la dénatura en voulant fonder le crédit public sur le crédit commercial. Les lettres patentes des 2 et 20 mai 1716 autorisèrent Law à fonder une banque générale de circulation qui devait escompter les effets de commerce, se charger de liquider les opérations des commerçants par des virements, et émettre des billets remboursables à vue en écus de banque d’un poids et d’un titre certain. Cette banque générale fut, par la déclaration du 27 décembre 1718, érigée en banque royale. Deux ans après, le célèbre Ecossais était obligé de fuir pour aller mourir à Venise().
Sous le ministère de Turgot, c’est-à-dire le 24 mars 1776, on autorisa l’établissement de la caisse d’escompte, dont nous avons déjà parlé. Cette caisse escomptait à quatre pour cent les lettres de change et les autres effets de commerce admis à l’escompte par le choix des administrateurs; se livrait au commerce des matières d’or et d’argent; se chargeait en recette et dépense des deniers des particuliers qui voulaient avoir un compte ouvert chez elle.
La caisse d’escompte faisait entrer dans ses payements des billets au porteur, qu’on pouvait refuser, et qu’elle réalisait à la première demande.
Ses commencements ne furent pas heureux.
On se rappelait la terrible catastrophe de la banque de Law. N’y a-t-il pas encore aujourd’hui, quand il est question d’institutions de crédit, beaucoup de personnes, que ce souvenir effraye, faute de se rappeler les faits et les circonstances qui accompagnèrent l’établissement de cette banque?
La caisse d’escompte eut ensuite quelques succès, grâce au concours de plusieurs banquiers de la capitale, et à des règles nouvelles dans son organisation, approuvées par l’arrêt du 7 mars 1779.
Après avoir dominé la crise de 1783, due en partie à l’insolvabilité de l’Etat, cet établissement retrouva la confiance du public. Il y eut même un jeu effréné sur ses dividendes; mais il eut bientôt à se défendre des violentes attaques de Mirabeau.
En 1787, les actions de la caisse d’escompte baissaient.
Dès cette époque, le sort de cette banque était étroitement uni à celui du gouvernement, et cette institution traversait de nombreuses crises occasionnées par les circonstances politiques.
Avant 1789, les transports étaient encore bien lents et difficiles, malgré les améliorations déjà opérées dans les voies de communication.
Les sciences n’avaient pas perdu le caractère contemplatif. Elles restaient toujours dans le vague des abstractions, sans descendre sur le terrain des applications positives.
Enfin, ce n’est qu’en 1776 que l’économie politique produisait tous ses utiles enseignements.
D’ailleurs, dans l’ancienne société, des malheurs et des déchirements de toute espèce venaient souvent troubler les paisibles fonctions du commerce et de l’industrie. Qu’on veuille bien, en effet, se rappeler les calamités qui désolèrent la France pendant la fin du XIVe et le commencement du XVe siècle. Ensuite, lorsque des édits étaient publiés dans le but de donner une certaine impulsion au commerce, des guerres étrangères en empêchaient l’exécution. S’il avait quelques instants heureux, cette prospérité disparaissait bientôt au milieu des horreurs de la guerre civile. Plus tard, quand l’industrie entrait dans une nouvelle voie, quand le commerce faisait de grands progrès, favorisé par le génie de Colbert, l’industrie manufacturière n’était-elle pas chassée de France parla révocation de l’édit de Nantes, les persécutions religieuses et les dragonnades?
Les observations qui précèdent suffiront peut-être pour faire comprendre dans quelle infériorité devait être la propriété mobilière par rapport à la propriété foncière.
En outre, plusieurs droits, qui font aujourd’hui partie de la propriété mobilière, tels que les fonds de commerce, les actions dans les sociétés commerciales ou industrielles, n’existaient pas, ou étaient bien peu nombreux. Les offices étaient considérés comme immeubles. Il en était de même des rentes constituées, sauf dans quelques coutumes qui les réputaient meubles. Enfin, les productions de l’intelligence, ce qu’on appelle ordinairement la propriété littéraire, artistique et industrielle, ne jouissaient pas des garanties spéciales qu’elles ont reçues dans la suite.
Les règles de notre ancienne jurisprudence durent nécessairement se ressentir du peu d’importance de la propriété mobilière. C’était la possession de la terre qui constituait la puissance et la supériorité ; c’est à la propriété foncière que les anciens législateurs prodiguèrent leurs soins. Toutes les règles qui avaient pour but la protection de la propriété, n’étaient pas faites pour la propriété mobilière. Nous en dirons autant de toutes celles qui tendaient à la conservation des biens dans les familles.
La révolution affranchit le commerce et les manufactures de tous les droits qui nuisaient à leur prospérité (voy. art. 12, 13, 17, 19, 22, décret 15-28 mars 1790; — voy. aussi art. 355 constit. fructidor an III); rendit la liberté à l’industrie par l’abolition des maîtrises, jurandes et corporations (voy. art. 2 décret 2-17 mars 1791; — décret 14-17 juin 1791, art. 2; — préambule constit. 3-14 septembre 1791); affranchit ainsi le travail de toutes les entraves qui avaient arrêté son développement; facilita la circulation du numéraire, et ranima les transactions commerciales par l’autorisation du prêt à intérêt (1. 3-12 octobre 1789).
Quelques années après, un orateur du tribunat s’exprimait en ces termes sur l’impulsion que ces réformes avaient donnée à l’industrie: «Jetons un coup d’œil sur l’état présent de la société, aux besoins, aux tendances de laquelle toute loi sage doit répondre et veiller. Nous voyons une foule d’hommes qui cherchent à porter sur d’utiles entreprises l’activité dont la révolution a partout exalté le principe. Dans les campagnes, dans les villes, sur les frontières, sur les côtes, chacun épie l’occasion de rétablir ou d’avancer sa fortune; celui qui a des fonds disponibles médite une opération lucrative; l’esprit de spéculation, qui ne résidait guère que dans une classe, s’est, pour ainsi dire, emparé de la nation().»
D’un autre côté, après Buffon, les sciences avaient pris une nouvelle direction. Elles étaient devenues plus pratiques; et les arts, s’appuyant sur elles, eurent une marche plus sûre. Les utiles découvertes de la chimie firent faire d’immenses progrès aux fabriques, aux manufactures. Les arts mécaniques parvinrent à un point de perfection qu’il était difficile de prévoir().
Enfin, nous avons chaque jour sous les yeux les nouveaux prodiges que fait naître cette heureuse alliance des sciences et des arts. La galvanoplastie, la photographie, la télégraphie électrique, sont des inventions contemporaines, et ce ne sont pas les seules.
Les machines se multiplient à l’infini. Le territoire de la France se couvre de ces nombreux «esclaves métalliques et plutoniens» qui semblent «destinés à relever l’homme de
» l’antique malédiction du travail manuel.»
Tout concourt, dans notre civilisation moderne, à l’accroissement de la propriété mobilière.
Les procédés de l’industrie se perfectionnent de plus en plus sous l’inspiration de la science son inséparable compagne.
Quoique les institutions de crédit, qui sont appelées, en augmentant la masse des valeurs actives, à donner un si large essor à la production, n’aient pas encore atteint tous les développements, dont nous les croyons susceptibles, on commence à mieux les connaître et les apprécier. Les nations sont même engagées par un intérêt particulier à fixer sur ce point leur attention, et à restreindre dans de certaines limites la circulation des espèces métalliques, car les nouvelles richesses minérales qui s’exploitent ne tarderont pas à augmenter la masse des métaux précieux(); et ce sont celles qui auront le plus de numéraire qui, par suite de la dépréciation, éprouveront le plus fort dommage.
Ajoutons à ces considérations la noble émulation que vont développer entre tous les peuples ces luttes glorieuses et pacifiques dont l’Angleterre a donné le signal; ces immenses champs clos de l’industrie dans lesquels les nations devraient désormais se combattre avec les seules armes des peuples civilisés, les armes du travail.
Les communications entre les individus et entre les peuples sont aussi plus nombreuses et plus promptes. La vapeur et l’électricité font disparaître toutes les distances.
Les échanges et les transactions sont devenus plus faciles.
Les richesses particulières à chaque pays seront bientôt mieux connues. Chacun des autres peuples pourra en faire son profit et les approprier à ses usages.
Tout ce mouvement industriel nous emporte vers un avenir dont nous ne pouvons entrevoir que les premiers horizons.
Mais il est facile de reconnaître la place importante que la propriété mobilière occupe déjà dans notre société.
Un savant publiciste() a tracé le tableau des sentiments intimes que la propriété foncière inspire: il nous la montre créant pour la famille la patrie domestique, plaçant la vie et l’activité de l’homme dans la situation la plus morale, et le contenant le plus sûrement dans un sentiment juste de ce qu’il est et de ce qu’il peut. La richesse mobilière ne serait au contraire qu’un instrument à sa disposition, pour satisfaire à ses besoins, ses plaisirs, ses volontés. La propriété mobilière, au lieu de lui inculquer un sentiment de modestie sur ce qu’il peut lui-même dans sa propre destinée, favoriserait en quelque sorte son orgueil.
Sans entrer dans cet ordre d’idées, nous constaterons, avec ce publiciste lui-même, les services immenses que la propriété mobilière a déjà rendus et est appelée à rendre à la civilisation.
N’est-ce pas le capital mobilier, par exemple, qui, en prenant à sa charge ce qu’il y a de pénible dans le travail matériel, peut seul permettre à l’homme de développer ses facultés, son intelligence?
Si la propriété mobilière a peut-être moins que la propriété foncière la vertu de faire naître l’esprit de patience et de résignation, ainsi que l’observe ce savant écrivain, il faut convenir qu’elle est au moins aussi propre à inspirer à l’homme le sentiment de sa dignité.
La propriété foncière parque les habitants de chaque Etat dans les limites d’un territoire. La propriété mobilière seule est destinée à établir et consolider les relations pacifiques entre tous les membres de la grande famille humaine. C’est une vérité qui n’a pas échappé au génie de Montesquieu: «Les effets mobiliers, dit-il, comme l’argent, les billets, les lettres de change, les actions sur les compagnies, les vaisseaux, toutes les marchandises appartiennent au monde entier, qui, dans ce rapport, ne compose qu’un seul Etat dont toutes les sociétés sont les membres().
Tout s’enchaîne, d’ailleurs, dans les desseins de la Providence. Avant que le cercle de la propriété mobilière se fût élargi, les moyens de communication restaient imparfaits. C’est seulement quand la propriété mobilière prend de l’extension, qu’ils arrivent au point de perfection où nous les voyons actuellement.
Enfin, des bornes ont été imposées à la propriété foncière par la main du Créateur. Il n’y a d’autres limites pour la propriété mobilière que celles de l’intelligence de l’homme. Ces limites s’étendront en raison des progrès de l’esprit humain. Dans un avenir peu éloigné, on verra peut-être l’importance de la propriété mobilière dépasser de beaucoup celle de la propriété foncière.
C’est surtout le capital mobilier qui est appelé à augmenter le bien-être et, par suite, la moralisation des peuples. Sans doute, l’existence matérielle n’est pas tout pour l’homme; autrement, comment expliquer ses nobles sentiments, les ardentes aspirations de son âme? Mais, n’en doutons pas, l’habitude de l’aisance le maintient dans un état de dignité conforme à sa nature.
Un fait, toutefois, a déjà été souvent signalé : c’est celui de la concentration des capitaux. De bons esprits croient y trouver le symptôme d’une féodalité financière.
Peut-on espérer que le perfectionnement des moyens de crédit permettra un jour de mettre les instruments de travail aux mains de la pauvreté laborieuse, en respectant les droits de chacun et de tous? Est-il permis de penser que, par suite du principe de la libre concurrence et de l’abondance des capitaux, ils seront rendus plus accessibles à tout le monde? Ce n’est pas ici le lieu de nous prononcer sur ces graves questions, dont la solution doit préoccuper tout penseur animé d’une généreuse et sage philanthropie.
Nous avons seulement voulu, dans ces quelques pages, essayer d’indiquer d’une manière générale et sommaire l’état de la propriété mobilière dans l’ancienne France, afin qu’en mettant en regard sa prospérité dans la société moderne, il soit permis de dire que c’est pendant la paix, par les inappréciables ressources du crédit, sous l’influence de la science et le souffle vivifiant de la liberté, qu’elle peut se développer.
Nous avons aussi espéré, en constatant son accroissement, et en faisant pressentir l’extension, qu’elle doit recevoir encore, rendre plus évidente l’utilité des réformes que nous proposerons d’introduire dans la législation qui la régit.