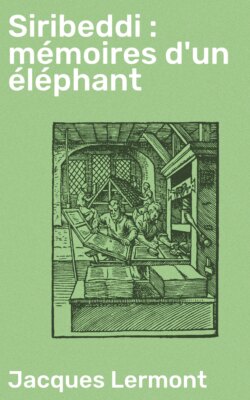Читать книгу Siribeddi : mémoires d'un éléphant - Jacques Lermont - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCHAPITRE V
Table des matières
LES EXPÉRIENCES DE SIRIBEDDI (SUITE)
Le plus grand défaut de Siribeddi était encore la gourmandise; celui-là il le partageait avec tous ses pareils, c’est celui qui est le plus enraciné chez eux et qui leur joue le plus de mauvais tours.
A mesure qu’il grandissait, Siribeddi ne se nourris sait plus uniquement de lait, ses petites dents avaient poussé et lui permettaient de mâcher des feuilles tendres et des fruits que sa mère lui cueillait du bout de sa longue trompe, car le plus souvent ils se trouvaient hors de sa portée. Dans la jungle, il y en avait à l’infini selon les endroits où le Grand-Chef conduisait sa bande: tantôt c’était la goyave si rafraîchissante pendant les grandes chaleurs et dont le parfum rappelle celui de la fraise; tantôt une espèce de cerise qui, lorsqu’elle est mûre, est de la grosseur d’une petite prune et d’un rouge orangé ; cette cerise, particulière à l’île de Ceylan, a des côtes comme en ont les melons; elle a un goût et une odeur qui n’appartiennent qu’à elle, mais qui sont loin d’être désagréables. Et la pomme des bois dont la chair jaune et la peau assez dure ont le goût de l’abricot un peu trop mûr, et le fruit de l’arbre à pain et les feuilles du plantain sauvage, un arbre immense que les éléphants affectionnent tout spécialement et que les Indous appellent le Figuier du Paradis, en disant que c’est sur cet arbre qu’Adam et Ève cueillirent les feuilles qui formèrent leurs premiers vêtements. Je n’en finirais pas si je vous énumérais tout ce que les éléphants trouvent dans ces forêts de Ceylan, sans compter les champignons qui croissent un peu partout, et les fleurs de toutes sortes, les orchidées qui y pullulent, et les plantes grimpantes de mille espèces qui s’enchevêtrent les unes dans les autres et forment parfois des treillis gigantesques, des barrières infranchissables d’un arbre à un autre. Siribeddi ne dédaignait pas plus que ses compagnons une fleur odorante ou un fruit savoureux, mais il rêvait de goûter à une noix de coco.
«C’est délicieux,» lui avait dit Yousouh.
Malheureusement on ne rencontre pas toujours des cocotiers dans la jungle. Il va de soi que les arbres dont je vous parlais tout à l’heure ne sont pas côte à côte dans un petit espace. Les éléphants les découvraient dans leurs courses vagabondes et je vous laisse à penser s’ils s’en régalaient. Quelques-uns de ces arbres n’étaient pas indigènes: des colons les avaient acclimatés dans leurs jardins bien loin dans la plaine, et si on les rencontre parfois dans la jungle, c’est parce que des oiseaux en transportent la semence à travers l’espace. N’est-ce pas admirable le rôle de ces jardiniers ailés?
Malgré le désir de Siribeddi de goûter à une noix de coco, il était peu probable qu’il pût satisfaire son désir dans la forêt. La faute en est sans doute à ses pareils qui, au lieu de cueillir les noix et d’épargner l’arbre pour une autre récolte, trouvent plus simple de couper, ou plutôt de déraciner le cocotier pour avoir ses fruits et ronger ses racines. Cette raison est beaucoup plus plausible que celle que donnent les Indous qui prétendent que «le cocotier aime le voisinage de l’homme, et ne peut croître que là où est celui-ci». En réalité, cet arbre demande quelques soins, mais comme on en a trouvé dans des îles désertes, il est évident que la main de l’homme n’est pas du tout indispensable à sa croissance.
Le cocotier étant un arbre précieux à plus d’un point de vue, les Cynghalais le cultivent beaucoup. Les éléphants visitent quelquefois, au grand détriment des légitimes propriétaires, les plantations situées sur la lisière de la jungle. Le Grand-Chef de la tribu des Longues-Queues avait trop d’expérience et de sagesse pour y conduire souvent sa bande. Il savait que l’entreprise présentait de grandes difficultés, les hommes veillent sur leurs propriétés, ils y tendent des pièges sans nombre contre les visiteurs nocturnes et ce n’est, qu’à force de précautions qu’on parvient à sortir sain et sauf d’une expédition de ce genre. Un jour, cédant aux suggestions de ses amis, le Chef consentit à pousser jusqu’à une certaine plantation où il n’était allé qu’une seule fois, longtemps auparavant. Il se rappelait bien le chemin; sa mémoire prodigieuse n’oubliait rien de ce qu’il avait fait en sa vie.
Les enfants ne se tenaient plus de joie. Enfin on partit. Il y en eut pour trois nuits de marche; le jour on se reposait; les jeunes et les vieux aidés par les autres, lorsqu’ils étaient fatigués. A la troisième journée de voyage, on campa non loin de la plantation, puis, dès que vint la nuit, cette nuit sans lune des tropiques, si claire que tous les objets y sont distincts presque comme en plein jour, on s’apprêta à pénétrer dans la terre promise.
Le Grand-Chef devait déployer tous ses talents d’observation pour ne pas se laisser surprendre. Ne voyant ni feux autour de ce bois, ni aucun être suspect, n’entendant aucun bruit, ne sentant pas l’odeur de l’homme, ni celle du chien et du cheval qu’il détestait, parce que la présence de ces animaux annonce le voisinage de leur maître, l’homme, le Grand-Chef et sa bande se livrèrent en paix à tous leurs instincts de maraudeurs. Quelle débauche de fruits! Que de feuilles lacérées, froissées, foulées aux pieds! Que de jeunes arbres déracinés et éventrés pour en retirer la moelle!
«Yousouh avait raison, s’écria Siribeddi, lorsque sa maman lui mit dans la bouche une noix qu’elle venait de casser, il n’y a rien de meilleur que ce jus sucré et cette amande si douce.»
Il était trop petit pour les casser lui-même, mais il regardait avec intérêt la manière dont sa mère s’y prenait. Mme Mahala roulait sous son pied la noix pourvue de sa première enveloppe extrêmement dure, puis d’une seconde enveloppe, composée d’un amas de fibres entre-croisées, et quand il ne restait plus que la coquille, elle la cassait avec ses grosses dents du fond. C’était prodigieux la quantité que chacun en absorbait! Pour sa part, Siribeddi en mangea, je crois, un peu plus qu’il n’aurait dû, mais je dois avouer que tous étaient singulièrement alourdis lorsqu’arriva l’heure du départ.
On repartit en moins bon ordre qu’à l’arrivée; le lait de coco porte peut-être à la tête, ils avaient un peu l’air d’avoir peine à marcher droit et de ne plus trop savoir ce qu’ils faisaient.
«J’aurais bien dû partir plus tôt, murmura le Chef en confidence à l’oreille du Philosophe. Pourvu qu’il ne nous arrive pas malheur!»
Et il fit presser le pas. Tout d’un coup on entendit un cri, suivi d’un autre. Que s’était-il passé ? Le Chef retourna vivement en arrière. Siribeddi s’était laissé prendre au piège tendu par les propriétaires de la plantation de cocotiers. Au lieu de passer sur les traces du Grand-Chef, le jeune éléphant avait été tenté par un melon déposé perfidement sur les branchages qui cachaient une fosse. Le sol se dérobant sous lui, il avait roulé dans le trou sans pouvoir se retenir. Aussitôt, n’écoutant que son désespoir, sa mère s’y était jetée après lui, et peu s’en était fallu que M. Jumbo ne fit de même. En présence de ce danger, tous dégrisés se pressèrent autour des prisonniers en poussant des exclamations de terreur.
«Vous êtes fous, s’écria le Philosophe, ce n’est pas ainsi que vous sauverez cet enfant. Vite, vite, aidez-moi. Pas un cri surtout, vous donneriez l’alarme et nous serions perdus.»
Siribeddi était plus mort que vif.
«Où as-tu mal, mon chéri?» lui demandait sa maman en le tâtant pour voir s’il ne s’était pas fracturé quelque membre.
«J’ai mal partout,» répondit-il en gémissant.
Chose étonnante, il n’avait rien de cassé. Quant à Mme Mahala, les branchages qui jonchaient le sol de la fosse depuis que Siribeddi les y avait fait choir avec lui, amortissant sa chute, ne lui laissaient que de légères contusions. Dans son inquiétude pour son fils, elle ne les sentait même pas. Mais qu’allaient-ils devenir tous deux si l’on ne parvenait à les retirer de là au plus tôt? Ils tomberaient au pouvoir de ces hommes implacables dont ils avaient ravagé les propriétés. Quelle perspective! Le jour n’allait pas tarder à paraître à l’horizon et avec lui, les hommes.
«Hâtez-vous, répétait le Grand-Chef qui avait approuvé de tous points le plan du Philosophe, nos moments sont comptés.»
Ce plan consistait à jeter de la terre dans la fosse, de manière à la remplir en partie et à surélever le sol. Encore fallait-il ne pas blesser les prisonniers. Quelles angoisses! M. Jumbo en était blême.
«Calme-toi, disait-il à sa femme, nous te sauverons, nous vous sauverons tous les deux.»
Mais au fond du cœur il se demandait si, faute de temps, le Grand-Chef, dans l’intérêt du plus grand nombre, ne se verrait pas forcé d’abandonner à leur malheureux sort ces êtres tant aimés, et à cette seule pensée, de grosses gouttes de sueur perlaient sur son front. Les minutes lui paraissaient des siècles.
Enfin le trou fut à moitié comblé et Mme Mahala put tendre son fils à M. Jumbo. Alors seulement la bonne mère songea à elle; s’aidant de ses genoux, sur lesquels elle s’arc-boutait, elle fit tant et tant que bientôt elle fut auprès de ses amis.
«Nous l’avons échappée belle!» murmura-t-elle.
Quelque bonheur qu’on éprouvât à les revoir, on n’avait pas le temps de se répandre en congratulations; la bande se reforma sans le moindre écart à la discipline, cette fois, les enfants au milieu, bien gardés et soutenus par leurs parents; tous, muets et confus, accélérèrent leur marche sur les ordres du Grand-Chef.
«Il ne s’agit pas de nous laisser rattraper, avait dit celui-ci. Qui sait si nous ne serons pas poursuivis.»
On ne respira qu’au bout de plusieurs heures, lorsqu’on se retrouva dans l’intérieur de la forêt.
Siribeddi était moulu, brisé, contusionné, mais il sentait si bien que le mal venait de lui seul qu’il n’osait se plaindre.
«Il est heureux que nous en soyons quittes à si bon compte, dit son papa d’une voix étouffée par l’émotion.
— Oh! s’écria Mme Mahala, si tu savais combien j’ai eu peur, mon ami; je croyais que je ne te reverrais jamais.
— Quant à cela, répondit M. Jumbo, tu pouvais être tranquille, je ne vous aurais pas abandonnés.
— Vraiment?
— Oui, vraiment. Libres ou non, nous ne nous séparerons jamais. En doutes-tu? Si vous aviez été pris tous les deux, je vous aurais suivis, fût-ce en captivité, fût-ce au bout du monde.»
Et il disait vrai. Du reste, il n’eût pas été le premier à donner à sa compagne cette preuve d’amour et de fidélité. Bien des éléphants avaient fait de même avant lui, préférant la captivité, auprès d’êtres chéris, à la liberté sans l’épouse qu’ils aimaient. «Fidèles jusqu’à la mort», telle pourrait être leur devise. Leur cœur une fois donné ne se reprend plus.