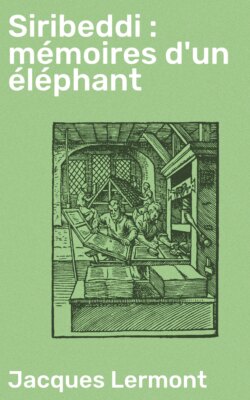Читать книгу Siribeddi : mémoires d'un éléphant - Jacques Lermont - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCHAPITRE IV
Table des matières
LES EXPÉRIENCES DE SIRIBEDDI
Plusieurs mois se passèrent ainsi, avec ce seul changement que la tribu des Longues-Queues ayant dépouillé tous les bananiers des environs de leurs feuilles et de leurs fruits, avait quitté la clairière où Siribeddi avait fait ses premiers pas, pour aller s’installer successivement dans d’autres parties de la forêt; les éléphants continuaient donc leur vie de farniente pendant le jour, et de jeux aquatiques pendant la nuit. Aucun événement digne d’être rapporté ne vint, à cette époque, rompre la monotonie de leur existence.
Siribeddi se développait rapidement: sa petite intelligence s’éveillait peu à peu, il réfléchissait, comparait, jugeait et commençait à se faire une idée assez nette de tout ce qui l’entourait. Son amitié pour le jeune Yousouh n’avait fait que croître; toutes les fois qu’on ne le trouvait pas auprès de sa maman, on était sûr de le voir en compagnie de son cher Yousouh. Celui-ci, qui avait un an de plus que lui, l’initiait à une foule de choses, se constituait son gardien, son instituteur, inventait pour lui mille divertissements nouveaux, agissait, en un mot, comme l’eût fait un frère aîné. Il déchargeait ainsi Mme Mahala d’une partie de sa tâche, aussi M. Jumbo prétendait-il que, grâce à Yousouh, il avait enfin retrouvé sa compagne. Cela ne les empêchait pas d’être l’un et l’autre aux petits soins pour leur cher fils, mais, Mme Mahala l’avait dit avec raison, il n’était pas mauvais que Siribeddi fût, dès sa plus tendre enfance, habitué à vivre avec des individus de son âge.
«Nous sommes éminemment sociables, disait Mme Mahala souvent, je ne voudrais pour rien au monde que Siribeddi devînt misanthrope.»
Misanthrope! En vérité, Siribeddi n’y songeait guère. C’était la gaîté même, il amusait toute la tribu par ses petites saillies et ses réparties, et, toujours bien reçu, quoi qu’il fît et quoi qu’il dît, il n’était pas loin de s’imaginer que l’univers entier avait été créé pour lui!
«Nous devons être les rois de la création, dit-il un jour à sa maman. Quel animal pourrait rivaliser avec nous? Nous ne sommes pas des lourdauds comme les buffles, des écervelés comme les cerfs, des méchants comme ces tigres dont tu me parles toujours. Que sont les oiseaux à côté de nous? Moins que rien. Nous seuls devrions être puissants et redoutés. Quand je vois notre chef déraciner un palmier gigantesque avec autant de facilité qu’un autre animal arracherait un brin d’herbe, je ne puis m’empêcher de songer que toutes les bêtes qui peuplent la forêt devraient être nos tributaires.»
Mme Mahala était toute surprise d’entendre de semblables discours sortir de la bouche de son fils.
«Ah! Siribeddi, soupirait-elle, l’orgueil est un grand défaut. Qui a pu te mettre pareille idée en tête! Tu es bien jeune pour parler ainsi, jamais ton père ne m’a tenu ce langage. Je ne disconviens pas que nous n’ayons en partage la force et l’intelligence, mais pourquoi vouloir régner sur d’autres animaux? Qu’ils poursuivent leur route et nous la nôtre; nos voies sont différentes; nous n’avons pas à nous gêner mutuellement. Voudrais-tu que tous les hôtes de la forêt vinssent nous apporter leur tribut? Les vois-tu déposant leurs offrandes à nos pieds pour nous remercier de les épargner. Qu’en ferions-nous, grand Dieu, et qu’avons-nous besoin d’autre chose que de ce que Dieu nous donne? Tu parles comme ceux qui se nourrissent de chair et de sang, nous nous laisserions mourir de faim plutôt que d’en faire autant. Nous ne sommes point des cannibales. Pourquoi donc affirmerions-nous notre puissance en massacrant des innocents? serait-ce dans le seul but de nous faire craindre? Sois bien persuadé, au contraire, que c’est parce qu’on reconnaît que notre mansuétude est un effet de bonté et non de faiblesse qu’on nous tient en si haute estime.
— C’est égal, dit Siribeddi, il me déplaît d’entendre dire que le lion est le roi des animaux, ce titre nous est dû. C’est un triste monarque que celui qui dévore chaque jour quelqu’ un de ses sujets pour leur prouver son amour!
— Qu’importe après tout, mon enfant? Nous sommes assez sages pour ne pas envier un titre qui ne nous servirait de rien. Nous n’avons et ne reconnaissons personne au-dessus de nous; si nul ne nous doit rien, en revanche nous ne devons rien à qui que ce soit, et nous avons la satisfaction de dire que nous ne faisons de mal à aucun être, sinon dans des cas de légitime défense.»
Le jour n’était pas loin, cependant, où Siribeddi devait s’apercevoir que quelle que fût la force de ses parents et des anciens de la tribu, la sienne, en particulier, était bien minime.
Comme tous les enfants, il était un peu porté à abuser de sa vigueur naissante envers les êtres plus faibles que lui. Chaque fois que sa mère le surprenait en flagrant délit d’abus de ce genre, elle le corrigeait sévèrement. De temps en temps, ses victimes se chargeaient de le punir. Une fois, entre autres, qu’il s’était amusé à détruire une fourmilière en la renversant de fond en comble d’un coup de pied, les insectes furieux se vengèrent en le piquant cruellement. Siribeddi revint tout penaud vers sa maman.
«Regarde ce que ces méchantes bêtes m’ont fait,» dit-il, en lui montrant son pied déjà enflé.
Les éléphants ont la plante des pieds si sensible qu’un rien les blesse: une épine, un caillou coupant qu’ils rencontrent sur leur route, peut les faire boiter pendant plusieurs jours.
Mme Mahala plaignant de tout son cœur maternel son enfant souffrant, enveloppa son pied dans une compresse de larges feuilles humides qui soulagea aussitôt Siribeddi. Mais le Philosophe, qui avait tout vu de loin, vint rétablir la vérité des faits.
«Siribeddi n’a eu que ce qu’il méritait, dit-il à Mme Mahala, soignez-le parce qu’il est trop jeune pour comprendre tout l’odieux de son action, mais ne le plaignez pas.
— Comment as-tu pu être aussi cruel! s’écria Mme Mahala, les fourmis sont d’infatigables travailleuses qui ne se reposent ni jour ni nuit, et c’est une mauvaise action de les déranger de leur travail?
— Je l’avais oublié, murmura Siribeddi.
— Sais-tu bien, ajouta le Philosophe, qu’à côté d’innocentes victimes que tu as faites en détruisant leur habitation, tu obliges les survivantes à un travail immense pour réparer les dégâts que leur a causés ton étourderie.»
Siribeddi tout confus baissa la tête.
«Je ne recommencerai plus, dit-il.
— A la bonne heure, reprit le Philosophe, quand on sait reconnaître ses torts on est déjà à moitié corrigé. Tu ne t’imagines pas quelles vaillantes petites bêtes sont ces fourmis, et quels services elles rendent à la forêt.»
Siribeddi ouvrit de grands yeux:
«Vous vous moquez de moi, dit-il.
— Pas le moins du monde, mon enfant, les fourmis, et surtout les fourmis blanches qu’on appelle termites, sont les balayeuses de la forêt, c’est grâce à elle que jamais aucun bois mort ne dépare la splendeur de nos arbres.
— Je ne vois pas, interrompit Siribeddi, ce que de si petits insectes ont à faire avec la beauté de nos forêts.
— Tu ne le vois pas, comme tu dis, parce que tu ne t’es jamais donné la peine de regarder autour de toi, mais si un arbre vient à tomber, qu’il soit ruiné par l’âge, ou que la foudre l’ait frappé, il n’est pas plus tôt sur le sol que les fourmis se mettent à l’œuvre, et elles sont si nombreuses et elles travaillent avec tant d’activité que quelques heures leur suffisent pour emporter miette à miette, dans leurs fourmilières, ce qu’elles n’ont pu grignoter sur place. Avec quelle rapidité, tu en jugeras quand je t’aurai conté que j’ai remarqué des arbres tombés en travers de notre chemin quand nous allions au bain et dont il ne restait plus trace au retour.
— Si vous ne me le disiez pas, s’écria Siribeddi, je ne le croirais pas.
— Tu peux me croire, Siribeddi, ce sont littéralement des armées de fourmis qui rivalisent de zèle pour détruire un seul arbre. De même pour les cadavres d’animaux, qui entreraient si vite en décomposition sous notre climat, les fourmis, grandes travailleuses, nous en débarrassent. Après leur passage, il ne reste que les os, d’une blancheur d’ivoire.
— Dorénavant, dit Siribeddi, je serai plein de respect pour mesdames les fourmis. On ne me reprendra plus à piétiner sur leurs demeures; sans compter, ajouta-t-il en riant, qu’elles piquent plus fort qu’on ne pourrait l’attendre d’un si petit corps.
— Ne dis pas de mal de leur corps, dit le Philosophe; il a tant de rapports avec le nôtre!»
Cette fois, Mme Mahala ouvrit d’aussi grands yeux que son fils.
«Mais oui, continua le Philosophe, cet insecte presque imperceptible a, avec nous, un point commun, c’est son proboscis. Il a une sorte de petite trompe avec laquelle il saisit les objets et les transporte d’un endroit à un autre.
— Et la mouche, demanda Mme Mahala, n’a-t-elle pas un instrument analogue?
— Oui, ma chère, vous avez raison, la mouche a aussi un proboscis.
— Oh! s’écria Siribeddi, et moi qui croyais que nous étions seuls ainsi favorisés.
— Cela rabat ton orgueil, dit le Philosophe. Un privilège que nous partageons avec ces infiniment petits n’en serait-il plus un à ton avis? Eh bien, tu aurais tort, mon ami, si tu en faisais fi à cause de cela, — et tu avais tort aussi, ajouta-t-il en riant, de t’enorgueillir d’un avantage physique. Tout au plus te serait-il permis de tirer vanité de qualités acquises, telles que le savoir, la patience, la bonté, et encore! tu les gâterais en t’en faisant honneur.... Maintenant que tu as compris ce que valent les fourmis, retourne jouer avec tes camarades.»
IL FAILLIT S’Y CASSER LA JAMBE. (P. 47.)
La leçon ne fut pas perdue pour Siribeddi; désormais il respecta les fourmilières et leurs habitants et il eut une moins bonne opinion de lui-même.
Un autre jour, par inadvertance, Siribeddi courant comme un petit fou sans faire attention où il marchait, mit le pied dans le terrier d’un jeune lapin. Il faillit s’y casser la jambe; fort heureusement, il en fut quitte pour la peur. Sa frayeur n’était rien en comparaison de celle qu’il fit au propriétaire du terrier, et il fut le premier à rire de sa petite mésaventure.