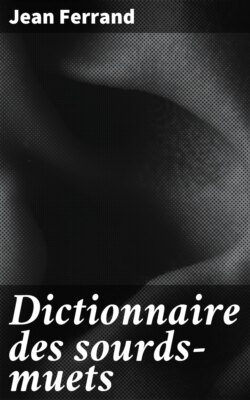Читать книгу Dictionnaire des sourds-muets - Jean Ferrand - Страница 5
I.
ОглавлениеEn 1776, l’abbé Ferrand était chanoine de la métropole de Tours. Parmi les signatures de l’acte d’inhumation de J.-B. Meusnier, père du général Meusnier, mort à Tours le 10 mars 1776, se trouve celle du chanoine Ferrand, suivie de ces mots: «Je signe plein de vénération pour ce serviteur de Dieu». Etait-il originaire de Tours ou de Vannes, comme certains documents, le nom de Venetensis en particulier qui lui est donné quelque part, porteraient à le croire. Né à Tours, aurait-il pour quelque temps fait partie du diocèse de Vannes, ou bien, né à Vannes, aurait-il été plus tard incorporé au clergé de Tours?
Ce que nous savons d’une manière plus certaine, et ce qui est d’ailleurs plus important, c’est que l’abbé Ferrand était un prêtre vertueux, zélé, à l’âme ardente, à l’esprit vif et entreprenant, et en outre un prédicateur distingué. Il faisait ordinairement des stations d’Avent et de Carême en différentes cathédrales, et donnait des retraites dans les séminaires et les maisons religieuses. Il fut du nombre des prédicateurs que l’Evêque de Chartres, Monseigneur de Fleury, appela dans son diocèse pour le jubilé universel de 1775, qui n’eut lieu [à Chartres qu’au commencement de 1776.
C’est alors que l’Evêque de Chartres, voulant l’attacher à son diocèse, le fit chanoine de sa cathédrale et le nomma supérieur des filles de la Providence qui avaient leur couvent dans sa ville épiscopale.
Mgr de Fleury rendait ainsi un hommage non équivoque à la vertu du prêtre et à l’éloquence du prédicateur. «Ce fut lui,» raconte l’Abbé Cognery, supérieur des filles de la Providence après l’Abbé Ferrand, dans la troisième partie du sommaire historique concernant cette communauté, «ce fut lui qui vint donner au petit séminaire, la retraite du jubilé à la quelle j’assistai étant alors à ma troisième année de séminaire et à ma première de philosophie. Cette retraite produisit beaucoup de fruit parmi les jeunes élèves dont la prédication fut goûtée. Aussi, lorsque, après sa nomination au canonicat, il vint, vers la Saint-Jean suivante, en prendre possession, étant entré au séminaire pendant que les séminaristes étaient en récréation dans la cour, dès que nous l’aperçûmes, sans nous être concertés, nous nous rangeâmes spontanément sur deux lignes pour le recevoir et lui témoigner notre respect, notre reconnaissance et notre joie de le revoir au milieu de nous.»
Lorsqu’on lui offrit la supériorité des filles de la Providence, il accepta d’autant plus volontiers qu’on lui annonçait qu’il y avait du bien à faire. Son zèle et son activité allaient pouvoir se donner libre carrière.
Cette congrégation des filles de la Providence avait été fondée vers le dix-septième sièle, par François de Pedoue, chanoine et pénitencier de Chartres. François de Pedoue, homme de beaucoup d’esprit et appartenant à une famille distinguée, s’était, dans sa jeunesse, laissé aller à quelques écarts. Poète satyrique et assez libre, ses ouvrages lui avaient attiré en 1626, la censure ecclésiastique et des haines redoutables. Revenu au sentiment de ses devoirs, comme il n’était point rare à cette époque de foi profonde, il expia par une vie mortifiée et consacrée au bien, les égarements de sa jeunesse. Vers 1643, il forma une congrégation de filles dévotes, qui se donnèrent pour mission de retirer de la débauche les femmes de mauvaise vie. Au bout de quelques années, le succès n’ayant pas répondu à leurs efforts, elles résolurent de se livrer à l’éducation des petites orphelines de la ville et des faubourgs. Leur projet fut approuvé par l’évêque Jacques Lescot, qui les institua par lettres du 23 décembre 1653, sous le nom de filles de la Providence, et régla, le 22 avril 1654, les statuts de la communauté, à laquelle il fut interdit de faire des vœux. Elles s’établirent d’abord dans deux maisons de la rue Muret que le Chanoine de l’edoue leur avait données; elles y demeurèrent jusqu’en 1762. A cette époque les Ursulines qui s’étaient établies à grand’peine à Chartres au siècle précédent, malgré l’appui que leur prêtait la reine-mère, Marie de Médicis, et après que les Chartrains, qui étaient décidément des gens très pratiques, comme nous le verrons encore tout à l’heure, leur eurent imposé des conditions telles que de leur établissement, il ne devait résulter que des avantages pour la ville; les Ursulines donc, peu nombreuses et ayant un revenu des plus modiques, furent obligées d’abandonner leur monastère, et les Filles de la Providence s’installèrent en leur place dans l’ancien hôtel Montescot. Commencé en 1668 par Claude de Montescot, cet hôtel, à l’aspect symétrique, grandiose et majestueux, est un des plus beaux monuments non religieux de la ville de Chartres; depuis 1792, il sert d’Hôtel-de-Ville.
Mais la nouvelle communauté qui venait en 1762 l’habiter n’était guère plus prospère que celle qui le quittait. Elle aussi devait rendre de nombreux services à la classe pauvre de la ville, et était en même temps sur le point de s’éteindre, faute de sujets. Lorsqu’on lui donna le chanoine Ferrand pour supérieur, il ne restait plus que huit sœurs, presque toutes âgées. Ce choix était donc excellent à tous égards; et, suivant l’expression de l’abbé Cognery, ce «fut un nouveau trait de la divine Providence sur cette maison.» Tout le monde allait gagner; la communauté d’abord, les pauvres de Chartres ensuite, que les religieuses allaient secourir avec plus d’efficacité, enfin l’abbé Ferrand lui-même qui devait y trouver une occasion de satisfaire son besoin d’activité et de dévouement.
«Son premier soin, dit le sommaire historique que avons déjà cité fut d’aviser aux moyens de relever la communauté en lui procurant de nouveaux sujets. Il était lié d’amitié avec plusieurs chanoines de Tours, ses anciens confrères, et autres bons prêtres de la ville. Il eut recours à eux; par leur entremise il réussit à recueillir de Tours et lieux circonvoisins une colonie de jeunes filles qui désiraient entrer en religion, et il se chargea de fournir leur dot. En peu d’années la communauté se trouva composée d’une vingtaine de sujets, ce qui donna la facilité de mettre à exécution le projet qu’il avait conçu d’abord, mais qu’il n’avait pu réaliser sur le champ.» D’autre part, dans un recueil de documents du fonds Roux concernant la Providence, il y a une pièce du 2 Juin 1778, qui nous donne, à propos des efforts tentés par l’abbé Ferrand pour repeupler la communauté dont il était le gardien, des détails intéressants. Les échevins ayant appris que les filles de la Providence venaient de recevoir cinq ou six nouvelles sœurs, s’émurent, parce que les religieuses n’ayant sans doute pas de dot, allaient nécessairement vivre des revenus de la communauté, alors que ces revenus devaient, d’après les statuts être consacrés à l’entretien d’un nombre d’orphelines proportionné à ces revenus mêmes, et en aucune manière affectés aux religieuses. Les échevins prétendaient que ces statuts ne s’observaient pas, que les sœurs avaient moins d’enfants que ne le comportaient leurs revenus, qu’il fallait donc s’enquérir si les nouvelles religieuses avaient une dot. En conséquence, on interrogea la supérieure, puis, pour contrôler son dire, une autre sœur qui refusa de répondre, et enfin l’abbé Ferrand lui-même, reconnu pour être le directeur temporel de la communauté. Celui-ci convint «de l’admission des dites cinq filles au noviciat, du peu de dot de l’une d’elles, et de ne point des autres.» Il dit qu’il avait cru devoir les admettre, eu égard au petit nombre de religieuses et à l’accroissement du revenu qu’il avait procuré à leur maison, tant par l’augmentation des baux que par le produit de la filature de coton et le travail qu’il y avait introduit. — Mais objectèrent les échevins, cette augmentation doit d’après les règles de leur institut, être employée uniquement au soulagement des pauvres de la ville et à l’admission d’un plus grand nombre de filles dites bonnets gris. L’Abbé répondit que les dix-huits places fondées étaient remplies. — Les échevins, défenseurs inexorables des droits de leur ville, lui disent que ce nombre, suivant un article des statuts, est illimité, et doit être augmenté à proportion de l’augmentation des revenus; et, pour achever de le convaincre, ils vont chercher les statuts et les lui font lire; si bien que l’abbé Ferrand, n’ayant plus rien à répondre, leur dit qu’il concourrait avec plaisir avec eux pour procurer l’avantage des pauvres de la ville, mais que la maison avait besoin de sujets, et que les preuves qu’il avait déjà données de son zèle et de ses bienfaits devaient-être un sûr garant de ses intentions. — Pour que les échevins, dont les réclamations n’avaient pu être complètement réfutées, se soient contentés d’une telle réponse, il faut que réellement les bienfaits de l’abbé Ferrand aient été bien manifestes, et ce qui ressort clairement de tout ce précède, c’est l’ardeur qu’il mettait à servir tout à la fois les intérêts de sa communauté et les intérêts des pauvres.
On vient de voir que l’abbé Ferrand avait établi chez les Filles de la Providence une filature de coton. Il l’installa à ses frais dans un des bâtiments extérieurs appartenant à la communauté, et l’on y reçut un bon nombre de jeunes filles pauvres de la ville à qui on procurait en même temps du travail et une instruction chrétienne. Cette belle entreprise ne réussit pas entièrement au gré de ses désirs; bien souvent même il en résulta au bout de l’année des déficits financiers que l’abbé Ferrand comblait de sa bourse. Soit que les produits fussent réellement de qualité inférieure, soit simplement malveillance de la part du corps des marchands à qui cette filature faisait peut-être tout, elle végéta péniblement et au milieu des troubles occasionnés par la Révolution naissante, en 1789, l’ouvrage manqua complètement.
Quel était cependant ce projet dont on nous parlait plus haut, que l’abbé Ferrand avait conçu tout d’abord et qu’il n’avait pu réaliser qu’un peu plus tard? Le sommaire historique va nous l’apprendre. «Pendant que la communauté resta dans la rue Muret elle s’était borné à l’éducation des orphelines et de jeunes pensionnaires; elle n’avait jamais tenu de classes externes. Lorsque Mgr de Fleury la transféra à l’ancien couvent des Ursulines, spécialement dévouées à l’éducation de la jeunesse, ce fut à la condition qu’elle continuerait les classes qui étaient tenues par ces religieuses. La communauté, en les remplaçant dans leur maison n’y avait trouvé que deux classes en exercice; elle n’était pas tenue à en avoir davantage. Monsieur Ferrand, considérant qu’il avait alors assez de sujets pour le bienfait de l’éducation établit deux nouvelles classes. Il s’en trouva alors quatre au lieu de deux, et toutes gratuites. Le nombre des classes étant augmenté, celui des enfants augmenta en proportion, de sorte qu’au moment de la révolution de 1789, il y en avait de deux cent à deux cent cinquante, tant de la ville que de la campagne...
Il avait en outre formé une école de Sourdes-muettes à la tète de laquelle, il avait placé une sœur, après lui avoir donné lui-même les leçons nécessaires pour cette instruction.»
En dehors même de cette école de sourdes-muettes, dont nous parlerons à loisir tout à l’heure, ce n’est pas peu de chose que d’avoir fait instruire gratuitement par quelques religieuses, à la fin du dernier siècle, plus de deux cents jeunes filles pauvres. N’eut-il que ce titre de gloire, le nom de l’abbé Ferrand méritait d’être tiré de l’oubli et d’être salué avec respect par ceux qui se vouent à l’éducation des pauvres et des souffrants. Seulement la Révolution de 1789 vint porter un coup terrible à beaucoup d’œuvres de charité. Voyant la tournure que prenaient les événements, l’abbé Ferrand quitta la France, «dans un temps où tout était permis contre ceux qu’on savait ne pas être partisans de la Révolution.» Il avait auparavant comme tous les chanoines, signé la protestation envoyée au nom du chapitre le 21 avril 1790 contre les décrets de l’Assemblée Nationale. Un arrêté du directoire du département d’Eure-et-Loir le déclara émigré le 8 août 1793. Quel fut le lieu de son exil? Nous n’en savons rien. Peut-être se retira-t-il en Allemagne où la présence de l’Evêque de Chartres attirait son clergé.
La maison des filles de la Providence étant considérée comme un établissement d’instruction publique et comme un asile pour les orphelines, les décrets de l’Assemblée Constituante ne lui furent pas d’abord appliqués. Mais l’autorité supérieure s’étant assurée qu’on y donnait aux jeunes élèves des principes antiiconstitutionnels, exigea des religieuses le serment qu’on faisait prêter aux fonctionnaires de l’Etat. Sur leur refus, on décréta le 11 mai 1791, que leurs biens seraient transférés au bureau des pauvres de la ville, et qu’on les remplaçait par des sujets dont le civisme ne fût pas douteux. Le conseil général de la commune, sur la motion qui fut faite de conserver la classe spéciale de sourdes-muettes, refusa de continuer cette philanthropique institution. En 1880, quelques filles de la Providence de l’ancien couvent se réunirent dans une maison de la rue de la Bourdinière. Elles obtinrent la reconnaissance de leur congrégation par décret impérial du 24 juillet 1806 et allèrent occuper l’ancien prieuré de Saint-Etienne, devenu la maison conventuelle de Saint-Jean.
«L’abbé Ferrand rentra en France, dit l’abbé Cognery dans le Sommaire, dès qu’il avait vu jour à le faire en sûreté (1804). Il ne lui restait plus rien. Tous ses biens patrimoniaux avaient été vendus comme bien d’émigré. Les sœurs de la Providence dont il était toujours supérieur lui offrirent de grand cœur un asile dans leur maison, et elles prirent soin de lui comme deleur père jusqu’à sa mort qui n’arriva qu’en 1815, le 14 décembre. Il avait 84 ans.» Son nom, nous ne savons pour qu’elle cause, ne se trouve pas dans le nécrologe des prêtres du diocèse de Chartres morts depuis 1801.
Les sœurs de la Providence, avec un souvenir plein de respect et de reconnaissance pour leur bien-aimé supérieur, gardent religieusement son portrait qui date de l’époque et où l’on trouve une physionomie douce, intelligente et fine. Son testament daté de 1806 qui n’est pas écrit de sa main parce qu’il était en danger de mort, et qui nous apprend qu’il s’appelait Jean et enfin les quelques pages du Sommaire historique où il est parlé de lui, et où nous avons puisé un grand nombre des renseignements qui précèdent, c’est peu de chose à la vérité. Pour l’école de jeunes sourdes-muettes en particulier ce serait totalement insuffisant si le hasard ne nous avait fait découvrir à la bibliothèque de Chartres un manuscrit précieux d’une valeur inestimable.