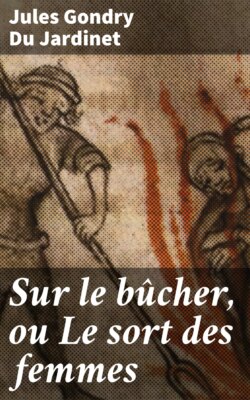Читать книгу Sur le bûcher, ou Le sort des femmes - Jules Gondry Du Jardinet - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
L’article 213.
ОглавлениеDans un petit salon transformé en boudoir et orné de meubles qui respiraient à la fois la grâce et une certaine austérité, remarquable surtout par une bibliothèque d’œuvres choisies et magnifiquement reliées, une jeune femme tenait un livre, dont elle froissait un passage d’une main fébrile.
Ses yeux lançaient des éclairs.
Elle se leva convulsivement.
Ce brusque mouvement débarrassa de ses liens sa chevelure d’ébène, qui flotta sur ses épaules et encadra son front, où se lisait une belle intelligence.
Sa haute taille apparut dans toute sa majesté lorsque, rejetant loin d’elle le petit livre gracieusement relié qui avait suscité sa grande colère, elle s’écria:
— Jamais, non, jamais une femme ne devrait signer un acte qui la place sous le joug d’un homme.
Ce livre était le code qui renferme le passage suivant:
«La femme doit obéissance à son mari.»
Après quelques instants de réflexion, elle se dit encore:
— Qu’ils sont perfides, ces hommes! Ils s’inclinent à nos pieds, et lorsque nous souscrivons à leurs désirs, ils s’emparent aussitôt, pour nous asservir, du pouvoir acquis devant le maire et les autels.
Le malheur des autres femmes nous apprend assez le sort qui nous attend. Elles aussi se sont flattées de conserver le sceptre que la volonté du maître a bientôt arraché de leurs mains. L’attrait du pouvoir est si grand.
N’enchaînons pas notre liberté. Ébranlons l’édifice de l’iniquité humaine jusque dans ses fondements. Devenons législatrices à notre tour et forçons ces hommes, qui sourient de notre faiblesse aujourd’hui dans leur toute-puissance, à s’estimer heureux de marcher notre égal.
La mécontentement de Juliette de Crèvecœur augmentait avec les griefs qu’elle se rappelait à elle-même en les exagérant. C’était une trop digne émule de Paul Mink et de Mme Audouard, dont les discours ont plus d’une fois fait rougir leurs compagnes, femmes comme elles, mais bien plus dignes, parce qu’elles entendaient mieux leurs devoirs de filles, d’épouses et de mères.
Les principes de la prétendue libre pensée avaient entraîné Juliette de Crèvecœur dans les exagérations que nous venons d’entendre.
En rejetant les préceptes religieux sous prétexte d’indépendance, Juliette s’était ensuite abandonnée à la superstition. L’humanité est ainsi faite, qu’elle s’efforce en vain de matérialiser l’idée d’une action supérieure qui la domine malgré elle. Aussi Juliette ajoutait-elle foi aux prétendues révélations d’une nécromancienne qui, imitant les sibylles antiques, pour mieux frapper l’imagination de ses dupes, habitait un antre non loin de la Nouvelle-Orléans.
Cette magicienne avait prédit à Juliette que le succès couronnerait ses efforts et que son nom serait exalté dans l’univers entier.
L’orgueil de Juliette lui avait fait accepter avec empressement cet oracle.
Exploitant la crédulité et la vanité de sa cliente, la nécromancienne voyait l’or ruisseler en abondance dans sa sébile.
Juliette de Crevecœur était riche. Par sa mère, elle était alliée aux premières familles de France.
Tout la rattachait à la France. Cependant, depuis son enfance, elle habitait les Etats-Unis. C’est qu’un riche héritage avait appelé son père à la Nouvelle-Orléans.
Ce voyage, qui semblait devoir bientôt se terminer, se transforma en séjour définitif.
Lorsque Juliette eût atteint l’âge de vingt ans, elle perdit son père. Deux ans après, elle pleurait sa mère.
Cette dernière perte l’affecta surtout. Elle restait presque seule, car elle ne connaissait pas les membres de sa famille, qui presque tous, habitaient la France et la Belgique. A peine en conservait-elle un bien faible souvenir.
Il est vrai qu’aux Etats-Unis, aux portes mêmes de la Nouvelle-Orléans, habitait lord Midwell, né du premier mariage de sa mère avec un noble Anglais. Mais les goûts de Juliette et de son frère différaient tellement que, sans être en désaccord, leurs rapports étaient fort rares.
Lord Midwell était un Anglais dans toute l’acception du mot, jouissant de sa richesse avec une insouciance sans égale du genre humain. Clara, son épouse, avait en vain essayé de galvaniser cette nature que rien ne semblait émouvoir.
Ce fut au milieu de ce concours de circonstances que Juliette répondit à l’appel d’un vieil oncle maternel qui demandait instamment à la voir, en souvenir de celle qui n’était plus.
Juliette se rendit en France, visita la Belgique et les ruines du château de Crevecœur, qui dominent la petite ville de Bouvignes, cette rivale de Dinant, avec laquelle elle fut longtemps en guerre, et dont la rivalité n’a pu s’éteindre, même après plusieurs siècles.
A Paris, elle assista aux réunions publiques où les femmes réclamaient bruyamment leur indépendance et presque leur supériorité sur l’homme.
Ces idées pénétrèrent d’autant plus facilement dans l’esprit de Juliette, que lord Midwell lui avait donné, dans son enfance, un précepteur imbu des idées voltairiennes subversives de toute société.
Son imagination donnant une direction à son activité, elle résolut de transporter sur le sol américain le germe de ces idées et de régénérer, disait-elle, le Nouveau-Monde.
Ce fut avec ces idées et ce projet qu’elle débarqua à la Nouvelle-Orléans. Bientôt elle en fit part à ses amies, dont quelques-unes sourirent à cette ouverture, tandis que d’autres y applaudirent.
Parmi ses prosélytes, Fatime, une des femmes d’un riche musulman, se faisait remarquer par un enthousiasme à toute épreuve et par un désir exagéré d’arriver à la célébrité. Rien n’arrêtait cette femme lorsqu’il s’agissait d’appeler sur elle l’attention publique. Elle ne prétendait à rien moins qu’à remplir l’univers du bruit de son nom et à passer à la postérité.
Juliette avait aussi gagné la confiance de Sara, qui était destinée ou condamnée à devenir l’épouse du vieux Singapoor, indien qui remplissait les fonctions de consul britannique. Pour être moins bruyant, le concours de Sara n’en était que plus utile, car elle inspirait partout la compassion. On savait que les lois de l’Inde la destinaient à périr sur le bûcher après la mort de son futur époux.
Beaucoup d’autres dames de la Nouvelle-Orléans avaient été enthousiasmées des théories de Juliette. C’était une réaction contre l’abaissement parfois exagéré de la femme dans la famille, et contre le délaissement dans lequel se trouvaient plusieurs d’entre elles, qui se voyaient abandonnées pour d’indignes rivales.
Une réunion publique devait avoir lieu le jour même où commence notre récit, et Juliette se proposait d’y déclamer contre les hommes et leurs prétentions inscrites dans le Code.
Ce qui avait mis le comble à son mécontentement et avait surrexcité son irrascibilité même, c’est que Fernand de Montfort, son cousin et son filleul, venait de refuser catégoriquement de prêter son concours à son œuvre de prétendue régénération sociale.
Cette détermination était d’autant plus fâcheuse que Juliette, espérant vaincre les résistances de Fernand, avait annoncé sa présence au meeting. Elle voulait faire jouer à Fernand le rôle effacé que le mari de Mme Paul Minck n’a que trop souvent accepté dans les réunions publiques.
Le refus de Fernand était grave: il faisait partie du Congrès de l’Union américaine.
Pour obvier à cette difficulté, Juliette avait prié ses amies de passer immédiatement chez elle.
Comment remplacer efficacement le concours de Fernand? Comment colorer d’un prétexte plausible son absence au meeting?
Juliette se posait cette question pour la centième fois, lorsque son attention fut appelée par un bruit de pas dans son antichambre.
— Ah! fit-elle d’un air presque satisfait, c’est Fatime, sans doute, qui s’est empressée de répondre à mon appel.
La porte s’ouvrit.
L’étonnement se peignit sur les traits de Juliette. Elle tressaillit.
C’était Fernand de Montfort.
Grand, élancé, d’une physionomie à la fois expressive, sympathique et respirant, sous l’énergie, la confiance si naturelle à la jeunesse, qui n’a pas encore éprouvé les déceptions humaines, tel était, à vingt-six ans, le jeune homme dont les mérites avaient inspiré assez de confiance à ses concitoyens pour qu’ils lui confiassent le soin de défendre au Congrès leurs intérêts communs.
Juliette se demandait quel était le motif de la visite de Fernand de Montfort et s’il allait enfin acquiescer à ses désirs. Elle le désirait plus qu’elle n’osait l’espérer.
Cependant elle cacha sa pensée dans les replis les plus profonds de son cœur.
Avec un accent où se peignait une indignation factice, mais bien simulée, elle lui dit:
— Votre présence ici, Monsieur, est-elle une adhésion à ma volonté ou une nouvelle insulte?
— Une insulte?
— Oui. Je vous le repète; il faut vous décider aujourd’hui. Il n’y a plus d’alternative. Le moment de la manifestation publique approche. Faites effacer de votre code l’article qui déclare que la femme doit obéissance à son mari.
— Mais cela est-il en mon pouvoir?
— N’êtes-vous pas législateur? Parlez à vos collègues, montez à la tribune, prononcez des discours qui retentissent dans tous les États de l’Union. J’en serai l’écho dans les meetings de la Nouvelle-Orléans.
L’avenir est à nous. C’est en vain qu’on s’oppose à ce progrès.
Unissez vos efforts aux miens, et peut-être consentirai-je à oublier que vous avez méprisé les conseils de votre marraine, de celle qui remplace votre mère.
— Croyez-vous que ma mère m’eût donné les mêmes conseils que vous, et que du haut du ciel, où l’ont placée ses vertus, elle ne se voilerait pas la face si je consentais à défendre vos théories?
— Vous doutez de mon projet lorsque le monde entier frémit à notre appel; que l’esprit de liberté souffle partout!
Ne savez-vous pas que Fatime et Sara s’efforcent de réveiller l’esprit d’indépendance dans les pays qui les ont vues naître, dans l’Inde et jusque dans le sérail du sultan?
Ignorez-vous les efforts qui se font à Paris, la capitale du monde civilisé ?
Les succès qui accompagnent les meetings m’en présagent aussi pour l’assemblée qui se réunit aujourd’hui, sous mon inspiration à la Nouvelle-Orléans.
Juliette s’était exaltée à la pensée de ses travaux et du triomphe qui l’attendait.
Au milieu de cette avalanche d’idées et de mots, Fernand se taisait. Ce n’est pas qu’il fut insensible. Non. Un combat terrible s’élevait entre son cœur et sa raison.
Son cœur lui insinuait d’accéder au désir de celle que pendant si longtemps il avait respectée comme une mère.
La raison lui commandait la résistance.
Ce fut la raison qui l’emporta, lorsque Juliette lui dit:
— Eh bien! que prétendez-vous faire? Me suivrez-vous?
— Je ferai tout pour vous être agréable; mais ne me demandez pas l’impossible.
— L’impossible n’est pas français, dit-on à Paris.
— Les idées d’outre mer vous passionnent et vous égarent.
— La passion du bien n’égare jamais. J’ai promis à mes sœurs de les soulager dans leurs misères présentes et de veiller à leur bonheur futur; je n’y faillirai pas.
Nous, qui sommes nées avec de la fortune, nous fonderons des établissements qui donneront à nos sœurs l’indépendance par le travail.
Le courage grandit avec la connaissance qu’on a de sa propre force. Nous vous étonnerons, messieurs, vous qui nous considérez comme les instruments de vos caprices; nous vous forcerons à nous admirer dans nos œuvres.
Bientôt, en Turquie, nous redresserons les erreurs du Coran, qui permet à un homme d’avoir plusieurs femmes; l’Inde ne verra plus la femme brûlée vive sur le bûcher qui réduit en cendres le corps de son époux; enfin nos regards ne seront plus attristés, à la vue de la femme esclave, courbée sous le joug, battue de verges ou subissant, dans les larmes, les caprices d’un maître qui abuse d’elle et de ses sentiments.
— Mais, loin de prendre la défense de ces horreurs, je les condamne.
— Vous condamnez, dans autrui, ce que vous feriez vous-même en vous armant de votre code, qui condamne la femme à un esclavage déguisé.
— Vous êtes injuste envers le code et bien cruelle pour moi.
— Et vous bien perfide. Hommes, vous n’élevez la femme, un instant, sur un piédestal, qu’afin de la briser avec plus d’éclat.
— Dieu lit dans mon cœur. Il y voit ma sincérité et ma tristesse.
Exaspérée de ne pouvoir vaincre la résolution de Fernand, Juliette s’éloigna en disant avec colère:
— Choisissez, monsieur, entre l’acquiescement à ma volonté ou ma haine.
Elle comptait encore sur l’affection de Fernand, qui s’était toujours montré si tendre et si soumis.
Mais Fernand se disait:
— N’aurait-elle pas de cœur?
Le doute était entré dans son esprit.
— Quel n’est pas mon malheur, se disait-il: Choisir entre mon affection ou l’infamie. O marraine, vous êtes trop cruelle pour moi; vous ne m’aimez pas. Vous faites fi de mon honneur, vous n’êtes pas digne d’être ma seconde mère.
Tandis que Fernand se désolait ainsi, Juliette se dirigeait vers l’antre de la sibylle.