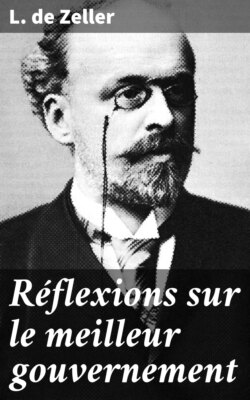Читать книгу Réflexions sur le meilleur gouvernement - L. de Zeller - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IMPORTANCE DE L’HISTOIRE OU DE L’EXPÉRIENCE POUR LA SCIENCE POLITIQUE.
ОглавлениеParceque depuis deux siècles la plupart des sciences ont fait d’immenses progrès, l’on a pensé que la science de la politique pouvait prendre le même essor.
L’on n’a point remarqué que ces sciences récemment agrandies étaient dans leur enfance, qu’elles reposaient sur des faits mal observés, mal connus, et que de nouveaux faits, des observations plus attentives, mûries par le génie devaient nécessairement leur faire faire de grands progrès, et les fixer.
Par exemple, pour la physique, Aristote fut détrôné par Descartes, et Descartes lui-même par Newton.
Les systèmes d’Aristote et de Descartes se sont écroulés parceque leurs bases étaient chimériques, n’étaient pas prises dans la nature.
La théorie de Newton éclairera tous les siècles tout l’univers; elle sera un monument éternel de l’esprit humain, parceque les fondements de cette théorie sont aussi indestructibles que le monde.
Si les systèmes d’Aristote et de Descartes ont fait place à une science nouvelle, parceque leurs bases imaginaires ont été remplacées par des faits réels bien observés, il ne peut en être ainsi de la politique; car les faits, les bases sur lesquels reposent cette science n’ont pu et ne peuvent changer. Il s’agit toujours de contenir les hommes, leurs passions, dans les bornes de la justice; de conserver parmi eux l’ordre et la paix; de les aider à pourvoir à leurs besoins, à assurer leur bien-être; de les protéger dans l’exercice de leurs talents, de leur industrie; de leur enseigner, de leur faire pratiquer les préceptes de la morale; enfin, de les rendre et meilleurs et plus heureux.
Or la justice, la morale, les passions, les besoins natifs des hommes sont toujours les mêmes; et les règles, les principes qui ont pu jadis leur assurer tous les avantages dont on vient de parler peuvent encore les leur garantir.
Seulement, la marche des siècles ayant fait avancer la civilisation et créé de nouveaux besoins, ces besoins exigent de nouvelles combinaisons politiques. Mais ces combinaisons nouvelles ne sont que des accroissements, des corollaires de la science, dont le fond reste le même. Ce qui était bien au temps de Lycurgue, la monarchie, la division du pouvoir, etc., l’est encore aujourd’hui, et les écueils des temps passés sont encore à éviter.
En Crète, à Rome, en Angleterre, en France, Minos, Servius Tullius, Henri VII et Louis XVI agrandirent trop le pouvoir du peuple. Qu’est-il arrivé ? En Crète, à Rome, en Angleterre, et en France le trône fut renversé.
En lisant l’histoire, l’on est étonné de voir les peuples se tourmenter sans cesse pour créer de nouveaux modes de gouvernement, et pourtant, malgré la fécondité de leur génie, rester dans le même cercle, revenir même à leur point de départ.
Les plus anciens gouvernements furent monarchiques. Mais comme le pouvoir tend toujours au despotisme, les grands de la nation, qui furent les premières victimes de la tyrannie du prince, réunirent leurs efforts pour le renverser et s’emparer de l’autorité.
Parmi ces usurpateurs, les plus puissants cherchèrent à dominer seuls; car le pouvoir, pour changer demain, ne perd point sa tendance à vaincre les obstacles qu’il rencontre, à se rendre libre de toutes entraves, à régner sans partage.
Les plus puissants de la noblesse firent donc la guerre aux autres nobles, pour agrandir leur autorité leur tyrannie.
Ces guerres, leurs désastres la victoire des uns la défaite des autres, et tout le poids de cette aristocratie, tyrannisante ou tyrannisée, porta sur le peuple, qui crut ne pouvoir mieux faire, pour secouer l’oppression et prévenir de pareils malheurs, que de changer le gouvernement et de s’emparer du pouvoir.
Mais l’on s’aperçut bientôt que l’exercice du pouvoir par le peuple avait aussi ses inconvénients ses dangers, et que le despotisme populaire était encore plus insupportable que le despotisme aristocratique et monarchique. Dès lors l’on reconnut qu’il ne fallait point s’en tenir à aucune des formes simples de ces gouvernements, mais constituer un gouvernement mixte dans lequel l’on réunirait les avantages attachés à la forme de chacun des trois gouvernements monarchique, aristocratique et démocratique, en évitant, autant que possible, les inconvénients qu’ils présentent.
Les. peuples créèrent donc des magistrats, mais seulement pour des temps limités qui héritèrent d’une partie de la puissance des rois; des sénats qui conservèrent une partie du pouvoir qu’avait exercé l’aristocratie; et le peuple se maintint dans l’exercice d’une portion de la puissance souveraine. Le pouvoir fut ainsi divisé pour que ses fractions pussent se contenir l’une par l’autre, et détruire toute propension despotique.
Tel était le fond du gouvernement de Crète, de Sparte, d’Athènes, de Thèbes de Carthage, de Rome, des républiques d’Italie, etc. Mais Sparte, qui, en adoptant la division du pouvoir, avait conservé la royauté héréditaire, fut considérée par toute l’antiquité comme ayant le plus parfait gouvernement.
Sommes-nous beaucoup plus avancés aujourd’hui, et n’est-ce pas sur le même fond que les gouvernements se reposent ou tendent à se reposer toutefois sous les auspices du pouvoir royal héréditaire, pouvoir dont l’absence dans les gouvernements que je viens de citer (sauf Sparte) fut la principale cause de leur peu de durée?
L’idée du gouvernement représentatif n’a même rien de neuf; nous voyons que toutes les villes de la Grèce envoyaient au conseil des amphictyons, à ce tribunal suprême de tout le pays des députés pour les représenter, pour soutenir, défendre leurs intérêts.
Si, pour le gouvernement intérieur de chaque république, à Sparte, à Thèbes, à Athènes, l’on n’a point introduit le gouvernement représentatif, c’est parceque tout le peuple, pouvant facilement se transporter au forum, et traiter lui-même ses affaires, n’avait pas besoin de représentants.
Dans nos états modernes, en adoptant le même principe de gouvernement, l’on ne pouvait faire voyager des villes, des provinces entières, pour les réunir sur une même place et y débattre leurs intérêts. Il fallut donc imiter les Grecs quant à leurs députations au conseil des amphictyons.
Puisque la politique a toujours à se baser sur les passions, les besoins des hommes, qui sont les mêmes dans tous les temps; puisque les principes jadis d’une heureuse application peuvent l’être encore aujourd’hui, et les dangers des temps passés être encore des dangers pour les temps actuels, l’on peut dire que ce qui constitue principalement la science de la politique est la science des temps; la science de tous les événements heureux et malheureux qui ont régi le monde, des causes qui ont le plus influé sur la puissance, la gloire, le bonheur des peuples, et la durée de leur empire, des faux systèmes qui ont fait peser sur les nations toutes sortes de calamités et les ont détruites; en un mot, que la science de la politique est la science de l’histoire, de l’expérience.
Ce n’est pas qu’il faille s’attacher servilement, se borner à ce qui a été fait; l’esprit humain s’agrandissant, se perfectionnant chaque jour, nous devons mieux faire que nos pères, parcequ’aux lumières des temps qui nous ont précédés nous pouvons joindre nos propres lumières, augmenter le foyer, faire faire des progrès à nos connaissances, à nos institutions; et c’est en ce sens qu’il faut marcher avec le siècle. Mais dédaigner le passé et les leçons qu’il nous donne, comme l’ont lait messieurs de la révolution, tout changer, tout détruire, pour tout refaire sur des bases non consacrées par l’expérience, ce n’est plus marcher avec le siècle, mais remonter au premier âge, au berceau du monde, à ces temps d’ignorance où tous les hommes sans expérience devaient tout apprendre au prix du malheur; c’est compromettre tous les bienfaits de la civilisation renoncer à l’héritage des siècles.
Il est beau sans doute, guidé par des vues philanthropiques, de chercher, dans des spéculations nouvelles, à perfectionner l’ordre social, à écarter des peuples les malheurs, la misère qui les assiègent si souvent, à leur créer de nouvelles sources de bien-être.
Mais il faut toujours que ces spéculations politiques soient peu hasardées, parcequ’on ne peut mettre au hasard le sort des peuples, et qu’elles ne cessent jamais d’être justiciables de l’expérience, parceque, sur les différents essais qu’on peut tenter, c’est encore l’expérience qu’il faut consulter.
L’expérience est la raison suprême, l’autorité en dernier ressort. Ce qu’elle approuve est bien, ce qu’elle condamne est mal, indépendamment de toutes subtilités sophistiques; et il faut que l’on soit toujours prêt à abandonner tout système toute prétendue théorie que l’expérience signale comme fausse, dangereuse ou impraticable, et qu’elle proscrit.
L’on a répété souvent que telle doctrine était juste, admirable en théorie, mais qu’elle n’était point praticable.
Il y a là une erreur, un contre-sens.
L’on ne conçoit pas comment une théorie peut être juste, et n’être point praticable.
Une théorie n’est point une collection de préceptes dictés arbitrairement par un législateur, sauf à l’expérience à s’en arranger à s’y soumettre: toute théorie ainsi composée ne serait qu’un roman. Une véritable théorie est le produit de l’expérience, ses leçons mises en préceptes.
Une théorie n’est point mère, mais fille de l’expérience. C’est par l’expérience qu’elle est fondée, c’est de l’expérience qu’elle tient tous ses titres; et pour tous ses préceptes c’est l’expérience qui ordonne statue, et jamais l’imagination fantasque ou la volonté arbitraire d’un législateur.
Si, pour établir des préceptes des lois, composer des théories, il suffisait de recueillir les inspirations d’un législateur, l’on ne verrait point chaque législation se greffer, pour ainsi dire, sur une législation plus ancienne, et aller prendre sa source et son autorité dans les premiers âges du monde.
Notre législation civile, par exemple, est la reproduction des lois de Justinien, avec les modifications et perfectionnements indiqués par l’expérience.
Les lois de Justinien étaient aussi la reproduction de celles des douze Tables, qui avaient été elles-mêmes calquées sur les lois des Grecs, et ces dernières sur celles de Crète et d’Égypte, etc.
Pourquoi donc remonter si haut? pourquoi tant de recherches, tant de soins? c’est parceque les passions, les besoins des hommes étant les mêmes dans tous les temps, le législateur ayant toujours à agir sur le même fond, les lois produites, éprouvées par le temps, sont toujours préférables aux plus belles spéculations législatives.
Notre charte elle-même n’émane sûrement point d’une volonté arbitraire. Quelles sont les lois politiques qui conviennent aux Français? quelles sont les lois politiques qui peuvent mieux assurer leur bonheur? voilà toute la question, et il est bien clair que la réponse à cette question ne dépend point de la volonté du prince. C’est son intelligence, sa haute intelligence, qui jette ses regards sur l’histoire de la France et de tous les autres peuples; interroge tous les siècles, tous les âges; distingue ce qui peut s’adapter au temps actuel, au génie, aux besoins des Français, ce qui peut leur convenir, les rendre heureux, et l’insère dans la charte. Aussi ces lois tirent moins leur force de la volonté du prince que de leur convenance. Si ces lois étaient draconiennes, si elles compromettaient nos droits, nos intérêts, notre bonheur, non seulement l’autorité du législateur, mais l’autorité de tous les princes de la terre, ne pourrait leur faire prendre racine.
La constitution anglaise, cet admirable monument de législation si bien adapté aux inclinations, au caractère, au génie des peuples, est l’œuvre du temps plutôt que du législateur. C’est vers le treizième siècle qu’elle commença à s’établir, par la concession de la grande charte et ce n’est que dans le dix-huitième siècle, sous la maison de Brunswick, que, mûrie par le temps et l’expérience, et perfectionnée par des réformes continuelles, elle parvint à ce degré de stabilité qui fixe invariablement le pouvoir dans ses véritables limites, et assure à jamais la prospérité, la gloire, le bonheur de la nation.
Il est donc évident qu’en politique ( et cette vérité s’applique d’ailleurs à toutes les autres sciences, même aux arts) toute théorie n’est autre chose que les leçons de l’expérience mises en préceptes. Pour peu que nous réfléchissions sur nous-mêmes, nous nous convaincrons que nous ne pouvons rien connaître que par l’expérience; que c’est l’expérience qui forme les hommes, qui forme les peuples, qui consacre toutes les institutions; que c’est par l’expérience que la civilisation marche; que nous valons mieux que nos ancêtres; que nos neveux vaudront mieux que nous; que l’expérience est la reine du monde; qu’expérience et sagesse sont une même chose; qu’on est d’autant plus sage qu’on tient plus compte de l’expérience, et d’autant plus insensé qu’on la néglige davantage.
«L’on m’accuse, disait M. Burke, de porter sur la constitution
» française un jugement avant l’expérience; et
» c’est précisément l’expérience que j’invoque contre elle,
» mais l’expérience de tous les siècles, de tous les peuples,
» et celle surtout de mon pays. Quel guide plus sûr
» pouvais-je me proposer pour confondre la doctrine
» de ces législateurs nés d’hier et qui, désavouant avec
» mépris tout rapport, toute conformité avec les législations
» anciennes et même avec la nôtre, déclarent qu’il
» faut tout changer puisque tout est à renouveler, puisque
» rien n’est à sa place dans l’ordre social. Tant de
» monstrueuses innovations, on nous les présente comme
» des vérités absolues. Dans l’ordre politique, les vérités
» absolues sont les trésors que Dieu s’est réservés, et
» qu’il ne nous communique pas. Que nous a-t-il laissé
» pour nous conduire dans l’ordre social? l’expérience.
» Quoi! je l’entendrai perpétuellement invoquer cette
» expérience, dans les sciences naturelles et physiques;
» on reconnaîtra de toutes parts qu’elle seule nous a donné
» les plus belles découvertes, et nous la laisserons bannir
» des sciences morales, son premier, son éternel domaine!»
De grands publicistes ne sont point exempts du reproche de ne pas tenir assez compte de l’expérience, de ne point assez envisager dans les principes qu’ils professent les suites de leur application, et de sacrifier souvent à la rigueur de leur doctrine le véritable intérêt, le bonheur des peuples.
Locke, Sidney et beaucoup d’autres publicistes enseignent très bien que le pouvoir est destiné à protéger les peuples, à faire leur bonheur, et que les princes qui font servir leur puissance à d’autres fins, ou qui lui donnent plus d’extension que ces fins n’exigent, exercent un pouvoir usurpé, illégitime.
Ce sont là des principes de la plus simple logique: suivons maintenant les conséquences qu’ils en tirent. Lorsque de simples citoyens exercent, au préjudice de la société, des droits qu’ils n’ont point, ou qui excèdent ceux qui leur appartiennent, ils sont justiciables des tribunaux, qui les font rentrer dans l’ordre et les punissent. Mais dans la société il n’existe point de tribunaux qui aient la puissance de rappeler les rois à leurs devoirs, de les punir de leurs usurpations. Alors, disent ces messieurs, il faut que les peuples, comme Jephté, en appellent au ciel: les peuples doivent prendre les armes pour soumettre leurs princes à la justice.
Eh! messieurs, vous oubliez que le gouvernement est institué pour prévenir les troubles, les guerres civiles et que, si pour l’honneur de vos principes vous excitez les peuples à la révolte, si vous leur mettez les armes à la main, vous arrivez à une fin diamétralement opposée à l’institution du gouvernement, vous tombez dans une politique contradictoire et fausse.
Sûrement il est fâcheux qu’un prince abuse de son pouvoir; mais dans cette occurrence, plutôt que de vous concentrer dans vos principes, il faut voir quels plus grands maux résulteront pour les peuples, ou de résister au prince, de lui faire la guerre, ou de faire quelque concession sur des maximes dont une rigoureuse application serait trop sévère, et de se résigner à des abus passagers qui certes sont un grand mal, mais dont le remède paraît si funeste.
Dans la guerre que vous voulez entreprendre contre le prince, si vous succombez, le prince tiendra la nation sous un joug plus dur qu’auparavant, pour l’empêcher de remuer désormais; si vous triomphez, si vous renversez le trône, vous rompez en même temps tous les liens du corps social, vous tombez dans l’anarchie, dans un état de guerre où chacun est esclave de tous ceux qui sont plus forts que lui, où chaque particulier devient tyran, où la tyrannie se multiplie à l’infini, jusqu’au moment où quelque soldat habile écrasera, sous la force de ses coups, tous les tyrans comme tous les peuples
Puisque cette guerre ne présente que des calamités pour la nation l’intérêt des peuples proscrit évidemment votre doctrine, qui ne pourra jamais être un principe de conduite en politique.
Mais les auteurs théoriques transigent difficilement sur leurs principes; ils veulent toujours les faire prévaloir bien différents, sur ce point, des hommes d’état, qui s’attachent principalement à l’expérience, et lui sacrifient, au besoin, tous les principes dont elle condamne l’application.
Je vais citer un exemple.
Dans nos lois civiles, lorsqu’un père se trouve opposé d’intérêt avec ses enfants, le législateur donne aux enfants un tuteur particulier, parcequ’il présume que malgré la sollicitude, l’attachement d’un père pour ses enfants, ses intérêts personnels pourraient l’aveugler et compromettre les intérêts de ses enfants.
D’après ce principe aussi juste que sage un fonctionnaire public, qui tient ses emplois, souvent sa fortune du gouvernement, ne devrait point être admis à représenter le peuple à la chambre des députés: car, toujours lié d’intérêt avec le trône, il se trouve opposé d’intérêt avec le peuple, et l’on ne peut se persuader qu’il aura pour le peuple plus de sollicitude, plus d’attachement qu’un père pour ses enfants, qu’il saura mieux se dépouiller du sentiment de ses propres intérêts, pour soutenir ceux de ses adversaires.
Mais l’expérience fait voir
Qu’un collége, ou qu’une assemblée d’hommes populaires prenant part au gouvernement serait trop puis-santé, et qu’elle envahirait bientôt tous les pouvoirs pour tout détruire, si l’esprit démocratique de ce collége ou de cette assemblée n’était tempéré par l’influence salutaire d’une partie de ses propres membres unis au gouvernement.
A Rome le simple collège des tribuns, en parlant au nom du peuple était devenu si puissant, que le sénat, pour n’être point envahi par cette puissance, ne trouva point de meilleurs moyens que de tempérer, paralyser le tribunat par le tribunat même, en mettant, dans l’intérêt du sénat comme dans l’intérêt de la république, quelque tribun dont l’opposition arrêtait les projets trop violents des autres tribuns.
Mais lorsque Tiberius Gracchus eut donné le malheureux exemple de faire déposer par le peuple les tribuns opposants cette barrière rompue, la puissance du tribunat et du peuple ne connut plus de bornes, régna sans partage, et périt bientôt par ses excès, en entraînant la république dans sa ruine.
En Angleterre, la chambre des communes, sous Charles Ier, s’empara aussi du gouvernement, et précipita la nation dans l’abîme.
Nos assemblées constituante et législative firent éprouver pareil sort à la France.
Ces assemblées de représentants du peuple en France, en Angleterre, comme à Rome, ne devinrent aussi envahissantes et désorganisatrices que lorsque l’influence salutaire du gouvernement, par ses fonctionnaires, ou des hommes unis avec lui, ne s’y fit plus ou point assez sentir.
Instruits par ces grandes leçons de l’expérience, nos hommes d’état ont ouvert aux fonctionnaires publics la chambre des députés, bien que leur entrée dans cette chambre soit contraire aux principes.
En bonne règle il ne devrait y avoir que des hommes d’état qui se permissent de raisonner et d’écrire sur la politique. Ces messieurs trouvent, dans leur propre expérience, une seconde logique que rien ne peut suppléer. D’ailleurs ils ne sont point condamnés, comme les hommes étrangers aux affaires publiques à raisonner sur des dehors souvent trompeurs. Connaissant les causes, tous les entours de ce qu’ils voient; ils peuvent mieux juger, tirer plus de fruit de leurs réflexions, et sont moins exposés à l’erreur. Quels avantages pour nous instruire!
Cependant les hommes d’état ont peu écrit, et les regrets qu’exprimait Aristote, on peut encore les exprimer aujourd’hui.
D’où vient ce silence de leur part?
Serait-ce parceque la politique des livres ne peut ressembler à celle des affaires, parcequ’il est impossible de communiquer au papier cet art, cette habileté profonde, cette âme de la politique qui lui fait faire de si grandes choses, qui lui a fait changer plusieurs fois la face du monde, et a mis l’univers aux pieds du sénat romain, en jetant les peuples, par ces grands spectacles, dans un tel étonnement, qu’ils n’ont pu expliquer ce prodigieux effet de la politique que par les décrets de la Providence?
Serait-ce par l’impuissance où se trouvent fréquemment les hommes d’état d’appuyer leurs mesures sur des principes fixes, ou plutôt parceque ces mesures sont souvent en opposition avec les principes, comme dans l’exemple que nous venons de citer?
Serait-ce enfin parceque parmi les moyens dont se sert la politique il y en a qui ne peuvent être avoués?
Ah, écartons cette dernière idée!
Si Machiavel nous a montré les infernales manœuvres de quelques princes, ce n’est point là de la politique; mais le miroir où la corruption de quelques hommes doit faire sur tous les hommes d’état l’impression que recevaient les jeunes Spartiates à la vue de leurs esclaves plongés dans l’ivresse.
Soyons convaincus qu’en politique comme dans le civil, le crime est toujours crime et la justice toujours une. Y a-t-il deux soleils? a-t-on deux consciences? Et comment pourrait-il y avoir deux justices: celle de l’homme d’état, et celle du simple citoyen? Cette odieuse politique à partie double où une partie seulement était publique et l’autre ensevelie dans les secrets de l’état, a pu être suivie quelquefois dans des temps de ténèbres; mais les progrès des lumières doivent la faire disparaître, surtout dans les gouvernements représentatifs, où, tout étant public, la politique doit agir cartes sur table.
Si, comme je le pense, la réserve des hommes d’état pour écrire vient de la difficulté de faire passer dans des livres tout le secret de leurs talents, des ressorts de la politique pratique quelle circonspection ne doivent point avoir les hommes étrangers aux affaires publiques! Ce n’est qu’en s’appuyant sur des faits, l’expérience des siècles, qu’ils peuvent se hasarder à faire quelques pas dans une carrière aussi difficile à parcourir.
Pourtant, comme tous les faits historiques réunis dans un même livre n’instruiraient pas beaucoup sans l’enchaînement des causes qui les ont produits, et que ces causes nous sont mal connues, il ne faut pas seulement raisonner d’après des faits qui ne feraient point assez jaillir de lumière, mais partir de certaines inductions logiques, sauf à les appuyer par des faits historiques, de manière à s’avancer toujours sous les auspices de l’expérience et de la raison.
Cherchant à faire connaître le prix qu’on doit attacher pour la politique aux leçons du temps, la nécessité de s’appuyer sur l’expérience, sans cependant négliger les avantages que peuvent présenter des spéculations nouvelles;
Cherchant à distinguer cette politique pratique qu’on trouve dans l’histoire, dans les écrits des hommes d’état, de cette politique à système qui ne repose que sur des spéculations de l’esprit, sans pouvoir recevoir jamais d’application;
Ce serait le cas, ce semble, de parler de cette souveraineté populaire qu’on voulait établir sur la ruine de tous les gouvernements; de faire voir combien cette prétention était chimérique; combien dans son dédain pour l’expérience, elle était dangereuse, impolitique, et combien nous devons être prévenus contre ces spéculations qui, en méprisant l’autorité du temps, en éprouvent infailliblement la vengeance. Mais étant forcé, dans le cours de mes discussions sur le meilleur gouvernement, de traiter spécialement cette thèse, je m’abstiendrai d’en rien dire ici.
Je me suis un peu étendu sur l’importance de l’histoire et de l’expérience pour la politique, parceque j’ai besoin d’étayer le titre sur lequel je me fonde pour me permettre de raisonner politique, et de le défendre d’ailleurs contre ces auteurs qui prétendent qu’il faut changer de politique comme de calendrier.