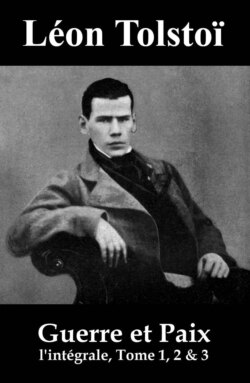Читать книгу Guerre et Paix (l'intégrale, Tome 1, 2 & 3) - León Tolstoi - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XXI
ОглавлениеPendant que l’on dansait ainsi la septième «anglaise», que les musiciens détonnaient de fatigue, et que les domestiques et les cuisiniers, à bout de forces, préparaient le souper, un sixième coup d’apoplexie frappait le comte Besoukhow. Les médecins ayant déclaré que tout espoir de guérison était perdu, on lut au moribond les prières de la confession, on le fit communier et l’on se prépara à lui donner l’extrême-onction. L’agitation et l’inquiétude inséparables de ces derniers moments régnaient autour de ce lit de mort. De nombreux agents des pompes funèbres, alléchés par l’appât de riches funérailles, se pressaient devant la grande porte d’entrée, ayant soin pourtant de se dérober entre les voitures qui s’arrêtaient devant le perron. Le général-gouverneur de Moscou, qui avait envoyé ses aides de camp plusieurs fois par jour pour avoir des nouvelles du malade, était venu ce soir-là en personne prendre un dernier congé de l’illustre contemporain de Catherine. Le magnifique salon de réception était plein de monde. Tous se levèrent avec respect à l’entrée du général en chef, qui venait de passer une demi-heure seul avec le mourant, et qui, en saluant à droite et à gauche, se hâta de traverser le salon sous le feu de tous les regards.
Le prince Basile, singulièrement pâli et amaigri, le reconduisait, en lui disant quelques mots à voix basse. Après avoir accompli ce devoir, il s’arrêta dans la grande salle, et se laissa tomber sur une chaise, en se couvrant les yeux de la main.
Bientôt après, il se leva et se dirigea vivement et d’un air anxieux vers un long couloir qui aboutissait à l’appartement de l’aînée des princesses, et il y disparut.
Les personnes qui étaient restées dans le salon à demi éclairé chuchotaient entre elles ou se taisaient subitement, et jetaient des regards curieux et inquiets du côté de la porte, chaque fois qu’elle s’ouvrait pour livrer passage à ceux qui entraient chez le malade ou qui en sortaient.
«Le terme est arrivé! Disait un vieux prêtre assis à côté d’une dame qui l’écoutait avec vénération… Le terme est arrivé! Aller plus loin est impossible!
— N’est-ce pas trop tard pour l’extrême-onction? Demanda sa voisine, feignant de ne point savoir à quoi s’en tenir là-dessus.
— C’est un bien grand sacrement,» répondit le serviteur de l’Église, et, passant doucement la main sur son front chauve, il ramena en avant quelques rares mèches de cheveux gris.
«Qui était-ce donc? Le général en chef? Demandait-on à l’autre bout de la chambre… Comme il est encore jeune!
— Et il est à la veille de ses soixante-dix ans!… On dit que le comte n’a plus sa tête… Il était question de lui donner l’extrême-onction…
— J’ai connu quelqu’un qui l’a reçue sept fois.»
La seconde des nièces du comte Besoukhow venait de quitter son oncle. Elle avait les yeux rouges; elle alla s’asseoir à côté du docteur Lorrain, qui était gracieusement accoudé sous le portrait de l’impératrice Catherine.
«Il fait véritablement beau, princesse, très beau, lui dit le médecin… on pourrait en vérité se croire à la campagne, bien qu’on soit à Moscou!
— N’est-ce pas? Répondit la demoiselle avec un soupir… Me permettez-vous de lui donner à boire?»
Le médecin parut réfléchir:
«A-t-il pris la potion?
— Oui.»
Il regarda son «Bréguet»:
«Prenez un verre d’eau cuite et mettez-y une pincée (faisant le geste de ses doigts fluets) de… de crème de tartre.
«Che ne gonnais bas de gas où l’on reste en fie abrès le droisième goup, disait un médecin allemand à un aide de camp.
— Quel homme robuste c’était! Répondit son interlocuteur… À qui reviennent toutes ses richesses? Ajouta-t-il tout bas.
— Il se drouvera pien un amadeur,» reprit l’Allemand avec un gros sourire.
La porte s’ouvrit de nouveau. Tout le monde regarda: c’était la seconde princesse qui, après avoir préparé la tisane, entrait chez le malade.
Le médecin allemand s’approcha de Lorrain.
«Il bourra pien drainer engore jusqu’au madin.»
Lorrain plissa ses lèvres, et fit solennellement un geste négatif avec son index:
«Cette nuit au plus tard!» dit-il tout bas, en souriant orgueilleusement à sa propre science, qui lui permettait de si bien préciser la situation de l’agonisant.
Le prince Basile ouvrit la porte de la chambre de la princesse aînée. Il y faisait presque nuit: deux petites lampes brûlaient devant les images, et il s’en exhalait une douce odeur de fleurs et de parfums. Une foule de petits meubles, de chiffonnières et de guéridons de toutes formes l’encombraient, et l’on entrevoyait à demi cachées par un paravent les blanches couvertures d’un lit très élevé.
Un petit chien aboya.
«Ah! C’est vous, mon cousin!»
Elle se leva, en passant la main sur ses bandeaux, si constamment et si correctement lisses, qu’on aurait pu les croire fixés sur sa tête par une couche de vernis.
«Qu’y a-t-il? Dit-elle, vous m’avez effrayée!
— Il n’y a rien. C’est toujours la même chose, mais je suis venu causer affaires avec toi, Catiche,» lui dit le prince.
Et il s’assit avec lassitude dans le fauteuil qu’elle avait occupé.
«Comme tu as chauffé ta chambre! Voyons, assieds-toi là, et causons.
— Je croyais qu’il était arrivé quelque chose…»
Et elle se mit en face de lui, toute prête à l’écouter avec son air impassible et dur.
«J’ai essayé de dormir, mais je ne peux pas.
— Eh bien, ma chère?» dit le prince Basile qui lui prit la main et qui ensuite l’abaissa graduellement, selon son habitude…
Ces quelques mots devaient faire allusion à bien des choses, car le cousin et la cousine s’étaient entendus sans rien se dire.
La princesse, dont la taille était longue, sèche et disgracieuse, tourna lentement ses yeux gris à fleur de tête et sans expression, et les fixa sur lui; puis elle secoua la tête, soupira et reporta son regard vers les images. Ce mouvement pouvait s’interpréter de deux manières: c’était de la douleur et de la résignation, ou bien de la fatigue et l’espoir d’un prochain repos.
Le prince Basile le comprit ainsi.
«Crois-tu donc que je ne m’en ressente pas aussi? Je suis éreinté comme un cheval de poste. Causons pourtant, et sérieusement, si tu veux bien…»
Il se tut et la contraction de ses joues donna à sa physionomie une expression désagréable, qui ne ressemblait en rien à celle qu’il prenait devant témoins. Son regard était aussi tout autre, et on y lisait à la fois l’impudence et la crainte.
La princesse, retenant son petit chien sur ses genoux, de ses mains osseuses et maigres, le regardait attentivement dans le plus profond silence, bien décidée à ne pas le rompre la première, dût-il se prolonger toute la nuit.
«Voyez-vous, chère princesse et chère cousine Catherine Sémenovna, reprit le prince Basile avec un effort visible, il faut penser à tout dans de pareils moments; il faut penser à l’avenir, au vôtre… je vous aime toutes trois comme mes propres filles, tu le sais…?»
Comme la princesse restait impassible et impénétrable, il continua sans la regarder, en repoussant avec humeur un guéridon:
«Tu sais bien, Catiche, que vous trois et ma femme vous êtes les seules héritières directes. Je comprends tout ce que le sujet a de pénible pour toi et pour moi aussi, je te le jure; mais, ma chère amie, j’ai dépassé la cinquantaine, il faut tout prévoir!… Sais-tu que j’ai envoyé chercher Pierre? Le comte l’a exigé en indiquant son portrait…»
Le prince Basile releva les yeux sur elle: rien n’indiquait sur sa figure si elle l’avait écouté, ou si elle le regardait sans songer à rien.
«Je ne cesse d’adresser de ferventes prières à Dieu, mon cousin, pour qu’il soit sauvé et pour que sa belle âme se détache sans souffrance de ce monde.
— Oui, oui, certainement, répliqua le vieux prince, en attirant cette fois à lui avec un mouvement de colère l’innocent guéridon…
— Mais enfin, voici l’affaire… tu la connais… le comte a fait l’hiver dernier un testament par lequel il laisse toute sa fortune à Pierre, en mettant de côté ses héritiers légitimes.
— Oh! Il en a tant fait de testaments! Repartit la nièce avec une tranquillité parfaite… En tout cas, il ne saurait rien léguer à Pierre, car Pierre est un fils naturel!
— Et que ferions-nous? S’écria vivement le prince Basile en serrant contre lui le guéridon à le briser… – Que ferions-nous si le comte demandait à l’Empereur, dans une lettre, de légitimer ce fils? Eu égard aux services du comte, on le lui accorderait peut-être!»
La princesse sourit, et ce sourire disait qu’elle en savait là-dessus plus long que son interlocuteur.
«Je te dirai plus: la lettre est écrite, mais elle n’a pas été envoyée, et pourtant l’Empereur en a connaissance. Il s’agirait de découvrir si elle a été détruite; si, au contraire, elle existe… alors… quand tout sera fini! – et il soupira pour faire entendre ce que voulait dire le mot «tout», – on cherchera dans les papiers du comte…, le testament sera remis à l’Empereur avec la lettre, sa prière sera accueillie et Pierre héritera légitimement de tout!
— Et notre part? Demanda la princesse avec une ironie marquée, bien convaincue qu’il n’y avait rien à craindre.
— Mais, ma pauvre Catiche, c’est clair comme le jour: il sera le seul héritier, et vous ne recevrez pas une obole – Tu dois le savoir, ma chère! Le testament et la lettre ont-ils été détruits? S’il les a oubliés, où se trouvent-ils? Dans ce cas il faudrait s’en emparer, car…
— Il ne manquerait plus que cela, lui dit-elle en l’interrompant du même ton et avec la même expression dans le regard… Je ne suis qu’une femme et, selon vous, nous sommes toutes des sottes? Mais je suis sûre qu’un bâtard ne peut hériter de rien, un bâtard! Ajouta-t-elle en français, comme si ce mot dans cette langue devait répondre victorieusement à tous les arguments de son adversaire.
— Tu ne veux pas me comprendre, Catiche, car tu es intelligente. Si le comte obtient la légitimation, Pierre deviendra comte Besoukhow, et toute la fortune ira à lui de droit. Si le testament et la lettre existent, il ne te reviendra à toi, que la consolation d’avoir été bonne, dévouée… etc.… etc.… c’est certain!
— Je sais que le testament existe, mais je sais aussi qu’il n’est pas légal, et vous me prenez, je crois, pour une idiote, mon cousin, répondit la princesse, convaincue qu’elle avait été mordante et spirituelle.
— Ma chère princesse Catherine, reprit le vieux prince avec une impatience marquée, je ne suis pas venu pour te blesser, mais pour causer avec toi de tes propres intérêts. Tu es une bonne et aimable parente, et je te répète pour la dixième fois que, si le testament et la lettre se trouvent parmi les papiers du comte, tes sœurs et toi vous cessez d’être les héritières. Si tu manques de confiance en moi, adresse-toi à des gens compétents. Je viens d’en causer avec Dmitri Onoufrievitch, l’homme d’affaires de la maison, et il m’a répété la même chose.»
La lumière se fit tout à coup dans les idées de la princesse. Ses lèvres minces pâlirent, mais ses yeux gardèrent leur immobilité, tandis que sa voix, qu’elle ne pouvait plus maîtriser, avait des éclats inattendus.
«Ce serait charmant, je n’ai jamais rien demandé, et je ne veux rien accepter! S’écria-t-elle en jetant à terre son carlin, et en arrangeant les plis de sa robe… Voilà la reconnaissance, voilà l’affection pour celles qui lui ont tout sacrifié! Bravo! C’est parfait. Je n’ai heureusement besoin de rien, prince!
— Mais tu n’es pas seule, tu as des sœurs…
— Oui, continua-t-elle sans l’écouter, je le savais depuis longtemps, mais je n’y pensais plus: l’envie, la duplicité, l’intrigue, la plus noire des ingratitudes, voilà à quoi je devais m’attendre dans cette maison. J’ai tout compris, et je sais à qui je dois m’en prendre de ces intrigues.
— Mais il ne s’agit pas de cela, ma chère amie.
— C’est votre protégée, cette charmante princesse Droubetzkoï, que je n’aurais pas voulu avoir pour femme de chambre, cette vilaine et atroce créature!
— Voyons, ne perdons pas notre temps.
— Ah! Laissez-moi: elle s’est faufilée ici pendant l’hiver et a raconté au comte des horreurs, des choses épouvantables sur nous toutes, sur Sophie surtout. Impossible de vous les répéter!… Le comte en est tombé malade et n’a pas voulu nous laisser entrer chez lui pendant quinze jours. C’est alors qu’il a écrit ce sale papier, qui, à ce que je croyais, ne pouvait avoir aucune valeur.
— Nous y voilà…, mais pourquoi ne pas m’avoir prévenu? Où est-il?
— Il est enfermé dans le portefeuille à mosaïque qu’il garde toujours sous son oreiller… Oui, c’est elle, et si j’ai un gros péché sur la conscience, c’est la haine que m’inspire cette vilaine femme! Pourquoi se glisse-t-elle parmi nous? Oh! Un jour viendra où je lui dirai son fait,» s’écria la princesse complètement hors d’elle-même.