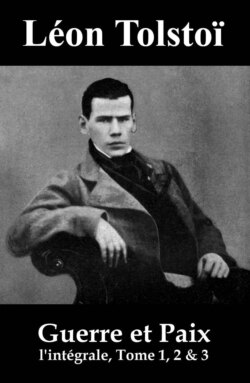Читать книгу Guerre et Paix (l'intégrale, Tome 1, 2 & 3) - León Tolstoi - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XXV
ОглавлениеOn attendait de jour en jour à Lissy-Gory, domaine du prince Nicolas Andréévitch Bolkonsky, l’arrivée du jeune prince André et de sa femme; mais cette attente ne troublait en rien le mode d’existence établi par le vieux prince, qu’on avait surnommé, dans un certain cercle, «le roi de Prusse». Général en chef de l’empereur Paul, il avait été exilé par lui dans sa propriété de Lissy-Gory, et il y vivait depuis lors dans la retraite avec sa fille Marie et sa demoiselle de compagnie, MlleBourrienne. Le nouveau règne lui avait ouvert les portes de sa prison et lui avait rendu le droit de séjourner dans les deux capitales; mais il s’obstinait à ne pas quitter sa terre, ayant déclaré à qui voulait l’entendre que les cent cinquante verstes qui le séparaient de Moscou pouvaient bien être franchies par ceux qui désiraient le voir, et que, quant à lui, il n’avait besoin de rien, ni de personne.
Les vices de l’humanité provenaient, disait-il, exclusivement de deux causes: l’oisiveté et la superstition. De même, il ne reconnaissait que deux vertus: l’activité et l’intelligence; et il s’occupait personnellement de l’éducation de sa fille, afin de développer en elle, autant que possible, ces deux qualités. Jusqu’à l’âge de vingt ans, elle avait étudié, sous sa direction, la géométrie et l’algèbre, et sa journée avait été méthodiquement employée à des occupations déterminées et suivies.
Quant à lui, il écrivait ses mémoires, résolvait des problèmes de mathématiques, tournait des tabatières, travaillait au jardin et surveillait la construction de ses différentes bâtisses, qui lui donnaient fort à faire, car le bien était grand et l’on bâtissait toujours.
Jusqu’au moment de son entrée dans la salle à manger, qui avait lieu invariablement à la même heure, ou, pour mieux dire, à la même minute, sa vie entière était réglée dans ses moindres détails avec une exactitude scrupuleuse. Il était cassant et exigeant à l’extrême à l’égard de son entourage, y compris sa fille; aussi, sans être cruel, il avait su inspirer une crainte et un respect qu’un homme vraiment méchant aurait eu de la peine à obtenir. Malgré sa vie retirée et en dehors de tout emploi officiel, aucun des fonctionnaires du gouvernement où il demeurait n’eût manqué de venir lui présenter ses devoirs et de pousser la déférence jusqu’à attendre son apparition dans le grand vestibule, à l’exemple de la princesse Marie, de l’architecte et du jardinier. Tous ressentaient du reste le même sentiment mêlé de crainte et de respect, lorsque la lourde porte de son cabinet s’ouvrait lentement pour laisser passer ce petit vieillard, avec sa perruque poudrée, ses mains sèches et fines, ses sourcils épais et grisonnants, dont l’ombre adoucissait parfois l’éclat des yeux brillants et presque jeunes encore.
Dans la matinée où devait arriver le jeune ménage, la princesse Marie traversa, selon son invariable habitude, le grand vestibule pour aller souhaiter le bonjour à son père, et, comme toujours, à ce moment-là, elle ne pouvait se défendre d’une certaine émotion, elle se signait et priait pour se donner du courage, afin que cette première entrevue se passât sans bourrasque. Le vieux serviteur poudré qui était toujours assis dans le vestibule se leva et lui dit tout bas:
«Veuillez entrer.»
Le bruit régulier d’un tour se faisait entendre dans la pièce voisine. La princesse en ouvrit timidement la porte, qui tourna doucement sur ses gonds, et s’arrêta sur le seuil; le prince travaillait, il se retourna et reprit aussitôt son ouvrage.
Ce cabinet était plein d’objets d’un usage journalier. Une énorme table, sur laquelle étaient jetés au hasard des cartes et des livres, des armoires vitrées dont les clefs brillaient dans leurs serrures, un bureau très élevé pour écrire débout, et sur lequel s’étalait un cahier ouvert, un tour garni de ses outils, et des copeaux jonchant le parquet, témoignaient d’une activité variée, constante et réglée. Au mouvement cadencé de son pied chaussé d’une botte molle à la tartare, à la pression ferme et égale de sa main nerveuse, on restait frappé de la forte dose de volonté contenue dans ce vieillard encore vert. Après avoir travaillé pendant quelques secondes, il retira son pied de dessus la pédale, essuya le repoussoir, qu’il jeta dans un sac de cuir cloué au tour, et s’approcha de la table. Il n’avait pas l’habitude de bénir ses enfants, mais il leur offrait toujours à baiser une joue, que le rasoir négligeait le plus souvent. Ce cérémonial accompli, il examina sa fille et lui dit avec une certaine brusquerie, qui cependant n’était pas exempte d’affection:
«Tu vas bien, tu vas bien? Assieds-toi là…»
Et, s’emparant d’un cahier de géométrie écrit de sa main, il étendit la jambe et attira à lui un fauteuil.
«C’est pour demain,» dit-il vivement en feuilletant les pages et en marquant de l’ongle le paragraphe qu’il avait choisi.
La princesse Marie se pencha sur la table.
«Tiens, voici une lettre pour toi,» ajouta-t-il tout à coup, en retirant d’un vide-poche suspendu au mur une enveloppe dont l’adresse avait été écrite par une main féminine, et il la lui jeta.
À la vue de cette lettre, le visage de la princesse Marie se marbra de taches rouges; elle la saisit aussitôt et la regarda.
«Est-ce de ton «Héloïse»? Demanda le prince avec un sourire glacial, qui laissa voir des dents jaunes, mais bien conservées.
— Oui, c’est de Julie, répondit-elle timidement.
— Je laisserai encore passer deux lettres, mais je lirai la troisième; vous vous écrivez des folies, je parie, … je lirai la troisième.
— Mais lisez celle-ci, mon père…»
Et sa fille la lui tendit en rougissant.
«J’ai dit la troisième, ce sera la troisième, s’écria le vieux prince, en repoussant la lettre pour reprendre son cahier de géométrie.
— Eh bien, mademoiselle…»
Et il se pencha au-dessus de sa fille, en appuyant une main sur le dossier du fauteuil où elle était assise et où elle se sentait comme enveloppée de cette atmosphère acre, imprégnée d’une odeur de tabac, particulière à la vieillesse et qui lui était si familière… «Eh bien, ces triangles sont égaux; tu vois l’angle ABC.»
La princesse regardait avec effroi les yeux brillants de son père, ses joues se couvraient de taches de feu, la peur lui ôtait la faculté de penser et la rendait incapable de suivre les déductions de son professeur, si claires qu’elles fussent… Cette scène se répétait tous les jours; mais à qui en était la faute, au maître ou à l’élève, qui finissait par voir trouble et par ne plus rien entendre? La figure de son père touchait la sienne, elle sentait l’odeur pénétrante de son haleine et ne pensait plus qu’à fuir au plus vite et à se retirer dans sa chambre pour y étudier et résoudre en toute liberté le problème proposé. Lui, de son côté, s’échauffait, repoussait et ramenait son fauteuil avec fracas, tout en faisant maints efforts pour se maîtriser; puis de nouveau il se fâchait, tempêtait et envoyait le cahier à tous les diables.
Le malheur voulut que, cette fois encore, la princesse répondît de travers:
«Quelle sotte!» s’écria-t-il, en rejetant le manuscrit.
Puis, se détournant, il se leva, fit quelques pas, passa la main sur les cheveux de sa fille, se rassit et reprit son explication de plus belle.
«Cela ne va pas, princesse, cela ne va pas! Lui dit-il, voyant qu’elle était prête à le quitter en emportant son cahier… Les mathématiques sont une noble science, et je ne veux pas que tu ressembles à nos sottes demoiselles. Persévère, tu finiras par les aimer, et la bêtise délogera de ta cervelle.»
Et il conclut en lui donnant une petite tape sur la joue.
Elle fit un pas, il l’arrêta du geste, et, saisissant sur son bureau un livre nouvellement reçu, il le lui tendit:
«Ton «Héloïse» t’envoie aussi je ne sais quelle Clef du mystère; c’est religieux, à ce qu’il paraît. Je ne m’inquiète en rien des croyances de personne, mais je l’ai parcouru. Tiens, prends-le, et va-t’en.» Et, lui tapant cette fois sur l’épaule, il ferma la porte derrière elle.
La princesse Marie rentra dans sa chambre. L’expression craintive, qui lui était habituelle, rendait encore moins attrayant son visage maladif et sans charme. Elle s’assit devant la table à écrire, garnie de miniatures encadrées, et encombrée de livres et de cahiers jetés au hasard, car elle avait autant de désordre que son père avait d’ordre, et rompit avec impatience le cachet de la lettre de sa plus chère amie d’enfance, Julie Karaguine, que nous avons déjà rencontrée chez les Rostow.
Voici le contenu de cette lettre:
«Chère et excellente amie, quelle chose terrible et effrayante que l’absence! J’ai beau me dire que la moitié de mon existence et de mon bonheur est en vous, que, malgré la distance qui nous sépare, nos cœurs sont unis par des liens indissolubles, le mien se révolte contre la destinée, et je ne puis, malgré les plaisirs et les distractions qui m’entourent, vaincre une certaine tristesse cachée que je ressens au fond du cœur depuis notre séparation. Pourquoi ne sommes-nous pas réunies, comme cet été, dans votre grand cabinet, sur le canapé bleu, le canapé aux confidences?
«Pourquoi ne puis-je, comme il y a trois mois, puiser de nouvelles forces morales dans votre regard si doux, si calme, si pénétrant, regard que j’aimais tant et que je crois voir devant moi quand je vous écris7.»
Arrivée à cet endroit de la lettre, la princesse Marie poussa un soupir, se retourna et se regarda dans une psyché, qui lui renvoya l’image de sa personne disgracieuse et de son visage amaigri, dont les yeux toujours tristes semblaient avoir pris, en se voyant reflétés dans la glace, une expression encore plus accentuée de mélancolie. «Elle me flatte,» se dit-elle en reprenant sa lecture. Et cependant Julie était dans le vrai: les yeux de Marie étaient grands, profonds, et avaient parfois des éclairs qui leur donnaient une beauté surnaturelle, en transformant complètement sa figure, qu’ils éclairaient de leur douce et tendre lumière. Mais la princesse ne se rendait pas compte à elle-même de l’expression que ses yeux prenaient chaque fois qu’elle s’oubliait en pensant aux autres, et l’impitoyable psyché continuait à refléter une physionomie gauche et guindée. Elle reprit sa lecture:
«Tout Moscou ne parle que de guerre! L’un de mes deux frères est déjà à l’étranger; l’autre est avec la garde, qui se met en marche vers la frontière. Notre cher Empereur a quitté Pétersbourg et, à ce qu’on prétend, compte lui-même exposer sa précieuse existence aux chances de la guerre. Dieu veuille que le monstre corse qui détruit le repos de l’Europe soit terrassé par l’ange que le Tout-Puissant, dans sa miséricorde, nous a donné pour souverain. Sans parler de mes frères, cette guerre m’a privée d’une relation des plus chères à mon cœur. Je parle du jeune Nicolas Rostow, qui, avec son enthousiasme, n’a pu supporter l’inaction et a quitté l’université pour aller s’enrôler dans l’armée. Eh bien, chère Marie, je vous avouerai que, malgré son extrême jeunesse, son départ pour l’armée a été un grand chagrin pour moi! Ce jeune homme, dont je vous parlais cet été, a tant de noblesse, tant de cette véritable jeunesse qu’on rencontre si rarement dans ce siècle où nous ne vivons qu’au milieu de vieillards de vingt ans, il a surtout tant de franchise et de cœur, il est tellement pur et poétique, que mes relations avec lui, quelque passagères qu’elles aient été, ont été une des plus douces jouissances de mon pauvre cœur, qui a déjà tant souffert. Je vous raconterai un jour nos adieux et tout ce qui s’est dit au départ. Tout cela est encore trop récent.
«Ah! Chère amie, vous êtes heureuse de ne pas connaître ces jouissances et ces peines si poignantes; vous êtes heureuse, puisque ces dernières sont ordinairement les plus fortes. Je sais très bien que le comte Nicolas est trop jeune pour pouvoir jamais devenir pour moi quelque chose de plus qu’un ami; mais cette douce amitié, ces relations si poétiques sont pour mon cœur un vrai besoin; mais n’en parlons plus. La grande nouvelle du jour, qui occupe tout Moscou, est la mort du comte Besoukhow et l’ouverture de sa succession. Figurez-vous que les princesses n’ont reçu que très peu de chose, le prince Basile rien, et que c’est M. Pierre qui a hérité de tout et qui, par-dessus le marché, a été reconnu pour fils légitime, par conséquent comte Besoukhow et possesseur de la plus grande fortune de Russie. On prétend que le prince Basile a joué un très vilain rôle dans toute cette histoire et qu’il est reparti tout penaud pour Pétersbourg. Je vous avoue que je comprends très peu toutes ces affaires de legs et de testament. Ce que je sais, c’est que ce jeune homme, que nous connaissions tous sous le nom de M. Pierre tout court, est devenu comte Besoukhow et possesseur de l’une des plus grandes fortunes de Russie. Je m’amuse fort à observer les changements de ton et de manières des mamans accablées de filles à marier, et des demoiselles elles-mêmes, à l’égard de cet individu, qui, par parenthèse, m’a toujours paru être un pauvre sire. Comme on s’amuse depuis deux ans à me donner des promis que je ne connais pas le plus souvent, la chronique matrimoniale de Moscou me fait comtesse Besoukhow. Mais vous sentez bien que je ne me soucie nullement de le devenir. À propos de mariage, savez-vous que, tout dernièrement, «la tante en général», Anna Mikhaïlovna, m’a confié, sous le sceau du plus grand secret, un projet de mariage pour vous. Ce n’est ni plus ni moins que le fils du prince Basile, Anatole, qu’on voudrait ranger, en le mariant à une personne riche et distinguée, et c’est sur vous qu’est tombé le choix des parents. Je ne sais comment vous envisagerez la chose. Mais j’ai cru de mon devoir de vous en prévenir. On le dit très beau et très mauvais sujet: c’est tout ce que j’ai pu savoir sur son compte. Mais assez de bavardage comme cela; je finis mon second feuillet, et maman m’envoie chercher pour aller dîner chez les Apraxine. Lisez le livre mystique que je vous envoie et qui fait fureur chez nous. Quoiqu’il y ait dans ce livre des choses difficiles à atteindre avec la faible conception humaine, c’est un livre admirable, dont la lecture calme et élève l’âme. Adieu. Mes respects à monsieur votre père, et mes compliments à MlleBourrienne. Je vous embrasse comme je vous aime.
«Julie.»
«P.-S. Donnez-moi des nouvelles de votre frère et de sa charmante petite femme8.»
Cette lecture avait plongé la princesse Marie dans une douce rêverie; elle réfléchissait et souriait, et son visage, éclairé par ses beaux yeux, semblait transfiguré. Se levant tout à coup, elle traversa résolument la chambre, et, s’asseyant à sa table, elle laissa courir sa plume sur une feuille de papier; voici sa réponse:
«Chère et excellente amie, votre lettre du 13 m’a causé une grande joie. Vous m’aimez donc toujours, ma poétique Julie! L’absence, dont vous dites tant de mal, n’a donc pas eu sur vous son influence habituelle. Vous vous plaignez de l’absence? Que devrais-je dire, moi, si j’osais me plaindre, privée de tous ceux qui me sont chers? Ah! Si nous n’avions pas la religion pour nous consoler, la vie serait bien triste! Pourquoi me supposez-vous un regard sévère, quand vous me parlez de votre affection pour ce jeune homme? Sous ce rapport, je ne suis rigide que pour moi. Je comprends ces sentiments chez les autres, et si je ne puis les approuver, ne les ayant jamais ressentis je ne les condamne pas. Il me paraît seulement que l’amour chrétien, l’amour du prochain, l’amour pour ses ennemis est plus méritoire, plus doux que ne le sont les sentiments que peuvent inspirer les beaux yeux d’un jeune homme à une jeune fille poétique et aimante comme vous. La nouvelle de la mort du comte Besoukhow nous est parvenue avant votre lettre, et mon père en a été très affecté. Il dit que c’est l’avant-dernier représentant du grand siècle, et qu’à présent c’est son tour mais qu’il fera son possible pour que son tour vienne le plus tard possible. Que Dieu nous garde de ce terrible malheur! Je ne puis partager votre opinion sur Pierre, que j’ai connu enfant. Il m’a toujours paru avoir un cœur excellent, et c’est là la qualité que j’estime le plus. Quant à son héritage et au rôle qu’y a joué le prince Basile, c’est bien triste pour tous les deux! Ah! Chère amie, la parole de notre divin Sauveur, «qu’il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu,» cette parole est terriblement vraie! Je plains le prince Basile et je plains encore davantage le sort de M. Pierre. Si jeune et accablé de ses richesses, que de tentations n’aura-t-il pas à subir! Si l’on me demandait ce que je désirerais le plus au monde, ce serait d’être plus pauvre que le plus pauvre des mendiants. Mille grâces, chère amie, pour l’ouvrage que vous m’avez envoyé et qui fait si grande fureur chez vous!
«Cependant, puisque vous me dites qu’au milieu de plusieurs bonnes choses il y en a d’autres que la faible conception humaine ne peut atteindre, il me paraît assez inutile de s’occuper d’une lecture inintelligible, qui par là même ne pourrait être d’aucun fruit. Je n’ai jamais pu comprendre la rage qu’ont certaines personnes de s’embrouiller l’entendement en s’attachant à des livres mystiques qui n’élèvent que des doutes dans leurs esprits, en exaltant leur imagination et en leur donnant un caractère d’exagération tout à fait contraire à la simplicité chrétienne. Lisons les Apôtres et les Évangiles. Ne cherchons pas à pénétrer ce que ceux-là renferment de mystérieux, car comment oserions-nous, misérables pécheurs que nous sommes, prétendre à nous initier dans les secrets terribles et sacrés de la Providence, tant que nous portons cette dépouille charnelle, qui élève entre nous et l’Éternel un voile impénétrable? Bornons-nous donc à étudier les principes sublimes que notre divin Sauveur nous a laissés pour notre conduite ici-bas; cherchons à nous y conformer et à les suivre; persuadons-nous que moins nous donnons d’essor à notre faible esprit humain, plus il est agréable à Dieu, qui rejette toute science ne venant pas de lui; que moins nous cherchons à approfondir ce qu’il lui a plu de dérober à notre connaissance, plus tôt il nous en accordera la découverte par son divin esprit. Mon père ne m’a pas parlé du prétendant, mais il m’a dit seulement qu’il a reçu une lettre et attend une visite du prince Basile. Quant au projet de mariage qui me regarde, je vous dirai, chère et excellente amie, que le mariage, selon moi, est une institution divine à laquelle il faut se conformer. Quelque pénible que cela soit pour moi, si le Tout-Puissant m’impose jamais les devoirs d’épouse et de mère, je tâcherai de les remplir aussi fidèlement que je le pourrai, sans m’inquiéter de l’examen de mes sentiments à l’égard de celui qu’il me donnera pour époux. J’ai reçu une lettre de mon frère qui m’annonce son arrivée à Lissy-Gory avec sa femme. Ce sera une joie de courte durée, puisqu’il nous quitte pour prendre part à cette malheureuse guerre, à laquelle nous sommes entraînés, Dieu sait comment et pourquoi. Non seulement chez vous, au centre des affaires et du monde, on ne parle que de guerre, mais ici au milieu des travaux champêtres et de ce calme de la nature que les citadins se représentent à la campagne, les bruits de la guerre se font entendre et sentir péniblement. Mon père ne parle que de marches et de contremarches, choses auxquelles je ne comprends rien, et avant-hier, en faisant ma promenade habituelle dans la rue du village, je vis quelque chose qui me déchira le cœur: c’était un convoi de recrues enrôlées chez nous et expédiées pour l’armée! Il fallait voir l’état où se trouvaient les mères, les femmes et les enfants des hommes qui partaient! Il fallait entendre les sanglots des uns et des autres! On dirait que l’humanité a oublié les lois de son divin Sauveur, qui prêchait l’amour et le pardon des offenses, et qu’elle fait consister son plus grand mérite dans l’art de s’entre-tuer.
«Adieu, chère et bonne amie. Que notre divin Sauveur et sa très sainte Mère vous aient en leur sainte et puissante garde!
«Marie9.»
«Ah! Princesse, vous expédiez votre courrier; j’ai déjà écrit à ma pauvre mère,» s’écria en grasseyant MlleBourrienne d’une voix pleine et sympathique.
Sa personne vive et légère contrastait singulièrement avec l’atmosphère sombre, solitaire et mélancolique qui entourait la princesse Marie.
«Il faut que je vous prévienne, princesse, ajouta-t-elle plus bas: le prince a eu une altercation avec Michel Ivanow; il est de très mauvaise humeur, – et s’écoutant grasseyer avec plaisir, – très morose… Tenez-vous donc sur vos gardes… vous savez…
— Ah! Chère amie, je vous ai priée de ne jamais me parler de la mauvaise humeur de mon père; je ne me permets pas de le juger, et je tiens à ce que les autres fassent comme moi,» répondit la princesse Marie en regardant à sa montre.
Et, remarquant avec effroi qu’elle était en retard de cinq minutes sur l’heure qu’elle était obligée de consacrer à son piano, elle se dirigea vers la grande salle. Pendant que le prince se reposait, de midi à deux heures, sa fille devait exercer ses doigts: ainsi le voulait la règle immuable de la maison.