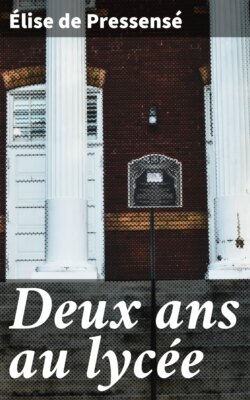Читать книгу Deux ans au lycée - Élise de Pressensé - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
COMMENT ON DEVIENT AMIS.
ОглавлениеTable des matières
On était aux premiers jours d’octobre. Les coliers, déshabitués du travail par quelques semaines de liberté, sortaient en troupe bruyante u lycée où ils venaient d’être enfermés pendant eux mortelles heures et se formaient en groupes apageurs ou s’éloignaient en longues bandes, maintenues dans l’ordre par la présence du maître ’études. Celui qui parut le dernier de tous au aut des marches s’arrêta pour regarder autour le lui, puis descendit lentement et s’éloigna ans être abordé par aucun de ses camarades.
Evidemment, il était nouveau venu et ne conlaissait personne dans ce petit monde où il ne s’éait pas encore fait une place et où, sans doute, il se sentait bien seul. Il marchait la tête baissée, absorbé dans ses réflexions, et ne s’apercevait pas qu’il était l’objet de l’attention et des remarques de trois jeunes garçons qui suivaient la même direction que lui sur le trottoir opposé.
–Je vous dis que sa maman l’a accompagné ce matin et hier aussi jusqu’au coin de la rue Caumartin, disait l’un d’eux, n’est-ce pas vrai, Lucien?
–Oui, répondit Lucien qui avait les cheveux rouges et l’air lourdaud, oui, je l’ai vue de mes propres yeux, et elle est restée au coin de la rue à le regarder jusqu’à ce qu’il fût entré.
–Pas possible! dit avec nonchalance le plus grand des lycéens qui dépassait les deux autres de toute la tête et marchait près d’eux d’un air moitié dédaigneux, moitié protecteur.
–Il faut que ce soit un fameux niais, ajouta le premier interlocuteur.
–Eh bien, je me charge de le déniaiser, reprit le grand, nous allons commencer son éducation à l’instant même. Vous verrez comment je m’y prendrai.
Alors, traversant la rue et abordant le petit étranger avec toutes sortes de démonstrations de politesse:
–Mademoiselle, dit-il, comment se fait-il que, contre vos habitudes, vous vous aventuriez seule dans la rue? Permettez-moi de vous offrir ma protection et de vous accompagner jusqu’à votre porte.
Le jeune garçon rougit jusqu’aux oreilles en se voyant apostrophé de cette manière et voulut hâter le pas sans répondre, mais on ne le lui permit pas; on le retint, on l’entoura, on l’accabla de plaisanteries plus ou moins fines, jusqu’au moment où, sentant qu’il allait avoir des larmes dans les yeux s’il ne laissait pas un libre cours à son indignation, il s’arrêta et jeta bravement à la face de l’ennemi ces deux mots vigoureux:
–C’est lâche!
–Oh! oh! dit le plus grand des persécuteurs, voilà un bien gros mot. Sans les égards qui vous sont dus, Mademoiselle, je ne le supporterais pas. Qu’est-ce qu’il y a de lâche à vous offrir ma protection?
–Oui, c’est lâche, parce que vous voyez bien que je suis étranger, que je ne connais personne et que vous vous mettez trois contre un. Vous vous moquez de moi parce que ma mère m’a accompagné. Je n’en ai pas honte, moi, mais j’aurais honte de faire ce que vous faites.
A ce discours véhément, le gamin aux cheveux rouges et son camarade commencèrent à ricaner de plus belle, mais leur chef leur imposa silence.
–Bien dit, mon petit lion,–et en parlant il posa sa main sur l’épaule du jeune garçon qui se taisait, tout surpris lui-même de sa sortie, et qui tremblait encore de tous ses membres du conflit de ses émotions.–J’aime ça. Il faut avoir bec et ongles dans le monde où nous vivons; je vois qu’il y aura moyen de s’entendre avec vous. Allons, vous autres, passez votre chemin et laissez-nous tranquilles. Voilà l’autre trottoir là-bas où vous pourrez ricaner tout à l’aise sans que je sois tenté de vous tirer les oreilles.
–C’est un peu fort ça, dit la tête rouge, c’est lui qui commence le jeu et puis tout à coup il lui prend fantaisie de nous traiter comme des chiens.
–Oui, comme des chiens, grommela l’autre.
–Vous avez dit le mot, mes roquets; allez, et tâchez de ne pas japper sur mes talons ni sur ceux de mes amis.
–C’est bien, Raoul, nous nous en souviendrons, dirent les deux gamins en s’éloignant.
–A votre aise, je suis enchanté que vous ayez bonne mémoire, leur cria Raoul; puis se retournant vers son nouveau compagnon, il déclama:
–Soyons amis, Cinna, c’est moi qui t’en convie!
–Mais, dit le jeune garçon, c’est un peu vite.
–Bah! est-ce que vous seriez rancunier, par hasard? Voyez quel bel exemple je vous donne: je vous pardonne les injures que vous m’avez dites, et ce qui est bien plus difficile, toutes les sottes plaisanteries que je vous ai faites. On ne peut rien demander de plus. Quel âge avez-vous?
–Bientôt quatorze ans.
–Votre nom?
–Je m’appelle Gabriel.
–Un nom d’ange, je vous plains. Gabriel tout court?
–Sorbier.
–Un nom d’arbre, c’est moins compromettant. Gabriel Sorbier. Et vous vénez des champs?
–Je viens de la campagne. Comment le savez-vous?
–Cela se devine tout de suite. Si ce, n’était un plagiat je vous appellerais Pâquerette; vous avez la fraîcheur et la simplicité de cette fleur champêtre entre toutes. Mais votre biographie, que vous vous faites arracher brin à brin, est bien succincte. Depuis combien de temps êtes-vous à Paris?
–Depuis quinze jours.
–En pension?
–Non, avec ma mère.
–Ah! c’est vrai, j’oubliais. Et votre mère vous accompagne au lycée?
Gabriel rougit et jeta un regard de reproche sur le questionneur.
–Ma mère est veuve, dit-il, elle n’a que moi. Elle est seule ici et ne connaît personne.
Il se tut. Raoul regarda les vêtements noirs de son nouvel ami et comme au fond, malgré sa légèreté, il avait du cœur, il se promit de ne plus plaisanter sur ce sujet.
–Eh bien! reprit-il, moi je vais vous faire mon historique sans qu’il soit nécessaire de me tant prier. Je me nomme Raoul Landel, je suis Parisien pur sang, j’ai seize ans et je commence ma seconde. Si vous vous adressez à mes professeurs pour avoir des renseignements sur moi, il est probable qu’ils ne vous donneront pas une haute idée de mon mérite. Mon père n’a pas le fétichisme des bonnes places et du livre d’honneur. Rien ne lui paraît plus ridicule que la pédanterie des professeurs, et la niaiserie des parents qui croient que leur fils sera un grand homme parce qu’il est premier ou second sur cinquante imbéciles. Il dit qu’il y a cent à parier contre un qu’un bon élève ne sera qu’un cuistre. Mon père a des doctrines bien arrêtées, vous voyez, et moi je suis trop soumis pour ne pas les mettre en pratique. Ce qui est assez curieux, c’est que sa manière d’agir n’est pas toujours d’accord avec ses théories. Cette année, par exemple, il voulait me retrancher mon voyage de vacances parce que je n’avais pas eu de prix. Sans ma mère il aurait peut-être tenu bon. Quelquefois aussi il menace de ne pas me donner mon argent de semaine quand je ne suis pas dans les premiers, et quand je réponds que je ne veux pas devenir un cuistre, il se met dans de roides colères. Alors ma mère vient en cachette me donner de son argent, et comme mon père oublie souvent d’exécuter sa menace, je me trouve riche au double. J’ai cinq francs par semaine, sans parler de ces bonnes chances-là, mais l’année prochaine j’aurai une pension trimestrielle. Combien avez-vous?
–Dix sous par semaine, répondit innocemment Gabriel.
–Et que faites-vous de cela? demanda Raoul en se mordant les lèvres pour ne pas rire.
–J’achète mes plumes et je mets le reste de côté pour mes cadeaux.
–0vertu! s’écria Raoul en prenant une pose comique, qui a pu dire que tu n’es qu’un nom? C’est un païen, très-certainement, un vieux mécréant de païen. Mais moi, je pourrai affirmer que je l’ai vue, la vertu, que je l’ai contemplée de mes yeux, sous les traits. d’une simple fleur des champs.
–Je n’ai pas honte de ce que ma mère n’est pas riche, dit Gabriel, qui dompta une forte envie de se mettre en colère avant de pouvoir prononcer ces paroles.
–Il n’a honte de rien, il n’a peur de rien, c’est un héros! s’écria Raoul, toujours du même ton d’emphase comique.
Gabriel, vraiment fâché de cette persistance de plaisanterie, détourna la tête et fit quelques pas en regardant droit devant lui d’un air un peu offensé.
–Voyons, mon camarade, reprit Raoul d’un ton plus simple, ne vous formalisez pas de ce que je plaisante. Je m’égaye un peu en plein air, parce que je sais qu’une fois rentré à la maison, je vais être triste comme un bonnet de nuit.
–Et pourquoi donc?
–Est-ce que je sais? c’est toujours comme ça. Je m’y ennuie; ma mère se lève tard et sort toute l’après-midi; mon père est toujours à son bureau. Quand j’aurai fait mon devoir, je flânerai un peu, je lirai le journal; ça n’est pas bien gai.
–Vous n’avez ni frère ni sœur? demanda Gabriel.
–J’ai une sœur, mais elle ne sort pas de sa chambre jusqu’au soir. On la porte au salon quand il n’y a pas de visites et qu’elle n’est pas trop souffrante.
–Elle est donc bien malade?
–Non. oui. Je ne sais pas trop ce qu’elle a; je l’ai toujours vue ainsi. Mais voici notre maison, ajouta-t-il en s’arrêtant devant un petit hôtel dont la façade élégante était précédée d’une cour. Où demeurez-vous? si ce n’est pas trop loin, j’irai vous accompagner.
C’était dans une des rues les plus rapprochées, une petite rue silencieuse et paisible, au cinquième étage d’une maison de modeste apparence. Arrivé là, Raoul dit adieu à son nouvel ami, en lui recommandant de prendre le même chemin pour retourner au lycée, et de l’attendre un moment devant la porte de l’hôtel, s’il ne le trouvait pas sur le trottoir.
Gabriel monta les cinq étages un peu étourdi de tout ce qu’il avait vu et entendu pendant les vingt minutes qui venaient de s’écouler. Raoul l’attirait et lui déplaisait en même temps. Son sourire était franc; ses grands yeux bruns semblaient dire des choses meilleures que celles qui sortaient de ses lèvres. Gabriel, qui n’avait jamais eu pour camarades que de petits paysans sans instruction, subissait le charme de son langage facile et de ses manières aisées. Mais ce ton de perpétuelle plaisanterie lui semblait fatigant et irritant, accompagné, comme il l’était, d’un petit air de supériorité qui n’avait rien de bien agréable. Raoul, il est vrai, était plus grand que lui de toute la tête; mais cela ne suffisait pas pour l’autoriser à prendre des airs de protecteur avec le jeune provincial. Arrivé à la dernière marche du cinquième étage, celui-ci conclut qu’il ne fallait pas supporter cette façon d’agir, et, sur cette ferme résolution, sonna vigoureusement. Sa mère elle-même vint lui ouvrir.
–Eh bien, dit-elle en jetant un regard sur sa figure qui portait les traces de ses pensées, qu’est-ce qui te donne l’air si martial? On dirait que tu vas me prendre d’assaut.
–Non, maman, je n’ai point d’intention hostile contre toi, répondit-il en laissant sa physionomie s’adoucir. Je vais vite travailler, et pendant que nous dînerons, je te raconterai tout ce qui m’est arrivé.
–Tout ce qui t’est arrivé!. Il me faut de la patience pour attendre jusque-là.
–Oh! c’est peu de chose, à tout prendre. Je connais maintenant un de mes camarades, voilà tout. Mais il ne faut pas que je m’arrête; j’ai un long devoir, et je voudrais faire honneur.
Il s’arrêta; mais sa mère acheva la phrase:
–A ton père, à ton seul précepteur. Ah! tu le lui dois, mon enfant. Quelle peine ne s’est-il pas donnée pour t’enseigner, et avec quelle joie il le faisait, même après les plus grandes fatigues. Jamais, sous aucun prétexte, il ne négligeait une leçon ou ne la remettait au lendemain. Quand je lui demandais de le faire, il me répondait: «Comment pourrais-je inculquer à Gabriel le sentiment de son devoir, si je manque au mien?» Mais va, mon cher garçon, je ne veux pas te retenir.
–Ne pleure pas, chère maman, dit-il en embrassant sa mère, je n’oublierai jamais tout cela.
Madame Sorbier suivit des yeux son fils jusqu’à ce que la porte de sa petite chambre se fût refermée sur lui; puis, malgré sa prière, elle s’assit, cacha sa figure dans ses mains et pleura quelques moments en silence. Le peu de mots qu’elle venait d’échanger avec lui avaient réveillé en elle tout un essaim de tristes pensées, et les souvenirs du passé assaillaient son cœur comme la marée envahit le rivage. Ils étaient bien beaux et bien doux, ces souvenirs, et ils faisaient avec le présent un contraste bien douloureux. Pendant quinze ans, la vie de Madame Sorbier avait été calme et heureuse. C’était une vie de devoirs, d’affections, de joies simples et profondes. Son mari exerçait la profession de médecin dans la campagne, et n’avait jamais rien désiré au delà de cette sphère modeste où il trouvait l’emploi de toutes ses forces, et où son influence était plus grande et plus utile qu’elle n’eût pu l’être ailleurs. Il n’était pas seulement le médecin, il était aussi le conseiller et l’ami des paysans; il travaillait à les guérir de leurs préjugés et de leurs superstitions, et comme sa profession lui donnait accès dans toutes les familles, il se trouvait admirablement placé pour connaître leurs idées fausses et pour les combattre. Il leur apprenait à voir dans la religion, non pas un tissu de formes grossières qui ne correspondent à rien de vrai, mais une relation entre l’homme et Dieu dont l’influence doit se retrouver dans tous les actes de la vie. Si M. Sorbier agissait beaucoup au dehors, il ne négligeait pas pour cela les devoirs plus prochains. C’était lui qui faisait toute l’éducation de son fils; il le développait sans cesse par ses entretiens, et il l’instruisait par des leçons spéciales qui étaient un plaisir pour le professeur comme pour l’élève. Il exigeait beaucoup de régularité et de conscience dans le travail, mais en même temps il laissait aux facultés leur libre jeu, et permettait des essais, des innovations, des infractions à la coutume, pourvu qu’elles eussent leur raison d’être. Cette méthode d’éducation n’avait pas fait de Gabriel un prodige; il n’avait pas l’esprit brillant, et se distinguait plutôt par l’harmonie de ses facultés que par une supériorité quelconque; mais il était plus développé d’une manière générale qu’on ne l’est d’ordinaire à quatorze ans. Sa raison et son cœur s’étaient élargis ensemble; ce qui lui manquait, c’était la vie commune avec d’autres enfants de son âge. Il ne savait rien de leurs coutumes, rien de leur langage, ni de leurs rapports les uns avec les autres. Le monde dans lequel il venait d’entrer lui était absolument étranger; c’était là ce qui effrayait sa mère et lui serrait le cœur, quand elle pensait aux tentations inconnues qu’il allait rencontrer.
Quelques mois auparavant, M. Sorbier était mort subitement, jeune encore, et sans avoir pu donner à sa femme aucune direction pour l’éducation de son fils. N’ayant pas de liens de famille très-étroits, elle s’était décidée à venir avec celui-ci s’établir à Paris, où il pouvait faire toutes ses études sans la quitter. A la campagne, Madame Sorbier aurait pu vivre dans l’aisance; mais à Paris, il fallut se réduire à la plus stricte économie. Elle loua un très-petit appartement, prit une femme de ménage pour quelques heures de la journée, et commença courageusement une vie de solitude et de travail. Sous un extérieur simple et doux, elle avait beaucoup de fermeté et de courage; son bonheur passé, loin de l’amollir, l’avait fortifiée, et, comme au milieu du calme et des douceurs de sa vie d’autrefois elle n’avait jamais vécu pour elle-même, le dévouement lui était familier comme il ne l’est pas toujours aux personnes qui ont marché dans des sentiers faciles.
La mère et le fils se retrouvèrent au dîner. L’heure de midi était restée pour eux celle du repas principal de la journée; le soir, Madame Sorbier en préparait elle-même un plus léger.
–Eh bien, dit-elle, tu m’as promis de me raconter tes aventures.
Gabriel avait oublié qu’il ne pouvait le faire sans dire ce qui lui avait attiré les méchantes plaisanteries de ses camarades. Il resta donc un peu interdit, craignant d’attrister sa mère en lui disant que c’était à cause d’elle qu’on s’était moqué de lui. Elle le regardait avec inquiétude, il n’y avait plus moyen de reculer, et il fit son récit en passant le plus légèrement possible sur l’origine de cette rencontre. Le cœur de Madame Sorbier se serra encore en l’entendant. Elle ne pourrait donc plus même s’accorder la douceur de suivre son enfant sans l’exposer aux railleries de cette jeunesse impitoyable. Qu’étaient devenues les longues promenades dans les bois, la vie commune à tous les instants du jour? Ah! qu’elle lui semblait déjà loin d’elle, cette belle et douce vie, belle même depuis que la mort l’avait brisée et assombrie, car son fils était encore tout à elle!
–Ce grand garçon ne me plaît pas beaucoup, dit-elle d’un air pensif; ne te laisse pas entraîner à trop d’intimité, Gabriel, crois-moi. Ne te livre pas avant de le connaître mieux.
–Je voudrais l’amener ici une fois, dit Gabriel; je serais étonné si sa figure ne te plaisait pas.
–Comme tu voudras, mon enfant. Mais tu sais que ses parents pourraient ne pas désirer qu’une camaraderie de collége prît un caractère plus sérieux. Notre position est sans doute bien différente de la leur.
–Qu’est-ce que cela peut faire? En tout cas, lui et moi nous recevons la même éducation.
–L’éducation n’est pas tout, ni pour rapprocher ni pour séparer. Avec une instruction égale, les habitudes peuvent être absolument différentes; les nôtres doivent l’être beaucoup de celles des habitants de cette grande ville.
–De cette grande prison, dit Gabriel en soupirant.
Et il s’approcha de la fenêtre, qui ne lui offrait qu’une vaste perspective de toits et les sommets de quelques arbres déjà dépouillés. Madame Sorbier ne répondit pas. Elle se sentait trop bien d’accord avec ce soupir et cette parole.