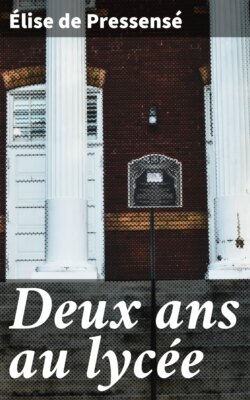Читать книгу Deux ans au lycée - Élise de Pressensé - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
DEUX MISÈRES.
ОглавлениеTable des matières
–Où vas-tu, maman? demanda Gabriel avec une nuance d’inquiétude en voyant, ce matin-là, sa mère mettre son chapeau pendant que lui-même préparait ses livres.
–Ne crains rien, répondit Madame Sorbier, je ne veux pas t’exposer inutilement aux railleries de tes camarades; mais je voudrais être bien sûre que tu saurais les supporter s’il y avait un devoir à remplir.
Gabriel rougit et répondit en embrassant sa mère:
–Je veux savoir les supporter pour ne pas me priver d’un plaisir. Maman, viens avec moi, je t’en prie.
Madame Sorbier le regarda avec un doux sourire.
–Non, mon cher enfant, je ne puis aller avec toi. Je vais voir une pauvre petite fille malade, dont Rose, notre femme de ménage, m’a parlé. Cette enfant lui est confiée par sa mère, qui est en service; elle est malade depuis quelques jours, et hier, en rentrant chez elle, Rose l’a trouvée sans connaissance. La pauvre mère y a passé la nuit; mais ce matin, elle a dû retourner dans la maison où elle sert, et Rose a laissé la petite seule avec sa vieille mère pour venir ici. Je lui ai promis d’aller la soigner pour qu’elle puisse être tranquille.
Ils sortirent ensemble et se séparèrent aussitôt. Gabriel prit le chemin sur lequel il devait rencontrer son nouvel ami. Madame Sorbier, à travers des rues inconnues, se dirigea vers la demeure de la pauvre femme de ménage. Elle se sentait le cœur plus au large qu’elle ne l’avait eu depuis longtemps. C’était la première fois, depuis son arrivée à Paris, qu’elle avait l’occasion de faire quelque bien à son prochain. Accoutumée à regarder ceux qui l’entouraient comme des frères, elle avait souffert de cette inaction. Le petit incident de la veille lui avait causé un peu de peine, mais il avait eu pour résultat une plus complète abnégation d’elle-même; elle remettait son fils avec un plus entier abandon entre les mains de Dieu, se disant que ce qu’il garde est bien gardé.
Madame Sorbier suivait donc d’un pas rapide les rues écartées que Rose lui avait indiquées. Elle trouva la maison, puis, ayant reçu les directions les plus minutieuses, elle passa sans s’arrêter devant la loge, qui était vide, monta six étages, et, arrivée tout au fond d’un long corridor, elle frappa à une porte numérotée.
–Entrez! dit une voix cassée.
Elle tourna la clef et entra.
C’était une grande chambre à peine meublée, mais propre. Une vieille femme accroupie devant un petit fourneau de fonte allumait un peu de feu pour faire bouillir son lait. Elle fit, pour se lever, un effort qui lui arracha un gémissement.
–Ne bougez pas, lui dit Madame Sorbier, je viens de la part de Rose, votre fille.
–Oui, Rose est ma fille, dit la vieille d’une voix grondeuse en reprenant sa besogne. C’est bien malheureux qu’elle me laisse comme ça pour aller servir le monde. A mon âge, on est mieux dans un fauteuil qu’à genoux sur le carreau. J’ai les membres tout perclus de rhumatismes. Ça n’est pas gai.
Madame Sorbier s’approcha du lit de l’enfant malade, devinant bien que c’était la mère qu’elle voyait agenouillée près d’elle, si pâle et si absorbée. La pauvre petite créature était toujours roide et immobile. On avait coupé ses cheveux blonds qui, depuis la veille, étaient restés oubliés sur le rebord intérieur de la fenêtre. Susanne renouvelait sans cesse des compresses sur le front et aux poignets de l’enfant, et la regardait avec une expression de si intime douleur, qu’il était impossible de n’avoir pas le cœur ému.
–Dieu peut encore vous la rendre, lui dit Madame Sorbier de sa voix sympathique.
Susanne leva sur elle un regard où il n’y avait ni révolte ni amertume.
–J’en ai perdu trois de cette maladie, dit-elle.
Et elle baisa la petite main froide qui ne pouvait plus lui rendre caresse pour caresse.
–Vous êtes épuisée, dit Madame Sorbier en regardant les traits décomposés de la pauvre femme, laissez-moi prendre votre place un instant. Mettez-vous sur le lit et tâchez de fermer les yeux. Il n’y a rien à faire que ce que vous faites en ce moment, n’est-ce pas?
Susanne hésita. Il lui paraissait impossible de confier sa petite mourante à une étrangère, même en restant si près. Mais un regard jeté sur la douce et sérieuse figure de Madame Sorbier transforma cette impression en un sentiment tout contraire: il lui sembla que son enfant serait mieux soignée que par elle-même. Elle s’étendit donc sur le lit de Rose, le visage tourné vers le coin de la chambre où elle voyait la petite figure pareille déjà à celle d’une morte, et se sentit calmée et soulagée par la présence de cette inconnue. Pendant ce temps, la vieille femme s’agitait et continuait à grommeler ses plaintes, qui se terminaient invariablement par ces mots: «Ça n’est pas gai.» Elle laissait choir tantôt une chose tantôt l’autre et s’en prenait aux objets eux-mêmes de la maladresse de ses pauvres mains tremblantes.
–Je crois qu’il faudrait beaucoup de tranquillité autour de l’enfant, dit Madame Sorbier en se tournant vers elle, après un cataclysme plus bruyant que les autres qui lui avait semblé provoquer un léger tressaillement nerveux dans les traits de la petite malade.
Bien qu’elle eût parlé de sa voix la plus douce, cette suggestion ne fut pas bien reçue.
–Je suis chez moi, dit la vieille en élevant la voix; je ne sais pas pourquoi des étrangers viendraient me donner des leçons. Je ne comprends pas ma fille de m’exposer à être traitée ainsi. C’est déjà bien assez ennuyeux d’avoir dans sa chambre un enfant malade, et tout ce tracas, et toutes ces histoires qui ne vous regardent pas. Au moins faut-il être libre de se faire une pauvre tasse de café, quand on n’a pas fermé l’œil de la nuit.
Madame Sorbier regarda la mère de Lisa. Elle ne paraissait pas avoir entendu ce monologue peu gracieux; cependant, ses yeux étaient ouverts et toujours attachés sur le lit. Sans doute elle était accoutumée à l’humeur maussade de la vieille femme.
–Je voudrais m’en aller, puisque vous le désirez, dit Madame Sorbier, se rapprochant un peu de celle-ci pour se faire entendre sans élever la voix; mais voyez, la pauvre mère se repose un peu, et vous-même vous serez plus libre de faire votre petit ménage pendant que je resterai près de l’enfant. Je n’ai aucune intention de vous fâcher; mais mon mari était médecin et recommandait toujours beaucoup de silence pour cette maladie.
A partir de ce moment, on eût dit que la chute tapageuse des pincettes devenait moins fréquente.
Les heures s’écoulaient, et Madame Sorbier restait toujours. Elle espérait assister à un changement dans l’état de l’enfant, mais aucun ne se faisait pressentir. Susanne s’était levée sans que le sommeil eût pu fermer ses yeux un seul instant, et était revenue à son poste. Madame Sorbier et elle échangèrent quelques mots à voix basse. La pauvre mère recevait les paroles de consolation, et refusait celles d’espoir. «J’en ai perdu trois de cette maladie,» répétait-elle. Tout à coup ses larmes, que jusqu’alors elle avait retenues, coulèrent à flots. Elle cacha sa figure dans ses mains.
–Ah! dit-elle, je vais perdre mon enfant; j’en ai un autre qui est pour moi comme s’il ne m’appartenait pas, et celle qui aurait pleuré avec moi, ma chère, ma douce Mademoiselle Hélène, je ne la verrai plus.
Elle raconta en quelques mots le malheur qui était venu se joindre à son angoisse.
–Mais ne pouvez-vous expliquer ce qui s’est passé, dit Madame Sorbier, écrire une lettre?. Sans doute on ne voudrait pas persister dans une injustice, une fois qu’elle serait reconnue.
–Monsieur est si absolu, dit la pauvre femme d’un ton découragé; je ne crois pas qu’il revienne jamais sur une décision prise. Oh! si ce n’était que Mademoiselle Hélène m’aime et a besoin de moi, je ne m’inquiéterais pas d’avoir perdu ma place; je n’aurais qu’une seule pensée.
Elle se pencha vers l’enfant, et baisa encore la petite main glacée en murmurant: Pauvre agneau! cherpetit ange! comme pour lui demander pardon le s’être occupée d’antre chose que d’elle seule. Pendant ce temps, Gabriel avait attendu un moment devant la porte de Raoul; puis, craignant d’être en retard, il s’était remis rapidement eu marche. Mais à peine était-il au bout de la seconde rue qu’un pas pressé et un coup de sifflet derrière lui l’avertirent de s’arrêter.
–Eh bien! dit Raoul en s’arrêtant, et nos conventions?
–Elles ne m’engageaient pas à manquer l’heure de la classe par dévouement d’amitié, dit Gabriel en riant.
–Manquer l’heure de la classe! répéta Raoul de son ton railleur; non, non, je n’attends pas de vous de pareils sacrifices. Mais je vous ferai observer qu’il est huit heures moins douze minutes, et que par conséquent nous avons une fois et demie le temps de nous y rendre, sans nous presser plus que de raison. J’aurais dû deviner que la peur d’être en retard était encore une de vos vertus.
Malgré son ton léger, Raoul n’avait pas d’entrain ce matin-là. Il marchait la tête basse, sans parler, les yeux fixés sur la terre.
–Pourquoi m’avez-vous évité hier soir? demanda-t-il enfin; vous avez filé si vite que je ne vous ai pas vu.
–J’étais pressé de retourner à la maison.
–Qu’avez-vous donc tant à faire à la maison?
–Mais rien de particulier. Quand j’ai fini mes devoirs, ma mère et moi, nous lisons ou nous causons ensemble.
–Et vous aimez ça?
–C’est ce que j’aime le mieux, causer surtout. Nous avons toujours cent choses à nous dire. Ma mère s’intéresse à tout ce que je fais et à tout ce que je pense.
–Eh bien, moi, quand je retourne à la maison, il est rare que je ne m’ennuie pas à périr. Hier, il y a pourtant eu chez nous deux événements: d’abord un dîner qui a duré deux mortelles heures; puis ma sœur a jugé à propos de se trouver mal toute seule dans sa chambre, et de mettre toute la maison en émoi.
–Cela a dû vous désennuyer un peu, dit Gabriel.
–Bravo! l’enfant se forme; il devient caustique! s’écria Raoul avec une gaieté forcée.
Mais il ajouta d’un ton plus naturel et un peu triste:
–Eh bien, le fait est qu’il y avait de ma faute dans tout cela, et que je voudrais n’avoir pas été si égoïste.
Un regard interrogateur de Gabriel fut sa seule réponse à ce demi-aveu. Raoul raconta en peu de mots ce qui s’était passé, et ajouta:
–Vous seriez meilleur que moi, n’est-ce pas? Si vous aviez une sœur malade, vous ne l’oublieriez pas ainsi?
–Je ne sais pas, mais je vous trouve bien heureux d’avoir une sœur.
Les deux jeunes gens achevèrent la route en silence. Comme ils se rejoignaient après la classe, les regards de Gabriel furent attirés par un jeune garçon qui, appuyé contre le mur de l’une des maisons faisant face au lycée, suivait d’un œil moitié curieux, moitié malveillant, les écoliers s’en allant un à un, ou par groupes, leurs livres sous le bras. Le pauvre enfant était mal vêtu, mal peigné; sa figure pâle et chétive n’avait rien de bien attrayant. Cependant Gabriel ne pouvait le quitter des yeux.
–Que regardez-vous donc? demanda Raoul.
–Voyez-vous ce garçon là-bas qui regarde passer les élèves? Je voudrais lui parler.
–Lui parler! quelle absurde idée! Est-ce votre habitude d’entrer en conversation avec les mendiants que vous rencontrez dans la rue?
–Ce n’est pas un mendiant. Comme il a l’air triste!
–Il a l’air sale surtout.
–Je crois que nous lui faisons envie.
–Des lycéens faire envie à un gamin des rues! quelle idée romanesque! Vous ne savez donc pas que nous sommes des parias. Personne au monde ne vous portera envie, tant que vous serez sous la férule. Est-ce que vous trouvez vous-même ce régime de travail forcé bien agréable?
–Je n’y suis pas depuis longtemps, et vraiment, jusqu’ici, je ne me trouve pas bien à plaindre. Attendez moi, je veux dire un mot à ce garçon.
Mais Raoul le retint; et pendant que Gabriel s’efforçait de secouer son étreinte, le pauvre enfant s’éloignait d’un pas lent et morne dans la direction opposée.
–Qu’est-ce que vous lui trouvez donc de si séduisant? demanda Raoul en lâchant Gabriel, quand il fut sûr qu’il avait renoncé à Je suivre. Il est fort laid à voir, l’air maussade, refrogué. Je ne comprends pas ce qui a pu vous charmer en lui.
–Il a l’air malheureux, plutôt que maussade. Je suis sûr qu’il ne sait pas lire.
–C’est très-probable.
–Et qu’il voudrait apprendre.,
–Eh bien, qu’il aille à l’école! Vous n’avez pas l’intention de vous charger de son éducation, je pense?
–Je l’ai vu déjà plusieurs fois à la même place, quand nous sortons.
–Il a peut-être dessein de faire quelque mauvais coup. Mon père dit qu’il faut se défier des gens mal vêtus, et passer le plus loin d’eux possible, quand ce ne serait que pour ne pas se salir.
–Ma mère ne me parle pas ainsi, dit Gabriel avec indignation; elle ne me donne pas l’exemple de se tenir le plus loin possible de ceux qui peuvent avoir besoin d’elle.
–Oh! les femmes sont si chimériques. Elles font du sentiment à propos de tout. Ma mère, à moi, se morfond de tendresse pour un vilain petit chien à longs poils que je pince toutes les fois que je le puis. Le drôle crie comme si on l’écorchait, et m’attire de salutaires réprimandes; mais quand je devrais être grondé pendant vingt-quatre heures consécutives, je ne me priverais pas du plaisir de pincer Love, lorsque sa petite personne dodue se trouve sur mon chemin, et qu’il me regarde avec son air hargneux et suffisant. Tenez, il ressemble vraiment à votre protégé de tout à l’heure. Il a l’air rébarbatif comme lui; mais il est plus propre, il faut en convenir.
Gabriel se détourna avec impatience. Raoul, en ce moment, lui était antipathique.
Comment se fit-il que l’image du jeune garçon déguenillé lui revint tout le jour avec tant de persistance? Il croyait sans cesse voir sa figure pâle et ses yeux ardents fixés sur les lycéens qui passaient sans le regarder, ou ne le remarquaient que pour s’éloigner instinctivement, afin de ne pas le toucher. Il ne manque certainement pas d’enfants sales et ignorants dans les rues; pourquoi celui-ci ne se laissait-il pas oublier?
Madame Sorbier s’aperçut de la préoccupation de son fils et lui en demanda la cause.
–Ah! dit-elle, après avoir écouté son récit, rien ne me parait plus triste que cette habitude que l’on prend dans une grande ville de passer à côté de tant de misères et de souffrances sans les deviner, ou si on les devine, sans essayer de les soulager; je suis sûre que le cœur s’endurcit à la longue. Puis elle raconta en peu de mots à Gabriel le chagrin que lui avait confié la mère de Lisa auprès du lit de son enfant.
–Je suis sûr que c’est de la sœur de Raoul qu’elle voulait parler, s’écria le jeune garçon.
–Comment peux-tu le savoir?
–J’en suis sûr, maman. Quand j’ai rencontré Raoul ce matin il avait l’air préoccupé et le ton e plaisanterie qu’il essayait de prendre était forcé. Après quelques instants il m’a raconté que a sœur malade avait été laissée seule dans sa chambre pendant un grand dîner par la personne qui prend soin d’elle, et que très tard dans la soirée on l’avait trouvée évanouie. Il m’a dit qu’il y avait dans tout cela un peu de sa faute à ni, parce qu’il avait promis de venir auprès l’elle et qu’il l’avait oublié.
–C’est bien cela. Ah! si nous pouvions être utiles à cette pauvre femme! Elle semble aimer cette jeune fille autant que son propre enfant. Si a petite fille meurt elle ne supportera pas ce double chagrin; mais comment faire?
–Si je le disais à Raoul aujourd’hui, maman? ) eut-être quand il saura combien elle est malheureuse trouvera-t-il quelque moyen de lui faire rendre justice?
–Je ne compte guère sur l’intervention d’un garçon de cet âge et de ce caractère, dit Madame Sorbier. Il ne doit pas avoir l’habitude de se mettre à la place des autres et de se préoccuper de ce qu’ils peuvent souffrir.
–Pourtant, maman, je t’assure que cela me fait beaucoup de peine de voir souffrir. Pourquoi cela n’en ferait-il pas à Raoul?
–Mon Gabriel, tu as eu constamment sous les yeux l’exemple de ton père qui ne pouvait voir une souffrance morale ou physique sans chercher à la soulager ou à la guérir. Il n’est pas étonnant que tu te sois accoutumé à tenir quelque compte des sentiments des autres. Mais combien d’enfants y a-t-il qui voient mettre en pratique autour d’eux cet esprit de dévouement qui pénétrait toute la vie de ton père?
–Crois-tu que je pourrai jamais lui ressembler? demanda Gabriel en embrassant sa mère.
–Je l’espère, mon enfant. Tu as quelque chose de lui dans les traits et dans les attitudes. Pour ce qui est du caractère cela dépend de toi et de la direction que tu donneras à ta vie. La semence a été répandue dans ton cœur, c’est à toi à lui faire porter des fruits, sous la bénédiction de Dieu. C’est un grand privilége d’avoir eu un père comme le tien, mais c’est aussi une grande responsabilité, car si le travail des années pendant lesquelles il s’est occupé de toi était perdu, si tu avais une vie égoïste et vulgaire, tu serais plus coupable que tout autre.
–J’espère que je n’aurai pas une vie égoïste et vulgaire, dit Gabriel. Maman, ce n’est pas de toi non plus que je l’apprendrai.