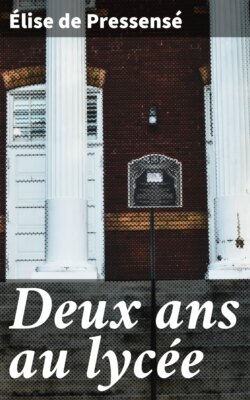Читать книгу Deux ans au lycée - Élise de Pressensé - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеV
UNE MAXIME DE M. LANDEL
Table des matières
–Hélène, ma chérie, dit Madame Landel deux jours plus tard en entrant dans la chambre de sa fille, je voudrais que ton père cédât et reprît cette pauvre Susanne, puisque sa petite fille va mieux, car j’avoue que si elle l’avait perdue j’aurais eu de la répugnance à voir auprès de toi une figure plus lugubre encore qu’avant; mais il n’y a pas moyen de lui faire entendre à cela. Je suis toute prête, moi, à pardonner les torts qu’elle a eus.
–Mais, maman, vous savez bien qu’elle n’en a pas eu. Elle n’avait rien oublié. Et quand elle aurait oublié?. Songez donc que sa petite fille était mourante.
–Dans sa position, dit Madame Landel, on ne devrait vraiment pas se marier; les sentiments d’une mère pour ses enfants ne sont pas compatibles avec les devoirs d’une servante. Je trouve bien que c’est un grand inconvénient d’avoir auprès de toi une femme qui a d’autres préoccupations et d’autres affections; mais comme elle a vraiment de bonnes qualités et qu’elle te convient sous bien des rapports, comme d’ailleurs nous ne trouvons personne pour la remplacer, je voudrais que ton père revînt sur sa détermination.
Hélène soupira sans répondre. Les paroles de sa mère tombaient sur son cœur comme des gouttes d’eau glacée; mais elle n’avait jamais pensé que ses souffrances lui donnassent une mission d’enseignement auprès de ceux qui lui étaient supérieurs par l’âge, et elle se contenta de dire après un silence:
–Ne croyez-vous pas que papa me l’accordera si je lui dis combien je le désire?
Madame Landel secoua la tête.
–Je l’ai à peine vu depuis que nous savons comment tout s’est passé, et peut être si je pouvais lui parler. J’espère qu’il viendra un moment aujourd’hui!
Madame Landel ne restait pas davantage auprès de sa fille depuis que Susanne était partie. Il ne lui était pas même venu à l’esprit qu’elle pût renoncer pour quelques jours à la petite routine de sa vie; la nièce du concierge venait s’établir dans la chambre voisiné, Hélène lui demandait ce dont elle avait besoin et échangeait quelques paroles avec elle quand l’envie lui en prenait. Mais si la jeune fille était douce et prévenante, elle ne pouvait remplacer Susanne, si dévouée, si sympathique, si prompte à deviner et à soulager la souffrance. Hélène voulut se lever et s’habiller pour recevoir son père. Ce fut une véritable épreuve pour elle. Personne n’avait la promptitude, l’adresse et la douceur de mouvements auxquelles elle était accoutumée. L’élégante femme de chambre de Madame Landel, Mademoiselle Anaïs, si habile à coiffer et à faire les robes, était aussi inexpérimentée que possible quand il s’agissait de soigner une malade. Elle poussait à chaque instant de petits cris affectés et faisait dix fois plus de mouvements que ce n’était nécessaire; mais tout cela n’était que d’un très-médiocre secours. Enfin la pauvre enfant se trouva revêtue de sa robe de chambre de cachemire bleu, qui faisait ressortir la pâleur et la délicatesse de son teint, et installée auprès de sa petite table où personne n’avait renouvelé les fleurs ni posé les livres qu’elle aimait. Il lui fallut tout demander, tout prescrire, et cela seul était une souffrance pour une nature aussi délicate et aussi timide que la sienne. Mademoiselle Anaïs se retira en disant qu’elle avait à s’occuper de la toilette de Madame pour sa promenade en voiture, et Hélène, accablée de fatigue et de ce sentiment d’isolement qui, depuis quelques jours, lui était si familier, appuya sa tête sur son oreiller et ferma les yeux. Ce fut à ce moment que son père entra. Il s’approcha d’elle sans qu’elle s’en aperçût et la regarda un moment en silence. Deux larmes avaient coulé sur ses joues pâles à travers ses paupières à demi fermées; elle n’était pas sur ses gardes, M. Landel eut le temps de les apercevoir avant que, entr’ouvrant les yeux, elle les eût essuyées par un mouvement précipité. La vue de ces larmes silencieuses, discrètes, qu’on s’efforçait de lui cacher, lui en dit plus que beaucoup de plaintes et de gémissements, car il savait bien qu’Hélène le recevait toujours avec un sourire. Elle lui parut plus pâle et plus frêle encore que de coutume.
–Eh bien, dit-il en s’efforçant de raffermir sa voix qui tremblait un peu, comment va cette petite fille?
–Mieux, papa, beaucoup mieux, répondit-elle.
–Mieux, toujours mieux, dit-il en imitant son ton et en essayant de rire. Je ne crois pas que j’aie jamais reçu une autre réponse. A force d’aller mieux, il me semble qu’on devrait arriver à la santé parfaite. En sommes-nous là?
–Pas tout à fait, pas encore.
En disant ces mots, Hélène le regardait avec son doux sourire.
–Eh bien, espérons, ayons patience; cela viendra. J’ai entendu parler l’autre jour d’un médecin qui fait des cures merveilleuses.
–Oh! papa, vous savez que tout ce qui peut se faire on l’a fait, et que je pourrai me fortifier encore, mais jamais me guérir.
–En vérité! si un médecin qui n’a pas su trouver le moyen de te guérir prétend qu’il n’y en a pas, nous serions bien fous de le croire. Nous en consulterons d’autres, nous irons les chercher bien loin s’il le faut. Il y a des eaux qui font des miracles. Nous y irons. Avec de l’argent, on peut tout, ou du moins presque tout.
M. Landel ajouta instinctivement ces dernières paroles en voyant une expression douloureuse sur les traits de sa fille. Hélène ne répondit pas. Il continua.
–Voyons, que pourrais-je te donner qui te fît plaisir? Si tu as un désir, dis-le sans hésiter. Ne crains pas que je trouve que c’est trop cher. Rien ne sera trop coûteux pour que je te le donne, si cela peut te faire oublier un moment tes privations.
–Je n’ai envie de rien, papa, de rien au monde que vous puissiez m’acheter. Maman et vous me donnez tout ce que je puis désirer; mais, si vous voulez me rendre bien heureuse.
–Eh bien, parle.
–Laissez revenir Susanne, cher papa, elle me manque tant.
La figure de M. Landel, lorsqu’il entendit le nom de Susanne, prit une expression de mécontentement et de dureté.
–Je ne comprends pas, dit-il, que tu puisses tenir autant à une personne de cette sorte. Elle a manqué à son devoir, il faut qu’elle en porte la peine.
–Laissez-moi vous raconter tout ce qui s’est passé.
Et Hélène exposa les faits tels qu’elle les connaissait, aussi brièvement que possible, car elle voyait des marques d’impatience sur la figure de son père.
–C’est elle qui le dit.
Telle fut la seule réponse de M. Landel, et il se leva pour partir. En se penchant vers la jeune fille pour l’embrasser, il ajouta:
–Il ne faut pas que nous dépendions de nos inférieurs; ce sont eux qui doivent dépendre de nous. Nous te trouverons une autre femme de chambre qui te conviendra mieux, et tout ira bien..
–Ah! dit Hélène, vous croyez ma pauvre Susanne coupable, et vous voulez la punir; mais vous me punissez avec elle.
M. Landel ne répondit rien à ces paroles, qui cependant lui revinrent plusieurs fois à la mémoire.
Le lendemain matin, Hélène vit apporter dans sa chambre une jardinière garnie de fleurs rares et charmantes. En tout autre moment ce cadeau l’eût ravie, car elle aimait les fleurs, et c’était son plus grand plaisir d’en avoir autour d’elle. Mais elle pensa que celles-ci étaient destinées à la consoler de l’arrêt porté contre Susanne, et elle ne put les regarder sans avoir le cœur serré.
Raoul venait plus souvent qu’autrefois dans la chambre de sa sœur. Tantôt il y apportait de la gaieté et de l’animation; tantôt, selon le caprice du moment, il gardait un silence morose. Il était loin de comprendre encore que nous devons et que nous pouvons, au lieu d’être esclaves de nos dispositions du moment, les dominer et les transformer pour l’amour de ceux qui nous entourent. A certains jours, Hélène ne pouvait tirer de lui qu’un seul mot, mot de collégien s’il en fût, qu’il prononçait avec un circonflexe formidable et un bâillement assorti:
–Je m’embête!
–Pauvre garçon! disait-elle de sa voix caressante. Puis, sans faire de sermons inutiles, elle essayait de le sortir de cet égoïsme, qui est la vraie source de l’ennui; mais elle ne réussissait guère. Raoul s’étirait, bâillait encore, allait et venait dans la chambre, touchant à tout, ôtant chaque objet de sa place, et quand sa pauvre sœur, immobile sur sa chaise longue, laissait échapper un mot de remontrance ou d’impatience, il s’en allait en disant qu’elle était d’une humeur insupportable, et qu’il n’y avait pas moyen de rester avec elle.
Il retournait dans sa chambre, et Hélène pleurait et se reprochait de ne pas savoir retenir son frère, et être aimable et amusante pour lui.
C’est ainsi que souvent on gâte la vie de famille, on lui ôte tout son charme, faute de savoir s’oublier dans les rapports journaliers, et de faire d’infiniment petits sacrifices qui ne coûtent rien, une fois qu’on en a pris l’habitude, et qui rapportent au centuple la joie et le bien-être du cœur. Un mot retenu au moment où les lèvres allaient le laisser tomber, ou un mot prononcé lorsqu’on était tenté de garder le silence, un bâillement réprimé, une plainte égoïste étouffée, une petite volonté de détail oubliée pour satisfaire un désir deviné chez un autre, voilà ces sacrifices qui rendent la vie de famille si douce, quand elle est ce qu’elle doit être. Ils n’ont rien de bien effrayant; mais Raoul, comme beaucoup de jeunes gens de son âge, comme beaucoup de personnes plus âgées, hélas! n’avait pas même l’idée qu’on pût les attendre de lui. Il ignorait absolument une science, qui est vraiment la science de la vie; il ne savait pas se mettre à la place des autres.