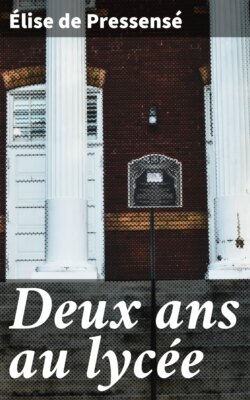Читать книгу Deux ans au lycée - Élise de Pressensé - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
RAOUL CHEZ LUI.
ОглавлениеTable des matières
Raoul était rentré chez lui et s’était mis, suivant son habitude, à fumer un cigare à la fenêtre de sa chambre, qui donnait sur le jardin. Cette chambre était assez grande et meublée avec élégance. Le lit, placé dans une alcôve, se trouvait à moitié caché par une draperie; les murs étaient ornés de belles gravures, de fusils et de pistolets d’un travail précieux. Une grande bibliothèque vitrée occupait le fond de la pièce. Près de l’une des fenêtres, était le bureau de Raoul, aussi vaste et aussi compliqué de tiroirs et d’arrière-tiroirs que s’il eût appartenu à un ministre d’Etat.
Raoul était du nombre de ceux qui n’ont jamais eu le temps de désirer. Tout petit garçon, ayant déjà reçu montre, chaîne d’or, meubles de toutes sortes et jouets coûteux de toute espèce, il n’avait pu trouver à demander pour ses étrennes qu’une paire de bottes. Il les avait reçues et, le premier moment de joie passé, ne s’était pas senti plus heureux.
Quand il eut fini son cigare, on vint lui dire que sa mère l’attendait pour déjeuner. Madame Landel était une femme élégante et d’un extérieur agréable. Raoul la trouva au coin du feu de la salle à manger, son petit chien sur ses genoux; elle lui sourit et mit de côté le journal qu’elle lisait. Raoul se pencha sur sa mère, et au même instant le petit animal, roulé en boule soyeuse et à moitié endormi, se secoua brusquement et aboya avec colère.
–Raoul! dit Madame Landel vivement, tu l’as pincé, j’en suis convaincue; c’est de la méchanceté pure.
–C’est de la charité pure, maman; ce chien est trop heureux, toujours couché sur vos genoux ou sur des coussins, choyé, caressé, nourri de friandises. Il prendrait ce monde pour un paradis, et il faut bien de temps en temps le tirer de cette erreur. Love n’a dans la maison que deux vrais amis, moi et Guillaume, qui a coutume de l’éveiller par un grand coup de pied quand il est sûr que vous ne pouvez pas l’entendre crier.
–Ah! c’est indigne. Eh bien, Love couchera, à partir d’aujourd’hui, dans mon cabinet de toilette. Pauvre petite bête, quel plaisir peut-on avoir à la faire souffrir?
–Ce n’est qu’un besoin de compensation qui a sa source dans l’amour de la justice. Je n’ai jamais la moindre envie de donner un coup de pied à un chien que je rencontre assis sur la pierre du trottoir.
Pendant que ces paroles s’échangeaient, Love était descendu des genoux de sa maîtresse et s’était blotti dans un coin, d’où il regardait Raoul d’un air sournois.
–Hélène a été souffrante cette nuit, dit Madame Landel en déjeunant; cela me coûte beaucoup de devoir la quitter toute l’après-midi et la laisser seule encore ce soir. J’ai des visites indispensables à faire et nous attendons du monde à dîner.
Raoul regarda sa mère et parut réprimer une envie de parler.
–Ne pourrais-tu aller un peu auprès de ta sœur ce soir? continua Madame Landel.
–J’aurai à travailler, dit le jeune garçon d’un ton bref.
–Ah! combien je voudrais lui consacrer plus de temps; mais les obligations de la société sont si tyranniques! Heureusement je sais qu’avec des livres elle est contente. Sa femme de chambre est inappréciable; elle se mettrait au feu pour la pauvre enfant. Son dévouement me donne une sécurité complète. Je ne sais ce que je ferais sans elle.
–Sa figure n’est pas réjouissante, observa Raoul.
–Elle n’a pas l’air gai, mais elle est douce et ne manque pas de distinction pour sa classe. Je crois, d’ailleurs, qu’elle a quelque chagrin. Elle est veuve et a des enfants à elle, un garçon ou une fille, ou tous les deux peut-être. Hélène m’a dit quelque chose de semblable. Sais-tu que ce n’est pas très-aimable, Raoul, de lire le journal pendant le petit moment que nous passons ensemble.
Raoul jeta le journal d’un air maussade.
Il y eut un silence prolongé que Madame Landel rompit en lui demandant s’il travaillait bien.
–Comme de coutume, répondit négligemment l’aimable garçon.
–Et ton professeur de cette année paraît-il mieux disposé pour toi que celui de l’année dernière?
–J’ai de bonnes raisons pour croire que ce sera exactement la même chose.
–C’est singulier. Que peuvent-ils avoir contre toi? Nous devrions peut-être les inviter.
–Celui-ci est un ours qui ne viendrait pas.
Raoul se leva en disant ces mots.
–Déjà! dit sa mère; tu ne vas pas travailler immédiatement après le déjeuner.
–Oui; je vais travailler sans perdre une minute.
–Pauvre enfant!–Madame Landel l’aurait-elle plaint de même, si elle avait su comment il avait passé son temps avant le déjeuner?–Fais au moins un tour de jardin.
–C’est si amusant, un tour de jardin!
–J’irais bien avec toi, mais il faut que je monte un moment auprès de ta sœur, pendant que Susanne déjeune.
–La couturière attend Madame, dit un domestique en ouvrant la porte.
–Ah! quel ennui! j’avais oublié ce rendez-vous. Je n’aurai pas un moment à passer avec Hélène; pauvre petite!
–Je vais y aller, se dit Raoul en bâillant d’un air nonchalant, quand sa mère fut partie. Tant pis pour ma rédaction; elle se fera comme elle pourra.
Hélène Landel était une jeune fille de dix-sept ans que la plus cruelle des maladies, une affection de l’épine dorsale, avait atteinte et brisée au sortir de l’enfance. Ses jambes étaient paralysées; elle avait perdu la fraîcheur de son âge, et ses traits délicats portaient l’empreinte de la souffrance; mais il s’y mêlait tant de douceur et de grâce que sa physionomie semblait n’en avoir que plus de charme. Elle reçut son frère avec un sourire, et lui tendit sa main froide et un peu tremblante.
–Est-ce que tu souffres beaucoup? demanda-t-il.
–J’ai eu une crise cette nuit, mais c’est passé maintenant. Je suis contente de te voir, Raoul; sais-tu que je ne t’ai pas aperçu depuis hier matin?
–A quoi servent les reproches? répliqua le jeune garçon d’un ton bourru.
–Les reproches! Je ne voulais pas t’en faire, je t’assure; je sais bien que tu as à travailler.
–On étouffe ici avec ce feu. Je ne comprends pas comment tu peux y tenir.
–Ouvre la fenêtre, si tu as trop chaud; il y a justement un rayon de soleil. C’est sans doute parce que je ne fais pas de mouvements, que je suis toujours glacée.
–Comment peux-tu supporter cette vie? demanda Raoul sans regarder sa sœur.
Les grands yeux bleus d’Hélène se remplirent de larmes.
–Il le faut bien, dit-elle.
Puis se reprenant:
–Non, je ne veux pas employer ce mot, il faut, qui est si froid et si sec. Je dois et je puis supporter cette vie, puisque Dieu veut que ce soit la mienne. Tu sais, Raoul, mon refrain favori: Vouloir ce que Dieu veut.
Raoul allait dire que c’était du jargon, et qu’il détestait le jargon; mais il rencontra le regard de sa sœur, et les paroles s’arrêtèrent sur ses lèvres. Il se leva et alla regarder par la fenêtre.
–Voilà qu’on prépare la voiture. Est-ce que maman sort déjà?
–Oh! pas encore, dit Hélène; il est de trop bonne heure. Elle m’avait promis qu’elle viendrait un moment.
–Hélène, dit Raoul en se retournant et attachant sur sa sœur un regard pénétrant, quand maman gémit de ce qu’elle ne peut pas rester avec toi, et s’en va faire des visites tout le jour, cela s’appelle-t-il vouloir ce que Dieu veut?
Hélène rougit, puis pâlit, et répondit d’une voix tremblante:
–Maman a tant de relations. La position de notre père exige qu’elle les entretienne, et elle pense que cela est très-important pour nous....
–Cela nous est, en effet, d’une singulière utilité, dit Raoul avec amertume. Je hais les prétextes, les sophismes, et tout ce qui est faux.
–O Raoul!.
–Je ne suis pas un ange, moi. Les anges ont le privilége de ne pas voir les choses comme elles sont, mais je ne l’ai pas. J’appelle un chat un chat, et.
–Je t’en supplie, Raoul!
Le jeune garçon s’arrêta, puis se rapprochant de sa sœur:
–Soyons dans le vrai, Hélène, quel intérieur avons-nous? Un père toujours occupé, toujours surchargé d’affaires et de soucis, sachant à peine ce que nous faisons, et pas du tout ce que nous sommes. Quand il est à la maison, on peut être sûr qu’il y a du monde; les autres jours, il dîne en ville. Une mère qui ne nous connaît guère mieux, qui sort tout le jour, qui ne trouve pas une heure à te donner, entre sa couturière et ses visites, à toi qui es malade et toujours seule.
–Raoul, tu te trompes, dit la jeune fille avec vivacité; maman vient très-souvent me voir un moment. Elle prend soin que j’aie tout ce qu’il me faut; et puis elle sait que Susanne me soigne si bien!
–Oui, elle entre trois ou quatre fois par jour dans ta chambre pour s’informer de toi, et à moi elle me demande au moins une fois par semaine si je travaille bien. Cela ne lui donne pas trop de peine. Hélène, je déteste notre intérieur, je déteste notre vie, je m’ennuie. Je voudrais m’en aller loin d’ici!.
La pauvre enfant ne put s’empêcher de se dire que son frère était bien ingrat, lui qui avait la liberté de ses mouvements, des études, des camarades. mais elle n’exprima pas cette pensée qui traversait son esprit.
–Ne crois-tu pas, dit-elle timidement, que nous serions plus heureux si nous vivions un peu plus ensemble à nous deux? Si tu venais quelquefois le soir avec tes livres, je ne t’empêcherais pas de travailler, et je serais moins seule. Tu me dirais ce que tu as vu, ce que tu as pensé et fait pendant la journée. 0Raoul, ce serait délicieux! Veux-tu venir ce soir?
–Oui, dit Raoul, je viendrai.
Il la quitta en l’embrassant, et Hélène, restée seule, se mit à penser à la relation qu’elle allait avoir avec ce frère qui, jusqu’alors, s’était tenu éloigné d’elle, et qu’elle ne pouvait chercher pour lui faire sentir son affection. Sa mère ne fit qu’entrer en passant pour lui donner un rapide baiser; mais l’après-midi lui parut courte, et les occupations monotones qui la remplirent eurent ce jour-là un charme particulier. Aussi, quand Madame Landel, tout habillée pour le dîner, entra encore en passant, elle dit à sa fille:
–Tu as l’air bien, ce soir, ma chérie; tu ne souffres pas? tu es contente?
Hélène l’embrassa et-répondit qu’elle était très-bien, très-contente, et que sa mère devait jouir de sa soirée sans se préoccuper d’elle.
Bientôt après Susanne entra apportant sur un plateau le petit dîner solitaire de la jeune fille. Avec la pénétration que donne un intérêt sincère pour les autres, Hélène s’aperçut aussitôt que sa femme de chambre était pâle, agitée, et que ses yeux étaient pleins de larmes qu’elle cherchait à retenir.
–Qu’avez-vous, Susanne? dit-elle; est-il arrivé quelque chose?.
–Ce n’est qu’une mauvaise nouvelle que je viens de recevoir, Mademoiselle; ma petite Lisa est malade.
–Malade! J’espère que ce n’est rien de grave?
–Elle est sans connaissance, dit la pauvre mère, qui éclata en sanglots.
–Oh! pauvre Susanne... et depuis quand?
–Depuis ce matin. Il y a plusieurs jours qu’elle est tombée malade, mais on croyait que ce ne serait rien. C’est aujourd’hui seulement qu’on a demandé le médecin. Il a dit que le mal était dans la tête, et qu’il fallait me prévenir.
–Et vous n’êtes pas allée tout de suite, Susanne? Que faites-vous ici?
–Je ne pouvais pas m’en aller sans le demander à Madame.
–Eh bien! ne l’avez-vous pas fait?
–J’ai prié Guillaume de lui en dire un mot avant qu’on se mît à table. Madame m’a fait répondre qu’elle viendrait me parler après le dîner; mais ils sont si longs, ces grands dîners!.
–Maman ne savait pas que c’était une maladie si grave, dit Hélène. Susanne, vous allez partir tout de suite; je le prends sur moi. J’expliquerai tout à maman. Je n’ai pas besoin de vous. Mon frère viendra passer la soirée avec moi; je ne serai pas seule.
–Mais la nuit?
–Eh bien, la nièce du concierge peut venir coucher dans votre chambre. Elle le fera volontiers, j’en suis sûre, et c’est la personne que j’aime le mieux avoir après vous. Ne pensez plus à moi, dépêchez-vous!
Tous les obstacles ainsi levés, Susanne se précipita dans la petite chambre qu’elle occupait à côté de celle d’Hélène, jeta un châle sur ses épaules et sortit. Elle ne trouva aucun des domestiques sur son chemin, tous étaient occupés dans la salle à manger ou l’office. La loge même était vide. Susanne se hâta de descendre à la cuisine, située au sous-sol et pria la cuisinière, qui se reposait sur ses lauriers, de ne pas oublier de prévenir la nièce du concierge, dès qu’elle serait rentrée, que Mademoiselle Hélène avait besoin d’elle.
–Ainsi vous vous en allez courir le monde, et vous laissez votre besogne aux autres? dit la cuisinière d’un air revêche.
–Mademoiselle n’a pas besoin de moi, répondit la pauvre Susanne avec douceur, et ma petite fille est très-malade.
Déjà elle était bien loin et la porte d’entrée se refermait sur elle.
–C’est bon, dit le cordon bleu, qui avait un détestable caractère et se sentait protégée contre le blâme qu’il eût pu lui attirer par des mérites d’un autre ordre, on verra. Cette mijaurée n’aura peut-être pas demain de si grands airs. Ce n’est pas moi qui irai rien dire à la petite concierge. S’il n’y a personne là ce soir toute la faute en retombera sur Madame Susanne, et je m’offrirai pour coucher dans la chambre de Mademoiselle. Je voudrais bien savoir si je ne suis pas aussi bonne pour cela que cette pauvresse de femme de chambre qui y regarde à deux fois avant de s’acheter une paire de souliers. C’est honteux de voir comme elle est habillée dans une maison si comme il faut. Je ne comprends pas qu’on la garde. Moi, Dieu merci, je n’ai à m’occuper que de moi-même, aussi je ne manque de rien et quand je serai lasse de mon métier, je ne serai pas en peine.
Après ce monologue satisfaisant, la cuisinière reprit son attitude somnolente.
Elle n’était pas fâchée de la perspective de se voir nécessaire à Hélène, car dans la maison tous les domestiques éprouvaient un sentiment d’intérêt pour la jeune malade si douce et si patiente. Guillaume qui aidait Susanne à la porter quand elle descendait au salon ou au jardin, la cuisinière qui lui faisait de petites soupes légères quand elle ne pouvait supporter d’autre nourriture, le cocher lui-même qui l’avait quelquefois conduite au Bois de Boulogne quand elle était assez bien pour se promener en voiture, tous avaient reçu d’elle quelque remercîment gracieux, quelque parole bienveillante, aussi le rôle que Susanne avait auprès d’elle, excitait l’envie de ses camarades, qui l’accusaient à la fois de grands airs et de sordide économie. Les grands airs de la pauvre femme n’étaient autre chose qu’une tristesse habituelle et une distinction de nature qui la rendait un peu étrangère dans un milieu où les conversations et les plaisanteries n’étaient pas toujours du meilleur goût. Son économie sordide était une nécessité, puisqu’elle avait à subvenir aux besoins de ses enfants sans autre ressource que des gages qui étaient à peine proportionnés aux services qu’elle rendait. Susanne n’avait qu’une amie dans la maison, c’était Hélène, mais celle-ci connaissait ses soucis, ses chagrins et en portait avec elle le fardeau.
La soirée passa sans amener Raoul dans la chambre de sa sœur. Le dîner avait été fort long, puis il avait cédé à l’envie de fumer un cigare, puis enfin, se voyant en retard, il s’était mis au travail et n’avait plus songé à sa promesse. Hélène attendit, attendit en vain. Elle s’efforça de lire, mais sa tête était fatiguée, les yeux lui faisaient mal, elle ne pouvait fixer son attention. Déjà depuis longtemps elle avait entendu les convives passer de la salle à manger au salon, ce n’était donc pas le dîner qui pouvait retenir Raoul. La solitude, qu’elle ne redoutait pourtant pas, lui semblait plus triste à cause du mouvement qui se-faisait dans la maison, et du bruit des voix qu’elle entendait indistinctement. Une grande agitation nerveuse s’empara d’elle, le sentiment de sa complète dépendance, le l’impossibilité où elle était de se lever et de marcher pour appeler, lui devint intolérable. Et lorsque, après un temps d’angoisse et d’attente lui lui parut d’une longueur mortelle, la pendule sonna enfin onze coups, la pauvre enfant sentant venir une des douloureuses crises de son mal et persuadée qu’on l’avait oubliée et qu’elle devrait rester seule toute la nuit, perdit connaissance.
Ce fut dans cet état d’insensibilité que la cuisinière la trouva, quand elle entra dans son appartement pour prendre la place de Susanne. Très-effrayée, elle sonna avec violence et en un instant la chambre fut encombrée de gens alarmés qui ne savaient ce qu’ils devaient faire et couraient çà et là.
–Comment se fait-il que, si tard, elle soit encore debout? où est Susanne? demandait Madame Landel.
–Oui, où est Susanne? répéta M. Landel d’un ton irrité.
–J’ai trouvé Mademoiselle seule et évanouie, dit la cuisinière, Susanne est sortie.
–Sortie, c’est inqualifiable!–Mais le souvenir de la requête que la femme de chambre lui avait fait parvenir, arrêta les paroles sur les lèvres de Madame Landel. Elle l’avait oubliée jusqu’à ce moment, et pourtant elle savait que c’était pour voir son enfant bien malade que Susanne avait demandé à sortir.
–Mais comment a-t-elle pu laisser ma fille seule? reprit–elle après un moment de silence.
–Elle ne remettra pas les pieds dans la maison, dit M. Landel d’un ton absolu, elle s’est montrée complétement indigne de la confiance que nous lui avons accordée. Laisser cette enfant seule, et sans prévenir personne, . c’est impardonnable!.
–Je ne la croyais pas capable d’une chose pareille, ajouta Madame Landel.
La cuisinière se garda bien d’éclaircir ce mystère.
Une heure après tout était rentré dans l’ordre. Hélène qui, en rouvrant les yeux, avait demandé Susanne, s’étonna aussi que sa fidèle garde eût pu la quitter sans lui assurer les soins nécessaires, et pensa que l’émotion causée par l’état de son enfant lui avait fait perdre la tête. En entendant son père répéter d’une manière aussi positive que la première fois que Susanne ne remettrait pas les pieds dans la maison, elle voulut l’excuser et supplier qu’on ne prononçât pas un arrêt aussi sévère, mais on lui imposa silence en lui enjoignant de tâcher de dormir. Dormir!. avec une pensée comme celle-là pour ajouter l’angoisse morale aux souffrances physiques!. Quand chacun se fut retiré, laissant la malade aux soins de Stéphanie, elle essaya de se calmer, de se raisonner et d’espérer, mais elle ne put y parvenir, et pendant ces longues heures d’insomnie elle tourna et retourna sa pauvre tête endolorie sur son oreiller en écoutant les ronflements sonores de sa garde et les comparant au sommeil léger de Susanne qui était toujours auprès d’elle pour adoucir ses souffrances avant qu’elle eût le temps de l’appeler.
Cette longue nuit finit pourtant par s’écouler. De très-bonne heure Susanne frappa à la porte de service. Ce fut le domestique qui lui ouvrit.
–Que voulez-vous? lui demanda-t-il brusquement.
–Je viens demander la permission de rester encore vingt-quatre heures auprès de mon enfant; le médecin dit que la crise décisive ne peut pas tarder beaucoup plus longtemps. Je reviendrai après. D’une manière ou d’une autre la pauvre petite n’aura plus besoin de moi.
–Vous pouvez bien rester tant que cela vous conviendra. Monsieur a défendu qu’on vous laisse rentrer.
Susanne le regarda sans paraître saisir le sens de ces paroles.
–Ne m’entendez-vous pas? répéta le domestique, qui prenait parti pour la cuisinière, de qui la bienveillance lui était plus précieuse que celle de la pauvre et mélancolique femme de chambre. Pourquoi restez-vous là sans bouger?
–Je ne vous comprends pas, dit-elle.
–C’est pourtant clair comme le jour: Monsieur a défendu qu’on vous laisse rentrer. Vous allez me dire votre adresse, on vous enverra ce qu’on vous doit.
–Mais qu’ai-je donc fait?
–Jolie question, ma foi! N’est-ce rien de laisser Mademoiselle sans prévenir personne, et si souffrante, qu’on l’a trouvée à minuit évanouie et toute seule?
–Mon Dieu! est-ce possible? dit Susanne.
–Est-ce possible!. Vraiment, c’est bien à vous de faire l’étonnée. Qui est-ce qui l’a laissée seule?
–Mais la nièce du concierge.
–Elle affirme qu’on ne lui a rien dit et qu’elle ignorait complétement que vous fussiez sortie, et ce n’est pas une menteuse, bien qu’elle ne se fasse pas passer pour une sainte.
Susanne comprit tout.
–Je ne pouvais pourtant pas laisser mourir ma petite Lisa sans la revoir, dit-elle. Laissez-moi monter auprès de Mademoiselle.
–J’ai ma consigne, vous ne passerez pas la porte.
–Je vous en supplie.
–C’est parfaitement inutile. Vous savez que je n’ai pas le cœur tendre. Donnez-moi votre adresse et ne me demandez rien.
–Dites-moi au moins si Mademoiselle va mieux ce matin.
–Stéphanie a couché dans sa chambre, et elle n’est pas encore sortie; d’ailleurs, cela ne vous regarde plus. Allons, dépêchez, j’ai à faire mon service.
Susanne donna l’adresse demandée et se retira le cœur horriblement serré. Ne devait-elle plus revoir sa chère jeune maîtresse? Hélène elle-même ne la justifierait-elle pas au moins en partie en disant ce qui s’était passé? Mais bientôt sa pensée se reporta sur son enfant mourante; elle hâta le pas pour la retrouver et oublia tout dans cette terrible anxiété.