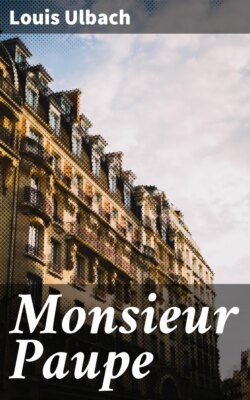Читать книгу Monsieur Paupe - Louis Ulbach - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
LE LOUP
ОглавлениеTable des matières
Le tailleur pouvait se rendre chez lui sans traverser la petite place ménagée devant la grille du château. Mais une instinctive curiosité, une soif subite de sa haine lui suggéra le désir immodéré de voir si les murs, si la pelouse, si les grands arbres, si la grille, avaient un pressentiment du malheur apporté par Me Herluison.
La nuit descendait.
M. Paupe arriva lentement, doucement, tout contre la grille, et, s’appuyant aux barreaux, se mit à regarder insolemment, avidement, férocement, la large pelouse, mal entretenue depuis quelques mois. Il s’imaginait presque qu’il allait entendre une plainte, un sanglot s’échapper par les fenêtres ou les portes du château. Il voulait recueillir ce premier aveu d’un désespoir qui le vengeait.
Un bruit de voix, en effet, parvint à son oreille, mais bien différent de celui qu’il espérait.
C’étaient des voix enfantines qui jaillissaient, pour ainsi dire, du milieu du gazon, lançant leurs perles à la place de la gerbe tarie d’un vieux jet d’eau.
Le tailleur eut un reniflement de bête sauvage; son regard flambloya, et, la bouche haletante, il se mit à écouter avec l’avidité d’un fauve qui aspire une proie.
Un petit garçon de neuf à dix ans, une petite fille de cinq ans, riaient et jouaient, se poursuivant à travers l’herbe plus haute que d’habitude, qu’on dédaignait ou qu’on oubliait de faucher.
La petite fille trébuchait souvent, tombait, se relevait, et le petit garçon se moquait d’elle.
On n’entendait pas ce qu’ils disaient. Disaient-ils quelque chose? Ils ne se parlaient pas; ils échangeaient des cris, des improvisations de chansons, de rondes enfantines, sur des airs qu’ils inventaient aussi; et ils se jetaient des petites touffes d’herbe à la tète, éclatant de ce beau rire des enfants, supérieur à toute musique humaine, quand la figure de l’un d’eux disparaissait sous ce voile de foin.
Le tailleur, la rage dans l’âme, se disait en les écoutant:
–Chez moi, il y a des enfants qui sont de cet âge, qui ne rient pas, et qui n’ont pas le temps de jouer. Marcienne met le couvert pour le souper. Maximilien, le pauvre estropié, se traîne aux meubles pour rejoindre sa sœur… Ils sont pâles, ils sont tristes; et pourtant je leur rapporte régulièrement de quoi payer le pain que nous mangeons. Ce n’est pas chez moi que les huissiers sont attendus! Mes enfants, à moi, s’ils avaient cette herbe pour s’y rouler, se porteraient mieux, et l’on verrait si le sang des Paupe n’est pas aussi rose que le sang des d’Arsonval. Entendre rire des enfants, c’est bon! Je n’ai jamais entendu rire les miens! Mais je sais comment ils pleurent. Oh? ceux-ci pleureront bientôt! Je me souviens que, moi aussi, j’ai joué sur ce gazon. Mon père me regardait rire et il était content. Je veux voir rire ma fille; je veux faire rire mon fils.
M. Paupe resta quelques minutes absorbé dans ses réflexions, et le regard attaché à ce spectacle des deux enfants qui jouaient.
Le jour baissait; le crépuscule chaud, caressant, se répandait sur le petit garçon et la petite fille, sans les effrayer. Ils continuaient à s’amuser dans l’obscurité croissante; et c’était pour eux que la lune commençait à passer ses regards curieux dans les arbres.
M. Paupe ne distinguait plus que confusément les deux enfants; mais il les percevait d’un regard intérieur, et voulait les attirer par l’aspiration haletante de sa haine.
Précisément, dans leurs ébats, ils quittèrent la pelouse, s’engagèrent dans l’allée circulaire, et vinrent, en tournant, effleurer la grille.
M. Paupe ne put résister à un désir absurde, sauvage. Il avança la bouche entre les barreaux, et, l’arrondissant en cornet, il poussa un cri rauque, bruyant.
Les enfants s’arrêtèrent épouvantés; ils virent, se découpant sur les dernières lueurs du soleil couchant, cet être bizarre, monstrueux; le prirent assurément pour une bête particulièrement funeste aux petits garçons et aux petites filles, et, poussant une longue clameur plaintive, ils s’enfuirent vers la maison.
M. Paupe fut ravi de son triomphe; il avait fait peur à quelqu’un de la famille d’Arsonval.
Ces enfants allaient raconter sans doute qu’un homme terrible les attendait à la grille pour les dévorer, et cette confidence serait une torture par surcroît, ajoutée à celles que Me Herluison était en train de faire subir à l’orgueil du comte.
Mais cette satisfaction ne suffisait sans doute pas au tailleur vindicatif, car il s’éloigna de la grille avec un sourd malaise. Il regarda de loin la façade du château. Elle restait obscure, muette; on n’entendait plus les enfants qui étaient rentrés. Rien ne transpirait de la douleur attendue et espérée.
M. Paupe jeta un dernier regard brutal à cette maison maudite et reprit son chemin.
Sa colère grondait toujours en lui; mais elle était pénétrée maintenant d’une émotion singulière. La vision de ces petits enfants d’Arsonval avait avivé, puis attendri sa fibre paternelle. Il avait hâte de revoir sa fille Marcienne, qu’il forcerait bien à sourire, et son fils Maximilien auquel il songea tout à coup à apporter quelque douceur.
Avant de rentrer chez lui, M. Paupe entra chez l’épicier du village, et, comme il venait de toucher de l’argent, il préleva une dîme sur son gain, pour acheter une petite bouteille de dragées en pâte, qu’il mit près de son argent, dans la poche de sa veste.
Cette attention extraordinaire le fit sourire. L’idée lui en était venue, en pensant qu’on faisait probablement des cadeaux de sucreries aux enfants des riches, et que désormais, les enfants du comte d’Arsonval n’en auraient plus, puisqu’ils allaient devenir plus pauvres, relativement, que ses enfants.
La maison de M. Paupe n’était pas la plus misérable du village, mais elle justifiait cependant quelques-uns des soupirs que le tailleur avait exhalés devant Me Herluison.
Elle n’avait qu’un rez-de-chaussée. Sous un toit de chaume, faisant auvent, on lisait sur une enseigne:
PAUPE, MARCHAND TAILLEUR
Par la fenêtre à guillotine qu’une lisière de drap garnissait aux jointures, on apercevait l’établi sur lequel Paupe taillait et cousait.
Il fallait franchir la porte à deux vantaux se séparant horizontalement par le milieu, et descendre d’un pas dans la chambre sans plancher, pour pousser plus loin l’inventaire.
La maison avait une certaine profondeur, et une porte vitrée, faisant face à la porte principale, laissait deviner, derrière une seconde chambre, un petit jardin.
Sur le devant, contre la fenêtre, un banc planté sans doute par M. Paupe, et consistant en une planche posée sur deux petits poteaux enfoncés dans le sol, servait aux rares moments de repos que prenait le tailleur, le matin et le soir, après chaque repas.
Une fraîcheur de cave saisissait le visiteur, dans la pièce principale, celle qui servait d’atelier, de boutique, de salle à manger au tailleur. Elle était exposée au nord. Mais dans deux autres chambres de derrière, éclairées par le jardin, les enfants recevaient l’air et le soleil.
Ils n’y tenaient guère; ils avaient la vocation de l’ombre, et préféraient de beaucoup la pièce du devant: peut-être parce qu’elle donnait sur la rue, parce qu’on y voyait passer les gens, et parce que, lorsque la fenêtre à guillotine était ouverte, on humait l’odeur d’un trou rempli d’eau sale, qui s’était creusé de lui-même, à l’angle de la maison; tandis que, du côté du jardin, les enfants n’eussent respiré que l’odeur du thym, planté en bordure autour d’un carré de choux.
Quand le tailleur eut poussé sa porte:
–Comme tu reviens tard! lui dit une voix douce qui lui semblait pénétrée de la fraîcheur de la chambre.
Paupe regarda sa fille avec un air subit de soumission.
–C’est vrai, Marcienne, mais j’ai un peu flâné en route. Je vous ai fait attendre pour souper?
–Nous avions peur! reprit la petite fille, en tirant avec la pointe d’une aiguille la mèche fumeuse d’une lampe en plomb, qui, jusqu’à l’arrivée du tailleur, était restée économiquement enfoncée dans l’huile,
–Peur?
–Oui. On dit qu’il rôde de vilaines gens dans la forêt.
–Qui dit cela?… Il n’y a que des loups dans les bois, et je ne crains rien des loups. Soupons.
M. Paupe déposa son paquet sur l’établi, et vint à la table, pendant que Marcienne allait prendre dans l’âtre la soupe préparée par elle.
La fille du tailleur n’avait pas douze ans, et paraissait en avoir quatorze. La pauvre petite s’était hâtée de grandir pour atteindre à sa tâche. Elle faisait le ménage, la cuisine, aidée, il est vrai, dans cette seconde partie de sa besogne, par M. Paupe, quand il était là, par une voisine, quand elle était embarrassée du problème et, en tout temps, par la nécessité qui réduisait ce problème quotidien aux formules les plus simples.
Marcienne n’était pas jolie; mais elle avait une de ces figures larges et blanches, qui sont incessamment dans la lueur d’une extase.
Ses yeux bleus avaient une douceur infinie; et quand ils se fixaient avec persistance, ils prenaient un air de volonté qui imposait. Ses cheveux étaient d’un blond foncé qu’un peu de pommade eût rendu brun; mais, légèrement crêpelés dans leur sécheresse naturelle, ils mettaient autour de son visage un fond un peu opaque, sans lourdeur, qui faisait valoir la blancheur du teint.
Elle était grande pour son âge, comme ces fleurs sans soleil qui poussent vite sur une tige décolorée; toutefois, sa maigreur promettait une certaine élégance dans la taille, et sa pâleur évoquait, plutôt qu’elle ne la repoussait, l’idée d’une force nerveuse considérable.
La bouche, trop fendue, mais bien modelée, et laissant voir, dans un perpétuel sourire, des dents blanches, solidement plantées, était l’attrait spécial de cette enfant, intéressante pour l’observateur, comme une ébauche de jeune fille prédestinée à un rôle de lutte héroïque, ou de prière, ou d’immolation.
Comment Marcienne avait-elle appris à lire, à écrire, à compter? Comment, les quelques semaines passées, tous les ans, à l’école, avaient-elles suffi à lui procurer cette instruction qu’elle complétait, en donnant des leçons à son frère, en pratiquant la vie, c’est-à-dire en tenant les comptes de son père, en lisant quelquefois pour lui un article de journal, et plus rarement un article d’almanach?
Marcienne, sans paraître annoncer un prodige, était une de ces créatures de bonne volonté qui font naturellement des choses difficiles, parce qu’elles ne voient pas les difficultés, et qui les font admirablement bien.
Selon les circonstances, ces âmes soumises qui ne mesurent pas le fardeau, dépensent, dans l’obscurité d’un devoir terre à terre et quotidien, des forces qui, produites au grand jour, font les héroïnes légendaires, les sainte Geneviève et les Jeanne d’Arc.
La seule patrie à sauver, pour la fille du tailleur, c’était son frère Maximilien et son père, ces deux êtres que sa mère en mourant lui avait confiés, et qu’elle avait juré d’aimer et de servir, gagnant tous les jours un talent nouveau dans l’exercice de ce devoir sublime et simple, qu’elle remplissait si aisément que personne dans le pays ne songeait à l’admirer.
Le couvert était mis sur une table carrée en bois blanc, et l’épithète donnée au bois restait vraie pour la table, malgré son long usage: Marcienne s’appliquait et s’amusait à la tenir dans une propreté presque coquette.
Tout, au surplus, dans le pauvre logis, était épousseté, lavé, gratté, tous les jours. La pauvreté n’en était pas moins visible; au contraire. On eût dit qu’elle se montrait avec une effusion naïve.
Marcienne avait débouché la soupière fumante, et servait son père qui tendait silencieusement son assiette; puis, quand M. Paupe eut sa part jusqu’aux bords, elle prit soin de Maximilien.
Le pauvre petit, assis dans un fauteuil à longs pieds, qui l’élevait à la hauteur de la table, ne faisait aucun mouvement. Inerte, passif, pleurard, il attendait. Sa sœur le servit, lui remua avec sa cuillère d’étain la soupe trop chaude, la refroidit en soufflant, la tâta du bout des lèvres, et la lui fit manger doucement, patiemment, en lui demandant, à plusieurs reprises, s’il la trouvait bonne.
L’enfant répondait par un petit gémissement indécis qui remerciait, qui implorait, et qui trahissait tout à la fois l’impatience d’être servi.
Le souper se composait de la soupe, et d’un morceau de lard sur quelques légumes.
Marcienne ne prenait pas le temps de manger. Elle servait d’abord; quand son père et son frère étaient rassasiés, elle songeait à elle.
M. Paupe avait subi la loi de ce petit arrangement avec un égoïsme qui recevait sa récompense; car il prenait toujours un grand plaisir à voir Marcienne dans ses fonctions maternelles, et c’était pour ce pauvre homme, l’unique volupté de sa digestion que de contempler sa fille, soupant à son tour, mangeant, c’est-à-dire prenant des forces et de la vie, et se félicitant tout haut de l’excellence de sa soupe, en vidant la soupière, ou de son lard bouilli, en achevant les débris laissés sur le plat.
Marcienne versait ainsi à ses convives la petite illusion rétrospective d’un bon souper. Son père la bénissait, sans savoir bénir, en la trouvant parfaite, et en se trouvant moins veuf, le pauvre père, moins orphelin, le vieil enfant, puisqu’elle était là.
Le tailleur était ce soir-là particulièrement silencieux et farouche. Il but coup sur coup deux verres de vin, ce qui était une débauche, et, les sourcils froncés, il regarda fixement la fumée de la lampe de plomb, comme s’il eût attendu que la mèche éclatât tout à coup, et fît sauter en l’air les solives du plafond.
Marcienne, avant de desservir (opération qu’elle remplissait toujours lentement et un peu paresseusement, car elle aimait alors à causer, à se faire rendre des comptes), s’accouda, et, se penchant vers son père:
–On ne t’a pas payé? lui demanda-t-elle doucement.
–Si! j’ai la l’argent.
Paupe frappa sur la poche de sa veste; il sentit la petite bouteille de bonbons en pâte, et fit un mouvement pour la sortir et la donner au petit garçon. Mais, soit la peur d’être grondé pour avoir fait une dépense inutile; soit la honte d’avoir eu cet accès de sensibilité aristocratique, il laissa la petite bouteille à sa place, et se contenta de tirer les quelques écus de sa recette qu’il étala sur la table.
–Il faudra donner quelque chose au percepteur, dit Marcienne, en avançant la main pour prendre l’argent.
Paupe se dressa, et posa son poing sur la table, avec colère:
–C’est cela! le premier argent pour les autres! Le percepteur attendra.
–Mais, s’il se fâche?
–Il se fâchera; cela m’est bien égal! il ne m’enverra pas Herluison pour me saisir.
Marcienne élargit ses yeux dans un regard de profond étonnement.
C’était la première fois qu’elle entendait prononcer le nom d’Herluison. Que signifiait-il?
–On t’a fait de la peine? reprit-elle d’une voix tout ensemble câline et ferme, comme la voix d’une petite maman qui fait des offres à la faiblesse, pour la soutenir et la gronder, et en répliquant à l’air, beaucoup plus qu’aux paroles de son père.
–De la peine? Qui est-ce qui peut me faire de la peine, maintenant?–répartit M. Paupe avec deux ou trois soulèvements de la poitrine; –est-ce que je n’ai pas ma mesure comble?… Ta mère est morte; toi, tu fais une besogne au-dessus de tes forces… Maximilien est toujours dans le même état; quant à moi…
Il secoua la tête.
–Tu n’aimes pas le bon Dieu, et le bon Dieu fait semblant de ne pas t’aimer! répondit la petite fille.
–Qui t’a appris cela, Marcienne? c’est le curé,
–Ce n’est pas M. le curé qui m’a dit cela; je le pense.
–Le bon Dieu? Pourquoi l’aimerais-je?– murmura le tailleur, intimidé par le sourire avec lequel Marcienne lui avait parlé;– qu’est-ce qu’il a fait pour moi?
–Il t’a donné ta fille.
–Oui, et mon fils! répliqua Paupe d’une voix plus basse, en montrant le petit garçon qui penchait sa tête pâle, alourdie par la langueur du sommeil, sur le dossier de son fauteuil.
–Maximilien va mieux, je t’assure, dit Marcienne avec empressement.
–Grâce à toi! mais toi-même…
–Moi, je vais à merveille… Je ne me suis jamais sentie si bien portante, dit la petite fille dont les dents blanches semblaient éclairer la chambre.
M. Paupe ne voulait pas être convaincu, ce soir-là, de la bonté du bon Dieu.
–Non, non,–continua-t-il en se reculant dans sa tristesse, comme un ours attiré au jour et qui rentre dans sa tanière;–j’ai raison! S’il y avait une justice quelque part et un Dieu au ciel, je ne souffrirais pas comme je souffre; car je n’ai rien fait pour souffrir.
–Il y a des gens plus malheureux que nous.
–Je n’en connais pas.
–Eh bien, moi, j’en connais.
–Cite-les.
–Oh! ce n’est pas difficile,–répondit Marcienne avec une volubilité enfantine.–Il y a M. Mathias, qui a perdu, l’hiver dernier, ses deux enfants, après avoir perdu sa femme, et qui se trouve tout seul. Il y a les deux petits enfants de la mère Bastienne, qui ont perdu leur père et leur mère, et qui se trouveront sans un parent dans le monde, quand leur grand’mère, qui a quatre-vingts ans, sera morte.
–Comment sais-tu cela? dit M. Paupe, étonné de la rapidité de cette réplique.
–C’est tout simple! je dis tous les jours une prière pour le pauvre M. Mathias, et j’en dis deux pour les petits enfants de la mère Bastienne.
–Ah! et savent-ils cela au moins?
–Oh! non. D’ailleurs, c’est une façon de prier pour nous. J’ajoute toujours à ma prière: «Mon Dieu! conservez la santé de mon frère, et donnez-moi la force, pour que nous vivions, et pour que papa ne reste pas seul!» Je dis aussi: «Conservez-nous papa, mon Dieu! pour que nous vous aimions bien!»
Paupe mit la tête dans ses deux mains et parut réfléchir; mais il sentait ses yeux humides, et ne voulait pas qu’on les vît.
Marcienne devina les larmes, et fut satisfaite de les avoir provoquées. Elle savait que cette petite pluie éteignait souvent de gros orages dans le cœur paternel; et, comme elle avait l’intention de faire subir à M. Paupe un long interrogatoire, elle préparait mieux ainsi le coupable aux reproches et au repentir.
Elle se leva, sans faire de bruit, et desservit la table; puis, quand elle eut déposé les assiettes, la soupière et le reste, dans un coin de l’àtre, elle revint à la table, prit doucement son frère sur ses genoux, le coucha dans ses bras, acheva de l’endormir sous un baiser, et s’assit à la même place, devant son père.
Une grande demi-heure passa ainsi.
M. Paupe, peu à peu, avait dégagé sa tête de ses mains. S’il avait eu des larmes dans les yeux, un éclair les avait brûlées.
Il pensait au beau château d’Arsonval, qu’on allait vendre, et qu’il ne pourrait disputer. Il lui semblait qu’on le dépouillait une seconde fois. Il rêvait des grands bois dont il avait rapporté l’arome dans ses poumons. Il n’avait pas le temps d’y conduire Marcienne et Maximilien. Il revoyait en imagination les deux petits enfants qu’il avait vus jouer sur l’herbe, qui jouaient peut-être encore, maintenant que le loup n’était plus dans le bois pour les guetter, pour regretter de ne pouvoir les saisir et les étrangler.
M. Paupe avait eu peur que Marcienne, en parlant des gens malheureux pour lesquels elle priait matin et soir, ne lui citât la famille d’Arsonval. Mais non. La fille du tailleur ne priait que pour les pauvres. C’était bien; c’était juste. Le tailleur lui pardonnait son intercession, puisqu’elle ne contredisait pas sa haine, et puisqu’elle laissait toute liberté aux sourdes imprécations qui se débattaient en lui. Il lui semblait acquérir un droit nouveau et plus grand d’exécrer les enfants d’Arsonval puisque sa fille ne priait pas pour eux.
Ah! comme il allait s’en donner de cette joie de les voir déguerpir du château, après la visite de Me Herluison! Dans sa rêverie, Paupe voyait, à travers la fumée de la lampe, étinceler les yeux de l’huissier, ces yeux qu’il avait comparés à des vers luisants. Il se souvenait avec ravissement de son mauvais calembour; il pardonnait à la réplique du même ton, faite par l’huissier. Eh bien, oui, il était une taupe! mais une taupe méchante; on le verrait; car sa haine rampait sous terre, mais trouverait bien, quelque jour, le moyen de pousser hors de terre un petit monticule suffisant pour faire trébucher quelqu’un de cette famille maudite.
La méditation du tailleur fut interrompue par plusieurs coups, timides d’abord, puis plus accentués, frappés à la porte de la rue.
On ne frappait guère, d’ordinaire, à la porte de M. Paupe; les voisins s’annonçaient en passant la tête. Qui venait à pareille heure?
Marcienne, malgré le fardeau de son petit frère, se leva pour al aller ouvrir. Mais son père la rassura d’un signe de la main, car elle avait laissé paraître un peu d’effroi subit, et il alla ouvrir lui-même.
Un homme, encore jeune, très-pâle, entra.
C’était le comte d’Arsonval.